Cover Page the Handle
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Who Put Kurtz on the Congo? Harry White, Irving L
Who Put Kurtz on the Congo? Harry White, Irving L. Finston Conradiana, Volume 42, Number 1-2, Spring/Summer 2010, pp. 81-92 (Article) Published by Texas Tech University Press DOI: https://doi.org/10.1353/cnd.2010.0010 For additional information about this article https://muse.jhu.edu/article/452495 Access provided at 9 Oct 2019 05:10 GMT from USP-Universidade de São Paulo Who Put Kurtz on the Congo? HARRYWHITEANDIRVINGL.FINSTON Our article included in this issue, “The Two River Narratives in ‘Heart of Darkness,’” showed that Joseph Conrad imagined Kurtz’s Inner Station to be located on the Kasai River and not on the Congo as has been gener- ally assumed. We now ask how one of the most important, influential, and widely read and studied works of modern fiction has been so con- sistently and unquestioningly misread for so long on such a basic level. In what follows we show that something akin to a cover-up was initi- ated by the author regarding the location and direction of Charlie Mar- low’s voyage. We will then reveal the primary source for many of the current interpretations and misinterpretations of “Heart of Darkness” by showing how one very influential scholar was the first to place Kurtz’s station on the wrong river. Nowhere in any of his writings did Conrad report that Marlow’s venture into the heart of darkness followed his own voyage from Stan- ley Pool to Stanley Falls. Nowhere in “Heart of Darkness” does it say that Marlow voyages up the Congo to find Kurtz. -

Masterproef Maxim Veys 20055346
Universiteit Gent – Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Race naar Katanga 1890-1893. Een onderzoek naar het organisatorische karakter van de expedities in Congo Vrijstaat 1890-1893. Scriptie voorgelegd voor het behalen van de graad van Master in de Geschiedenis Vakgroep Nieuwste Geschiedenis Academiejaar: 2009-2010 Promotor: Prof. Dr. Eric Vanhaute Maxim A. Veys Dankwoord Deze thesis was een werk van lange adem. Daarom zou ik graag mijn dank betuigen aan enkele mensen. Allereerst zou ik graag mijn promotor, Prof. Dr. Eric Vanhaute, willen bedanken voor de bereidheid die hij had om mij te begeleiden bij dit werk. In het bijzonder wil ik ook graag Jan-Frederik Abbeloos, assistent op de vakgroep, bedanken voor het aanleveren van het eerste idee en interessante extra literatuur, en het vele geduld dat hij met mij heeft gehad. Daarnaast dien ik ook mijn ouders te bedanken. In de eerste plaats omdat zij mij de kans hebben gegeven om deze opleiding aan te vatten, en voor de vele steun in soms lastige momenten. Deze scriptie mooi afronden is het minste wat ik kan doen als wederdienst. Ook het engelengeduld van mijn vader mag ongetwijfeld vermeld worden. Dr. Luc Janssens en Alexander Heymans van het Algemeen Rijksarchief wens ik te vermelden voor hun belangrijke hulp bij het recupereren van verloren gewaande bronnen, cruciaal om deze verhandeling te kunnen voltooien. Ik wil ook Sara bedanken voor het nalezen van mijn teksten. Maxim Veys 2 INHOUDSOPGAVE Voorblad 1 Dankwoord 2 Inhoudsopgave 3 I. Inleiding 4 II. Literatuurstudie 13 1. Het nieuwe imperialisme 13 2. Het Belgische “imperialisme” 16 3. De Onafhankelijke Congostaat. -

Mouna, Le Semeur D'espoir
n°30 - Juin 2014 Trimestriel - n° d'agrément : P914556 - Bureau de dépôt : 4099 Liège X Expéditeur : MdC, rue d'Orléans, 2 - 6000 Charleroi Mouna, le semeur d’espoir des An e cie is n o s d d a ’ O p u S t r e l MdC e a asbl - M c i e m r A Nécrologie Editorial ’intégration des revues par- Les Van Lancker, tenaires dans le corps de ce magazine ne vous échappera une famille de légende ! pas car vous les retrouverez en pages 39 à 50. Cette stra- ean Van Lancker est décédé le 14 Dès l’année suivante, il s’installe dans la tégie vise à ce que notre magazine février dernier à Uccle et nous région de Kolo, au sud de Thysville (au- L donne l’occasion de parler de jourd’hui Mbanza-Ngungu) et constitue devienne le journal de référence des son père Jules. La carrière colo- la S.A. “Plantations Jules Van Lancker”. associations créées pour pérenniser niale de Jules Van Lancker débuta Il commence à établir des plantations les contacts Nord-Sud. Certaines J dans le peloton scaphandrier du de riz, de café et de palmiers. d’entre-elles ont disparu (CRACT, corps du génie de l’armée belge où il fut En 1924, il fonde la société SIEFAC qui Spa…), d’autres s’effaceront avec le remarqué et engagé en 1910 à la “Mission s’occupe jusqu’en 1929 d’exploitation décès de leurs géniteurs. d’Études des Forces Hydrau- forestière à Sensikwa mais liques du Bas-Congo”. s’installe ensuite dans le Celles qui nous ont fait confiance sur- Sa forte personnalité, son district du Kwilu pour vivront car de nouveaux collabora- esprit d’initiative le poussent l’exploitation d’une zone teurs apparaîtront avec l’émergence ensuite à créer ses propres d’huilerie et la création entreprises. -

One Speaks Softly, Like in a Sacred Place’: Collecting, Studying and Exhibiting Congolese Artefacts As African Art in Belgium
‘One speaks softly, like in a sacred place’: collecting, studying and exhibiting Congolese artefacts as African art in Belgium Maarten Couttenier Many publications have dated the European ‘discovery’ of ‘primitive art’ in the beginning of the twentieth century or even after the 1914–18 war. Overall, they argue that African objects, collected between the fifteenth and the eighteenth century, ended up as curiosities in European ‘Cabinets of Wonders’. During an ethnographic phase in the nineteenth century, travellers and museum staff were believed to be mostly interested in the functional aspects of these objects, as they ‘failed to see the beauty; curiosity was great, but is was mixed with pity.’1 Finally, these publications state that the true art value of these objects was discovered during an aesthetic phase in the beginning of the twentieth century by artists such as Henri Matisse, André Derain, Georges Braque, and Pablo Picasso.2 Despite the fact that Africans were of course the first to appreciate the beauty of their own objects (something that was not always recognized in the West), the Western interest in African art was supposedly linked to the need among European artists for ‘new sources of inspiration outside the continent to rejuvenate its old civilisation. Disgusted by the modern world, its steel machines and its pitiless brutality, the period after the 1914–1918 war turned passionately towards the primitive, and especially the “Negro” ’.3 The widely publicised exhibition ‘Primitivism’ in the 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern in the Museum of Modern Art in New York (1984–85), and the introduction by William Rubin in the catalogue, confirmed this ‘modernist myth’.4 ‘Primitivism’ or ‘the interest of modern artists in tribal art and culture, as 1 J. -
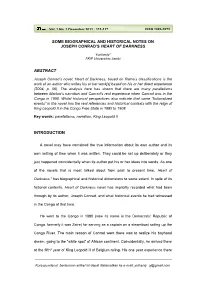
Some Biographical and Historical Notes on Joseph Conrad's Heart Of
Vol. 1 No. 1 Desember 2011 : 111-127 ISSN 2089-3973 SOME BIOGRAPHICAL AND HISTORICAL NOTES ON JOSEPH CONRAD’S HEART OF DARKNESS Yunhenly* FKIP Universitas Jambi ABSTRACT Joseph Conrad’s novel, Heart of Darkness, based on Ratna’s classifications is the work of an author who writes his or her work[s] based on his or her direct experience (2004, p. 56). The analysis here has shown that there are many parallelisms between Marlow’s narration and Conrad’s real experience when Conrad was in the Congo in 1890. Whilst historical perspectives also indicate that some “fictionalized events” in the novel has the real references and historical contexts with the reign of King Leopold II in the Congo Free State in 1885 to 1908. Key words: parallelisms, narration, King Leopold II INTRODUCTION A novel may have contained the true information about its own author and its own setting of time when it was written. They could be set up deliberately or they just happened coincidentally when its author put his or her ideas into words. As one of the novels that is most talked about from past to present time, Heart of Darkness,1 has biographical and historical dimensions to some extent. In spite of its fictional contents, Heart of Darkness novel has implicitly recorded what had been through by its author, Joseph Conrad, and what historical events he had witnessed in the Congo at that time. He went to the Congo in 1890 (now its name is the Democratic Republic of Congo, formerly it was Zaire) for serving as a captain on a steamboat sailing up the Congo River. -

Inventory of the Henry M. Stanley Archives Revised Edition - 2005
Inventory of the Henry M. Stanley Archives Revised Edition - 2005 Peter Daerden Maurits Wynants Royal Museum for Central Africa Tervuren Contents Foreword 7 List of abbrevations 10 P A R T O N E : H E N R Y M O R T O N S T A N L E Y 11 JOURNALS AND NOTEBOOKS 11 1. Early travels, 1867-70 11 2. The Search for Livingstone, 1871-2 12 3. The Anglo-American Expedition, 1874-7 13 3.1. Journals and Diaries 13 3.2. Surveying Notebooks 14 3.3. Copy-books 15 4. The Congo Free State, 1878-85 16 4.1. Journals 16 4.2. Letter-books 17 5. The Emin Pasha Relief Expedition, 1886-90 19 5.1. Autograph journals 19 5.2. Letter book 20 5.3. Journals of Stanley’s Officers 21 6. Miscellaneous and Later Journals 22 CORRESPONDENCE 26 1. Relatives 26 1.1. Family 26 1.2. Schoolmates 27 1.3. “Claimants” 28 1 1.4. American acquaintances 29 2. Personal letters 30 2.1. Annie Ward 30 2.2. Virginia Ambella 30 2.3. Katie Roberts 30 2.4. Alice Pike 30 2.5. Dorothy Tennant 30 2.6. Relatives of Dorothy Tennant 49 2.6.1. Gertrude Tennant 49 2.6.2. Charles Coombe Tennant 50 2.6.3. Myers family 50 2.6.4. Other 52 3. Lewis Hulse Noe and William Harlow Cook 52 3.1. Lewis Hulse Noe 52 3.2. William Harlow Cook 52 4. David Livingstone and his family 53 4.1. David Livingstone 53 4.2. -

A Study of the Zappo-Zap and Euro-African Encounters in the Late Nineteenth-Century Kasai
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Kent Academic Repository ‘The Black Knights of Fortune’: A Study of the Zappo-Zap and Euro-African Encounters in the Late Nineteenth-Century Kasai JESSICA VINCENT School of History 16th September 2015 Word Count: 32,845 ABSTRACT Recent popular publications have emphasised the brutality and suffering inflicted upon African communities at the onset of colonialism in the Congo, under the Belgium King Leopold II. Yet this Euro-centric approach works to obscure African agency and collaboration under the Congo Free State, and the dependency of the Free State officers upon their African partners. Through following the trajectory of the Zappo-Zap, a distinctly under-studied slaving ethnic group who migrated to the western Kasai region, this dissertation makes a headway into understanding that the violence of the Congo Free State was fabricated from existing modes of exploitation in the Congo prior to European penetration, such as the Arab-Swahili commercial empires. Notably loyal, the example of the Zappo-Zap serves to evaluate the role of African agents in the shaping of exploitative Free State policies, and elucidates the extent that the Zappo-Zap adapted to, and gained from, the reliance of the Free State on them, in the midst of numerous rebellions in the Kasai such as the infamous Luluabourg Revolt. Key words: colonialism; Congo; Kasai; adaptation; slavery CONTENTS PAGE Acknowledgements page. i. List of Figures page. ii. Abbreviations page. iii.. INTRODUCTION page 1. CHAPTER ONE OLD POLITICS AND NEW MEN page 12. -

257 DELCOMMUNE ( Alexandre- J.-P.)
257 remonte le Lomami, explore ensuite l'Aruwi- départ. mi, l'Itimbiri, la Lulonga, le Ruki, le lac Le 10 juillet 1892, après avoir séjourné un DELCOMMUNE ( Alexandre- J.-P.) (Na- Tumba et regagne Léopoldville le 15 mars mois au poste de l'État à Lofoi, Delcommune mur, 6.10.1855-Bruxelles, 7.4.1922). 1889. Au cours de ses deux voyages; après se dirige vérs le Tanganika, en empruntant Il fît ses premières études à l'école moyen- une absence d'un an, Delcommune a parcouru l'itinéraire suivi par Stairs, et arrive à M'Pala, ne de Rochefort, puis ses humanités complètes 12.000 km du réseau fluvial du bassin du où il est accueilli par les missionnaires. Là, le à l'Athénée de Bruxelles. Son père, ancien Congo. Il est nommé Consul de Belgique à capitaine Joubert lui transmet un message du combattant de 1830, le destinait à la carrière Léopoldville. capitaine Jacques, qui tient le poste d'Albert- administrative. A l'âge de 18 ans, Alexandre Delcommune descend ensuite sur Matadi, ville et est en conflit avec, les Arabes. Del- Delcommune est agréé comme commis au d'où il rentre en Europe en compagnie de son commune, Cassart et Diderrich vont à son Chemin de fer de l'État et ensuite comme frère Camille. Il rapporte de son voyage une secours. secrétaire du chef de la station de Bruxelles- magnifique collection de photographies prises L'expédition repart de M'Pala le 6 octobre Nord. Cette carrière ne lui convenant nulle- par Demeuse et des quantités importantes de 1892, traverse le plateau de Marungu, explore ment, il obtient l'autorisation de rejoindre son produits commerçables. -

De Eerste Europese Ontdekkingsreizen in Katanga 1797-1897 ( Pieter
De eerste Europese ontdekkingsreizen in Katanga 1797-1897 ( Pieter ... http://www.ethesis.net/katanga/katanga_hfst_7.htm De eerste Europese ontdekkingsreizen in Katanga 1797-1897 ( Pieter De Coster) home lijst scripties inhoud vorige volgende VII. DE BELGISCHE EXPEDITIES: DE INBEZITNAME VAN KATANGA VII. 1. De expeditie-Le Marinel VII. 1. 1. Biografie van Paul Le Marinel Paul-Amedée Le Marinel werd in 1858 geboren te Long Grove (VS) als zoon van Amedée Le Marinel en Honorine Guyot[158]. Zijn vader was een Franse militair, geboren te St.-Lô in Normandië, die zich in 1830 had aangesloten bij de Belgische revolutionairen. Na de revolutie diende hij nog achttien jaar in het Belgische leger, totdat hij in 1858 het kazerneleven vaarwel zei en met zijn Belgische echtgenote naar de VS trok om daar zijn geluk te beproeven. Hij belandde er in Long Grove (Iowa) waar hij een veeboerderij opstartte[159]. Het was ook hier dat zijn twee zonen Paul en Georges geboren werden, die allebei een opmerkelijke carrière als koloniaal zouden doorlopen. De levensloop van de vader van Le Marinel kan ons nu vreemd overkomen, maar was in de negentiende eeuw allerminst uitzonderlijk. Het Belgische leger was immers ontstaan uit een groep vrijwilligers met weinig militaire ervaring die geleid werden door overgelopen Nederlandse officieren of door buitenlandse officieren met revolutionaire sympathieën[160]. Vermoedelijk was dat ook één van de redenen waarom Amedée Le Marinel zich bij de Belgische opstandelingen aansloot. Het zouden overigens vooral Franse en Poolse officieren zijn die na de onafhankelijkheid het Belgische leger op een meer soliede basis zouden herinrichten[161]. -
Colonial Heritage
How to deal with the unequal distribution of ‘shared’ colonial heritage With the French and German recommendations as guidance Word count: 44, 472 Kato Declercq Student number: 01504409 Supervisor: Prof. Dr. Hugo DeBlock A dissertation submitted to Ghent University in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in African Studies Academic year: 2019 – 2020 Table of Contents 1. Introduction 4 2. The Western way of collecting 8 2.1. Collecting before colonisation 8 2.2. Collecting during colonisation 10 2.3. The improper interest in ‘the other’ 16 2.4. A selection of disputed Belgian cases 20 2.4.1. The storm ‘Emile Storms’ rages through the Congo Free State 20 2.4.2. The secret of the buffalo mask of Luulu 21 2.4.3. The abduction by A. Delcommune of a famous Nkisi Nkonde 23 2.4.4. Léon Rom, the man who decorated his garden with human skulls 25 2.4.5. What is the story of the Ndop statues of the Kuba Kingdom 26 3. Restitution, source of loaded debate 28 3.1. Definition of restitution 30 3.2. Issues intertangled with restitution 33 3.2.1. First encounter with the French and German guidelines 35 3.2.2. Why should one consider restitution: proponents and opponents 41 3.2.3. Which objects are eligible for restitution 44 3.2.4. Who can claim and to whom should be restituted 50 3.2.4.1. About claimants and receivers 51 3.2.4.2. Who bears the burden of proof 55 3.2.4.3. -

Portraying Conrad in Africa in the Graphic Novel Kongo by Tom Tirabosco and Christian Perrissin
Portraying Conrad in Africa in the graphic novel Kongo by Tom Tirabosco and Christian Perrissin 181 Nathalie Martinière Université de Limoges Abstract. Following the fashion for writers’ biopics, Kongo. Le ténébreux voyage de Józef Konrad Korzeniowski, by Tom Tirabosco and Christian Perrissin, deals with British author Joseph Conrad’s six months in the Congo as an employee of the Société Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo in 1890. Kongo is neither the first nor the only biographical piece of fiction dealing with Conrad who is generally referred to as a “novelist of the sea” and whose adventurous life offers material fit for all sorts of rewritings. This paper analyses how Tirabosco and Perrissin turn Conrad into a fictional character while relying on a number of historical sources. It points out that Kongo has its own agenda: it has something to tell us about Conrad, but also about the historical situation in which he found himself, i.e. the colonisation of the Congo by King Leopold II at the end of the nineteenth century. Dealing with an episode that contributed to his legend as a writer (our image of Conrad as a novelist would not be the same without Heart of Darkness), it underlines the porous boundaries between reality and fiction, therefore forcing us to bear in mind the historical reality behind the fiction. Kongo not only answers the contemporary period’s taste for writers’ biog- raphies, it also enables the general public to discover or rediscover the historical facts hidden behind a fiction which, in the case of Heart of Darkness, is often read (at least in France) as a “metaphysical” quest. -

Art Nouveau, Art of Darkness: African Lineages of Belgian Modernism, Part I Author(S): Debora L
Art Nouveau, Art of Darkness: African Lineages of Belgian Modernism, Part I Author(s): Debora L. Silverman Source: West 86th, Vol. 18, No. 2 (Fall-Winter 2011), pp. 139-181 Published by: The University of Chicago Press on behalf of the Bard Graduate Center Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/662515 . Accessed: 12/12/2014 08:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The University of Chicago Press and Bard Graduate Center are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to West 86th. http://www.jstor.org This content downloaded from 216.165.95.72 on Fri, 12 Dec 2014 08:47:57 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions Art Nouveau, Art of Darkness: African Lineages of Belgian Modernism, Part I Debora L. Silverman University of California, Los Angeles This article is the first of a two-part study. Part I identifies Belgian art nouveau as a specifically Congo style and as “imperial modernism,” created from Congo raw materials and inspired by Congo motifs—the lash, the vine, and the elephantine. Focusing closely on works by Victor Horta, Henry van de Velde, and Philippe Wolfers, Part I suggests how stylistic forms of modernism expressed a displaced encounter with a distant but encroaching imperial violence—the return of the repressor in visual form.