Activité Antioxydante Et Antibactérienne D'eucalyptus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
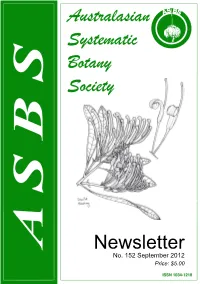
View PDF for This Newsletter
Newsletter No. 152 September 2012 Price: $5.00 Australasian Systematic Botany Society Newsletter 152 (September 2012) AUSTRALIAN SYSTEMATIC BOTANY SOCIETY INCORPORATED Council President Vice President Peter Weston Dale Dixon National Herbarium of New South Wales Royal Botanic Gardens Sydney Royal Botanic Gardens Sydney Mrs Macquaries Road Mrs Macquaries Road Sydney, NSW 2000 Sydney, NSW 2000 Australia Australia Tel: (02) 9231 8171 Tel: (02) 9231 8111 Fax: (02) 9241 2797 Fax: (02) 9251 7231 Email: [email protected] Email: [email protected] Treasurer Secretary Frank Zich John Clarkson Australian Tropical Herbarium Dept of National Parks, Recreation, Sport and Racing E2 building, J.C.U. Cairns Campus PO Box 156 PO Box 6811 Mareeba, QLD 4880 Cairns, Qld 4870 Australia Australia Tel: +61 7 4048 4745 Tel: (07) 4059 5014 Fax: +61 7 4092 2366 Fax: (07) 4091 8888 Email: [email protected] Email: [email protected] Councillor (Assistant Secretary - Communications Councillor Ilse Breitwieser Pina Milne Allan Herbarium National Herbarium of Victoria Landcare Research New Zealand Ltd Royal Botanic Gardens PO Box 40 Birdwood Ave Lincoln 7640 South Yarra VIC 3141 New Zealand Australia Tel: +64 3 321 9621 Tel: (03) 9252 2309 Fax: +64 3 321 9998 Fax: (03) 9252 2423 Email: [email protected] Email: [email protected] Other Constitutional Bodies Public Officer Hansjörg Eichler Research Committee Annette Wilson Bill Barker Australian Biological Resources Study Philip Garnock-Jones GPO Box 787 Betsy Jackes Canberra, ACT 2601 Greg Leach Australia Nathalie Nagalingum Christopher Quinn Affiliate Society Chair: Dale Dixon, Vice President Papua New Guinea Botanical Society Grant application closing dates: Hansjörg Eichler Research Fund: ASBS Website on March 14th and September 14th each year. -

Rangelands, Western Australia
Biodiversity Summary for NRM Regions Species List What is the summary for and where does it come from? This list has been produced by the Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities (SEWPC) for the Natural Resource Management Spatial Information System. The list was produced using the AustralianAustralian Natural Natural Heritage Heritage Assessment Assessment Tool Tool (ANHAT), which analyses data from a range of plant and animal surveys and collections from across Australia to automatically generate a report for each NRM region. Data sources (Appendix 2) include national and state herbaria, museums, state governments, CSIRO, Birds Australia and a range of surveys conducted by or for DEWHA. For each family of plant and animal covered by ANHAT (Appendix 1), this document gives the number of species in the country and how many of them are found in the region. It also identifies species listed as Vulnerable, Critically Endangered, Endangered or Conservation Dependent under the EPBC Act. A biodiversity summary for this region is also available. For more information please see: www.environment.gov.au/heritage/anhat/index.html Limitations • ANHAT currently contains information on the distribution of over 30,000 Australian taxa. This includes all mammals, birds, reptiles, frogs and fish, 137 families of vascular plants (over 15,000 species) and a range of invertebrate groups. Groups notnot yet yet covered covered in inANHAT ANHAT are notnot included included in in the the list. list. • The data used come from authoritative sources, but they are not perfect. All species names have been confirmed as valid species names, but it is not possible to confirm all species locations. -

Biodiversity Summary: Rangelands, Western Australia
Biodiversity Summary for NRM Regions Guide to Users Background What is the summary for and where does it come from? This summary has been produced by the Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities (SEWPC) for the Natural Resource Management Spatial Information System. It highlights important elements of the biodiversity of the region in two ways: • Listing species which may be significant for management because they are found only in the region, mainly in the region, or they have a conservation status such as endangered or vulnerable. • Comparing the region to other parts of Australia in terms of the composition and distribution of its species, to suggest components of its biodiversity which may be nationally significant. The summary was produced using the Australian Natural Natural Heritage Heritage Assessment Assessment Tool Tool (ANHAT), which analyses data from a range of plant and animal surveys and collections from across Australia to automatically generate a report for each NRM region. Data sources (Appendix 2) include national and state herbaria, museums, state governments, CSIRO, Birds Australia and a range of surveys conducted by or for DEWHA. Limitations • ANHAT currently contains information on the distribution of over 30,000 Australian taxa. This includes all mammals, birds, reptiles, frogs and fish, 137 families of vascular plants (over 15,000 species) and a range of invertebrate groups. The list of families covered in ANHAT is shown in Appendix 1. Groups notnot yet yet covered covered in inANHAT ANHAT are are not not included included in the in the summary. • The data used for this summary come from authoritative sources, but they are not perfect. -

Anjo Peninsula Flora and Vegetation Assessment
ANJO PENINSULA FLORA AND VEGETATION ASSESSMENT Prepared for DEPARTMENT OF INDUSTRY AND RESOURCES Job No 08.178 Report No RP007 DEPARTMENT OF INDUSTRY AND RESOURCES – Anjo Peninsula Flora and Vegetation Assessment ANJO PENINSULA FLORA AND VEGETATION ASSESSMENT Prepared for DEPARTMENT OF INDUSTRY AND RESOURCES Prepared by ENV Australia Pty Ltd Level 7, 182 St Georges Terrace PERTH WA 6000 Phone: (08) 9289 8360 Fax: (08) 9322 4251 Email: [email protected] Prepared by: Kevin Kenneally, Tim Willing, Kerryn McCann Status: Final QA Review: Dr Michael Brewis Technical Review: Rebecca McIntyre Content Review: Dr Mitchell Ladyman Date: 23 October 2008 08.178 RP007 Final (23-10-2008) DEPARTMENT OF INDUSTRY AND RESOURCES – Anjo Peninsula Flora and Vegetation Assessment TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY .......................................................................................III 1 INTRODUCTION ..........................................................................................1 1.1 OBJECTIVES....................................................................................................................................... 1 1.2 LOCATION........................................................................................................................................... 2 1.3 REGIONAL BIOGEOGRAPHY ............................................................................................................ 2 1.4 CLIMATE............................................................................................................................................. -

Factors Affecting the Recruitment of Riparian Vegetation on the Ord and Blackwood Rivers in Western Australia
Edith Cowan University Research Online Theses: Doctorates and Masters Theses 2000 Factors affecting the recruitment of riparian vegetation on the Ord and Blackwood Rivers in Western Australia Neil Pettit Edith Cowan University Follow this and additional works at: https://ro.ecu.edu.au/theses Part of the Other Ecology and Evolutionary Biology Commons Recommended Citation Pettit, N. (2000). Factors affecting the recruitment of riparian vegetation on the Ord and Blackwood Rivers in Western Australia. https://ro.ecu.edu.au/theses/1625 This Thesis is posted at Research Online. https://ro.ecu.edu.au/theses/1625 Edith Cowan University Copyright Warning You may print or download ONE copy of this document for the purpose of your own research or study. The University does not authorize you to copy, communicate or otherwise make available electronically to any other person any copyright material contained on this site. You are reminded of the following: Copyright owners are entitled to take legal action against persons who infringe their copyright. A reproduction of material that is protected by copyright may be a copyright infringement. Where the reproduction of such material is done without attribution of authorship, with false attribution of authorship or the authorship is treated in a derogatory manner, this may be a breach of the author’s moral rights contained in Part IX of the Copyright Act 1968 (Cth). Courts have the power to impose a wide range of civil and criminal sanctions for infringement of copyright, infringement of moral rights and other offences under the Copyright Act 1968 (Cth). Higher penalties may apply, and higher damages may be awarded, for offences and infringements involving the conversion of material into digital or electronic form. -

The City of Melbourne's Future Urban Forest
TheThe CitCityy ofof Melbourne’sMelbourne’s 5dcdaTDaQP]5^aTbc5dcdaTDaQP]5^aTbc Identifying vulnerability to future temperatures Authors: Dave Kendal, Jess Baumann Burnley Campus School of Ecosystem and Forest Sciences The University of Melbourne 500 Yarra Boulevard VIC 3010 AUSTRALIA T: +61 3 8344 0267 Contact: [email protected] Epert advice from Stephen Frank, Steve Livesley, Peter Symes, Anna Foley, David Reid, Peter May, Ian Shears and David Callow. First printed June 2016. Published online November 2016 by the Clean Air and Urban Landscapes Hub: http:// www.nespurban.edu.au/publications-resources/research-reports/ CAULRR02_CoMFutureUrbanForest_Nov2016.pdf The Clean Air and Urban Landscapes Hub is funded under the Australian Government’s National Environmental Science Programme with a mission to take a comprehensive view of the sustainability and liveability of urban environments. © The City of Melbourne 2016. Executive Summary Climate change is likely to have a significant effect on many trees in the City of Melbourne. Some species will perform better, while some will perform worse. The report describes the results of a project exploring the vulnerability of tree species currently planted in the City of Melbourne, and identifies some potential new species that may be more suitable for the City’s climate futures. A list of species combining those currently in the City of Melbourne’s urban forest with those being newly planted in the City of Melbourne was created. The global locations where species occur naturally and are in cultivation (and abundance where available) were compiled from existing datasets, such as ‘open data’ tree inventories and extracted from other published data, from approximately 200 cities around the world. -

Eucalyptus Globulus » Contre Le Varroa Jacobsoni Varroa Jacobsoni
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Blida 1 Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Département de Biotechnologie Laboratoire de biotechnologie des productions Mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme de Master Académique en Sciences de la Nature et de la Vie Spécialité : biotechnologie végétale Activité biologique des huiles essentielles des feuilles et du fruit d’une plante médicinale « Eucalyptus globulus » contre le Varroa jacobsoni varroa jacobsoni Présenté par : Mlle. SEMALI Rania. Le :09 /07/2019 Mlle. KEBICHI Yasmine. Devant les membres de jury : Mme MOUMENE S. MCA USDB Présidente Mme KEBOUR D. MCA USDB Promotrice Mr BENDALI A. MAA USDB Examinateur Promotion : 2018/2019 Dédicace : je dédie ce modeste travail : A la mémoire de ma grand-mère paternelle, A l’homme mon précieux offre du dieu que j’adore mon cher père SALAH EDDINE et a la femme qui n’a jamais dit non a mes exigences et qui n’a épargné aucun effort pour me rendre heureuse mon adorable mére MOUIDA, pour leurs soutiens, leurs amours et leurs encouragements tout au long de mon cursus universitaire et de ma vie professionnelle , a mon frère BAHAA EDDINE et mes deux sœurs FADIA et OMNIA. A ma grande-mère maternelle et mon grand père, mes oncles et mes tantes, que dieu leur donne une longue et une joyeuse vie, a tous les cousins, à tous mes proches et tous mes amis. Sans oublier mon binôme yasmine soutien morale, sa patience et sa compréhension tout au long de ce projet. -

NEWSLETTER Index Volumes 31-50
AlAstral iaVl S~stematic BotaVl~ Societ~ NEWSLETTER Index Volumes 31-50 -:?""'' Price: $5.00 Registered by Australia Post Publication No. NBH 8068 ISSN 1034-1218 AUSTRALIAN SYSTEMATIC BOTANY SOCIETY INCORPORATED Office Bearers President Dr M.D. Crisp Division of Botany and Zoology Australian National University GPOBox4 CANBERRA ACf 2601 Tel (06) 249 2882 Fax (06) 249 5573 Vice President Secretary Treasurer Dr G.P. Guymer Dr B.J. Conn Dr D.J. Bedford Queensland Herbarium National Herbarium of NSW National Herbarium ofNSW Meiers Road Mrs Macquaries Road Mrs Macquaries Road INDOOROOPILL Y QLD 4068 SYDNEY NSW 2000 SYDNEY NSW 2000 Tel (07) 377 9320 Tel (02) 231 8131 Tel (02) 231 8144 Fax (07) 870 3276 Fax (02) 251 4403 Fax (02) 251 4403 Councillors Dr T. Entwisle Dr J. Bruhl National Herbarium of Victoria Research School of Biological Sciences Birdwood Avenue Australian National University SOUTH YARRA VIC 3141 GPO Box 475 Tel (03) 655 2313 CANBERRA ACf 2601 Fax (03) 655 2350 Tel (06) 246 5175 Fax (06) 246 5249 Affiliated Society Papua New Guinea Botanical Society Australian Botanical Liaison Officer Dr P.S. Short Royal Botanic Gardens Kew Richmond, Suney. TW9 3AB. ENGLAND. Tel 44-81-940-1171 Fax 44-81 -948-11 97 Austral. Syst. Bot. Soc. Newsletter Index Volumes 31-50 1 INTRODUCTION ASBS Newsletter Index Issues 31-50 of the ASBS Newsletter Part 2 - Issued June 1992 Number Date Editor This is the second part of a consolidated index 31 June 1982 Gordon Guymer to all issues of the society's Newsletter, which 32 September 1982 Gordon .Ouymer council decided would be the most practical means 33 December 1982 Gordon Guymer 34 March 1983 Gordon Guymer of accessing the considerable amount of informa 35 June 1983 Gordon Guymer tion that this periodical contains. -

AGRE Don Josette 961/2015
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union-Discipline-Travail Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique Laboratoire de Pharmacodynamie- Biochimique Année Universitaire 2014-2015 THESE Présentée pour l’obtention du Titre de Docteur de l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Spécialité: Pharmacologie des substances Naturelles Numéro d’ordre AGRE Don Josette 961/2015 EVALUATION ET ESSAIS D’OPTIMISATION DE L’ACTIVITE ANTIFONGIQUE DES EXTRAITS D’ECORCES DE Eucalyptus torelliana F. Muell. (Myrtaceae) SUR LA CROISSANCE IN VITRO DE Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis. Soutenue publiquement Commission du jury le 20 Août 2015 Mme SERI-KOUASSI B. Philomène Professeur Titulaire UFHB : Présidente M. DJAMAN Allico Joseph Professeur Titulaire UFHB : Directeur M. LOUKOU Yao Guillaume Maître de Conférences UFHB : Co-Directeur Mme GUESSENND K. Nathalie Maître de recherches UFHB : Rapporteur Mme KAMANZI Kagoyire Professeur Titulaire UFHB : Rapporteur M. GONNETY Tia Jean Maître de conférences UNA : Examinateur Je dédie cette Thèse à…… I I A ma très chère mère AGRE Cécile. Merci pour ton aide, ton encouragement et ton soutien. Merci d‟avoir supporté mes caprices. Que le Roi de gloire, le Saint des Saints, Jésus-Christ bénisse l‟œuvre de tes mains et te permette d‟être le plus longtemps possible parmi nous tes enfants. Merci maman. A mon époux KOUADIO N’GANDI Jean-Serge Je tiens à te dire un sincère merci pour la motivation et tes conseils tout au long de la réalisation de ce travail. Cette phrase : « le bonheur, c‟est savoir ce qu‟on veut et le vouloir passionnément. », tu m‟as permis d‟en faire mienne. -
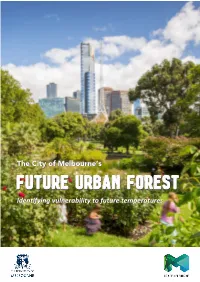
Identifying the Vulnerability of Trees to the City's Future Temperature Final
TheThe CitCityy ofof Melbourne’sMelbourne’s 5dcdaTDaQP]5^aTbc5dcdaTDaQP]5^aTbc Identifying vulnerability to future temperatures Authors: Dave Kendal, Jess Baumann Burnley Campus School of Ecosystem and Forest Sciences The University of Melbourne 500 Yarra Boulevard VIC 3010 AUSTRALIA T: +61 3 8344 0267 Contact: [email protected] Epert advice from Stephen Frank, Steve Livesley, Peter Symes, Anna Foley, David Reid, Peter May, Ian Shears and David Callow. First printed June 2016. Published online November 2016 by the Clean Air and Urban Landscapes Hub: http:// www.nespurban.edu.au/publications-resources/research-reports/ CAULRR02_CoMFutureUrbanForest_Nov2016.pdf The Clean Air and Urban Landscapes Hub is funded under the Australian Government’s National Environmental Science Programme with a mission to take a comprehensive view of the sustainability and liveability of urban environments. © The City of Melbourne 2016. Executive Summary Climate change is likely to have a significant effect on many trees in the City of Melbourne. Some species will perform better, while some will perform worse. The report describes the results of a project exploring the vulnerability of tree species currently planted in the City of Melbourne, and identifies some potential new species that may be more suitable for the City’s climate futures. A list of species combining those currently in the City of Melbourne’s urban forest with those being newly planted in the City of Melbourne was created. The global locations where species occur naturally and are in cultivation (and abundance where available) were compiled from existing datasets, such as ‘open data’ tree inventories and extracted from other published data, from approximately 200 cities around the world. -

NEWSLETTER No
Al!1stral iaVJ S~s~ematic BotaVJ~ Soe~et~ NEWSLETTER No. 75 JUNE 1993 Price: $5.00 Registered by Australia Post Publication No. NBH 8068 ISSN 1034-1218 AUSTRALIAN SYSTEMATIC BOTANY SOCIETY INCORPORATED Office Bearers President Dr M.D. Crisp Division of Botany and Zoology Australian National University GPOBox4 CANBERRA ACf 2601 Tel (06) 249 2882 Fax (06) 249 5573 Email [email protected] Vice President Secretary Treasurer Dr J.A. Chappill Dr C. Puttock Dr P.G. Wilson Department of Botany Australian National Herbarium National Herbarium of NSW University of Western Australia GPO Box 1600 Mrs Macquaries Road NEDLANDS WA 6009 CANBERRA ACf 2601 SYDNEY NSW 2000 Tel (09) 380 2212 Tel (02) 246 5523 Tel (02) 231 8158 Fax (09) 380 1001 Fax (02) 246 5249 Fax (02) 251 4403 Councillors Dr T. Entwisle Dr J. Clarkson National Herbarium of Victoria Queensland Herbarium Birdwood Avenue P.O. Box 1054 SOUTHYARRA VIC 3141 MAREEBA QLD 4880 Tel (03) 655 2313 Tel (070) 92 1555 Fax (03) 655 2350 Fax (070) 92 3593 Affiliated Society Papua New Guinea Botanical Society Australian Botanical Liaison Officer Dr P.H. Weston Royal Botanic Gardens Kew Richmond, Surrey. TW9 3AB. ENGLAND. Tel 44-81-940-1171 Fax 44-81-332-5278 Austral. Syst. Bot. Soc. Newsletter 75 (June 1993) 1 ARTICLES Wntiam V. Fitzgerald - miscellaneous notes on his N.W. Australian collections, publications and. manuscripts Philip Short National Herbarium of Victoria Birdwood Avenue, South Yarra, Victoria 3141 Introduction lished in The Western Mail (Perth). Some names lack, or are felt to lack, an adequate description, I have briefly dealt with William Vincent Fitz- . -

080559-04.004.Pdf
BiblioResearchConservation Science : a bibliography W. Aust. Volof research 4 (2) : i-x 1896–2001 and 1-356 (2002) i BiblioResearch : a bibliography of research outputs by the Department of Conservation and Land Management (and its predecessors) relating to the flora, fauna and forests of Western Australia, 1896–2001 COMPILED BY LISA J. WRIGHT Wildlife Science Library, Science Division, Department of Conservation and Land Management, Research Centre, Woodvale, Western Australia 6056. [email protected] ABSTRACT This bibliography, based on an electronic database of material authored by state government department staff since 1896, contains 9138 items on the flora, fauna and forests of Western Australia. An extensive search of staff lists, publications and library catalogues was undertaken to build a comprehensive database and as a result the bibliography provides a history of government research. Only 28 items were produced pre 1920, with 405 produced in the 1920s. After a decline during the 1930s and 1940s, the number of titles has steadily increased to 5122 titles produced in the 1990s. INTRODUCTION departments and authorities such as the Western Australian Museum. The Perth Observatory joined the Department This is a bibliography of publications and materials by in 1996 but, as their research is not biological, their staff of the Forests Department (1896–1984), the publications have not been included. Departments of Fisheries, Fisheries and Fauna and The bibliography commenced as a divisional Fisheries and Wildlife (1898–1984), the