" Prairies De La Voire Et De L'héronne " ______
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diaporama-Ppt-Abc110521
VISIOCONFERENCE 11 MAI 2021 Atlas de Biodiversité Communale Ordre du jour ✔ Contexte, périmètre et objectifs du projet d’ABC ✔ Etat initial ✔ Actions réalisées en 2020 ✔ Projets 2021 ✔ Projets 2022-2023 Contexte et objectifs Contexte Appels à manifestation d’intérêt (AMI) pour les Atlas de la biodiversité communale (ABC) : lancés annuellement par l’Office Français de la Biodiversité ✔Fin 2019 : dossier du PNRFO retenu ✔Recrutement d’un mi-temps « éducation à l’environnement » : en cours Objectifs ✔Mieux connaître la biodiversité ✔Sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la biodiversité ✔Faciliter la prise en compte de la biodiversité dans les projets, susciter des initiatives locales… Partenaire LPO Champagne-Ardenne (participation aux actions de concertation et de communication, synthèse et analyse des données faunistiques) Périmètre 22 communes cibles, sur le périmètre de la Communauté de communes Lacs de Champagne En lien avec les élus des communes et de la Communauté de communes Etat initial Synthèse Réalisation LPO Champagne-Ardenne Une carte et un tableau par commune (espèces patrimoniales) Exemple de Brienne la Vieille : éléments fournis pour le PLU Actions 2020 Communication Lancement de la communication sur le projet Création d’une vidéo Lancement d’un questionnaire pour recueillir les attentes et besoins des habitants sur le projet Un article rédigé pour le bulletin des Amis du Parc (« Escarboucle ») Contacts avec les élus et partenaires (rendez-vous, visio…) 8 communes 10 partenaires -

Canton BRIENNE-Le-CHÂTEAU
Canton BRIENNE-le-CHÂTEAU - Tri par nom de l'EPOUSE ? ? GAUTIER Nicolas 28/02/1731 Courcelles-sur-Voire ? ? PARIS Claude 26/11/1722 Maizières-lès-Brienne ? ? ROBERT Nicolas 11/01/1712 Hampigny ? Anne GAUPILLAT Jean 20/02/1708 Dienville ? Anne ROZON Leon 07/02/1735 Rosnay-l'Hôpital. ? Appoline BEAUFILS Antoine 03/03/1710 Blaincourt-sur-Aube ? Catherine RICHEBOURG Jacques 13/11/1737 Dienville ? Claude NOLSON Toussaint 03/07/1704 Maizières-lès-Brienne ? Claudine JESSON François 07/06/1723 Dienville ? Françoise BROCHON Mathieu 27/11/1758 Perthes-lès-Brienne ? Inconnu ? TASSIN Louis 28/01/1796 Mathaux ? Marie jeanne DURUP Edme bernard 24/11/1766 Brienne-le-Château ? Millot LALLEMEND Jean 27/11/1737 Maizières-lès-Brienne ? Pierrette TIROINE Claude 31/01/1785 Rosnay-l'Hôpital. ADAM Anne BEAUFILS Joseph brice 01/02/1725 Mathaux ADAM Auberte GAUPILLAT Laurent 15/02/1768 Radonvilliers ADAM Edmee LAURENT Laurent 22/01/1753 Brienne-le-Château ADAM Edmee LESEURRE Jean 01/02/1751 Rances ADAM Edmee MICHAULT Louis 27/11/1730 Précy-Notre-Dame ADAM Françoise BRAJEUX Alexandre 15/11/1751 Bétignicourt ADAM Gabrielle LUGNIER Nicolas francois 17/09/1781 Maizières-lès-Brienne ADAM Jeanne angelique BOUILLEVAUX Nicolas 25/11/1755 Saint-Léger-sous-Brienne ADAM Jeanne angelique GUERIN Etienne 21/11/1763 Saint-Léger-sous-Brienne ADAM Jeanne angelique MOREAU Pierre 10/05/1786 Saint-Léger-sous-Brienne ADAM Louise DARNEL Claude 15/11/1723 Mathaux ADAM Madeleine PINOT Edme 26/11/1759 Mathaux ADAM Marguerite LAVALET Louis mathieu 22/11/1784 Bétignicourt ADAM Marie BICHAT Antoine 21/11/1702 Blignicourt ADAM Marie LAURENT Pierre 18/01/1752 Brienne-la-Vieille ADAM Marie MAUROY Jean 30/06/1735 Lesmont ADAM Marie PETIT Laurent 23/11/1734 Brienne-le-Château ADAM Marie anne COLLET Jean Baptiste 05/03/1764 Rosnay-l'Hôpital. -

RECENSEMENT DE 1836 Brienne Le Château Pge Rg Nom Prénom Civ Profession Âge Dn Mariage Dcd
LES ANCÊTRES GARNIER A BRIENNE LE CHATEAU RECENSEMENT DE 1836 Brienne le Château pge Rg Nom Prénom Civ Profession âge dn Mariage Dcd 3 1 GARNIER Edmé vigneron 65 1770 5-3-1810 CURIN Marie ép. 54 1782 2 Garnier Edmé fils 16 1819 7 DUC Pierre vigneron 27 1809 8-2-1834 3 GARNIER Félix ép. 19 1817 Duc Pierre Félix fils 1 1835 23 4 GARNIER Edmé Nicolas vigneron 49 1787 6-5-1812 MARCELIN Marie-Jeanne ép. 50 1786 5 Garnier Edmé Nicolas fils 18 1818 6 Garnier Jean-Baptiste fils 16 1820 32 LORE Bazile Jachim vigneron 33 1803 4-2-1827 7 GARNIER Françoise ép. 28 1808 Loré Jean Bazile fils 8 1828 Loré Edmé fils 6 1830 Loré Anne fille 5 1831 Loré Esther fille 1 1835 33 AUBRY Nicolas vigneron 55 1781 avant 1812 8 GARNIER Marie ép. 52 1784 Aubry Pierre fils 24 1812 41 9 GARNIER Nicolas cultivateur 42 1794 1-12-1815 10 GARNIER Anne ép. 42 1794 11 Garnier Nicolas Honoré 10 1826 49 12 GARNIER Edmé François vigneron 81 1755 ? MILLET Mathie ép. 76 1760 52 13 GARNIER Nicolas vigneron 38 1798 18-7-1830 AUBERGEON Gabrielle ép. 50 1786 14 Garnier Marie-Anne fille 13 1823 15 Garnier Marie fille 4 1832 56 16 GARNIER Pierre vigneron 41 1795 13-1-1816 MARCIAUX Marie ép. 42 1794 17 Garnier Claude fils 12 1824 18 Garnier Edmé fils 8 1828 19 Garnier Charles fils 6 1830 20 Garnier Félix fille 16 1820 21 Garnier Anne fille 14 1822 58 22 GARNIER Bazile vigneron 41 1795 21-12-1819 THIERRY Madelaine ép. -

Communiqué De Presse Calamites Agricoles Sur
COMMUNIQUÉ DE PRESSE CALAMITES AGRICOLES SUR PRAIRIES Troyes, le 10 mars 2021 ÉPISODE DE SÉCHERESSE 2020 Le Comité National de Gestion des Ris!"es en #$ri%"lture ré"ni le 1& 'é(rier 2021 a émis "n a(is 'a(ora)le * la re%onnaissan%e de %alamité a$ri%ole po"r les pertes s"r les +rairies %a"sées +ar la sé%,eresse du 1er -"illet a" 30 se+tem)re 2020/ Par arr0té ministériel du . mars 2021, la re%onnaissan%e de %alamité a$ri%ole porte s"r les pertes de récolte sur prairies per a!e!tes et temporaires de la "o!e suiva!te $ 1ne indemnisation pe"t 0tre attri)"ée si les pertes de ré%oltes s"r +rairies sont s"+érie"res * 30%, et si les pertes s3él4(ent a" minim"m à 1. % de la (ale"r du produit br"t théori!"e de l3e5+loitation/ Les e5+loitants sinistrés pe"(ent dé+oser, +ar télédé%laration s"r le site TéléC#L#M, "ne demande d'indemnisation a" titre de la procédure des %alamités a$ri%oles du jeudi &' mars au #e!dredi &( a#ril )*)&+ ,ttps$--...+au/e.0ou#+1r-Politi2ues-pu/li2ues-A0riculture34oret-A!imau53C,asse3et-peche-Crises3et3 Aides3co!jo!cturelles Co!tact DDT $ Sté+,anie ESP# N#C 8 tél. 9 0. 2: ;1 18 1. ddt-sea'8)sic@a")e/$ou(/'r Pré'e%t"re de l3#")e Tél : 03 25 42 35 00 Contact presse 2, r"e Pierre L#BONDE CS 20 3128 10025 Troyes Cede5 CCC/ a")e /$o"(/'r 6att,ie" OLI=IER / Floren%e GO IEN <Pre'eta")e Tél : 03 25 42 36 52 6él : pre'8%omm"ni%ation<a")e/$o"(/'r <Pre'et10 ANNEXE Listes des co u!es de la zo!e reco!!ue sinistrée $ #ille(ille, #i58=illema"r-Palis, #lli)a"di4res, #man%e, #r%is s"r #")e, #r%on(ille, #r$anDon, #rrelles, #rrem)e%ourt, #rrenti4res, -

Notice Explicative De La Feuille C H Avanges À 1/50 000
NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE C H AVANGES à 1/50 000 p a r F. MÉNILLET avec la collaboration de C. BOURDILLON, M. BONNEMAISON, G. DUERMAEL, S. GARDIN, B. MATRION, E. ROUXEL-DAVID, R. TOMASSON e t R. TOUCH 2 0 0 2 Éditions du BRGM Service géologique national R é f é rences bibliographiques. Toute référence en bibliographie au présent document doit être faite de la façon suivante : – pour la carte : MÉ N I L L E T F. avec la collaboration de BO N N E M A I S O N M., BOURDILLON C., MAT R I O N B., TO U C H R. (2002) – Carte géol. France (1/50 000), feuille Chavanges (263). Orléans BRGM. Notice explicative par F. MÉ N I L L E T et al. (2002), 100 p. – pour la notice : MÉ N I L L E T F. avec la collaboration de BO U R D I L L O N C., BO N N E M A I S O N M., DU E R M A E L G., GA R D I N S., MAT R I O N B., R O U X E L - D AV I D E., TO M A S S O N R . , TO U C H R. (2002) – Notice explicative, Carte géol. France 1/50 000 feuille Chavanges (263) - Orléans : BRGM, 100 p. Carte géologique par F. MÉ N I L L E T et al. ( 2 0 0 2 ) . © BRGM, 2002. Tous droits de traduction et de reproduction réservés. -

En Champagne D 10 Paris D 677 D 7 Aube
Châlons-en-Champagne, Reims, Metz Oslo Dublin Poivres 7 Amsterdam Semoine 1 Londres E - Berlin Aube NOGENT-SUR-SEINE, église Saint-Laurent, Lucis ROMILLY-SUR-SEINE, église Saint-Martin, Baptême FONTAINE-LES-GRÈS, église Sainte-Agnès, toison de LUSIGNY-SUR-BARSE, église Saint-Martin, baptême VENDEUVRE-SUR-BARSE, église Saint-Pierre, CHAVANGES, église Saint-Georges, démon de Bruxelles 6 Potentia (la force de la lumière), Fabienne Verdier et de Jésus, Joël Mône et l’atelier Vitrail Saint-Georges l’agneau dont la maille évoque la bonneterie,2 de saint Martin, Louis-Germain Vincent-Larcher, 1859 ange tenant un encensoir, Max Ingrand, v. 1955 l’Apocalypse d’après A. Dürer, v. 1530-40 A Luxembourg la Manufacture Vincent-Petit (Troyes), 2018 (Lyon), 2013 Jean-Claude Vignes, 1955 Mailly-le-Camp en Champagne D 10 Paris D 677 D 7 Aube D 9 Genève Salon Villiers-Herbisse Milan Herbisse Trouans Marne D 71 Rome Sézanne Champfleury Dosnon Madrid Barcelone D 951 Sézanne Vitry-le- Lisbonne Vitraux D 10 Grandville François 47 L’ Huîtrelle D 373 Seine-et- Anglure Allibaudières D 76 Villenauxe- Marne Marne la-Grande Boulages Plancy- 46 Plessis- L’ Aube D 56 l'Abbaye Viâpres- D 396 Barbuise Champigny- D 677 Montpothier Étrelles- le-Petit sur-Aube D 10 sur-Aube Lhuître Charny-le- D 56 45 Provins La Villeneuve- Bachot Ormes Barbuise D 52 Le Chêne au-Châtelot Longueville- Arrembécourt La D 9 Paris D 951 Périgny- 51 sur-Aube D 56 Dampierre Saulsotte la-Rose D 373 Pouan-les- Bessy Torcy-le- Bailly- Rhèges Vallées D 441 Torcy- Vinets D 24 42 Grand le-Petit Isle- -
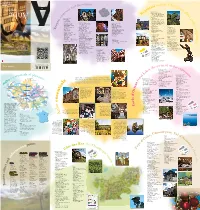
A Ube Essentials
ès Congr et ourisme T en Champagne en overies the isc nd Cha as d d is a mp en Champagne en an ta ag Aube s n n m e e u g Natural heritage p e o • Marnay-sur-Seine botanical garden l s N Chemin des Gougins - MARNAY-SUR-SEINE a u In 2 hectares, the remarkable diversity of the in plant world, via over 2,500 different species , m and varieties. Natural heritage • La Brisatte Garden p , • Pierre Pitois park Chemin de la Brisatte - MESNIL-SAINT-LOUP a s 54 rue Aristide Briand Mr and Mrs Bécard welcome you for free all LA CHAPELLE-SAINT-LUC r e Cultural heritage along the year to discover 440 vegetal species. 6.5 ha park with a zoo area, • La Motte-Tilly Chateau park and gardens k • Centre for Tools and Worker Thought Leisure and events y flower pavilion, insectarium. Magnificent 60 ha park with some s Hôtel de Mauroy • Gliding centre • Barberey-Saint-Sulpice chateau remarkable trees. o 7 rue de la Trinité - TROYES Barberey-Saint-Sulpice airport. Terroir park and gardens • Blancs Fossés dolmen a Important collection of tools of the • Carting in Creney and Saint Lyé. • Saint-Martin mill r 9 ha park – French gardens with MARCILLY-LE-HAYER n companions of the Tour de France. • The city in music 6 chemin de la Laiterie an old orchard. A Megalithic monument. • Museum of Modern Art From the end of June to the end of July. SAINT-MARTIN-DE-BOSSENAY T • Menois chateau park • Ile Olive park in Nogent-sur-Seine d Place Saint Pierre - TROYES • Troyes-Les Lacs and Troyes-Haute Seine Bar - Artisan beer tasting. -

ELECTIONS MUNICIPALES 1Er Tour Du 15 Mars 2020
ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 15 Mars 2020 Livre des candidats par commune (scrutin plurinominal) Page 1 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Ailleville (Aube) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. BEAUJOIN Jean-Michel M. HACKEL Claude M. PÉRARDOT Jacky Page 2 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Allibaudières (Aube) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. BEELL Gilbert M. BLONDELOT Jacky M. BOURGOIN Philippe Mme CARTE Chrystel M. CLERIN Jean-François Mme DIOT Patricia M. FINCK Didier M. FRANQUET Ludovic M. GENIN Raymond Mme GUILLEMAILLE Marie-Jeanne M. MEUNIER Bruno M. PLOYEZ Alexandre M. POUPART Martin Page 3 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Amance (Aube) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. BROUILLARD Laurent M. DROUILLY David Mme FEVRE Francine M. FEVRE Maxence Mme MAILLARD-DAUNAY Maryse M. PIETREMONT Jean-Michel M. POURILLE Jérémie Mme RICARD Colette Mme ROUYER Amélie M. ROUYER Thibaut M. VIE Jean-Claude Page 4 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Arconville (Aube) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. GAUCHER Guillaume M. NOBLOT Sylvère Mme RONDELET Chrystelle M. RONDELET Guillaume Mme TABARY Martine Page 5 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Argançon (Aube) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. BAUDOUIN Alain M. BONNASSOT Julien M. FARFELAN Laurent M. FOLLO Maurice M. JOUY Guillaume M. MEHLINGER Hervé Mme PETOUCHKOFF Patricia Mme SAUTEREAU Amélie Mme SCREVE Meggy M. -

CC Des Lacs De Champagne
Communes membres : 0 ortrait P Foncier Arrembécourt, Aulnay, Bailly-le-Franc, Balignicourt, Bétignicourt, Blaincourt-sur- CC des Lacs de Aube, Blignicourt, Braux, Brienne-la-Vieille, Brienne-le-Château, Chalette-sur- Voire, Chavanges, Courcelles-sur-Voire, Dienville, Donnement, Épagne, Hampigny, Jasseines, Joncreuil, Juvanzé, Lassicourt, Lentilles, Lesmont, Magnicourt, Maizières- lès-Brienne, Mathaux, Molins-sur-Aube, Montmorency-Beaufort, Pars-lès- Champagne Chavanges, Pel-et-Der, Perthes-lès-Brienne, Précy-Notre-Dame, Précy-Saint- Martin, Radonvilliers, Rances, Rosnay-l'Hôpital, Saint-Christophe-Dodinicourt, Saint-Léger-sous-Brienne, Saint-Léger-sous-Margerie, Unienville, Vallentigny, Villeret, Yèvres-le-Petit 0 Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement GRAND EST SAER / Mission Foncier Novembre 2019 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ 0 CC des Lacs de Champagne Périmètre Communes membres 01/2019 43 ( Aube : 43) Surface de l'EPCI (km²) 442,63 Dépt Aube Densité (hab/km²) en 2016 EPCI 22 Poids dans la ZE Troyes*(98,3%) Vitry-le-François - Saint-Dizier(1,7%) ZE 50 Pop EPCI dans la ZE Troyes(3%) Vitry-le-François - Saint-Dizier(0,1%) Grand Est 96 * ZE de comparaison dans le portrait Population 2011 9 842 2016 9 529 Évolution 2006 - 2011 -18 hab/an Évolution 2011 - 2016 -63 hab/an 10 communes les plus peuplées (2016) Brienne-le-Château 2 868 30,1% Dienville 878 9,2% 0 Chavanges 594 6,2% Brienne-la-Vieille 435 4,6% Saint-Léger-sous-Brienne 387 4,1% Radonvilliers 378 4,0% Lesmont 308 3,2% Hampigny -

Canton BRIENNE-Le-CHÂTEAU
Canton BRIENNE-le-CHÂTEAU - Tri par nom de l'EPOUX ? ? ADELINE Jeanne 10/01/1732 Maizières-lès-Brienne ? François BOURDEVILLE Marie 28/02/1729 Dienville ? Jacques MICHAUT Nicole 08/02/1723 Maizières-lès-Brienne ? Jean BRIGNIOT Marguerite 21/10/1737 Maizières-lès-Brienne ? Leon PETIT Jeanne 10/11/1704 Yèvres-le-Petit ? Louis GAUPILLAT Marguerite 22/09/1739 Dienville ? Louis HANIER Marie rose 07/11/1791 Rosnay-l'Hôpital. ? Pierre MICAIRE? Nicole 14/09/1734 Dienville ADAM Alexandre LEVASSEUR Anne 19/01/1773 Courcelles-sur-Voire ADAM Ambroise PAUTRE Marguerite 22/01/1753 Bétignicourt ADAM Antoine LE MOINE Antoinette 22/11/1728 Brienne-le-Château ADAM François NAVALET Elisabeth 13/08/1721 Rosnay-l'Hôpital. ADAM Jean Baptiste RAGON Jeanne 09/04/1742 Maizières-lès-Brienne ADAM Jean Baptiste CONTANT Jeanne 11/02/1760 Rosnay-l'Hôpital. ADAM Jean Baptiste HEMART Honorine cecile 15/02/1768 Rosnay-l'Hôpital. ADAM Jerome DELESTRE Edme 20/02/1748 Saint-Léger-sous-Brienne ADAM Nicolas BOUILLEVAUX Françoise 28/02/1724 Blignicourt ADAM Nicolas BEUDOT Françoise 03/02/1766 Yèvres-le-Petit ADAM Nicolas francois BOCHERON Marie 31/05/1745 Rances ADAM Nicolas joseph MARTIN Marie mathie 02/07/1792 Blignicourt ADAM Rene GRAMAIRE Magdeleine 24/02/1727 Rances ADELIN Nicolas MASSE Anne pierette 08/02/1799 Rosnay-l'Hôpital. ADELIN=ADELINE Pierre CAPITAN Anne 06/02/1725 Rances ADELINE Antoine PETIT Marie 14/01/1766 Brienne-le-Château ADELINE Antoine BESANCON Anne 23/11/1717 Maizières-lès-Brienne ADELINE Claude MAUCORPS Marie 31/01/1780 Dienville ADELINE Claude PINET=PIERRET Marie louise 28/11/1782 Hampigny ADELINE François SANDRAS Marie 22/01/1743 Blignicourt ADELINE François LARCHER Marie catherine 15/02/1762 Blignicourt ADELINE François PAILLEY Louise 26/07/1702 Maizières-lès-Brienne ADELINE François LALIAL=LALIAT Marie madeleine 11/01/1735 Vallentigny ADELINE Francois jerome LOISELET Jeanne 23/11/1779 Hampigny ADELINE Georges ROY Marguerite 25/11/1715 Hampigny ADELINE Jacques GERARD Perrette 27/11/1725 Rosnay-l'Hôpital. -

Rankings Municipality of Hampigny
9/24/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links FRANCIA / GRAND EST / Province of AUBE / Hampigny Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIA Municipalities Powered by Page 2 Ailleville Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Fontvannes AdminstatAix-Villemaur-Pâlis logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Fouchères Allibaudières FRANCIA Fralignes Amance Fravaux Arcis-sur-Aube Fresnay Arconville Fresnoy- Argançon le-Château Arrelles Fuligny Arrembécourt Gélannes Arrentières Géraudot Arsonval Grandville Assenay Gumery Assencières Gyé-sur-Seine Aubeterre Hampigny Aulnay Herbisse Auxon Isle-Aubigny Avant- lès-Marcilly Isle-Aumont Avant- Jasseines lès-Ramerupt Jaucourt Avirey-Lingey Javernant Avon-la-Pèze Jessains Avreuil Jeugny Bagneux- Joncreuil la-Fosse Jully-sur-Sarce Bailly-le-Franc Juvancourt Balignicourt Juvanzé Balnot- Juzanvigny la-Grange La Chaise Balnot- La Chapelle- sur-Laignes Saint-Luc Bar-sur-Aube La Fosse- Bar-sur-Seine Corduan Barberey-Saint- La Loge-aux- Sulpice Chèvres Barbuise La Baroville Loge-Pomblin Bayel La Louptière- Bercenay- Thénard en-Othe La Motte-Tilly Powered by Page 3 Bercenay- La Rivière- L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin le-Hayer de-Corps Adminstat logo Bergères La Rothière DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIA Bernon La Saulsotte Bertignolles -
Situation De La Commune Par Rapport Aux Entités Et Unités Paysagères
Situation de la commune par rapport aux entités et unités paysagères LE BARROIS LA CHAMPAGNE CRAYEUSE LA CHAMPAGNE HUMIDE LES VALLEES DE LA SEINE ET DE L'AUBE LES SAVARTS DU LA CHAMPAGNE LA PLAINE LE PAYS L'AUBE URBANISEE L'ECHANCRURE LA SEINE URBANISEE LES PENTES N° LE BARROIS LE BARROIS LE BARROIS LA PLAINE LA PLAINE LA PLAINE LE PAYS CAMP MILITAIRE DE LA FORET LA CHAMPAGNE LE PAYS DE TROYES D'OTHE DE MOLINS SUR AUBE DE LA SEINE EN LA BASSEE LA PLAINE DE TROYES A DE LA CUESTA INSEE NOM COMMUNE FORESTIER OUVERT VITICOLE BOSSELEE 1 BOSSELEE 2 BOSSELEE 3 DE L'ORVIN DE MAILLY DE SOULAINES DES ETANGS D'ARMANCE A ETRELLES SUR AUBE CHAMPAGNE HUMIDE NOGENTAISE BRIENNOISE ROMILLY SUR SEINE D'ILE DE FRANCE 10002 AILLEVILLE X 10003 AIX-EN-OTHE X 10004 ALLIBAUDIERES X X 10005 AMANCE X X 10006 ARCIS-SUR-AUBE X X 10007 ARCONVILLE X X 10008 ARGANCON X X 10009 ARRELLES X X 10010 ARREMBECOURT X 10011 ARRENTIERES X 10012 ARSONVAL X 10013 ASSENAY X 10014 ASSENCIERES X 10015 AUBETERRE X 10017 AULNAY X X 10018 AUXON X X 10019 VAL-D'AUZON X X X 10020 AVANT-LES-MARCILLY X 10021 AVANT-LES-RAMERUPT X 10022 AVIREY-LINGEY X X 10023 AVON-LA-PEZE X X 10024 AVREUIL X 10025 BAGNEUX-LA-FOSSE X X 10026 BAILLY-LE-FRANC X 10027 BALIGNICOURT X 10028 BALNOT-LA-GRANGE X X 10029 BALNOT-SUR-LAIGNES X 10030 BARBEREY-SAINT-SULPICE X 10031 BARBUISE X X 10032 BAROVILLE X X 10033 BAR-SUR-AUBE X 10034 BAR-SUR-SEINE X X 10035 BAYEL X X 10037 BERCENAY-EN-OTHE X 10038 BERCENAY-LE-HAYER X X 10039 BERGERES X 10040 BERNON X X 10041 BERTIGNOLLES X X 10042 BERULLE X 10043 BESSY X X 10044