Quand Le Bambou Répond Au Phénix
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

February 2019 a Winter Wonderland That Warms Your Spirit
CHINAINSIGHT Fostering business and cultural harmony between China and the U.S. VOL. 18 NO. 2 February 2019 A winter wonderland that warms your spirit . News, p. 4 Business & Economy, p. 5 Language, p. 7 The 35th Harbin International Ice and Snow Festival, the largest in the world, is celebrated during Harbin’s Sister Cities Conference. See pages 8-9. Books, p. 11 Community Minneapolis artist Paul Kwok exhibits at Chung Chi College in Hong Kong By Greg Hugh More than 100 guests recently attended Kwok currently lives in Minneapolis an exhibit of landscape paintings titled “In with his partner Pat Hui where they also and Out of Tradition” by Paul Ka Yin Kwok share a studio at Traffic Zone Center for Arts & Culture, p. 14 held at Chung Chi College of The Chinese Visual Art. The studio was the site of the University of Hong Kong from which Kwok recent group discussion of “Crazy Rich graduated in 1967. Asians” held by the Chinese Heritage Foundation. ♦ In This Issue Arts & Culture 12-14 Right: Books 10-11 Pat Hui Business & Economy 5 and Kwok in front of Community 8-9 one of his Events 15-16 paintings Government & Politics 6 Language 7 Officiating at the ribbon cutting ceremony was News 3-4 (far left Professor Fong Wing Ping, head of Pronouncements 2 college; and artist Kwok (second from left). Recent CHF discussion at studio. PAGE 2 / February 2019 pronouncements www.chinainsight.info Publisher’s Pronouncements CHINAINSIGHT Greetings and Gung Hay Fat Choy (Happy New Year): As we went to press with this issue of We also are pleased to announce that a team player. -

De La Música Tradicional De China. Selección
Discografía de la música tradicional de China. Selección Biblioteca Fundación Juan March Esta selección discográfica ha sido preparada con motivo de la exposición El principio Asia. China, Japón e India y el arte contemporáneo en España (1957-2017) y del ciclo de cinco conciertos Oriente y la música occidental. Durante la preparación de esta discografía no han sido incluidos numerosos registros publicados en China de muy difícil localización en Occidente. Tampoco se mencionan grabaciones sonoras anteriores al vinilo. Las músicas que aparecen en estos discos son un breve apunte de la riqueza musical tradicional que aún se practica en este país. Muchos de estos soportes sonoros han sido y son, además, fuente de estudio para compositores e intérpretes occidentales. La influencia de estas músicas sobre las técnicas compositivas, el timbre vocal e instrumental o sobre la concepción del tiempo musical es esencial para comprender una gran parte de la historia musical del siglo XX. Selección discográfica de José Luis Maire Biblioteca Fundación Juan March Abril de 2018 Música y canto budista La liturgia budista y taoísta en China tiene una historia de casi 2000 años y todavía se practica ampliamente en la actualidad. Desde su llegada a China hasta las llamadas tres dinastías del Norte y del Sur (420-589 d. C.), el budismo sufrió un proceso de consolidación hasta su profunda adaptación. Como numerosos documentos históricos demuestran (textos, pinturas y esculturas), el budismo introdujo en China nuevos géneros y prácticas rituales de una manera progresiva. Uno de los géneros más representativos y específicos de la liturgia vocal china es el denominado canto fanbei, caracterizado por la construcción de melodías melismáticas surgidas como consecuencia de un proceso de transculturación con las formas nativas de China. -

Hmong Music in Northern Vietnam: Identity, Tradition and Modernity Qualification: Phd
Access to Electronic Thesis Author: Lonán Ó Briain Thesis title: Hmong Music in Northern Vietnam: Identity, Tradition and Modernity Qualification: PhD This electronic thesis is protected by the Copyright, Designs and Patents Act 1988. No reproduction is permitted without consent of the author. It is also protected by the Creative Commons Licence allowing Attributions-Non-commercial-No derivatives. If this electronic thesis has been edited by the author it will be indicated as such on the title page and in the text. Hmong Music in Northern Vietnam: Identity, Tradition and Modernity Lonán Ó Briain May 2012 Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Music University of Sheffield © 2012 Lonán Ó Briain All Rights Reserved Abstract Hmong Music in Northern Vietnam: Identity, Tradition and Modernity Lonán Ó Briain While previous studies of Hmong music in Vietnam have focused solely on traditional music, this thesis aims to counteract those limited representations through an examination of multiple forms of music used by the Vietnamese-Hmong. My research shows that in contemporary Vietnam, the lives and musical activities of the Hmong are constantly changing, and their musical traditions are thoroughly integrated with and impacted by modernity. Presentational performances and high fidelity recordings are becoming more prominent in this cultural sphere, increasing numbers are turning to predominantly foreign- produced Hmong popular music, and elements of Hmong traditional music have been appropriated and reinvented as part of Vietnam’s national musical heritage and tourism industry. Depending on the context, these musics can be used to either support the political ideologies of the Party or enable individuals to resist them. -
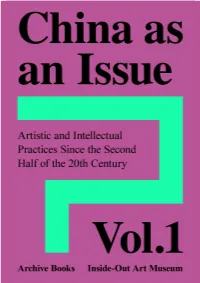
China As an Issue: Artistic and Intellectual Practices Since the Second Half of the 20Th Century, Volume 1 — Edited by Carol Yinghua Lu and Paolo Caffoni
China as an Issue: Artistic and Intellectual Practices Since the Second Half of the 20th Century, Volume 1 — Edited by Carol Yinghua Lu and Paolo Caffoni 1 China as an Issue is an ongoing lecture series orga- nized by the Beijing Inside-Out Art Museum since 2018. Chinese scholars are invited to discuss topics related to China or the world, as well as foreign schol- ars to speak about China or international questions in- volving the subject of China. Through rigorous scruti- nization of a specific issue we try to avoid making generalizations as well as the parochial tendency to reject extraterritorial or foreign theories in the study of domestic issues. The attempt made here is not only to see the world from a local Chinese perspective, but also to observe China from a global perspective. By calling into question the underlying typology of the inside and the outside we consider China as an issue requiring discussion, rather than already having an es- tablished premise. By inviting fellow thinkers from a wide range of disciplines to discuss these topics we were able to negotiate and push the parameters of art and stimulate a discourse that intersects the arts with other discursive fields. The idea to publish the first volume of China as An Issue was initiated before the rampage of the coron- avirus pandemic. When the virus was prefixed with “China,” we also had doubts about such self-titling of ours. However, after some struggles and considera- tion, we have increasingly found the importance of 2 discussing specific viewpoints and of clarifying and discerning the specific historical, social, cultural and political situations the narrator is in and how this helps us avoid discussions that lack direction or substance. -
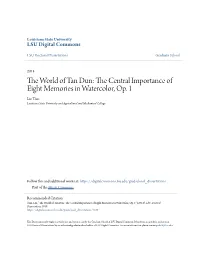
The World of Tan Dun: the Central Importance of Eight Memories in Watercolor, Op
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2014 The orW ld of Tan Dun: The eC ntral Importance of Eight Memories in Watercolor, Op. 1 Lin Tian Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the Music Commons Recommended Citation Tian, Lin, "The orldW of Tan Dun: The eC ntral Importance of Eight Memories in Watercolor, Op. 1" (2014). LSU Doctoral Dissertations. 1819. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/1819 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. THE WORLD OF TAN DUN: THE CENTRAL IMPORTANCE OF EIGHT MEMORIES IN WATERCOLOR, OP. 1 A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts in The School of Music By Lin Tian B.M., Shandong University, 2009 M.M., University of Tennessee at Knoxville, 2011 July, 2014 ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank my major professor Mr. Gregory Sioles for everything he has done for me throughout my doctorate study at LSU. Thank you for teaching me not only to be a better musician, but also a better person. Thank you for all the effects you have put into guiding me through the process of writing this dissertation. -

Download Article
Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 341 5th International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE 2019) Living Inheritance of Ancient Miao Songs in Southern Sichuan* Jia Yu Southwest Minzu University Chengdu, China Abstract—Ancient Miao songs in southern Sichuan are a literature. In the earliest collection of poems in China, "The living expression of Miao people's ideology and a vivid Book of Songs", there are verses such as "blowing reed-pipe reflection of their unique culture and religious beliefs. It is the wind instrument and playing reed, blowing reed-pipe wind special performance and inheritance environment of the ancient Miao songs in southern Sichuan that makes the ancient instrument and reed-pipe wind instrument, playing reed" songs form the "text" style of the combination of vocal music, and so on. In "The Book of Songs·Xiaoya", there are also instrumental music and even dance rhythm. Only in its folk six lost poems, namely, "Nangai", "Baihua", "Huashu", environment can it really survive. "Yougeng", "Chongqiu" and "Yuyi". "The annals of Xuyong Yongning County" contains: "Miao people data on Keywords—the Miao nationality in southern Sichuan; the high mountains in early January, date Gaofu, and dance ancient songs; living inheritance with each other." For the people of marriage, men blow reed-pipe wind instrument; women play mouth harps; and I. INTRODUCTION they will sing to each other. When Yang Sheng'an saw the Ancient Miao songs are collective creation epics written Miao people's grand mountain-stepping party, he wrote orally by the ancient Miao people. They are rich in content poems and praised it: "men and women dance with the and complete in categories. -

The Accordion in Twentieth-Century China A
AN UNTOLD STORY: THE ACCORDION IN TWENTIETH-CENTURY CHINA A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE DIVISION OF THE UNIVERSITY OF HAWAI'I IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN MUSIC AUGUST 2004 By Yin YeeKwan Thesis Committee: Frederick Lau, Chairperson Ricardo D. Trimillos Fred Blake ©Copyright2004 by YinYeeKwan iii ACKNOWLEDGEMENTS My 2002 and 2003 fieldwork in the People's Republic ofChina was funded by The Arts and Sciences Grant from the University ofHawai'i at Manoa (UHM). I am grateful for the generous support. I am also greatly indebted to the accordionists and others I interviewed during this past year in Hong Kong, China, Phoenix City, and Hawai'i: Christie Adams, Chau Puyin, Carmel Lee Kama, 1 Lee Chee Wah, Li Cong, Ren Shirong, Sito Chaohan, Shi Zhenming, Tian Liantao, Wang Biyun, Wang Shusheng, Wang Xiaoping, Yang Wentao, Zhang Gaoping, and Zhang Ziqiang. Their help made it possible to finish this thesis. The directors ofthe accordion factories in China, Wang Tongfang and Wu Rende, also provided significant help. Writing a thesis is not the work ofonly one person. Without the help offriends during the past years, I could not have obtained those materials that were invaluable for writings ofthis thesis. I would like to acknowledge their help here: Chen Linqun, Chen Yingshi, Cheng Wai Tao, Luo Minghui, Wong Chi Chiu, Wang Jianxin, Yang Minkang, and Zhang Zhentao. Two others, Lee Chinghuei and Kaoru provided me with accordion materials from Japan. I am grateful for the guidance and advice ofmy committee members: Professors Frederick Lau, Ricardo D. -

(EN) SYNONYMS, ALTERNATIVE TR Percussion Bells Abanangbweli
FAMILY (EN) GROUP (EN) KEYWORD (EN) SYNONYMS, ALTERNATIVE TR Percussion Bells Abanangbweli Wind Accordions Accordion Strings Zithers Accord‐zither Percussion Drums Adufe Strings Musical bows Adungu Strings Zithers Aeolian harp Keyboard Organs Aeolian organ Wind Others Aerophone Percussion Bells Agogo Ogebe ; Ugebe Percussion Drums Agual Agwal Wind Trumpets Agwara Wind Oboes Alboka Albogon ; Albogue Wind Oboes Algaita Wind Flutes Algoja Algoza Wind Trumpets Alphorn Alpenhorn Wind Saxhorns Althorn Wind Saxhorns Alto bugle Wind Clarinets Alto clarinet Wind Oboes Alto crumhorn Wind Bassoons Alto dulcian Wind Bassoons Alto fagotto Wind Flugelhorns Alto flugelhorn Tenor horn Wind Flutes Alto flute Wind Saxhorns Alto horn Wind Bugles Alto keyed bugle Wind Ophicleides Alto ophicleide Wind Oboes Alto rothophone Wind Saxhorns Alto saxhorn Wind Saxophones Alto saxophone Wind Tubas Alto saxotromba Wind Oboes Alto shawm Wind Trombones Alto trombone Wind Trumpets Amakondere Percussion Bells Ambassa Wind Flutes Anata Tarca ; Tarka ; Taruma ; Turum Strings Lutes Angel lute Angelica Percussion Rattles Angklung Mechanical Mechanical Antiphonel Wind Saxhorns Antoniophone Percussion Metallophones / Steeldrums Anvil Percussion Rattles Anzona Percussion Bells Aporo Strings Zithers Appalchian dulcimer Strings Citterns Arch harp‐lute Strings Harps Arched harp Strings Citterns Archcittern Strings Lutes Archlute Strings Harps Ardin Wind Clarinets Arghul Argul ; Arghoul Strings Zithers Armandine Strings Zithers Arpanetta Strings Violoncellos Arpeggione Keyboard -
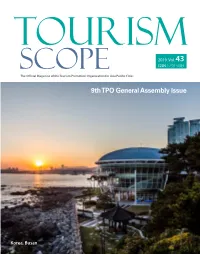
9Th TPO General Assembly Issue
2019. Vol. 43 ISSN 1739-5089 The Official Magazine of the Tourism Promotion Organization for Asia Pacific Cities 9th TPO General Assembly Issue Korea, Busan Contents 02 Official Program of the General Assembly 03 Highlights of the 9th TPO General Assembly / Side Events 04 Tour courses (TBC) –optional 06 Busan Metropolitan City welcomes all of you with open arms Special - TPO Members 07 The Second Largest City in the Republic of Korea, Busan 08 Home to Migratory Birds, Saha-gu, Busan 10 The Jewel-like Island, Jeju 12 Vitality of Mountain Palgong, Dong-gu, Daegu 14 Encounter of Natural Wonders with Ethnic Minority, Qiannan 16 UNESCO Creative City, Kanazawa 18 Blissful Land with Full of Joy, Dalat 20 A Calm Himalayan Village, Dhulikhel 22 Sea, Forest, and History All in One Island, Pariaman 24 Eco-city Where Whales Live, Ulsan 26 Wong Fei-hung’s Land, Foshan 28 The Oldest City in Taiwan, Tainan 29 City of Eternal Peace, Taiping 30 Russia’s Seaport City, Vladivostok 31 Pearl of the East, Manila 32 Angel’s City, Bangkok Tourism Promotion Organization for Asia Pacific Cities TPO is a network among cities in the Asia Pacific region and is an international tourism organization established for the development of the tourism industry. TPO exchanges tourism information among member cities to promote the tourism industry, and also carries out projects including tourism product development, joint marketing projects, and tourism education as well as human resources development. TPO has currently 124 city members and 51 industry members. Industry members consist of travel agencies, tourism related associations, research institutes, and destination marketing organizations(DMO). -
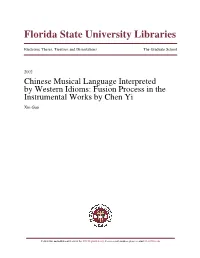
Fusion Process in the Instrumental Works by Chen Yi Xin Guo
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2002 Chinese Musical Language Interpreted by Western Idioms: Fusion Process in the Instrumental Works by Chen Yi Xin Guo Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC CHINESE MUSICAL LANGUAGE INTERPRETED BY WESTERN IDIOMS: FUSION PROCESS IN THE INSTRUMENTAL WORKS BY CHEN YI By XIN GUO A Dissertation submitted to the School of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Degree Awarded: Fall Semester, 2002 The members of the Committee approve the dissertation of Xin Guo defended on November 6, 2002. James Mathes Professor Directing Dissertation Andrew Killick Outside Committee Member Jane Piper Clendinning Committee Member Peter Spencer Committee Member Approved: Seth Beckman, Assistant Dean for Academic Affairs and Director of Graduate Studies, School of Music ACKNOWLEDGMENTS I would like to express my deepest gratitude to many people who have helped me in one way or another during my research and writing of this dissertation. Dr. Chen Yi’s music inspired me to choose the topic of this project; she provided all the scores, the recordings, and her reference materials for me and responded to my questions in a timely manner during my research. Dr. Richard Bass guided me throughout my master’s thesis, an early stage of this project. His keen insight and rigorous thought influenced my thinking tremendously. Dr. Harris Fairbanks spent countless hours proofreading both my thesis and dissertation. His encouragement and unwavering support helped me enormously and for this I am deeply indebted to him. -

W680 Owner's Manual 中性.Cdr
WELCOME To the happy family of satisfied electronic musical instrument owners! To get the most out of the many features and functions of the keyboard, please be sure to read carefully this manual and keep it at hand for future reference. MAIN FEATURES Strong multifunctional LCD system with large-scream display, which makes selecting and editing parameters much easier. 153 different kinds of voices, including 25 voices of Chinese folk instruments( Trichord, Gu-Zheng, Erhu, Suona) Almost including 100 popular accompaniment styles in the world. Each has its own intro and main (A, B two types), variation and ending. 36 types of commonly-used voices and 36 types of commonly-used styles for rapid choice. With 9 groups of percussion instrument and a group of Chinese traditional percussion instruments. Graceful piano shape design and soft LCD back light make the piano more luxurious. Be able to synthesize certain digital effects like the reverb chorus and 3 D stereo effect, which could create various sound field effects. Record function can record with one accompaniment track and two melody tracks. 6 demonstration songs, making great contributions to lifting your performance level. Demo has Minus Channel function, which enables you to repeatedly play a certain sentence, thus, makes great contribution to teaching. Memory Bank reserves 16 panel parameter presets for your rapid choice. MIDI function enables W680 suitable for every standard MIDI system. 1 CONTENT Safety precautions ¡¡¡¡¡¡¡¡¡P. 2 *. Selecting the Style ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡P. 2 8 *. Setting the Tempo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡P. 2 8 Control board ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡P. 6 *. Starting the Accompaniment ¡¡¡¡¡¡¡¡P. 2 9 Setting up the Music Stand ¡¡¡¡¡¡¡¡¡P. -

The Accordion in the 19Th Century, Which We Are Now Presenting, Gorka Hermosa Focuses on 19Th C
ISBN 978-84-940481-7-3. Legal deposit: SA-104-2013. Cover design: Ane Hermosa. Photograph on cover by Lituanian “Man_kukuku”, bought at www.shutterstock.com. Translation: Javier Matías, with the collaboration of Jason Ferguson. 3 INDEX FOREWORD: by the Dr. Pr. Helmut Jacobs................................................................ 5 INTRODUCTION......................................................................................................... 7 CHAPTER I: Predecessors of the accordion.............................................................. 9 I.1- Appearance of the free reed instruments in Southeast Asia.................... 10 I.2- History of the keyboard aerophone instruments: The organ................... 13 I.3- First references to the free reed in Europe.............................................. 15 I.4- The European free reed: Christian Gottlieb Kratzenstein....................... 17 I.5- The modern free reed instrument family................................................ 18 CHAPTER II: Organologic history of the accordion............................................... 21 II.1- Invention of the accordion..................................................................... 21 II.1.1- Demian’s accordion..................................................................... 21 II.1.2- Comments on the invention of the accordion. ............................ 22 II.2- Organologic evolution of the accordion................................................ 24 II.3- Accordion Manufacturers.....................................................................