RAVEL L'espagnol
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mercredi 25 Avril 2012 Nora Gubisch | Ensemble Intercontemporain | Alain Altinoglu
Roch-Olivier Maistre, Président du Conseil d’administration Laurent Bayle, Directeur général Mercredi 25 avril 2012 avril 25 Mercredi | Mercredi 25 avril 2012 Nora Gubisch | Ensemble intercontemporain | Alain Altinoglu Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, 2 jours avant chaque concert, à l’adresse suivante : www.citedelamusique.fr Altinoglu | Alain Gubisch | Ensemble intercontemporain Nora 2 MERCREDI 25 AVRIL – 20H Salle des concerts Lu Wang Siren Song Igor Stravinski Huit Miniatures instrumentales Concertino pour douze instruments Maurice Ravel Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé entracte Marc-André Dalbavie Palimpseste Luciano Berio Folk Songs Nora Gubisch, mezzo-soprano Ensemble intercontemporain Alain Altinoglu, direction Diffusé en direct sur les sites Internet www.citedelamusiquelive.tv et www.arteliveweb.com, ce concert restera disponible gratuitement pendant trois mois. Il est également retransmis en direct sur France Musique. Coproduction Cité de la musique, Ensemble intercontemporain. Fin du concert vers 22h15. 3 Lu Wang (1982) Siren Song Composition : 2008. Création : 5 avril 2008 à New York, Merkin Concert Hall, par l’International Contemporary Ensemble (ICE), sous la direction de Matt Ward. Effectif : flûte / flûte piccolo, clarinette en si bémol / clarinette en mi bémol / clarinette basse – cor, trompette – piano – harpe – percussions – violon, alto, violoncelle. Éditeur : inédit. Durée : environ 7 minutes. Cette pièce peut être vue comme un court opéra. Elle utilise la translittération d’un ancien dialecte de Xi’an, ma ville natale, extrêmement puissant et musical qui, dans le parlé/chanté, se déploie en intervalles démesurés et en glissandi. J’avais été particulièrement fascinée par une voix que j’entendis chez un conteur qui chantait dans ce dialecte : c’était la voix sèche, comme affolée et pourtant très séduisante d’un vieil eunuque. -

Orchestre De Paris Asume El Papel De Asesor Artístico En 2020/2021 Y Será Su Próximo Director Musical a Partir De Septiembre De 2022
70 Festival de Granada Biografías Klaus Mäkelä Klaus Mäkelä es director principal y asesor artístico de la Filarmónica de Oslo. Con la Orchestre de Paris asume el papel de asesor artístico en 2020/2021 y será su próximo director musical a partir de septiembre de 2022. Es, además, director invitado principal de la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca y director artístico del Festival de Música de Turku. Como artista exclusivo de Decca Classics, Klaus Mäkelä ha grabado el ciclo completo de sinfonías de Sibelius con la Filarmónica de Oslo como primer proyecto con el sello, que será editado en la primavera de 2022. Klaus Mäkelä inaugura la temporada 2021/2022 de la Filarmónica de Oslo este mes de agosto con un concierto especial interpretando el Divertimento de Bartók, el Concierto para piano nº 1 con Yuja Wang como solista, dos obras de estreno del compositor noruego Mette Henriette y Lemminkäinen de Sibelius. Ofrecerá un repertorio de similar amplitud durante su segunda temporada en Oslo., incluyendo las grandes obras corales de J. S Bach, Mozart y William Walton, la Sinfonía nº 3 de Mahler y las nº 10 y 14 de Shostakóvich con los solistas Mika Kares y Asmik Grigorian. Entre las obras contemporáneas y de estreno se incluyen composiciones de Sally Beamish, Unsuk Chin, Jimmy Lopez, Andrew Norman y Kaija Saariaho. En la primavera de 2022, Klaus Mäkelä y la Filarmónica de Oslo interpretarán las sinfonías completas de Sibelius en la Wiener Konzerthaus y la Elbphilharmonie de Hamburgo, y en gira por Francia y el Reino Unido. Con la Orchestre de Paris, visitará los festivales de verano de Granada y Aix-en- Provence. -

Press Release – London, 9 October 2019 Orchestre De Chambre
Press release – London, 9 October 2019 Orchestre de chambre de Paris : Lars Vogt, new Music Director Lars Vogt has been appointed Music Director of the Orchestre de chambre de Paris from 1 July 2020, for a 3-year term in agreement with the City of Paris and the ministry of Culture - Drac Ile-de-France. With Lars Vogt, the Orchestre de chambre de Paris has appointed a Music Director who is both an outstanding musician and an internationally acclaimed conductor. His presence further strengthens the orchestra’s original artistic approach and its roots in chamber music. This appointment is the result of a process that was begun more than a year ago by the Board of Directors of the Orchestre de chambre de Paris in constant dialogue with all their musicians. These positive exchanges led to a short list of four candidates including one female conductor on which all the musicians had an advisory vote. This rigorous procedure allowed the Board of Directors, meeting on 8 October 2019, to appoint Lars Vogt as the next Music Director of the Orchestre de chambre de Paris with the approval of the City of Paris and the ministry of Culture – Drac Ile-de-France. The appointment of Lars Vogt marks a new stage in the musical development begun by Douglas Boyd in 2015. Over the last five years, the Orchestre de chambre de Paris has seen a significant regeneration with 44% new players joining in this time. Today recognised as the most youthful orchestra in Paris, it is also the first professional French orchestra to have full gender equality. -

N E W S R E L E a S E
N E W S R E L E A S E CONTACT: Katherine Blodgett/The Philadelphia Orchestra Director of Public/Media Relations phone: 215.893.1939 e-mail: [email protected] FOR IMMEDIATE RELEASE DATE: December 19, 2008 THE PHILADELPHIA ORCHESTRAORCHESTRA,, WITH CHRISTOPH ESCHENBACHESCHENBACH CONDUCTING, TOURS EUROPE AND THE CANARY ISLANDS ThreeThree----weekweek tour includes visits to the Canary Islands, Spain, Portugal, Luxembourg, Hungary, and Austria ––– violinist Leonidas Kavakos joins tour as soloist (Philadelphia, December 19, 2008) – The Philadelphia Orchestra embarks on its 2009 Tour of Europe and the Canary Islands on January 26, 2009. Under the leadership of Christoph EschenbachEschenbach, the Orchestra visits nine cities in five countries making first visits to Santa Cruz de TenerifeTenerife, Las Palmas de Gran CanariaCanaria, LuxembourgLuxembourg, and BudapestBudapest. The three-week tour, which concludes February 14, also includes performances in BarcelonaBarcelona, LisbonLisbon, MadridMadrid, ValenciaValencia, and ViennaVienna. Violinist Leonidas Kavakos joins The Philadelphia Orchestra for eight of the tour’s concerts. ToToTourTo ur Repertoire and Artists On the 2009 tour, The Philadelphia Orchestra performs Prokofiev’s Fifth Symphony, Schubert’s Symphony in C major (“Great”), Pintscher’s Osiris , Bruckner’s Sixth Symphony, Schoenberg’s Chamber Symphony No. 1, and Beethoven’s Overture to Egmont . Guest soloist Leonidas Kavakos performs Bartók’s Violin Concerto No. 2 with the Orchestra on concerts in Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, and Luxembourg, and performs Sibelius’s Violin Concerto on concerts in Lisbon, Madrid, Valencia, Budapest, and Vienna. Conductor Christoph EschenbachEschenbach, music director of The Philadelphia Orchestra from 2003 to 2008, leads the 2009 Tour of Europe and the Canary Islands. -
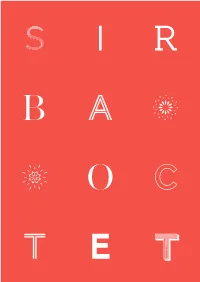
Sirba-Tantz-Ang-Eng-2017-Site.Pdf
S I R B A O C T E T Tantz ! Sirba Octet www.sirbaoctet.com © © Bernard Martine “Tantz! has its roots in the Eastern IT IS A PORTRAIT OF LIFE ITSELF! Europe of my grandparents before they emigrated nearly 100 years “It is a portrait of life itself – a lifetime T A N ago. I wanted to rediscover this of love that no longer exists to which intrinsic element of my cultural song is the only possible testimony we orientation by revisiting this music as the classical musician I am can have in the end. It encapsulates a TZ today.” whole era which used to exist and isn’t there any more but which will live on in Inspired by the migration both of the souls of those who value it and we people and of their music, the must all value it because it comes ! show forms a kind of bridge directly from the heart. between Romania, Moldova, Russia and Hungary and their That is what it is. rich, interwoven treasuries of traditional folk music. Each We must thank these wonderful carefully selected piece retains the musicians who have come together to identity and authenticity which we share and sustain this symbol of love, must protect and pass on, like Ariadne’s thread, thereby continuing the musical heritage reanimating a forgotten time that is that is an ode to life – moving, joyful and tinged with humour. ever present. Richard Schmoucler, artistic Thank you!” director (translated from original French) Ivry Gitlis, Paris, September 30th 2014 (translated from the original French) AN ENERGETIC AND HEARTFELT MUSICAL JOURNEY Tantz! means dance in Yiddish and this title eludes to the emotion, elegance and vigour of the show itself. -

ORCHESTRE DE PARIS Daniel Harding, Souffrant, Est Remplacé Par George Jackson
ORCHESTRE DE PARIS Daniel Harding, souffrant, est remplacé par George Jackson LES ÉLÉMENTS (PROLOGUE ET AUTRES EXTRAITS) (1) Jean-Féry REBEL 1666-1747 ECHO-FRAGMENTE, POUR CLARINETTE ET GROUPES INSTRUMENTAUX (2) Jörg WIDMANN né en 1973 Entracte WHEEL OF EMPTINESS, POUR SEIZE MUSICIENS (3) Jonathan HARVEY 1939-2012 SYMPHONIE N° 4, POUR CHŒUR ET ORCHESTRE (AVEC PIANO), S.4 (4) Charles IVES 1874-1954 Fin du concert aux environs de 22H50 Grande Salle Pierre Boulez – Philharmonie Paul AGNEW (1) • George JACKSON (2, 3, 4) direction Mehdi LOUGRAÏDA (4) • Lionel BORD (4) chefs assistants Jörg WIDMANN (2) clarinette Simon CRAWFORD-PHILLIPS piano 20h30 Les Arts Florissants (1, 2) • Ensemble intercontemporain (3, 4) (2, 4) Orchestre de Paris 2018 Chœur de l’Orchestre de Paris avril Lionel SOW chef de chœur 5 Un partenariat Orchestre de Paris, Les Arts Florissants et Ensemble intercontemporain Jeudi LES ÉLÉMENTS, (PROLOGUE ET AUTRES EXTRAITS) Jean-Féry REBEL L’introduction à cette symphonie Composé en 1737 et créé le 27 septembre 1737 (Chaos I à VII – était naturelle. C’était le chaos Débrouillement) Dédicace : au prince de Carignan même, cette confusion qui régnait Symphonie de danse en neuf mouvements : (en gras, les extraits au entre les éléments avant l’instant où, programme) Prologue : Le Chaos 1. Loure I – 2. Chaconne – 3. Ramage assujettis à des lois invariables, ils 4. Rossignols – 5. Loure II 6. Tambourins I et II – 7. Sicilienne ont pris la place qui leur est prescrite 8. Rondeau : Air pour l’Amour 9. Rondeau : Caprice dans l’ordre de la Nature. Effectif : cordes (violons, altos, violoncelles, contrebasses), 2 flûtes Jean-Féry Rebel allemandes, flûte à bec, hautbois, basson, 4 cors, clavecin ean-Féry Rebel fut un compositeur novateur dans Durée approximative : 15 minutes bien des domaines, mais c’est avant tout sa musique Jde danse qui révèle l’originalité de son talent. -

Avant Première Catalogue 2017
Avant PreCATALOGUEmi ère 2017 UNITEL is one of the world's leading producers of classical music programmes for film, television, video and new media. Based on exclusive relationships with outstanding artists and institutions like Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, the Salzburg Festival and many others, the UNITEL catalogue of more than 1700 titles presents some of the greatest achievements in the last half a century of classical music. Search the complete UNITEL catalogue online at www.unitel.de Front cover: Elīna Garanča in G. Donizetti's “La Favorite” / Photo: Wilfried Hösl UNITEL AVANT PREMIÈRE CATALOGUE 2017 Editorial Team: Konrad von Soden, Franziska Pascher Layout: Manuel Messner/luebbeke.com All information is not contractual and subject to change without prior notice. All trademarks used herein are the property of their respective owners. Date of Print: 31st of January 2017 ∙ © Unitel 2017 ∙ All Rights reserved FOR COPRODUCTION & PRESALES INQUIRIES PLEASE CONTACT: Unitel GmbH & Co. KG Gruenwalder Weg 28D · 82041 Oberhaching / Munich, Germany Tel: +49.89.673469-613 · Fax: +49.89.673469-610 · [email protected] Ernst Buchrucker Dr. Thomas Hieber Dr. Magdalena Herbst Managing Director Head of Business and Legal Affairs Head of Production [email protected] [email protected] [email protected] Tel: +49.89.673469-19 Tel: +49.89.673469-611 Tel: +49.89.673469-862 WORLD SALES C Major Entertainment GmbH Meerscheidtstr. 8 · 14057 Berlin, Germany Tel.: +49.30.303064-64 · [email protected] Elmar Kruse Niklas -

Recording Master List.Xls
UPDATED 11/20/2019 ENSEMBLE CONDUCTOR YEAR Bartok - Concerto for Orchestra Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop 2009 Bavarian Radio Symphony Orchestra Rafael Kubelik 1978L BBC National Orchestra of Wales Tadaaki Otaka 2005L Berlin Philharmonic Herbert von Karajan 1965 Berlin Radio Symphony Orchestra Ferenc Fricsay 1957 Boston Symphony Orchestra Erich Leinsdorf 1962 Boston Symphony Orchestra Rafael Kubelik 1973 Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa 1995 Boston Symphony Orchestra Serge Koussevitzky 1944 Brussels Belgian Radio & TV Philharmonic OrchestraAlexander Rahbari 1990 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer 1996 Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner 1955 Chicago Symphony Orchestra Georg Solti 1981 Chicago Symphony Orchestra James Levine 1991 Chicago Symphony Orchestra Pierre Boulez 1993 Cincinnati Symphony Orchestra Paavo Jarvi 2005 City of Birmingham Symphony Orchestra Simon Rattle 1994L Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi 1988 Cleveland Orchestra George Szell 1965 Concertgebouw Orchestra, Amsterdam Antal Dorati 1983 Detroit Symphony Orchestra Antal Dorati 1983 Hungarian National Philharmonic Orchestra Tibor Ferenc 1992 Hungarian National Philharmonic Orchestra Zoltan Kocsis 2004 London Symphony Orchestra Antal Dorati 1962 London Symphony Orchestra Georg Solti 1965 London Symphony Orchestra Gustavo Dudamel 2007 Los Angeles Philharmonic Andre Previn 1988 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen 1996 Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit 1987 New York Philharmonic Leonard Bernstein 1959 New York Philharmonic Pierre -

Philharmonie De Paris: Sounds in Flight
Philharmonie de Paris: sounds in flight The nest couldn’t have been made in a more auspicious setting. The Parc de la Villette, where one can also find the Géode and the Cité de la Musique, was the chosen grounds for the imposing Jean Nouvel oeuvre, opened at January 14th of 2015. At that date, in rememberance of the victims of the Charlie Hebdo attack, the resident Orchestre de Paris interpreted Gabriel Fauré’s Requiem. The mourning notes of its opening were not to become an omen, however. In the short time it has been operating, this majestic edifice has housed the finest symphonic orchestras in the world, all of them testifying to the perfect acoustics. It has awed millions of people in its 3.600 seats where, following closely the layout of the Berlin Philharmonic, the most distant seat is a mere 38 meters from the stage. portuguese culture of mixing tradition This building has expanded the horizons of and innovation in the rock industries, and youths and students with its Museum and promoting the demand for materials that 24 rooms for educational use. already export 70% of its production. Within the extractive and manufacturing sector, the The most immediate reference for this project ornamental rock subsector represents half of will always be the birds that draw its façade the total export value. and its paths. Totaling 340.000 pieces, these abstract birds are split between granite and The main advantages that helped earn aluminum shapes. Seven different, combining this standing refer to the union between shapes were drawn for these birds, forming innovating technologies and a tradition in a tangram puzzle comprised of 14 pieces per stonework mastery. -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 88, 1968
RUTGERS UNIVERSITY The State University of New Jersey IN MEMORY OF CHARLES MUNCH September 26, 1891 - November 6, 1968 ^Boston Symphony Orchestra Erich Leinsdorf Music Director THE RUTGERS UNIVERSITY CHOIR F. Austin Walter, Director Erich Leinsdorf, Conducting Soloists: SHERRILL MILNES SARAMAE ENDICH Baritone Soprano Program Notes Copyright © by Alec Robertson The University Gymnasium Thursday Evening, November 21, 1968 8:30 o'clock I "Wedding" Cantata No. 202 for Soprano J. S. Bach (1685-1750) Aria: Weichet nur, betriibte Schatten Recitative: Die Welt wird wieder neu Aria: Phobus eilt mit schnellen Pferden Recitative: D'rum sucht auch Amor sein Vergnugen Aria: Wenn die Friihlings liifte streichen Recitative: Und dieses ist das Gliicke Aria: Sich iiben im Lieben Recitative: So sei das Band der keuschen Liebe Gavotte: Sehet in Zufriedenheit Saramae Endich, soprano Joseph Silverstein, violin Ralph Gomberg, oboe Charles Wilson, harpsichord continuo Jules Eskin, 'cello continuo Henry Portnoi, double bass continuo Sherman Walt, bassoon continuo Program Note: During his period of office as court composer at Cothen, where he had no duties to perform in the Duke's chapel, Bach is said to have composed a large number of secular cantatas, but only one of these, our cantata No. 202, is preserved complete, two more being known to us from subsequent adaptations in the church cantatas. We have, therefore, the Wedding cantata composed at Cothen in its original version. Bach was often unwilling to leave good material composed for a special occasion aside, but the dance-like character of the cantata would have prevented him from using the music subsequently in a church work. -

1. 101 Strings: Panoramic Majesty of Ferde Grofe's Grand
1. 101 Strings: Panoramic Majesty Of Ferde Grofe’s Grand Canyon Suite 2. 60 Years of “Music America Loves Best” (2) 3. Aaron Rosand, Rolf Reinhardt; Southwest German Radio Orchestra: Berlioz/Chausson/Ravel/Saint-Saens 4. ABC: How To Be A Zillionaire! 5. ABC Classics: The First Release Seon Series 6. Ahmad Jamal: One 7. Alban Berg Quartett: Berg String Quartets/Lyric Suite 8. Albert Schweitzer: Mendelssohn Organ Sonata No. 4 In B-Flat Major/Widor Organ Symphony No. 6 In G Minor 9. Alexander Schneider: Brahms Piano Quartets Complete (2) 10. Alexandre Lagoya & Claude Bolling: Concerto For Classic Guitar & Jazz Piano 11. Alexis Weissenberg, Georges Pretre; Chicago Symphony Orchestra: Rachmaninoff Concerto No. 3 12. Alexis Weissenberg, Herbert Von Karajan; Orchestre De Paris: Tchaikovsky Concerto #2 13. Alfred Deller; Deller Consort: Gregorian Chant-Easter Processions 14. Alfred Deller; Deller Consort: Music At Notre Dame 1200-1375 Guillaume De Machaut 15. Alfred Deller; Deller Consort: Songs From Taverns & Chapels 16. Alfred Deller; Deller Consort: Te Deum/Jubilate Deo 17. Alfred Newman; Brass Of The Hollywood Bowl Symphony Orchestra: Hallelujah! 18. Alicia De Larrocha: Grieg/Mendelssohn 19. Andre Cluytens; Paris Conservatoire Orchestra: Bizet 20. Andre Kostelanetz & His Orchestra: Columbia Album Of Richard Rodgers (2) 21. Andre Kostelanetz & His Orchestra: Verdi-La Traviata 22. Andre Previn; London Symphony Orchestra: Rachmaninov/Shostakovich 23. Andres Segovia: Plays J.S. Bach//Edith Weiss-Mann Harpsichord Bach 24. Andy Williams: Academy Award Winning Call Me Irresponsible 25. Andy Williams: Columbia Records Catalog, Vol. 1 26. Andy Williams: The Shadow Of Your Smile 27. Angel Romero, Andre Previn: London Sympony Orchestra: Rodrigo-Concierto De Aranjuez 28. -

Dossier De Presse Jaehyuck Choi, Unsuk Chin, Miroslav Srnka, Enno Poppe
FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 5 sept 2020 – 7 fév 2021 DOSSIER DE PRESSE JAEHYUCK CHOI, UNSUK CHIN, MIROSLAV SRNKA, ENNO POPPE Service presse : Christine Delterme – [email protected] Lucie Beraha – [email protected] Assistées de Nora Fernezelyi – [email protected] 01 53 45 17 13 1 © Voradech Triniti JAEHYUCK CHOI À travers leurs œuvres, ces quatre compositeurs racontent les années d’apprentissage, l’attachement aux traditions, à leur pays d’origine, tout en s’interrogeant sur la société, en UNSUK CHIN Asie, en Europe ou aux États-Unis, où ils créent avec liberté et invention. MIROSLAV SRNKA Overheating a été composé par Miroslav Srnka à l’occasion du centenaire du Los Angeles Philharmonic en 2018. Il y est question de « surchauffe » climatique ou sociale dans cette ENNO POPPE mégapole. Le compositeur nous rappelle que 2018 marque aussi le centenaire de la République tchécoslovaque, son pays Jaehyuck Choi : Concerto « Nocturne III », pour clarinette et ensemble – natal. Création mondiale de la version pour ensemble Compositeur, chef d’orchestre, directeur artistique de Unsuk Chin : Graffiti, pour orchestre de chambre l’Ensemble Blank, Jaehyuck Choi a composé Nocturne III pour le Concours de composition de Genève où il a remporté le Miroslav Srnka : Overheating, pour ensemble – Création française Premier Prix. Élève d’Unsuk Chin en Corée du Sud puis de Matthias Pintscher à la Juilliard School de New York, il a ensuite Enno Poppe : Œuvre nouvelle, pour ensemble, 2020 – Création française déployé l’œuvre pour l’Ensemble intercontemporain dont le Ensemble intercontemporain soliste, Jerôme Comte, la décrit ainsi : « Nocturne III est très Matthias Pintscher, direction poétique, avec des mélodies aux lignes épurées, élégantes, Jérôme Comte, clarinette mais aussi des moments de grande puissance.