Le Vme Centenaire De L'église De Leysin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
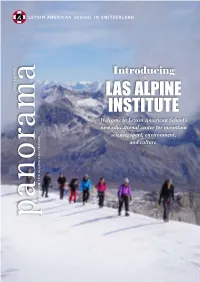
LAS Alpine Institute Cresting the Final the Dreaded Extended Learning Dr
LEYSIN AMERICAN SCHOOL IN SWITZERLAND Introducing THE 2016 EDITION 2016 LAS ALPINE INSTITUTE Welcome to Leysin American School’s new educational center for mountain science, sport, environment, and culture. A MAGAZINE FOR ALUMNI AND FRIENDS panorama LEYSIN AMERICAN SCHOOL IN SWITZERLAND Today, for a summer to Tomorrow remember YOUR GIFT TO THE LAS ANNUAL FUND, combined with those of other alumni, families & friends, ensures that we can continue to develop innovative, compassionate, and responsible citizens Alpine Adventure (ages 7-11) of the world. Alpine Exploration (ages 12-14) Alpine Challenge (ages 15-18) THE LAS ANNUAL FUND HELPS: • Support student scholarships and financial aid making LAS more diverse • Recruit, retain, and provide professional development for our world-class faculty • Continue to improve and upgrade our facilities and technology • Expand and enhance our wide range of academic, arts, athletics, and residential programs. Classes Excursions Cultural Tours Switzerland International Friends Morning classes in a Weekend excursions Students choose Switzerland offers Students share their variety of subjects to various a European country safety, security, and cultures local attractions to visit for one week natural beauty and lifestyles Please visit www.las.ch/alumni/giving to learn more about making a gift today! + 41 24 493 4888 | [email protected] | www.las.ch/summer 2 panorama | 2016 30 20 panorama Editors Emma Dixon, John Harlin III ‘14P, Benjamin Smith, Anthony Leutenegger Graphic Design Brittany Free Contributors Dr. L. Ira Bigelow ‘12P, ’13P, ‘15P, Mike Brinkmeyer, Alex Flynn-Padick, Paul Fomalont, John Harlin III ‘14P, Will Johnson, Mark Kolman, LAS Arts Team 49 (R. Allen Babcock, Kelly Deklinski, Keegan Luttrell, Brian Rusher), Anthony Leutenegger, Dr. -

Academic Years
LEYSIN AMERICAN SCHOOL IN SWITZERLAND Academic Years 2020-2022 EXTRAORDINARY EDUCATORS Our educators’ teaching methods are informed by years of research, education, and experience, allowing them to provide your child with high-quality, innovative learning opportunities. TOP UNIVERSITY ADMISSIONS We take pride not only in educating strong students but also attracting the attention of strong universities. The LAS University Advising Office plays a key role in our students’ successes, providing them with active guidance throughout their time at LAS. A CARING COMMUNITY LAS is a diverse, tight-knit community in which staff members are always on hand to provide students with care and guidance as they navigate the responsibilities and challenges that come with young adulthood. A HOME AWAY FROM HOME From LAS to post-graduation we provide the foundation and resources for students, parents, and alumni to stay connected and maintain lifelong friendships. LIVING OUR MISSION STATEMENT BY Developing innovative, compassionate, and responsible citizens of the world. A PASSION FOR LEARNING We help students uncover their passion by creating exciting ways for them to select Fred and Sigrid Ott had a vision—a school where students from around the world could reach their academic and engage with the material they are being taught—this includes hands-on learning, and personal potential in a beautiful, secure location, and become ready to face the world’s challenges as true individualized academic schedules, and opportunities for immersive travel. “citizens of the world.” Since 2005, LAS has been a non-profit philanthropic organization with the school’s leadership provided by the Ott family, now in its third generation. -

Academic Profile 2019-2020
Academic Profile 2019-2020 Leysin American School LAS Quick Info Chemin de La Source 3 1854 Leysin, Switzerland Reception: + 41 24 493 4888 EST. 1961 [email protected] | www.las.ch LAS is majority-owned by the Foundation for the Advancement of International Education, a non-profit organization overseen by the Swiss University General Inquiries and Visits government. It is managed by the 3rd generation of the founding family. [email protected] LOCATION Head of School LAS is located in the Alpine village of Leysin in the French-speaking region of Dr. Marc-Frédéric Ott, Ed.D. Switzerland, about two hours from Geneva. Tel: +41 24 493 4802, [email protected] SCHOOL TYPE Dean of Academics We are a coeducational boarding university-preparatory school. Mrs. Sabina Lynch Tel: +41 24 493 4821, [email protected] ENROLLMENT Associate Dean of the 300 students, grades 7-12 + post graduate year, senior class of 62 students. Belle Époque Campus Mr. Chris Taylor ACCREDITATION Tel: + 41 24 493 4805, [email protected] NEASC, European Council of Independent Schools, ISO 9001 (first boarding school worldwide), IB Organization. Director of University Advising Mr. Robert Kostrzeski Tel: +41 24 493 4814, [email protected] ACADEMICS Four-year LAS diploma (US high school credential) and the International University Advisor Baccalaureate (IB) Programme give students eligibility to study at universities Ms. Dimple Patel worldwide. LAS offers summer school, a pre-high school for grades 7 and 8, Tel: +41 24 493 4815, [email protected] and an ELA program. University Advisor GRADUATION REQUIREMENTS Dr. Malia LeMond The school year consists of two semesters, beginning in mid-August Tel: +41 24 493 4816, [email protected] and concluding in early June. -

Panoramaa MAGAZINE for ALUMNI and FRIENDS Explore the Swiss Alps, Pursue Your Passion, and Make Lifelong International Friendships at LAS Summer!
2019 EDITION panoramaA MAGAZINE FOR ALUMNI AND FRIENDS Explore the Swiss Alps, pursue your passion, and make lifelong international friendships at LAS summer! Follow us @leysinamericanschool www.las.ch/summer 2 | Panorama Striving Toward Academic Excellence By: Dr. Marc-Frédéric Ott Head of School ear Alumni, Parents, and Friends, of the new assessment policy will include one grading scale from 1 to 7 as mandated by the International Baccalaureate Programme. Why The past and coming year are marked by a continuous goal has LAS decided to make this change? Research has demonstrated of achieving academic excellence at LAS. The changes that standards-based grading leads to improvement of student D include offering more flexibility in class scheduling academic achievement thanks to higher student motivation levels. (LAS Continuum of Education), the addition of the new LAS edge The implementation of this new assessment policy along with the Program, and an upgrade in our assessment policy. LAS Continuum of Education and the LAS edge Program will no doubt help LAS strive toward academic excellence. A few years ago we created three clearly distinct academic programs: Middle School for 7th and 8th graders, Preparatory Years for 9th and There are a few more changes I would like to share. As of summer 10th graders, and Diploma Years for 11th graders and seniors. While 2019, we have completed the full renovation of the Esplanade it has worked quite well, starting this 2019/20 school year, the LAS building. The dormitory for our youngest boys, which was previously Continuum of Education will be adding more flexibility in the Eden building, will be transferred to the Esplanade. -

Aigle Leysin–Aigle Sépey Diablerets. Tracé Ferroviaire Commun Pour La
AL-ASD – Etude du tracé ferroviaire commun pour la traversée d’Aigle 1000-100 Date : 06.08.2016 Aigle Leysin-Aigle Sépey Diablerets Tracé ferroviaire commun pour la traversée d’Aigle Analyse de variantes avec proposition élaborée pour le compte de l’Entente Aiglonne Ce document a été élaboré à compte d’auteur. Chaque exemplaire est numéroté et ne peut être reproduit, même partiellement, de quelque manière que ce soit, sans l’autorisation écrite de l’Entente Aiglonne Aigle, le 6 août 2016 Ont participé à l’élaboration de ce document: Philippe Bellwald Gérald Hadorn Alain Moret Christophe Barbezat AL-ASD – Etude du tracé ferroviaire commun pour la traversée d’Aigle 1000-100 Date : 06.08.2016 TABLE DES MATIERES SOMMAIRE ............................................................................................................................. 4 1. PREAMBULE ................................................................................................................... 6 2. BREF HISTORIQUE ......................................................................................................... 6 3. SITUATION ACTUELLE ................................................................................................... 7 4. AMELIORATIONS PREVUES .......................................................................................... 8 4.1 Extension de l’AL : Leysin-Feydey – nouvelle gare terminus à Leysin .......... 8 4.2 Suppression du rebroussement d’Aigle-Dépôt ................................................ 8 4.3 Augmentation de l’offre -

ADDITIONS Pour La Région Des Alpes, Et Spéeialement Le Bassin Sarinien
ADDITIONS pour la région des Alpes, et spéeialement le bassin Sarinien AU Catalogue de la Flore Vaudoise DE Durand et Pittier. (M) = notes fournies par M. Gust. Mayor. (Jt) = notes de M P. Jaquet. 2r. = zone rhodanienne. 3s. = zone sarinienne. Thalictrum minus L. 2r : Grands Rochers ; 3s : le Ta- bousset, rochers en aval du pont. Anemone ranunculoides L. 2r : Luan, Neyrevaux Ayerne et Folliaux 1500'". A. vernalis L. Sonchaux (M) 3s : Chàtillon et Vanil Noir, Ausannaz, de Corbeyrier aux Agites, Luan, les Avants. Ranunculus platanifolius L. Aï 2100m, Sonchaux (M). R. Thora L. 3s couloir sur le col de Chaude, sous le point 2104m et en face près du Plan d'Arenaz (M). R. auricomus L. Chesières, Ecovets, Pont de la Tine. R. acris L. Aï, Mayen, Meitreillaz, Orrnonts 1950m Lioson d'Argnaulaz 1940m. R. lanuginosus L. 3s vallée de l'Etivaz et de l'Hon- grin- R. nemorosus D. C. var aureus Schi, arête entre Aï et Mayen 2142™. Trollius europaeus L. Truex 2100m arête entre Aï et Mayen 2142m la Dix 2200m. — 117 - Aquilegia vulgaris L AC. jusqu'à 1600m et monte jusqu'à 2100m entre Aï et Mayens. ! Delphinium elatum L. 3s : Pied des Bimis sur le cha let de la Verda (Jl). Aconitum Napellus L. altitudes extrêmes : Scie de Leysin U80m, ce. sommet de Chàtillon 2481m et de la Paraz 2452m var glacialis Rchb. A. variegatum L. Creux de Champ; — 3s: ce. gor ges du Tabousset. Corydalis fabacea Pers. Tompey, Neyrevaux, Gros Ayerne — 3s : sur l'alpe Merzère en montant aux Por tes de Savigny (J4). -

MXT FINAL ANG.Indd
ROADBOOK FOR RUNNERS Edition 2017 0''*$*"-.0/53&6953"*-'&45*7"- -*.*5&%&%*5*0/#:$0.13&441035 WE WILL ROCK YOU! AND WE’LL ROCK THE TRAILS TOO! The Montreux Trail Festival – Tour of the their playground with its breathtaking but as the kilometers go by, with a masterful Vaud Alps, or the unlikely encounter of somewhat unsung views. finish at the top of the Dent de Jaman. trail running, Freddie Mercury, traditional alpine pastures and the largest lake in With 6 offered courses, there’s something Trail running represents values that we Western Europe, where music is the for everyone. Two ultra courses, like and share: solidarity, generosity and guiding theme of the race. Symbolized by sponsored by our partner Compressport, sharing. This first edition of the Montreux the legendary Queen singer, whose statue will allow you to discover and roam the Trail Festival enables us to support will mark the arrival of participants, the Vaud Alps. In addition to that comes a a humanitarian project in Burma, in Montreux Trail Festival is a unique event unique experience, the Freddie’s Night15, collaboration with the Mercury Phoenix where discovery won’t be limited to the presented by our partner Columbia. This Trust, which was created by the surviving trails! festive race features a finish at night, members of Queen. You can contribute to with headlamps, in the lush Gorges du this project too! The idea of this new meeting first Chauderon. originated in the mind of Diego Pazos We thank you for your trust and wish you “Zpeedy”, winner of the Mont-Blanc 80K There’s also the Leysin30, which offers a an unforgettable experience! and of the Eiger Trail among others, as perfect combination in line with current well as in the minds of his friends, all trail running trends, as well as the The MXteam. -
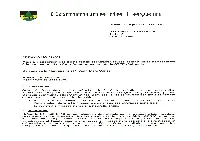
Preavis-02.2021.Pdf
Commune de Leysin ^^ Leysin, le 18 janvier 2021/JMU AU CONSEIL COMMUNAL DE ET A 1854LEYSIN PREAVIS N0 02/2021 Mise à disposition des biens-fonds et infrastructures communales nécessaires à la réalisation et au futur fonctionnement de la STEP régionale Délégué de la Municipalité : M. Jean-Marc Udriot Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 1. Préambule Suite à l'acceptation des préavis relatifs à la création d'une association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région d'Aigle (AERA), par les Conseils communaux des Communes membres, le projet poursuit son développement et une nouvelle étape doit être franchie : • la mise à disposition des bien-fonds nécessaires à la construction et l'exploitation de la STEP régionale ainsi que ses ouvrages annexes ; • le transfert d'infrastructures à la nouvelle entité. 2. Historique Créée le 21 août 2019 après validation des statuts par le Conseil d'Etat vaudois, l'Association pour l'épuration des eaux usées de la région d'Aigle (AERA), regroupe les communes d'Aigle, Ollon, Leysin, Yvorne et Corbeyrier. Ce projet commun vise la construction et l'exploitation d'une nouvelle infrastructure régionale d'évacuation et d'épuration des eaux usées, sur le site d'Aigle. Cette installation d'envergure doit remplacer les stations d'épuration des Communes d'Ollon, Leysin etYvorne. -2- 3. Contexte actuel L'AERA a lancé les appels d'offres pour le choix des mandataires qui réaliseront les études pour ce projet. Pour mémoire, celui-ci se compose de quatre volets : • La construction d'une nouvelle -

Swiss Schools and Lifestyle Guide
Swiss SCHOOL & LIFESTYLE GUIDE A guide to the educational system in Switzerland and the best locations to live, created in partnership with Carfax Consultants. Welcome letter Switzerland remains one of the world’s most revered and sought after locations and it is no surprise as we explore on page 6; the country is consistently rated strongly for its high standards of living, excellent education, quality of life, a robust and stable economy and favourably low levels of tax, crime and poverty. Private individuals who are drawn by this safe and dependable environment regularly approach Knight Frank to seek our recommendations and guidance from over 12 years working across this market. The Knight Frank Swiss Schools and Lifestyle Guide was developed alongside Carfax Consultants and the collective knowledge from our network of over 13 offices spread strategically throughout the country to provide a comprehensive overview of the top private schools, plus a guide to some of the various lifestyle options available and information on how to purchase. The guide considers both clients seeking permanent residence (see pages 4 & 5) as well as those who desire a holiday home or just to invest in Swiss real estate as a non-resident (see page 12). The Benefits of a Swiss Education (see page 14) offers a unique insight by Carfax Consultants for those not so familiar with the variety of options on offer. The experience that Carfax can provide to help clients place their children within the right school is paramount to a successful relocation. We hope you find the information useful and if you have any questions, or wish to find out more about how our team can help you find your dream home, with great educational options close by, please get in touch. -

Leysin American School Board Leadership
Leysin American Contents School Board Leadership 6 The Times We’ve Lived Through Marc-Frédéric Ott Letter from Head of School Managing Director, Dr. Marc-Frédéric Ott Head of School Christoph Ott 8 The Lessons We’ve Learned Managing Director, Head of Operations Letter from Head of Operations Dr. Christoph Ott LAS School Board Stefanie Ott P ’18 10 LAS Responds to the COVID-19 Pandemic Chair Anthony Leutenegger Wolfgang Meusburger P ’02, ’05 Vice-Chair Marc-Frédéric Ott Managing Director, Head of School Christoph Ott Managing Director, At the start of the pandemic Head of Operations it was apparent that the LAS Jeff Paulsen family would spring into Pascal Stefani P ’18 action and do their part LAS School Honorary Board to help heal the world. Steven Ott 10 Chair Maurizio Fabbri Vice-Chair LAS US Educational Fund for the Future Board Explore the Swiss On the Cover Bill Carney ’69 Besart Copa ’16 Alps, pursue your Jorge Flores II ’94 Clayton Gentry ’93 passion, and Kira Johnson ’89 C. Ryan Joyce School Representative make lifelong Donald Kennedy ’91, P ’22 Brian Knapp ’96 international Peggy Love ’66 Jakub Mardusinski ’10 friendships at LAS Gregory Marks ’11 Emma Miller ’07 Anna Rubio ’91 summer! Anupy Singla S ’18, ’19 John Sutton ’98 Chair Follow us @leysinamericanschool Francis Yasharian For information on LAS leadership opportunities, please contact C. Ryan Joyce, Director of Advancement, Maja and Kera, two of our newest LAS alumnas. at [email protected]. www.las.ch/summer Leysin American School | 3 CONTENTS panorama 17 The Class of 2020 2020 Edition Michelle Starke 24 LAS Faculty and Staff Editors Rise to the Occasion C. -

Impôts Communaux 2017
En % imp. cant. Impôt Droits de mutation 1 base foncier Succ. et donations fond. et capital, foncier soc. 2017 bénéf., registre etc. fixe fortune, affecté s/immeubles ascendante descendante immatric. parents total ‐ cessions, jusqu'en en non étrangers spécial personnel compl. revenu, non directe directe collatérale cent ‐ Pour spécial Impôt Immeubles Constr. Impôt Ventes, Ligne Ligne Ligne Entre Impôt Chiens Adopté Valable Impôt 1 2 1+2 ‰ ‰ Fr. ct. ct. ct. ct. ct. ct. Fr. DISTRICT D'AIGLE Aigle 2016 2021 67.5 67.5 1.20 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Bex 2016 2018 71.0 ‐ 71.0 1.25 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Chessel 2016 2017 74.0 ‐ 74.0 1.00 0.50 ‐ 50 50 ‐ 50 100 50 100.‐ Corbeyrier 2016 2017 70.0 ‐ 70.0 1.50 0.50 ‐ 50 100 50 100 100 50 1.‐p/Fr Gryon 2016 2017 75.0 ‐ 75.0 1.50 0.50 ‐ 50 50 50 50 100 50 100.‐ Lavey‐Morcles 2016 2018 71.0 ‐ 71.0 1.30 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Leysin 2016 2017 78.0 ‐ 78.0 1.50 0.50 ‐ 50 50 ‐ 100 100 50 100.‐ Noville 2016 2017 78.5 ‐ 78.5 1.50 0.50 ‐ 50 ‐‐50 100 50 100.‐ Ollon 2016 2017 68.0 ‐ 68.0 1.30 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Ormont‐Dessous 2016 2018 78.5 ‐ 78.5 1.50 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Ormont‐Dessus 2016 2017 76.0 ‐ 76.0 1.50 0.50 ‐ 50 50 ‐ 100 100 50 100.‐ Rennaz 2016 2017 67.5 ‐ 67.5 1.00 0.50 ‐ 50 50 ‐ 50 100 50 100.‐ Roche 2016 2017 68.0 ‐ 68.0 1.00 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 125.‐ Villeneuve 2016 2017 69.0 ‐ 69.0 1.00 0.50 ‐ 50 100 50 100 100 50 115.‐ Yvorne 2016 2017 71.5 ‐ 71.5 1.50 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ DISTRICT DE LA BROYE‐VULLY Avenches 2016 2017 -

SWISS REVIEW the Magazine for the Swiss Abroad April 2020
SWISS REVIEW The magazine for the Swiss Abroad April 2020 The return of the wolf – why not everyone is happy Whither e-voting? The Federal Councillor gives us his take Leysin – the Swiss mountain village where foreign nationals outnumber locals The publisher of “Swiss Review” is the Organisation of the Swiss Abroad (OSA). The best way to experience Switzerland. Bernina at Lago Bianco Express Simply beautiful, simply comfortable: Enjoy easy-going travel to any place in Switzerland – by train, bus and boat. Thanks to the world’s densest traffic networkMySwitzerland.com/swisstravelsystem 200210 STS Add ASO EN-DE-FR-IT-ES.indd 2 11.02.20 14:22 Contents Editorial 3 How does the story with the wolf go? 4 Mailbag “My, what a big mouth you have, grandmother.” “All the better to eat you with!” The wolf dressed as the 6 Focus grandmother had scarcely finished speaking when he The wolf is back in Switzerland – jumped from the bed with a single leap and ate up and likely to stay poor Little Red Riding Hood. As soon as the wolf had satisfied his appetite, he climbed back into bed, fell 10 Politics asleep and began to snore very loudly. We all know SVP initiative puts Swiss-EU relations how Little Red Riding Hood met her gruesome end. to the test Never trust the big bad wolf was the message we all took to heart as young Simonetta Sommaruga, the garden- children. loving president of the Confederation Fairy tale will flirt with reality in May, when Switzerland decides whether or not the wolf is still big and bad.