Plan Local D'urbanisme
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
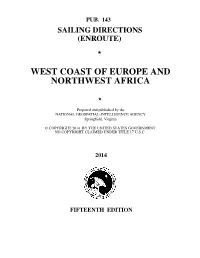
PUB. 143 Sailing Directions (Enroute)
PUB. 143 SAILING DIRECTIONS (ENROUTE) ★ WEST COAST OF EUROPE AND NORTHWEST AFRICA ★ Prepared and published by the NATIONAL GEOSPATIAL-INTELLIGENCE AGENCY Springfield, Virginia © COPYRIGHT 2014 BY THE UNITED STATES GOVERNMENT NO COPYRIGHT CLAIMED UNDER TITLE 17 U.S.C. 2014 FIFTEENTH EDITION For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office Internet: http://bookstore.gpo.gov Phone: toll free (866) 512-1800; DC area (202) 512-1800 Fax: (202) 512-2250 Mail Stop: SSOP, Washington, DC 20402-0001 II Preface date of the publication shown above. Important information to amend material in the publication is updated as needed and 0.0 Pub. 143, Sailing Directions (Enroute) West Coast of Europe available as a downloadable corrected publication from the and Northwest Africa, Fifteenth Edition, 2014 is issued for use NGA Maritime Domain web site. in conjunction with Pub. 140, Sailing Directions (Planning Guide) North Atlantic Ocean and Adjacent Seas. Companion 0.0NGA Maritime Domain Website volumes are Pubs. 141, 142, 145, 146, 147, and 148. http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal 0.0 Digital Nautical Charts 1 and 8 provide electronic chart 0.0 coverage for the area covered by this publication. 0.0 Courses.—Courses are true, and are expressed in the same 0.0 This publication has been corrected to 4 October 2014, manner as bearings. The directives “steer” and “make good” a including Notice to Mariners No. 40 of 2014. Subsequent course mean, without exception, to proceed from a point of or- updates have corrected this publication to 24 September 2016, igin along a track having the identical meridianal angle as the including Notice to Mariners No. -

Télécharger Le Calendrier 2021
Calendrier des manifestations nautiques 2021 Manifestations Pour qui ? Lieu Dates PM (LR) Coef. Contact La remontée de la Du lundi 24 au 16 H 11 87 Association « les lasses Charente dimanche 30 mai 20 H 54 77 marennaises » Du mercredi 9 au 17 H 02 71 Association J Semaine du Nautisme La Rochelle dimanche 13 juin 19 H 08 69 Semainedunautisme U Ile d’Aix Tour de Du samedi 26 au 19 H 03 93 Association « les lasses I l’Ile d’Aix dimanche 27 juin 19 H 50 88 marennaises » N Rallye d’Ars Ars en Ré Le samedi 26 juin 19 h 03 93 A.Babaud Rochefort, La 16 h 18 57 Tour de Charente Du mercredi 7 juillet Rochelle, St Martin, 17 h 58 72 Département Maritime à la Voile au samedi 10 juillet St Denis, Royan Baptême de Yannick J 17 H 58 72 Association « les lasses Chantal et 25 ans des Bourcefranc Samedi 10 juillet marennaises » U Lasses Marennaises I Un port sympa fait la fête Jard / Mer Mardi 13 juillet 19 H 45 76 G. Beranger L Du vendredi 23 au Douarnenez Association « Temps fête » Les fêtes maritimes dimanche 25 juillet L Association Le Château d’Oléron Vendredi 23 juillet 17 H 23 85 E Chantier Léglise PMO La Route de l’Huître Assoc. Les Lasses Marennes Samedi 24 juillet 18 H 09 91 T marennaises Dimanche 25 juillet Fouras Cercle nautique de Fouras (les 70 ans du CNF) 18 H 50 93 Sur le lac de Vassivière.. Vassivière Du 30 juillet au 1er août Maurice Pécout 17 H 46 77 Association « Flotille en Rdv de l’Ile de Ré La Flotte en Ré Dimanche 8 aout Pertuis » - Musée du Platin Société des Régates Grande Parade SRST Saint-Trojan Lundi 9 août 18 H 19 84 de St Trojan Manifestations Pour qui ? Lieu Dates PM (LR) Coef. -

Chap5 Synthese V03-11
CHAPITRE 5 SYNTHESE DE L’EVENEMENT XYNTHIA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA CHARENTE -MARITIME ÉLABORATION D ’UN DOCUMENT « ÉLEMENTS DE MEMOIRE ET RETOUR D ’EXPERIENCE » DE L ’EVENEMENT XYNTHIA La zone submergée est globalement moins importante que pour la tempête de 1999, de Saint Sorlin de Conac à Talmont sur Gironde. Plus en aval, seule la commune de Meschers sur Gironde (secteur du port) a subi des submersions plus importantes que celles identifiées en 1999. Les inondations sont principalement SYNTHESE dues à la remontée d’eau dans les chenaux et les ports, ainsi que par la submersion des digues, en DE L ’EVENEMENT XYNTHIA mauvais état. A noter d’autre part que les communes situées en aval de l’Estuaire, de Saint Georges de Didonne à les Mathes ont été très peu soumises à des inondations et/ou submersion lors de la tempête Xynthia. Peu de zones submergées ont en effet été relevées. Ces communes ont cependant été touchées ponctuellement par quelques entrées d’eau. C’est le cas notamment de la commune de Royan où des renseignements L’évènement météorologique Xynthia a frappé les côtes de la Charente-Maritime dans la nuit du 27 au semblent indiquer que le secteur de la Tache Verte a été inondé par les débordements des chenaux. Ces 28 février 2010. D’une violence exceptionnelle, la tempête Xynthia a fortement endommagé le littoral de la inondations localisées ne peuvent cependant pas être rattachées à la submersion et n’ont pas été Charente-Maritime, sur un territoire d’environ 80 communes : douze personnes ont perdu la vie cartographiées et identifiées comme zone submergée par cet évènement. -

Liste Des Assistants Maternels
LISTE DES ASSISTANTS MATERNELS NOM PRENOM ADRESSE CP COMMUNE TELEPHONE ALLARD Emmanuelle 12 RUE DU CHILOUP 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 09.84.09.26.72 BARBOSA DA SILVA Eugénia 6 FIEF DES DAMES 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 06.70.63.14.29 BAUDOUIN Roselyne 16 RUE DE LA GRANDE RAISE 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 06.21.16.74.78 BLONDIN Corinne 29 BIS AVENUE DES MARRONNIERS 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 06.64.90.17.32 BONIN Amélie 23 RUE DES CIGOGNES 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 06.70.12.12.14 BUISSON Lydia 60 RUE DE LA RIVIÈRE 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 06.87.22.28.55 BURGAUD Veronique 40 RUE DE L'ANGLE 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 06.15.55.25.35 CAMPOS DA SILVA Rachel 29 TER RUE DE L'AUNIS 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 06.12.62.15.07 CHASTENET Valérie 21 RUE DU CHILOUP 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 05.46.29.16.69 CORRE Marie-Françoise 4 IMPASSE DES ECUREUILS 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 06.76.67.82.00 DANET Valérie 39 BIS RUE DE FRACE 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 09.83.38.67.75 DARDANT Martine 11 AVENUE DE LA GARE 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 06.88.27.25.80 DAVIAUD Lydia 49 RUE DU VIEUX FIEF 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 06.19.21.33.30 DELBARRE Claire 8 RUE DES COURLIS 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 06.26.45.71.60 DELOT Isabelle 1 RUE DU VIEUX ROSIER 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 06.64.44.46.62 DESCHODT Patricia 7 RUE DE LA PILARDERIE 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 05.46.35.00.62 DOUCET Marie-Laure 8 RUE DES TILLEULS 17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 05.46.01.98.42 1/119 LISTE DES ASSISTANTS MATERNELS NOM PRENOM ADRESSE CP COMMUNE TELEPHONE FORTE Annie 8 IMPASSE DU SOLEIL LEVANT 17290 -

Horaires Privatisation
Barbâtre Î Pointe de la Fosse le e de No Fromentine irmoutier La Barre-de-Monts La Roche-sur-Yon Port Joinville St-Gilles-Croix-de-Vie Les Sables d’Olonne Î le d’Yeu La Tranche-sur-Mer La Rochelle HORAIRES Î le Retrouvez les horaires de départ NOUVEAUTÉ 2019 de Ré sur notre site internet : Île d www.inter-iles-catamarans.com ’A Fort Boyard A Location de vélos i x x St-Pierre-d’Oléron 2 Melody en attente Acheminement avec la barge Office de Tourisme Parkings payants : Roue Libre - Port de plaisance Parking du chenal (Port à sec) PRIVATISATION yclables 1 2 Boyardville Plages, forêt, Rochefort pistes c Privatisez Melody pour vos événements Îl professionnels ou privés : soirées AU DÉPART e d’ ’Oléron d’entreprises, incentives, séminaires, DE LLE DOLÉRON Marennes afterworks, anniversaires, vins d’honneur, enterrements de vie de jeune fille - BOYARDVILLE - ou garçon... Royan Minigolf 1 FORT BOYARD EN Estu BOYARDVILLE aire MAXI-CATAMARAN de la Dolus G i d’Infanterie Régiment r e on d Vitrezay vélos e Vitrezay Location Quai du 158 du Quai LA SORTIE Un cadeau atypique pour une DU CAPITAINE expérience unique ! St-Georges Offrez un cadeau original à ceux que vous COUCHER aimez : une sortie à la voile à bord d’un DE SOLEIL catamaran d’exception ! Des départs sont également possibles depuis La Rochelle et l’Île de Ré (Saint- Martin-de-Ré) à bord du second maxi Catamaran Harmony ! Plus d’informations : www.inter-iles-catamarans.com : : 05 46 50 18 98 Informations, horaires de départs : et réservations : Conditions générales de vente disponibles sur -

Directive Inondations Septembre 2014 Bassin Adour - Garonne
Version 2,1 Et Directive inondations Septembre 2014 Bassin Adour - Garonne Rapport de présentation de la cartographie du risque de submersion marine sur le Littoral Charentais-Maritime Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Poitou-Charentes 2/190 Table des matières 1 - Introduction.....................................................................................................................5 2 - Présentation générale des sous-bassins du littoral Atlantique................................7 2-1 Le sous-bassin de la Charente et le sous-bassin littoral........................................................8 2-2 Le TRI Littoral Charentais....................................................................................................10 3 - Caractérisation des submersions marines sur le secteur du Littoral Charentais- Maritime...............................................................................................................................14 3-1 La submersion marine.........................................................................................................14 3-2 Les submersions marine sur le secteur du Littoral Charentais-Maritime..............................15 4 - Historique des submersions marines sur le secteur du Littoral Charentais- Maritime...............................................................................................................................16 5 - Études sur les inondations dans le secteur du TRI Littoral Charentais-Maritime.20 6 - Qualification -

David CHIONNE
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | UMR 8591 Laboratoire de Géographie Physique | CNRS École Doctorale de Géographie de Paris | Avec le soutien de la Fondation de France THÈSE pour l’obtention du grade de docteur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne présentée et soutenue publiquement le 15 janvier 2018 par David CHIONNE CONTRIBUTIONS GÉOGRAPHIQUES À LA DÉFINITION D’UNE CULTURE DU RISQUE EN MILIEU LITTORAL : LE CAS DES RÉSIDENTS DE L’ÎLE D’OLÉRON (CHARENTE-M ARITIME, FRANCE) Lydie GOELDNER-GIANELLA, Professeur, Université Paris 1 (directeur) Michel DESSE, Professeur, Université de Nantes (rapporteur) Catherine M EUR-FÉREC, Professeur, Université de Bretagne Occidentale (rapporteur) Virginie DUVAT, Professeur, Université de La Rochelle (examinateur) Hervé FLANQUART, Professeur, Université du Littoral Côte d’Opale (examinateur) Denis M ERCIER,Professeur, Université Paris-Sorbonne (examinateur) Patrick M OQUAY, Professeur, École Nationale Supérieure de Paysage (examinateur) Photo couverture : Christian WACRENIER, 2016, « Ville de rêveurs et d’architectes de l’inutile » (Saint-Denis d’Oléron) Résumé/Abstract Contributions géographiques à la définition d’une culture du risque en milieu littoral : le cas des résidents de l’île d’Oléron (Charente-Maritime, France) Le point de départ de cette thèse a été l’expression de « culture du risque » telle qu’elle a été employée par l’État suite aux évènements liés à la tempête Xynthia en 2010. À travers celle-ci, ce dernier rend compte d’un manque de connaissances et de comportements inadaptés, caractérisant les populations vis-à-vis des aléas côtiers. Parallèlement, il aiche sa volonté de favoriser leur sensibilisation vis-à-vis de ces problématiques. Cependant, nous avons constaté qu’un dispositif législatif de communication et de sensibilisation existe depuis les années 1980, mais que son bilan paraît toujours mitigé. -

2014-03 ZDS St Georges Et St Pierre Étude
DREAL Collection des études Poitou-Charentes L’essentiel n° 2014-03 juillet 2014 Zones de Solidarité en Charente-Maritime Étude des sites de Saint-Georges et Saint-Pierre-d’Oléron après déconstruction pour leur aménagement environnemental Directrice de publication Anne-Emmanuelle Ouvrard Service commanditaire de l’étude DREAL Poitou-Charentes - Service énergie, climat, logement, aménagement illustration première et quatrième de couverture source du fond cartographique (www.geoportail.fr) 1, Chêne Fort - 89120 Chêne Arnoult 12 rue du Maréchal Foch 56410 Etel 11 rue Hoche 49100 Angers 10 rue des Feuillantines 75005 Paris La Barre Théberge 44 440 Trans Sur Erdre SOMMAIRE LE SITE DE BOYARDVILLE - LA PERROTINE 5 Un hameau littoral sur le chenal Qualité du paysage, attrait touristique et saisonnalité Aspects socio-économiques Les projets connexes Vision locale/ vision d’ensemble ETAT DES LIEUX DES ENJEUX JURIDIQUES 7 EVOLUTION DU PAYSAGE LITTORAL 9 Au XVIIIe siècle Au XIXe siècle Au cours du XXe siècle Les évènements météo-marins sévères 17 BOYARDVILLE - SAINT GEORGES D’OLÉRON 19 Introduction Les Zones de Solidarité L’impact paysager des déconstructions LA PERROTINE - SAINT PIERRE D’OLÉRON 25 Introduction Les Zones de Solidarité L’impact paysager des déconstructions Les projets et idées émises par les communes de St Pierre et St Georges d’Oléron, et par les associations 25 Projet-Processus - Objectifs de projet - Enjeux d’aménagement communs à toute zone de solidarité 27 Carte des paysages après déconstruction 29 Carte des grandes orientations -

Fort Boyard : Un Chef-D'œuvre Arrivé Trop Tard
25 23 22 26 27 Voyage au coe ur du patrimoine 24 28 La rade du port de Rochefort et ses défenses : Fort Boyard dont la mission était d’empêcher les vaisseaux ennemis de pénétrer dans la rade ; en effet, les canons des îles d’Aix et d’Oléron ne pouvaient alors atteindre le milieu du pertuis d’Antioche . Flotte Française . Arsenal de Rochefort . Boyardville . e … Pour 28 ans : en 1837, une commission d’un remorqueur à vapeur pour tirer Projeté dès la construction de Rochefort au XVII siècle, Fort Boyard ne s’élèvera au-dessus des flots que bien péniblement, constate que l’enrochement ne s’est les gabarres , mais il faudra tout de après un chantier à péripéties qui prendra une bonne partie du XIXe siècle. Trop tard pour remplir la mission qui lui avait été confiée : enfoncé que d’un mètre et qu’il semble même attendre 1848 pour qu’ils puissent défendre la rade de Rochefort contre les Anglais. stabilisé. La France est en paix et s’enrichit, remettre les assises terminées, deux mètres le ministère de la Marine voit grand et un au-dessus du niveau des grandes marées. ente : « Fort Boyard, sis en tard même, des « forts crampons de fer » 21 nouveau projet, plus imposant, est approuvé Reste à construire un fort… parfaitement mer, entre les îles d’Aix et sur le pourtour. Mais, la masse de rochers en 1841. Pour l’assise, elle sera constituée inutile. D’abord parce que la France est 3 d’alvéoles de ciment remplies de chaux , d’Oléron…». -

Carte Qualité Des Eaux De Baignades 2018 356,39 Ko
EDITION Qualité en Charente- 2018 * des eaux de baignade Maritime Classement 2017 Connaître la qualité des eaux de baignade en eau de mer ou en eau douce est un moyen pour prévenir tout 98 sites de baignade contrôlés Retrouvez les dernières analyses sur : risque pour la santé des baigneurs. Le suivi régulier de 98% des sites conformes en 2017 baignades.sante.gouv.fr la qualité des eaux de baignade est assuré par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. * Classement établi sur la base des résultats d’analyse des paramètres Escherichia Coli et entérocoques intestinaux obtenus durant les saisons estivales 2014 à 2017 - Directive européenne n°2006/7/CEE Plage de la Conche Plage du Gros Jonc Plage des Pas des Baleines Plage de la Loge des Gaudins Plage de Couny Plage de Trousse Chemise Plage du Grouin Plage de la Cible Plage de l'Arnerault NIVEAU DE CONTAMINATION ST-CLÉMENT- LES PORTES-EN-RÉ LOIX ST-MARTIN- LA FLOTTE EN CYANOBACTÉRIES DES-BALEINES DE-RÉ Satisfaisant Moyen, contrôle renforcé ARS-EN-RÉ L'HOUMEAU La Plage Plage de la Grange Plage de Chef-de-Baie Excessif, fermeture Plage de la Concurrence temporaire en LA ROCHELLE cours de saison Plage du Peu-Bernard Plage des Minimes Plage du Peu-Ragot LA COUARDE- Plage des Prises SUR-MER Non mesuré Plage du Platin Nord STE-MARIE- AYTRÉ Plage du Platin Sud Plage du Petit Sergent LE BOIS- Plage des Gollandières DE-RÉ RIVEDOUX- Plage des Gros Joncs PLAGE-EN-RÉ PLAGE Plage de la Platerre Plage des Grenettes Plage nord ANGOULINS-SUR-MER Plage de Montamer Plage sud de La Redoute Plage de la -

Le Plan Global De Déplacements (P.G.D.) Consiste À Définir Collectivement Une Stratégie D’Organisation Des Transports Sur Le Territoire De L’Ile D’Oléron
Communauté de Commune de l’île d’Oléron Plan Global de Déplacements de l'île d'Oléron Septembre 2012 Sommaire PREAMBULE ............................................................................................................5 Qu’est ce qu’un Plan Global de Déplacements ...........................................................5 Les objectifs visés......................................................................................................................5 Le PGD complète le SCOT........................................................................................................5 Le périmètre et l’horizon d’étude ...............................................................................................5 La prise en compte des attentes de chacun : la concertation....................................6 Les intervenants.........................................................................................................................6 Les temps forts ..........................................................................................................................6 CHAPITRE 1 - DIAGNOSTIC ....................................................................................7 Le territoire et ses particularités...................................................................................7 La saisonnalité ...........................................................................................................................7 La population .............................................................................................................................7 -

Fort Boyard Est Une Fortification Située Entre L'île D'aix, L'île D'oléron Et Le
Fort Boyard est une fortification située entre l'île d'Aix, l'île d'Oléron et le pertuis d'Antioche, appartenant à l'archipel charentais et rattachée à la commune de l'Ile-d ‘Aix, dans le département de la Charente-Maritime. Donc, en ce dimanche 2 juin, relativement ensoleillé, nous sommes 12 pirates à partir, à l’abordage de ce fort. Il y avait là, Capitaine Joël et ses 11 Flibustiers, Chantal, Bruno, Wolfi, Michel, Brigitte, Jean Claude, Pascale, Jean Pierre, Marie Line, Patricia, Pierre Yves. Objectif : rejoindre notre Frégate pirate, au port de la Rochelle. Un premier regroupement eut lieu sur Bordeaux, où nous accueillîmes Patricia et Pierre Yves, nos deux jeunes sympathiques flibustiers, puis direction Mirambeau pour retrouver Chantal et Joël. Là, petite pause-café dans une taverne, puis départ pour le port de La Rochelle par la RN 137. Vers les midis, destination atteinte. Après avoir rangé nos destriers, direction notre Auberge. En passant par le port, notre Frégate était bien là et elle avait fière allure. Pascale, Jean Claude et Bruno étaient au rendez-vous pour notre déjeuner, l’équipage était au complet, « 12 flibustiers prêts à en découdre ». Après nous être remplis la panse, et ripaillé quelque peu, direction le port. Un peu d’attente pour embarquer, le temps de hisser notre pavillon du M.C.E au plus haut du mat. Larguez les amarres, hissez ho « Morbleu » Cap à l’ouest et voici notre Frégate qui glisse direction Fort Boyard, Pass partout s’impatiente. Dressées face à l'Atlantique, derrière nous, s’effacent les trois tours de La Rochelle qui sont les plus importants vestiges des fortifications maritimes médiévales.