World Bank Document
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
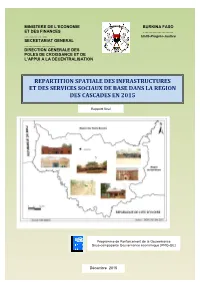
Repartition Spatiale Des Infrastructures Et Des Services Sociaux De Base Dans La Region Des Cascades En 2015
MINISTERE DE L’ECONOMIE BURKINA FASO ET DES FINANCES ………..………... …..……….... Unité-Progrès-Justice SECRETARIAT GENERAL ………..……….... DIRECTION GENERALE DES POLES DE CROISSANCE ET DE L’APPUI A LA DECENTRALISATION REPARTITION SPATIALE DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES SOCIAUX DE BASE DANS LA REGION DES CASCADES EN 2015 Rapport final Programme de Renforcement de la Gouvernance Sous-composante Gouvernance économique (PRG-GE) Décembre 2015 TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS ................................................................................................................... III LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS ............................................................................... IV RESUME .............................................................................................................................. VIII INTRODUCTION ..................................................................................................................... 1 PREMIERE PARTIE: CADRE GENERAL ................................................................................ 2 I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE ................................................................... 2 II- OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS ......................................................................... 3 III- METHODOLOGIE DE TRAVAIL ........................................................................................ 4 III-1- Collecte des données secondaires .................................................................................. 4 III-2- -

11.3. Zoning of Forest Reserves 11.3.1. Basic Idea of the Zoning
11.3. Zoning of Forest reserves 11.3.1. Basic idea of the Zoning The most important fact regarding zoning of the Gouandougou and Kongouko forest reserves in relation to the basic policies of the management plan for these forest reserves is that the creation of such village organizations as GGFs and a GGF Union as implementing bodies of the management plan will be unrealistic for some time to come. Accordingly, it will be essential for the administration/Forest Service to develop the basics for participatory forest reserve management in the future while conducting the management work (including educational activities and the control of illegal activities, i.e. law enforcement). In other words, the Forest Service should try to enhance the involvement of local villagers in the management of these forest reserves through the use of forest resources in the reserves. When full-scale participatory forest reserve management commences following the establishment of GGFs and a GGF Union in the future, it will be necessary to review the management plan in place, including the zoning plan, with reference to the situation in the Bounouna and Toumousséni forest reserves. Figure 11.2 shows the zoning plan for the Gouandougou forest reserve and Kongouko forest reserve respectively. These two forest reserves are endowed with relatively rich natural resources and the dependence and development pressure of residents of villages near these forest reserves are comparatively low. Accordingly, zones to promote the use of forest products by local villagers will be set up near the villages concerned to provide incentives for local villagers to conserve forest resources. -

Chapter9 Participatory Management Plan for Bounouna Forest Reserve
Chapter9 Participatory Management Plan for Bounouna Forest Reserve 9. Participatory Management Plan for Bounouna Forest Reserve 9.1. Policy of the Management Plan Objectives :Rehabilitation of forest resources and promotion of management by establishing GGFs in related villages Expected :Forest Service, GGFs in related villages, NGOs, sawmills, Stakeholders citizens of Banfora (Structures) Main Activities :Planting trees, agro-forestry, countermeasures against bush fire, supervision of illegal activities, creation of recreational forests Incentives for :A share of the revenues from fuel woods which will be produced communities in plantations, and from agricultural products produced in agro-forestry fields Since forest resources have already been degraded by bush fires and fuel wood collection in Bounouna Forest Reserve, the main objectives of this management plan is thus the “Rehabilitation of forest resources”. Considering the incentives for communities, creating plantations with fuel wood species and introducing agro-forestry could be main activities in the initial phase of the management plan, although several other countermeasures are possible. An institutional management will be established whereby some of the planted trees (fuel woods trees) are systematically cut after their maturity, and the benefits of those products (fuel woods) are shared for communities. The benefits of the produce from agro-forestry fields will be shared with community as well. Given those shares of benefits to communities as incentives, their concern on forest reserve will be heightened and their involvement in “forest activities” encouraged. Then, it is expected that local villagers will spontaneously join management/conservation activities, i.e. controlling bush fires in plantations, monitoring illegal cutting, and so on. -

Vrs - Burkina Faso
VRS - BURKINA FASO Ouagadougou, le 27/10/2012BAGASSIBALE STATISTIQUES DES BUREAUX DE VOTES PAR COMMUNES \ ARRONDISSEMENTS REGION BOUCLE DU MOUHOUN PROVINCE BALE COMMUNE BAGASSI Secteur/Village Emplacement Bureau de vote Inscrits ASSIO ASSIO II\ECOLE Bureau de vote 1 219 BADIE ECOLE Bureau de vote 1 177 BAGASSI ECOLE Bureau de vote 1 542 BAGASSI TINIEYIO\ECOLE Bureau de vote 1 470 BANDIO ECOLE Bureau de vote 1 253 BANOU ECOLE Bureau de vote 1 191 BASSOUAN ECOLE Bureau de vote 1 201 BOUNOU ECOLE1 Bureau de vote 1 246 BOUNOU ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 233 DOUSSI ECOLE B Bureau de vote 1 206 HAHO CENTRE\CENTRE ALPHABETISATION Bureau de vote 1 177 KAHIN ECOLE Bureau de vote 1 258 KAHO ECOLE Bureau de vote 1 273 KANA ECOLE Bureau de vote 1 269 KAYIO ECOLE Bureau de vote 1 220 KOUSSARO ECOLE Bureau de vote 1 305 MANA ECOLE Bureau de vote 1 495 MANA ECOLE Bureau de vote 2 264 MANZOULE HANGAR Bureau de vote 1 132 MOKO HANGAR Bureau de vote 1 308 NIAGA HANGAR Bureau de vote 1 128 NIAKONGO ECOLE Bureau de vote 1 293 OUANGA HANGAR Bureau de vote 1 98 PAHIN ECOLE Bureau de vote 1 278 SAYARO ECOLE Bureau de vote 1 400 SIPOHIN ECOLE Bureau de vote 1 249 SOKOURA ECOLE Bureau de vote 1 152 VY ECOLE1 Bureau de vote 1 360 VY ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 369 VYRWE MAGASIN Bureau de vote 1 127 YARO ECOLE Bureau de vote 1 327 Nombre de bureaux de la commune 31 Nombre d'inscrits de la commune 8 220 2 REGION BOUCLE DU MOUHOUN PROVINCE BALE COMMUNE BANA Secteur/Village Emplacement Bureau de vote Inscrits BANA KOKOBE\PREFECTURE Bureau de vote 1 353 BANA -

Second Progress Report 2Nd Progress Report
Technical Assistance for a Study on Forest Biomass Energy Conversion: Second Progress Report Delivery Report Output 2.2: Report on geographical location of the hot spots of wood waste generation in the countries mapped supply chains 2nd Progress Report Presented to: CTCN Author: Climate and Energy (C&E) Advisory Ltd, Nairobi & S2 Services, Cameroon Date: 28/08/2020 Version: D2.2 A Report on geographical location of the hot spots of wood waste generation in the countries mapped supply chains 1 www.eclimateadvisory.comA Report on geographical location of the hot spots of wood waste generation in the countriesCitadel mapped of Resilience supply chains and Sustainability Contents DEFINITIONS OF COMMONLY USED TERMS ..................................................................................................... 8 1. INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 10 1.1 OBJECTIVES AND SCOPE OF THE STUDY ........................................................................................................... 10 1.2 TECHNICAL APPROACH AND METHODOLOGY ................................................................................................... 12 2. QUANTIFICATION OF WASTE GENERATED AT EACH LINK IN THE SUPPLY CHAIN ..................................... 13 2.1 CLASSIFICATION OF BIOMASS RESIDUES ........................................................................................................... 13 2.1.1 Sawdust ........................................................................................................................................ -

Ceni - Burkina Faso
CENI - BURKINA FASO ELECTIONS COUPLEES PRESIDENTIELLE / LEGISLATIVES DU 22/11/2020 STATISTIQUES DES BUREAUX DE VOTE PAR COMMUNE / ARRONDISSEMENTS LISTE DEFINITIVE REGION : AFRIQUE PROVINCE : AFRIQUE DU SUD COMMUNE : PRETORIA AMBASSADE PRETORIA SECTEUR / VILLAGE LIEU EMPLACEMENT BUREAU DE VOTE NB_INSCRITS PRETORIA PRETORIA AMBASSADE Bureau de vote 1 85 Nombre de bureau de vote PRETORIA/AMBASSADE PRETORIA : 1 Nombre d'inscrits de la commune de PRETORIA/AMBASSADE PRETORIA :85 REGION : AFRIQUE PROVINCE : BENIN COMMUNE : COTONOU CONSULAT COTONOU SECTEUR / VILLAGE LIEU EMPLACEMENT BUREAU DE VOTE NB_INSCRITS COTONOU COTONOU CONSULAT Bureau de vote 1 494 COTONOU COTONOU CONSULAT Bureau de vote 2 286 Nombre de bureau de vote COTONOU/CONSULAT COTONOU : 2 Nombre d'inscrits de la commune de COTONOU/CONSULAT COTONOU :780 REGION : AFRIQUE PROVINCE : COTE D'IVOIRE COMMUNE : ABIDJAN AMBASSADE ABIDJAN SECTEUR / VILLAGE LIEU EMPLACEMENT BUREAU DE VOTE NB_INSCRITS ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade1 Bureau de vote 1 294 ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade1 Bureau de vote 2 294 ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade2 Bureau de vote 1 418 ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade4 Bureau de vote 1 299 ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade4 Bureau de vote 2 299 ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade5 Bureau de vote 1 355 Nombre de bureau de vote ABIDJAN/AMBASSADE ABIDJAN : 6 Nombre d'inscrits de la commune de ABIDJAN/AMBASSADE ABIDJAN :1.959 REGION : AFRIQUE PROVINCE : COTE D'IVOIRE COMMUNE : ABIDJAN CONSULAT ABIDJAN SECTEUR / VILLAGE LIEU EMPLACEMENT BUREAU DE VOTE NB_INSCRITS ABIDJAN ABIDJAN CONSULAT2 -

Burkina Faso
CENI - BURKINA FASO ELECTIONS COUPLEES PRESIDENTIELLE/LEGISLATIVES DU 29/11/2015 STATISTIQUES DES BUREAUX DE VOTE PAR COMMUNES \ ARRONDISSEMENTS LISTE DEFINITIVE CENI 29/11/2015 REGION : BOUCLE DU MOUHOUN PROVINCE : BALE COMMUNE : BAGASSI Secteur/Village Emplacement Bureau de vote Inscrits ASSIO ASSIO II\ECOLE Bureau de vote 1 348 BADIE ECOLE Bureau de vote 1 239 BAGASSI ECOLE Bureau de vote 1 441 BAGASSI ECOLE Bureau de vote 2 393 BAGASSI TINIEYIO\ECOLE Bureau de vote 2 202 BAGASSI TINIEYIO\ECOLE Bureau de vote 1 439 BANDIO ECOLE Bureau de vote 1 325 BANOU ECOLE Bureau de vote 1 314 BASSOUAN ECOLE Bureau de vote 1 252 BOUNOU ECOLE1 Bureau de vote 1 353 BOUNOU ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 329 DOUSSI ECOLE B Bureau de vote 1 369 HAHO CENTRE\CENTRE ALPHABETISATION Bureau de vote 1 212 KAHIN ECOLE Bureau de vote 1 390 KAHO ECOLE Bureau de vote 1 347 KANA ECOLE Bureau de vote 1 322 KAYIO ECOLE Bureau de vote 1 301 KOUSSARO ECOLE Bureau de vote 1 415 MANA ECOLE Bureau de vote 1 458 MANA ECOLE Bureau de vote 2 443 MANZOULE MANZOULE\ECOLE Bureau de vote 1 166 MOKO HANGAR Bureau de vote 1 393 NIAGA NIAGA\ECOLE Bureau de vote 1 196 NIAKONGO ECOLE Bureau de vote 1 357 OUANGA OUANGA\ECOLE Bureau de vote 1 164 PAHIN ECOLE Bureau de vote 1 375 SAYARO ECOLE Bureau de vote 1 461 SIPOHIN ECOLE Bureau de vote 1 322 SOKOURA ECOLE Bureau de vote 1 184 VY ECOLE1 Bureau de vote 1 531 VY ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 451 VYRWA VIRWA\ECOLE Bureau de vote 1 141 YARO ECOLE Bureau de vote 1 476 Nombre de bureaux de la commune 33 Nombre d'inscrits de la commune 11 109 CENI/ Liste definitive des Bureaux de Vote 29 - Nov. -

Burkina Faso
CENI - BURKINA FASO ELECTIONS MUNICIPALES DU 22/05/2016 STATISTIQUES DES BUREAUX DE VOTE PAR COMMUNES \ ARRONDISSEMENTS LISTE DEFINITIVE CENI 22/05/2016 REGION : BOUCLE DU MOUHOUN PROVINCE : BALE COMMUNE : BAGASSI Secteur/Village Emplacement Bureau de vote Inscrits ASSIO ASSIO II\ECOLE Bureau de vote 1 355 BADIE ECOLE Bureau de vote 1 243 BAGASSI ECOLE Bureau de vote 1 440 BAGASSI ECOLE Bureau de vote 2 403 BAGASSI TINIEYIO\ECOLE Bureau de vote 2 204 BAGASSI TINIEYIO\ECOLE Bureau de vote 1 439 BANDIO ECOLE Bureau de vote 1 331 BANOU ECOLE Bureau de vote 1 320 BASSOUAN ECOLE Bureau de vote 1 252 BOUNOU ECOLE1 Bureau de vote 1 358 BOUNOU ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 331 DOUSSI ECOLE B Bureau de vote 1 376 HAHO CENTRE\CENTRE ALPHABETISATION Bureau de vote 1 217 KAHIN ECOLE Bureau de vote 1 395 KAHO ECOLE Bureau de vote 1 349 KANA ECOLE Bureau de vote 1 323 KAYIO ECOLE Bureau de vote 1 303 KOUSSARO ECOLE Bureau de vote 1 419 MANA ECOLE Bureau de vote 1 458 MANA ECOLE Bureau de vote 2 451 MANZOULE MANZOULE\ECOLE Bureau de vote 1 166 MOKO HANGAR Bureau de vote 1 395 NIAGA NIAGA\ECOLE Bureau de vote 1 198 NIAKONGO ECOLE Bureau de vote 1 357 OUANGA OUANGA\ECOLE Bureau de vote 1 164 PAHIN ECOLE Bureau de vote 1 378 SAYARO ECOLE Bureau de vote 1 465 SIPOHIN ECOLE Bureau de vote 1 324 SOKOURA ECOLE Bureau de vote 1 184 VY ECOLE1 Bureau de vote 1 534 VY ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 453 VYRWA VIRWA\ECOLE Bureau de vote 1 141 YARO ECOLE Bureau de vote 1 481 Nombre de bureaux de la commune 33 Nombre d'inscrits de la commune 11 207 CENI/ Liste definitive -

Carte Sanitaire 2010
MINISTERE DE LA SANTE BURKINA FASO -------------- Unité-Progrès-Justice Carte sanitaire 2010 Janvier 2012 SOMMAIRE SIGLES ET ABBREVIATIONS ................................................................................................................................ 5 INTRODUCTION ....................................................................................................................................................... 6 I. SITUATION DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES .......................................................................... 7 I.1. Carte de la région sanitaire de la Boucle du Mouhoun ........................................................... 7 I.1.1. Carte district sanitaire de Boromo ........................................................................................ 8 I.1.2. Carte district sanitaire de Dédougou .................................................................................... 9 I.1.3. Carte du district sanitaire de Nouna ...................................................................................11 I.1.4. Carte district sanitaire de Solenzo .......................................................................................12 I.1.5. Carte district sanitaire de Toma ...........................................................................................14 I.1.6. Carte district sanitaire de Tougan .......................................................................................15 I.2. Carte de la région des Cascades .....................................................................................................16 -

Burkina Faso FY2015 Ex-Post Evaluation of Technical
Burkina Faso FY2015 Ex-Post Evaluation of Technical Cooperation Project “Participatory and Sustainable Forest Management in the Province of Comoe” External Evaluator: Chiaki Yamada, Value Frontier Co., Ltd. 0. Summary The objective of this Project was to formulate the Plan d'aménagement Forestier (PAF) 1 in four Classified Forests (CFs), to improve the capacity of forest administrative agencies for supporting activities and the capacity of Groupement de Gestion Forestière (GGF) 2/Union des Groupement de Gestion Forestière (UGGF) 3 for sustainable forest management. Moreover, by strengthening the cooperative relationship between forest administrative agencies and the GGF/UGGFs, this Project intends to have the GGF/UGGFs appropriately implement sustainable forest management activities. The implementation of this Project at both the ex-ante evaluation and ex-post evaluation was relevant to the development policy and needs of Burkina Faso, a country where serious decrease in forest areas and related problems have been confirmed and the appropriate implementation of forest management has been an object of focus. The Project also conformed to the measures taken under Japan’s ODA policy toward Burkina Faso as of the ex-ante evaluation. The relevance of the Project is therefore rated as high. Regarding the effectiveness of the Project, zoning borders were clarified in the target CFs, and the GGF/UGGFs acquired forest management knowledge and techniques through the project implementation. In addition, the PAF was formulated and forest activities were commenced based on the PAF. Moreover, as a series of flows were developed for the sale of timber and non-timber forest products (hereinafter referred to as "forest products"), one of the main project purposes, namely, that expected “activities be implemented for forest management by the local people”, was achieved. -

11-Taux De Fonctionnalité Des Forages En 2017 Par Village
11_Taux de fonctionnalité des forages en 2017 par village NOM_REGION NOM_PROVINCE NOM_COMMUNE BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE -

The Study on the Management of Forest Reserves in the Province of Comoe
No. Japan International Cooperation Agency (JICA) Ministry of Environment and Habitat Burkina Faso The Study on the Management of Forest Reserves in the Province of Comoe BURKINA FASO FINAL REPORT July 2005 INTERNATIONAL DEVELOPMENT CENTER OF JAPAN TAIYO CONSULTANTS CO., LTD. GE JR 05-033 Exchange Rate 1FCFA=JP¥0.2130 (May 2005) Preface In response to a request of the Government of Burkina Faso, the Government of Japan decided to conduct the study on the Management of Forest Reserves in the Province of Comoe and entrusted to the study to the Japan International Cooperation Agency (JICA). JICA selected and dispatched the study team headed by Dr. Junichi WATANABE of International Development Center of Japan and consists of International Development Center of Japan and Taiyo Consultants Co., LTD. between Sep 2002 and Jun 2005. The team held discussions with the officials concerned of the Government of Burkina Faso and conducted field surveys at the study area. Upon returning to Japan, the team conducted further studies and prepared this final report. I hope that this report will contribute to the promotion of this project and to the enhancement of friendly relationship between our two countries. Finally, I wish to express my sincere appreciation to the officials concerned of the Government of Burkina Faso for their close cooperation extended to the study. July 2005 Etsuo KITAHARA, Vice President Japan International Cooperation Agency Letter of Transmittance Mr. Etsuo Kitahara Vice president Japan International Cooperation Agency July, 2005 Dear Mr. Kitahara, The Study for Forest Management Plan for Comoe Province in Burkina Faso has now been completed and the Final Report for the Study is submitted herewith.