Mémoire De Master Thème
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

POLAND: COUNTRY REPORT to the FAO INTERNATIONAL TECHNICAL CONFERENCE on PLANT GENETIC RESOURCES (Leipzig 1996)
POLAND: COUNTRY REPORT TO THE FAO INTERNATIONAL TECHNICAL CONFERENCE ON PLANT GENETIC RESOURCES (Leipzig 1996) Prepared by: Wieslaw Podyma Barbara Janik-Janiec Radzikow, June 1995 POLAND country report 2 Note by FAO This Country Report has been prepared by the national authorities in the context of the preparatory process for the FAO International Technical Conference on Plant Genetic Resources, Leipzig, Germany, 17-23 June 1996. The Report is being made available by FAO as requested by the International Technical Conference. However, the report is solely the responsibility of the national authorities. The information in this report has not been verified by FAO, and the opinions expressed do not necessarily represent the views or policy of FAO. The designations employed and the presentation of the material and maps in this document do not imply the expression of any option whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations concerning the legal status of any country, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. POLAND country report 3 Table of Contents CHAPTER 1 THE COUNTRY AND ITS AGRICULTURAL SECTOR 6 1.1 THE COUNTRY 6 1.2 AGRICULTURAL SECTOR IN POLAND 8 CHAPTER 2 INDIGENOUS PLANT GENETIC RESOURCES 12 2.1 FLORA OF POLAND 12 2.2 FOREST GENETIC RESOURCES 37 2.3 WILD AND CROPS-RELATED SPECIES 38 2.4 LANDRACES AND OLD CULTIVARS 40 CHAPTER 3 CONSERVATION ACTIVITIES 42 3.1 IN SITU PRESERVATION OF GENETIC RESOURCES 42 3.2 EX SITU COLLECTIONS 45 3.2.1 Sample -

Advances in Wheat Genetics: from Genome to Field Proceedings of the 12Th International Wheat Genetics Symposium Advances in Wheat Genetics: from Genome to Field
Yasunari Ogihara · Shigeo Takumi Hirokazu Handa Editors Advances in Wheat Genetics: From Genome to Field Proceedings of the 12th International Wheat Genetics Symposium Advances in Wheat Genetics: From Genome to Field Yasunari Ogihara • Shigeo Takumi Hirokazu Handa Editors Advances in Wheat Genetics: From Genome to Field Proceedings of the 12th International Wheat Genetics Symposium Editors Yasunari Ogihara Shigeo Takumi Kihara Institute for Biological Research Graduate School of Agricultural Sciences Yokohama City University Kobe University Yokohama , Kanagawa , Japan Kobe , Hyogo , Japan Hirokazu Handa Plant Genome Research Unit National Institute of Agrobiological Sciences Tsukuba , Ibaraki , Japan ISBN 978-4-431-55674-9 ISBN 978-4-431-55675-6 (eBook) DOI 10.1007/978-4-431-55675-6 Library of Congress Control Number: 2015949398 Springer Tokyo Heidelberg New York Dordrecht London © The Editor(s) (if applicable) and the Author(s) 2015 . The book is published with open access at SpringerLink.com. Open Access This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non- commercial License, which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. All commercial rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifi cally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfi lms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specifi c statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. -

Using Linguistics to Reconstruct African Subsistence Systems: Comparing Crop Names to Trees and Livestock
598 CHAPTER 19 USING LINGUISTICS TO RECONSTRUCT AFRICAN SUBSISTENCE SYSTEMS: COMPARING CROP NAMES TO TREES AND LIVESTOCK ROGER BLENCH To appear in: In: Rethinking Agriculture: Archaeological And Ethnoarchaeological Perspectives. T.P. Denham, J. Iriarte & L. Vrydaghs (eds.) California: Left Coast Press. Info at: http://www.bergpublishers.com/uk/book_page.asp?BKTitle=Rethinking%20Agriculture INTRODUCTION Reconstructing the history of agriculture in Africa, or indeed any area of the world where written documentation is sparse or non-existent, is inevitably a multi-disciplinary exercise. Although the volume of archaeobotanical data available for Africa is gradually increasing, coverage remains extremely patchy and concentrates on a few species, notably sorghum, millet and finger-millet (see review in Neumann 2003). It is safe to say that most plants cultivated in Africa today are nowhere represented in the repertoire of plant remains recovered from the archaeological record. In the case of domestic animals, particularly cattle, sheep, goats and chickens, the situation is marginally better, with some materials for most species in much of the continent (see individual reviews in Blench & Macdonald 2000). African arboriculture or the intentional planting of trees, an ancient characteristic of many agricultural systems in the Old World, is a poorly understood and little-documented area; linking the sparse archaeobotanical material from trees with present-day management systems has hardly begun. Indirect indicators of agriculture in the past and the present, such as agricultural tools, settlement patterns, field systems and animal pens, remain understudied. Two tools other than archaeology are available for the reconstruction of agrarian history; historical and comparative linguistics and DNA (deoxyribonucleic acid) studies. -
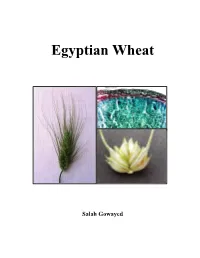
Egyptian Wheat
Egyptian Wheat Salah Gowayed Department of Agrobiodiversity Institute of Crop Sciences University of Kassel Germany Egyptian Wheat Doctoral Dissertation Submitted for the degree of Doctor of Agricultural Sciences of the Institute of Crop Sciences of the University Kassel Presented by Salah Gowayed BSc, MSc, Egypt Witzenhausen, 3 December 2009 ii Die vorliegende Arbeit wurde vom Fachbereich Agrarwissenschaften der Universität Kassel als Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Agrarwissenschaften (Dr. agr.) angenommen. Erster Gutachter: Prof. Dr. Karl Hammer Zweiter Gutachter: Prof. Dr. Christian Richter Tag der mündlichen Prüfung 3 December 2009 This work was approved by the Faculty of Agricultural Sciences, University of Kassel as a thesis to obtain the academic degree of Doctor of Agricultural Sciences (Dr. agr.). Referee: Prof. Dr. Karl Hammer Co-referee: Prof. Dr. Christian Richter Date of Examination: 3 December 2009 iii Table of Contents Content Pages List of Tables ««««««««««««««««««««««««««««««. vi List of Figures««««««««««««««««««««««««««««««. vii Dedication «««««««««««««««««««««««««««««««.. viii Acknowledgements «««««««««««««««««««««««««««« ix Summary x Zusammenfassung xi Chapter 1 Introduction …………………………………………………………………... 1 Problem Statement ««««««««««««««««««««««««......... 4 Aim and Scope ««««««««««««««««««««««««............... 5 Chapter 2 Egyptian Wheat: A Review………………………………………………….. 7 2.1 A Brief History of Wheat Classification «««««««««««««««««. 8 2.2.1 Domestication of Emmer Wheat «««««««««««««««««««..... 18 2.2.2 The Diversity Center of Domesticated Emmer Wheat ««««««««« 20 2.2.3 Origin and the Diversity Center of Ethiopian Wheat T. aethiopicum«««« 22 2.3 A Historical View of Agriculture and Egyptian Wheat «««««««««««... 24 2.3.1 Palaeoclimatic Conditions ««««««««..««««««««««««... 24 2.3.2 Egyptian History Phases««««««««««««««««««................. 25 2.3.2.1 Paleolithic or Old Stone Age««««««««««««««««««... 25 2.3.2.2 Neolithic Age 6000 BC (Neolithic Revolution)«««««««............... -

See Document
= â~ëëÉä= = = ìåáîÉêëáíó= = éêÉëë= = = = = = = = = = = = = = = = = = = bñéäçê~íáçå=~åÇ=Éëíáã~íáçå=çÑ=ãçêéÜçäçÖáÅ~ä=~åÇ=ÖÉåÉíáÅ= ÇáîÉêëáíó=çÑ=ïÜÉ~í=EqêáíáÅìã=ëééKF=ä~åÇê~ÅÉë=áå=lã~å= Sulaiman S. Al Khanjari This work has been accepted by the faculty of Organic Agricultural Sciences of the University of Kassel as thesis for acquiring the academic degree of Doctor der Agrarwissenschaften (Dr. agr.). 1. Supervisor: Prof. Dr. Karl Hammer 2. Supervisor: Prof. Dr. Andreas Bürkert Disputation 28. September 2005 Bibliographic information published by Die Deutsche Bibliothek Die Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche Nationabibliografie; detailed bibliographic data is available in the Internet at http://dnb.ddb.de Zugl.: Kassel, Univ., Diss. 2005 ISBN 3-89958-169-5 URN urn:nbn:de:0002-1698 © 2005, kassel university press GmbH, Kassel www.upress.uni-kassel.de Cover: 5 Büro für Gestaltung, Kassel Printed in Germany by Unidruckerei der Universität Kassel Dedicated to S. Al Shukaily, Z. Al Harthy and S. Al Khanjari Table of contents Page Acknowledgements VI 1 General introduction 1 2 Genetic resources 10 2.1 A survey of wheat landraces in Oman 10 2.2 Emmer (Triticum dicoccon Schrank) in Oman 22 2.3 Exploration of wheat landraces (Triticum spp.) in Oman 27 3 Morphological diversity 41 3.1 Morphological spike diversity of Omani wheat: I. Tetraploid landraces 41 3.2 Morphological spike diversity of Omani wheat: II. Hexaploid landraces 59 4 Molecular diversity 78 4.1 Molecular diversity of Omani wheat revealed by microsatellites: I. Tetraploid landraces 78 4.2 Molecular diversity of Omani wheat revealed by microsatellites: II. -

D™Arvisenetgabriel SN MAST 1 11
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana – Tanindrazana - Fandrosoana MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DE UNIVERSITE DE MAHAJANGA La culture de l’excellence MAHAJANGA Faculté des Sciences FACULTE DES SCIENCES DEPARTEMENT : BIOCHIMIE - MICROBIOLOGIE OPTION : BIOTECHNOLOGIE APPLIQUEE GRAIN MEMOIRE DE MASTER I DE BLE PROMOTION : IDEAL FARINE PAIN N° : 09 LES GRAINS DE BLE : LEUR VALEUR ALIMENTAIRELES GRAINS DE ET BLE LEURS : PROCEDES DE TRANSFORMATION TECHNOLOGIQUE EN PAIN LEUR VALEUR ALIMENTAIRE ET LEURS PROCEDES DE TRANSFORMATION TECHNOLOGIQUE EN PAIN Présenté et soutenu par : Monsieur D’ARVISENET Gabriel Le 31 Mai 2011 Devant les membres de jury composés de : Président de jury : Docteur MILADERA Jonhson Christian Juge : Docteur PAMPHILE Mananjara Directeur de mémoire : Docteur RAZAFIMAHEFA Année Universitaire : 2009 – 2010 1 REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana – Tanindrazana - Fandrosoana MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DE MAHAJANGA UNIVERSITE DE La culture de l’excellence MAHAJANGA FACULTE DES SCIENCES Faculté des Sciences DEPARTEMENT : BIOCHIMIE - MICROBIOLOGIE OPTION : BIOTECHNOLOGIE APPLIQUEE GRAIN MEMOIRE DE MASTER I DE BLE PROMOTION : IDEAL FARINE N° : 09 PAIN LES GRAINS DE BLE : LEUR VALEUR ALIMENTAIRE ET LEURS PROCEDES DE TRANSFORMATION TECHNOLOGIQUE EN PAIN Présenté et soutenu par : Monsieur D’ARVISENET Gabriel Le 31 Mai 2011 Devant les membres de jury composés de : Président de jury : Docteur MILADERA Jonhson Christian Juge : Docteur PAMPHILE Mananjara Directeur de mémoire : Docteur RAZAFIMAHEFA Année Universitaire : 2009 – 2010 2 DEDICACE « Je dédie spécialement ce travail à mes parents qui m’ont donné le bonheur et la chance d’effectuer ce travail et aussi à tout ce qui m’a soutenu jusqu’à maintenant ». -

Genetic Analysis of Resistance to Fusarium Head Blight in Wheat (Triticum Spp.)
Genetic analysis of resistance to Fusarium head blight in wheat (Triticum spp.) using phenotypic characters and molecular markers By Ali Malihipour A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies of the University of Manitoba in partial fulfilment of the requirements of the degree of DOCTOR of PHILOSOPHY Department of Biological Sciences University of Manitoba Winnipeg Copyright © 2010 by Ali Malihipour ABSTRACT Fusarium head blight (FHB), caused mainly by Fusarium graminearum (teleomorph: Gibberella zeae ), is one of the most damaging diseases of wheat. A ‘Brio’/‘TC 67’ spring wheat population was used to map quantitative trait loci (QTLs) for resistance to FHB, and to study the association of morphological and developmental characteristics with FHB resistance. Interval mapping (IM) detected a major QTL on chromosome 5AL for resistance to disease severity (type II resistance) and Fusarium-damaged kernels (FDK) under greenhouse and field conditions, respectively. Inconsistent QTL(s) was also detected on chromosome 5BS for disease severity and index using field data . The associations of plant height and number of days to anthesis were negative with disease incidence, severity, index, and deoxynivalenol (DON) accumulation data under field conditions. However, number of days to anthesis was positively correlated with disease severity (greenhouse) and FDK (field). Awnedness had a negative effect on FHB, namely the presence of awns resulted in less disease in the population. Spike threshability also affected FHB so that the hard threshable genotypes represented lower disease. Phylogenetic relationships of putative F. graminearum isolates from different sources were characterized using Tri101 gene sequencing data. Canadian and Iranian isolates clustered in F. -

Rudolf Mansfeld and Plant Genetic Resources
Schriften zu Genetischen Ressourcen Schriftenreihe der Zentralstelle für Agrardokumentation und -information Informationszentrum Biologische Vielfalt (IBV) BAND 22 Rudolf Mansfeld and Plant Genetic Resources Proceedings of a symposium dedicated to the 100th birthday of Rudolf Mansfeld, Gatersleben, Germany, 8-9 October 2001 Editors H. Knüpffer J. Ochsmann Herausgeber: Zentralstelle für Agrardokumentation und -information (ZADI) Informationszentrum Biologische Vielfalt (IBV) Villichgasse 17, D – 53177 Bonn Postfach 20 14 15, D – 53144 Bonn Tel.: (0228) 95 48 - 202 Fax: (0228) 95 48 - 220 Email: [email protected] Layout: Gabriele Blümlein Anette Scheibe Jörg Ochsmann Helmut Knüpffer Gudrun Schütze Druck: Druckerei Martin Roesberg Geltorfstr. 52 53347 Alfter-Witterschlick Schutzgebühr 12,- € ISSN 0948-8332 © ZADI Bonn, 2003 Diese Publikation ist im Internet verfügbar unter: http://www.genres.de/infos/igrreihe.htm Preface Preface In October 2001, the Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK) in Gatersleben, Germany, organised an international scientific symposium commemo- rating the centenary of RUDOLF MANSFELD, who was born on January 17, 1901. The symposium, entitled “Rudolf Mansfeld and Plant Genetic Resources”, and dedicated to his life’s work and scientific legacy was co-organised by the Genetic Resources Section of the Gesellschaft für Pflanzenzüchtung (GPZ, Society for Plant Breeding), and the Gemeinschaft zur Förderung der Kulturpflanzenforschung in Gatersleben e.V. (Society for the Advancement of Cultivated Plant Research). Professor RUDOLF MANSFELD worked in Gatersleben between 1946 and 1960, and was the former head of the Department of “Systematik und Sortiment” (Systematics and World Collection of Cultivated Plants) of the former Institute of Cultivated Plant Research. He was a plant taxonomist from the famous Berlin school of ADOLF ENGLER, and he developed principles for the classification of cultivated plants. -

Civis Agricola
Civis agricola EN ASIA, EUROPA, AMÉRICA, OCEANÍA, Y ÁFRICA, DESDE EL ÚLTIMO MÁXIMO GLACIAL, SOCIEDADES ITINERANTES ADOPTARON VIDA SEDENTARIA PERMANENTE PARA EVOLUCIONAR ECONOMÍAS AGRÍCOLAS Canis lupus A. F. MARTIN 2021 Contracubierta: Figura del Arte Rupestre de Coahuila, Mexico -Sierra de Jimulco, Gruta La Gualdria- Civis agricola EN ASIA, EUROPA, AMÉRICA, OCEANÍA, Y ÁFRICA, DESDE EL ÚLTIMO MÁXIMO GLACIAL, SOCIEDADES ITINERANTES ADOPTARON VIDA SEDENTARIA PERMANENTE PARA EVOLUCIONAR ECONOMÍAS AGRÍCOLAS Columba palumbus -Kensington Gardens, London- A. F. Martin, 2014-2021 Programa Exordio Canis lupus familiaris Agricultura y selección de plantas. La economía agrícola Domesticación Último Máximo Glacial Canis lupus familiaris Conocimiento de los cereales, y elaboración de harinas Europa Este Asia -Ohalo II- China La vida sedentaria y la adopción progresiva de la economía agrícola Younger Dryas Adopción de la agricultura ASIA Suroeste Asia Levante Anatolia Irán India Quinghai Tibet Plateau Norte China Sur China Central Asia Kazakhstan La Ruta de La Seda Arabia EUROPA AMÉRICA Brasil Andes -Perú- Mesoamérica Norte América OCEANÍA Australasia Melanesia Micronesia Polinesia ÁFRICA Este África Transferencias marítimas a Este África Transferencias terrestres a África Sahara Oeste África Marruecos Zuid-Africa Domesticidad Mus musculus Passer domesticus Felis silvestris catus Domesticación Bos primigenius taurus -Toro- Bos primigenius indicus -Cebú- Bos grunniens -Yak- Sus scrofa domestica -Puerco- Capra hircus -Chivo- Ovis aries -Cordero- Gallus gallus domesticus -Gallo- Equus caballus -Caballo- Equus africanus asinus -Asno- Lama glama -Llama- Vicugna pacos -Alpaca- Taurotragus oryx -Eland Común- Selección de caractéres adaptativos para la agricultura Oryza rufipogon -Arroz- Hordeum spontaneum -Cebada- Hordeum vulgare ssp. vulgare var. hexastichon v Triticum dicoccum -Farro- Triticum monococcum -Escanda- Triticum aestivum -Trigo Vulgar- Triticum araraticum Zea mays parviglumis -Maíz- Solanum sp. -

GENETIC ANALYSIS of the GROUP IV Rht LOCI in WHEAT
GENETIC ANALYSIS OF THE GROUP IV Rht LOCI IN WHEAT Edward Paul Wilhelm A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy University of East Anglia John Innes Centre June 2011 © This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that no quotation from the thesis, nor any information derived there from, may be published without the author‟s prior, written consent ABSTRACT The introduction of the group IV semi-dwarf Rht alleles, Rht-B1b (formerly Rht1) and Rht-D1b (formerly Rht2) into bread wheat varieties from the donor line „Norin 10‟ that began in the 1960s was a major contributor to the „green revolution‟. Rht-B1b and Rht-D1b were characterised and cloned over a decade ago (Gale and Youssefian 1985; Peng et al. 1999), however the Rht- A1 locus has not been isolated and little is known regarding the genetic diversity of the group IV Rht loci or the genetic composition of the contiguous sequence surrounding Rht that was presumably introgressed into wheat varieties along with the dwarfing alleles. To investigate the contiguous region around Rht, a hexaploid wheat („Chinese Spring‟ (CS)) BAC library was screened using a PCR-based technique (Febrer et al. 2009). This identified several Rht-containing BAC clones, three of which (representing the A, B, and D genomes) were sequenced and found to contain one to two genes upstream of Rht in conserved order. Gene synteny was also highly conserved in rice, Brachypodium distachyon, sorghum, and maize. -

Automatic Morphology Phenotyping of Tetra- and Hexaploid Wheat Spike Using Computer Vision Methods
БИОИНФОРМАТИКА И СИСТЕМНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ БИОЛОГИЯ Вавиловский журнал генетики и селекции. 2021;25(1):71-81 Оригинальное исследование / Original article DOI 10.18699/VJ21.009 Original Russian text www.bionet.nsc.ru/vogis/ Automatic morphology phenotyping of tetra- and hexaploid wheat spike using computer vision methods A.Yu. Pronozin1, A.A. Paulish2, E.A. Zavarzin2, A.Yu. Prikhodko2, N.M. Prokhoshin2, Yu.V. Kruchinina1, 3, N.P. Goncharov1, 4, E.G. Komyshev1, 2, 3, M.A. Genaev1, 2, 3 1 Institute of Cytology and Genetics of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia 2 Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia 3 Kurchatov Genomics Center of the Institute of Cytology and Genetics of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia 4 Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russia [email protected] Abstract. Intraspecif ic classif ication of cultivated plants is necessary for the conservation of biological diversity, study of their origin and their phylogeny. The modern cultivated wheat species originated from three wild diploid ancestors as a result of several rounds of genome doubling and are represented by di-, tetra- and hexaploid species. The identif ication of wheat ploidy level is one of the main stages of their taxonomy. Such classif ication is possible based on visual analysis of the wheat spike traits. The aim of this study is to investigate the morphological charac- teristics of spikes for hexa- and tetraploid wheat species based on the method of high-performance phenotyping. Phenotyping of the quantitative characteristics of the spike of 17 wheat species (595 plants, 3348 images), including eight tetraploids (Triticum aethiopicum, T. -

BC-TES-3841.Pdf
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" FACULTAO DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA Tesis: "INSTALACIÓN DE UNA MINI-PLANTA DE PRODUCCIÓN DE WHISKY TIPO BOURBON A PARTIR DE MAIZ (Zea mays)" Presentada para optar el Grado Académico de Ingeniero Químico PRESENTADO POR: Bachiller: Silva Cotrina Larry William ASESORADO POR: MsC., lng. CORONADO ZULOETA IVAN PEDRO LAMBAYEQUE .. PERÚ 2014 UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" FACULTAO DE INGENIER(A QUIMICA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIER(A QU(MICA Tesis: "INSTALACIÓN DE UNA MINI-PLANTA DE PRODUCCION DE WHISKY TIPO BOURBON A PARTIR DE MAIZ (Zea mays)" Presentada para optar el Grado Académico de ingeniero Químico PRESENTADO POR: Bachiller: Silva Cotrina Larry William ASESORADO POR: MsC., lng. CORONADO ZULOETA IVAN PEDRO LAMBAYEQUE- PERU 2014 "INSTALACIÓN DE UNA MINI-PLANTA DE PRODUCCION DE WHISKY TIPO BOURBON A PARTIR DE MAIZ (Zea mays) trina Larry William Autor Presentada a la escuela de in niería química de la facultad de ingeniería Química e industrias alimentarias, ara optar el grado de ingeniero químico. APROBADO POR : 6 o Tineo Huancas o 1 del Jurado LAMBAYEQUE- PERU 2014 [ndice INTRODUCCION CAPÍTULO 1 ............................................................................................................ 9 ESTUDIO DE MERCADO ...................................................................................... 9 1.1 DEFINICION DEL PRODUCTO .............................................................9