Vie Rurale Dans L'aisne ME Ok
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fiche Dispositif
Aide à l'agro-foresterie boisement et à l'agriculture biologique AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE Présentation du dispositif Dans le cadre du programme "Lutte des pollutions diffuses" l'Agence de l'Eau Artois-Picardie accompagne les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques pour une meilleure protection de la ressource en eau. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Ce dispositif vise les agriculteurs engagés dans les démarches ou domaines suivants, sur les territoires prioritaires pour le maintien de l'agriculture en zones humides : agro-foresterie, agriculture biologique, agriculture de conservation des sols, à la production intégrée, aux modes de production à bas niveaux d'intrants, activité agricole dans les zones humides et les prairies. Peuvent bénéficier de ce dispositif les Maîtres d'ouvrage portant un projet augmentant les surfaces cultivées en agriculture biologique dans : les communes à enjeu « eau potable », les communes des 8 territoires prioritaires pour le maintien de l’agriculture en zones humides, les territoires ayant un projet de maintien ou de développement des prairies, les zonages Natura 2000 Peuvent également bénéficier de ce dispositif les Agriculteurs ayant leur siège d'exploitation ou exploitant au moins une parcelle dans : les communes à enjeu « eau potable », les communes des 8 territoires prioritaires pour le maintien de l'agriculture en zones humides, les territoires ayant un projet de maintien ou de développement des prairies, les communes concernées par un projet global de lutte contre l'érosion, reconnu par l'Agence, les zonages Natura 2000. Pour quel projet ? Dépenses concernées AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE Aide à l'agro-foresterie boisement et à l'agriculture biologique Page 1 sur 3 Sont éligibles les études et les travaux. -
Compostage Brûler Ses Déchets
N°5 Juin 2016 mAG ' Le magazine « spécial déchets ménagers » des habitants de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois CCPV À chaque déchet, À chaque déchet, une solution ! une solution ! NOUVEAU Depuis la mise en place de la tarifi cation incitative des déchets VIDÉO-PROTECTION sur notre territoire, DANS NOS DÉCHÈTERIES nous constatons des 9 ENCOMBRANTS résultats encourageants Le Vice-Président depuis 2013 : chargé des déchets PREMIERS RÉSULTATS Francis Passet -25% de déchets résiduels DE LA REDEVANCE 2 INCITATIVE collectés (bac au couvercle vert) et +28% de tri sélectif (bac au couvercle jaune). Je tiens à remercier les usagers ainsi que les agents de leurs efforts, qui permettent à notre collectivité de maîtriser les coûts des déchets et de réduire notre impact VISITER sur l’environnement. LE CENTRE DE TRI NOUVELLES 0 Cela nous a permis d’investir ces derniers mois dans de 3 INSTALLATIONS POUR LE VERRE L’HABITAT COLLECTIF ET LE TEXTILE nouvelles installations, afi n de garantir un service toujours plus performant : vidéo-protection dans nos déchèteries, installation de bornes à verre nouvelle génération, mise TÉMOIGNAGE COMPOSTAGE 4 en place de colonnes enterrées et aériennes pour l’habitat REDEVANCE INCITATIVE BRÛLER SES DÉCHETS collectif, etc. 5 2 FAUSSE BONNE IDÉE Par ailleurs, pour atteindre les nouveaux objectifs LE TRI POUR LES PROS 3 MENSUALISEZ ambitieux de réduction des déchets fi xés par l’ADEME 6 VOTRE FACTURE (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie) qui prévoit notamment de diminuer de moitié LA COMMUNAUTÉ l’enfouissement de nos déchets résiduels d’ici à 2025, 3 DE COMMUNES notre collectivité s’est engagée dans un Plan Local de 6 RÉPOND À VOS Prévention des déchets (PLP) pour les années à venir. -

CHAPTER XIX the Capture of Hiio11t St. Quentin and Psronne Is Held By
CHAPTER XIX THE HINDENBURG OUTPOST-LINE THEcapture of hiIo11t St. Quentin and PSronne is held by many Australian soldiers to be the most brilliant achievement of the A.1.F.l Among the operations planned by Monash it stands out as one of movement rather than a set piece; indeed within Australian experience of the Western Front it was the only important fight in which quick, free manoeuvre played a decisive part. It furnishes a complete answer to the comment that Monash was merely a composer of set pieces. But Monash himself realised that it was also largely a soldiers’ battle. Monash passed four brigades under the enemy’s nose round the bend of the Somme, with all his invariable care in plan- ning, supplying and bridging. But what an instrument was to his hand! The picture given in the histories of some German regiments of their slender, exhausted remnants being over- . whelmed by masses of fresh troops is sheer propaganda. The 2nd and 3rd Divisions at least, with companies depleted to the German level, weary with-in soiiie cases-incredibly pro- tracted effort, and without normal artillery support, constantly attacked more than their number of Germans in strong, well wired positions and captured more prisoners than they could safely hold. The tactics were necessarily left largely to divisional, brigade, battalion and even platoon commanaers , they were sometimes brilliant and sometimes faulty, but in general the dash, intelligence, and persistence of the troops dealt a stunning blow to five German divisions, drove the enemy from one of his key positions in France, and took 1 Gen. -

The Battles of the Ridges
lKo4 HE BA uF THE ARRAS - MARCH - J U 9IZ LONDON: C. ARTHUR PEARSON Ltd. ONE SHILLING NET. • THE BATTLES OF THE RIDGES : THE BATTLES OF THE RIDGES ARRAS — M March—Ju BY FRANK FOX, R.F.A. " Author of "Problems of the Pacific The Agony of Belgium" " The Balkans" " The British Army at War," crc.y &c. LONDON ARTHUR PEARSON, I/TD. 1 8 Henrietta Street, W.C.2 1918 — CONTENTS CHAP. PAGE Foreword . , . 7 I. --The Position, Spring 19x7 . 9 II. The Battle of Arras: The Preparation 17 III. —The Battle of Arras : The Push 27 IV. —The Battle of Arras : The Prize 40 V. Fighting on a Forty-Mile Front 51 — . VI. Using up the Germans . 62 VII. —The May Fighting and the M.E.B.U.s .. .. 76 VIIL—Messines Ridge: The Prepara- tion 88 IX.—Messines Ridge: The Victory.. 98 Conclusion . 112 LIST OF ILLUSTRATIONS FACING The British Commander-in-Chief, Sir Douglas Ha-ig . Frontispiece Arras Cathedral To-day . 32 A Tank going into Action . 33 German Prisoners, Happy to be Caught 48 Using a German Gun against Germans . 49 A Wood after Bombardment . 64 Mules bringing up Ammunition . 65 A Mine Crater, Messines ..... 80 British Soldiers off for a Rest . 81 MAPS 1. The Battle of Messines . 99 2. The Battle of Arras .. .. i At end book 3. The British Western Front . j °t FOREWORD HE events of the Great War on the Flanders—Artois front from March to June, 191 7, are as yet too recent to permit of their full discussion without prejudice to current military operations. -

Annuaire Des Artisans
ANNUAIRE DES ARTISANS DU Vermandois 2018 QU’EST LE MOT DU PRÉSIDENT CE QUE Le développement économique fait partie intégrante de l’ADN de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois RTISANAT que j’ai l’honneur de présider. En 2017, le budget alloué à cette compétence était de 820 000 €. Il permet notamment de continuer à développer les 3 zones d’activité (situées à Bohain-en-Vermandois, Holnon et Vermand) et de donner Composé essentiellementl’ de petites aux chefs d’entreprises les moyens de progresser. L’année dernière nous avons reçu 41 créateurs ou repreneurs entreprises, le secteur de l’artisanat d’entreprises, pour un accompagnement et des conseils est un géant économique. Présent dans personnalisés, mais aussi pour l’obtention de prêts à taux zéro les secteurs de l’alimentation, du bâtiment, engagés par INITIATIVE AISNE, dont nous sommes membre. de la production et des services ; l’artisanat 7 dossiers ont été acceptés en 2017 pour un montant total de rassemble plus de 510 activités différentes 88 500 € avec la création d’une vingtaine d’emplois à la clé. et occupe ainsi une place privilégiée DÉFINITION Nous avons également créé un marché fermier dont le but est dans l’économie française. DE L’ENTREPRISE ARTISANALE de rassembler et faire connaître les producteurs alimentaires En alliant savoir-faire traditionnel du Vermandois au travers de la vente en circuit court. et technologies de pointe, l’artisanat Les entreprises artisanales Le monde artisan est, bien entendu, lui aussi concerné par a développé les conditions permettant se caractérisent par leur cette dynamique. -

ÉTANGS DE VERMAND, MARAIS DE CAULINCOURT ET COURS DE L'omignon (Identifiant National : 220005028)
Date d'édition : 05/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005028 ÉTANGS DE VERMAND, MARAIS DE CAULINCOURT ET COURS DE L'OMIGNON (Identifiant national : 220005028) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 02VER102) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (BARDET O.), .- 220005028, ÉTANGS DE VERMAND, MARAIS DE CAULINCOURT ET COURS DE L'OMIGNON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 31P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005028.pdf Région en charge de la zone : Picardie Rédacteur(s) :Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (BARDET O.) Centroïde calculé : 661580°-2545619° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 07/04/1999 Date actuelle d'avis CSRPN : 07/04/1999 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 5 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 5 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 6 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -
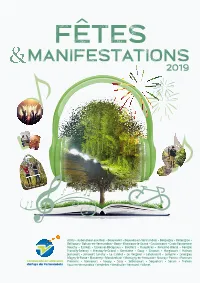
Manifestations 2019
FETES MANIFESTATIONS 2019 Attilly • Aubencheul-aux-Bois • Beaurevoir • Beauvois-en-Vermandois • Becquigny • Bellenglise • Bellicourt • Bohain-en-Vermandois • Bony • Brancourt-le-Grand • Caulaincourt • Croix-Fonsomme Douchy • Estrées • Etaves-et-Bocquiaux • Etreillers • Fluquières • Fontaine-Uterte • Foreste Francilly-Selency • Fresnoy-le-Grand • Germaine • Gouy • Gricourt • Hargicourt • Holnon Jeancourt • Joncourt Lanchy • Le Catelet • Le Verguier • Lehaucourt • Lempire • Levergies Magny-la-Fosse • Maissemy • Montbrehain • Montigny-en-Arrouaise • Nauroy • Pontru • Pontruet Prémont • Ramicourt • Roupy • Savy • Seboncourt • Sequehart • Serain • Trefcon Vaux-en-Vermandois • Vendelles • Vendhuile • Vermand • Villeret L’Oppidum de Vermand BIENVENUE AU PAYS DU VERMANDOIS SOMMAIRE MANIFESTATIONS DES COMMUNES .......................................................4-27 OFFICE DE TOURISME ..............................................................................28-29 HEBERGEMENTS ....................................................................................... 30-31 150 ANS HENRI MATISSE ........................................................................32-33 AGENDA DES MUSEES ............................................................................. 34-39 ANNUAIRE ................................................................................................ 40-51 COMMUNAUTE DE COMMUNES .............................................................52 SERVICES A LA POPULATION .................................................................. -

Télécharger La Carte
Fesmy-le-Sart St-Martin- Barzy-en- Rivière Thiérache Ribeauville Molain Bergues- Fontenelle La sur-Sambre Rocquigny Vallée- Oisy Aubencheul- Serain Mulâtre aux-Bois Wassigny Papleux Becquigny Prémont Boué Vaux-Andigny LeNouvion-en-Thiérache Vendhuile LaFlamengrie Gouy Vénérolles Etreux LeCatelet Beaurevoir Lempire La Bohain-en-Vermandois Mennevret Bony Neuville- lès-Dorengt Esquéhéries Hannapes Clairfontaine Brancourt- LaCapelle le-Grand Estrées Tupigny Mondrepuis Montbrehain Dorengt Hargicourt Leschelles Sommeron Petit- Buironfosse Bellicourt Ramicourt Seboncourt Verly Lerzy Joncourt Fresnoy-le-Grand Iron Wimy Hirson Nauroy Grougis Lavaqueresse Froidestrées Villeret Grand- Verly Sequehart Gergny Magny- Aisonville- Crupilly Neuve- la-Fosse Levergies Croix- Etaves- Lesquielles- Chigny Luzoir Maison Fonsommes et-Bernoville St-Germain Villers- St-Michel et-Bocquiaux Englancourt Pontru CompagnieFontaine- de lès-Guise CompagnieBellenglise de Ef ry Vadencourt Malzy Ohis Jeancourt Le Uterte Erloy Sorbais Verguier Montigny- Lehaucourt Buire Watigny en- Noyales Monceau- Pontruet Arrouaise sur-Oise Vendelles Essigny- Fonsommes Compagnie de Fieulaine Compagnie de Lesdins le-Petit Proix Autreppes Guise St-Algis Origny- Flavigny- Proisy Marly-Gomont Etréaupont Saint-QuentinRemaucourt en- Eparcy Saint-QuentinHauteville Maissemy le-Grand- Wiège- La Thiérache Gricourt et-Beaurain Faty Romery LaBouteille Hérie Any-Martin-Rieux Vermand Omissy Bernot Bucilly Morcourt Fontaine- Macquigny Haution Vervins Vervins Martigny Fayet Notre-Dame Audigny Leuze LeSourd -

Devenir En Vermandois
CONSEIL DE COMMUNAUTE REUNION DU 25 JANVIER 2018 A la Maison de Pays de BELLICOURT SEANCE ORDINAIRE COMPTE RENDU DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ________________________________________________________ Maison de Pays – Riqueval – R.D. 1044 02420 BELLICOURT Le 25 janvier 2018, les membres du Conseil de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois se sont réunis à la Maison de Pays à BELLICOURT. Etaient présents MM. les délégués titulaires (DT) ou suppléants (DS) : 1. Commune d’ ATTILLY Madame BELMERE (DT) 2. Commune d’AUBENCHEUL AUX BOIS Monsieur Francis PASSET (DT) 3. Commune de BEAUREVOIR Monsieur Eric LIMPENS (DT) 4. 5. 6. Commune de BEAUVOIS EN VERMANDOIS 7. Commune de BECQUIGNY 8. Commune de BELLENGLISE Monsieur Philippe GRAS (DS) 9. Commune de BELLICOURT Monsieur LECLERE Marcel (DT) 10. Monsieur Raoul FRANCOIS (DT) 11. Commune de BOHAIN EN VERMANDOIS Monsieur Patrick NOIRET (DT) 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Commune de BONY 19. Commune de BRANCOURT LE GRAND Monsieur Fabrice HERBIN (DT) 20. Monsieur Jean-François CHOPIN (DT) 21. Commune de CAULAINCOURT Monsieur Raphaël TROUILLET (DS) 22. Commune de CROIX FONSOMME 23. Commune de DOUCHY 24. Commune d’ESTREES Monsieur Gérard LEMPEREUR (DT) 25. Commune d’ETAVES ET BOCQUIAUX Madame Françoise CUNOT (DT) 26. Monsieur Gilles GABELLE (DT) 27. Commune d’ETREILLERS Madame Elisabeth DESAINTJEAN (DT) 28. Monsieur Jean-Michel MARIN (DT) 29. 30. Commune de FLUQUIERES Monsieur Pascal CORDIER (DT) 31. Commune de FONTAINE UTERTE 32. Commune de FORESTE Monsieur Hugues PAVIE (DT) 33. Commune de FRANCILLY SELENCY Monsieur Daniel DENIVET (DT) 34. Commune de FRESNOY LE GRAND Madame Annie FLAMANT (DT) 35. -

Déroulement Présentation Des Nouveaux
Compte-rendu Conseil d 'école du vendredi 22 juin 2018 Secrétaire:Mme Prévost Présents:Les enseignants;Mme Roger, responsable de la médiathèque;Parents élus;Mme Dhiver DDEN;Municipalités représentées par un adjoint: Vendelles;Jeancourt; Le Verguier; Vermand. Maire présent:Mr Merlin, Pontruet; L'équipe éducative; Elèves d eCM2. Absents Excusés:Mme Descamps, parent élu; Mme Gouillard,parent élu;Mr Décarsin, parent élu;Mme Stéfanski parent élu; Mr Pruvost, maire de Vendelles; Mme Vengeant, DDEN; Mr Boniface, maire de Vermand. Absents non-excusés:Mairies de Maissemy;Pontru;Attilly. Mme Darré:parent élu. Présentation de Mme Gix:membre du réseau d'aide aux enfants en difficultés scolaires. Interventions ponctuelles. Déroulement Présentation des nouveaux horaires: Les horaires retenus en conseil d'école extraordinaire ont été validés par le DASEN: Ouverture des portes à 8H30 et entrée en classe à 8H40 jusque 12H. L'après-midi, ouverture des portes à 13H30 et entrée en classe à 13H40 jusqu'à 16H20. Les transports s'aligneront sur ces horaires. Il faudra rester vigilants car le nombre d'enfants en garderie risque de croître. Point sur la fin des NAP:Stéphanie Non reconduction, car le budget passerait à 12€60 par enfant. Vie de l'école Présentation par les élèves de CM2 qui ont fait un reportage pour le journal du collège: Pour les PS et MS: Sortie au zoo, avec spectacle de marionnettes; 2 sorties à la MCL de Gauchy;Une séance découverte équitation; projet sur le loup mené dans les classes; Séances avec des conteuses. Pour GS;CP:Sortie à la maison Matisse et au parc d'isle; 2 séances avec des conteuses ; Sorties MCL; Projet sur le loup et exposition des dessins dans et albums exploités dans la classe. -

Déchets Ménagers Élire Leurs Conseillers Municipaux Mais Fiche 2/2 : Aussi, Pour La Première Fois Pour Cer- P
Numéro 5 Mars 2014 MAG' Le magazine des habitants infos de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois • CCPV AU SOMMAIRE P. 2-3 Tout sur l'intercommunalité P. 6 Accueils de Loisirs : bientôt les inscriptions ! Les 23 et 30 mars prochains, tous les P. 4 P. 7 électeurs sont appelés à voter pour Focus sur la Cité des Métiers Déchets ménagers élire leurs conseillers municipaux mais Fiche 2/2 : aussi, pour la première fois pour cer- P. 5 combien de temps conserver P. 8 Développement taines communes, leurs représentants ses documents ? touristique à la Communauté de Communes. Dans ce contexte d’élections municipales, il me semblait important de revenir sur le EN EXTRAIT dans ce numéro rôle de l’intercommunalité, un échelon pas toujours bien connu du grand public. Pourtant, le regroupement des communes n’est pas une nouveauté. LESLESPour PETITSPETITS preuve, INCONVÉNIENTSINCONVÉNIENTS la Communauté de QUECommunes L’ON PEUT du RENCONTRER… Pays du Vermandois, qui QUE L’ON PEUT RENCONTRER… Ce guide est proposé par : CeCe guideguide estest proposéproposé parpar :: compte aujourd’hui 54 municipalités Emanation d’odeur > Ajouter des matériaux secs. GUIDE DU EmanationEmanation d’odeurd’odeur >> AjouterAjouter desdes matériauxmatériaux secs.secs. GUIDE DU ”d’œuf pourri” > Brasser et aérer en retournant le compost. ”d’œuf”d’œuf pourri”pourri”adhérentes, >>vient BrasserBrasser etet aéreraérerde enen retournantfêterretournant lele sescompost.compost. 20 ans. Cause : Excès d’humidité Par beau temps, laisser le couvercle ouvert CauseCause :: ExcèsExcès d’humiditéd’humidité ParPar beaubeau temps,temps, laisserlaisser lele couverclecouvercle ouvertouvert et manque d’oxygène. etet manquemanqueL’adage d’oxygène.d’oxygène. -
DDFIP Présentation Du Dispositif
ZAI - Zone d'Aide à l'Investissement des PME : Exonération de la CFE DDFIP Présentation du dispositif Les PME peuvent bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsqu'elles sont situées dans les communes classées en zone d'aide à l'investissement (ZAI). La cotisation foncière des entreprises (CFE) est l'une des 2 composantes de la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La CFE est basée uniquement sur les biens soumis à la taxe foncière. Cette taxe est due dans chaque commune où l'entreprise dispose de locaux et de terrains. Ce dispositif d'exonération s'applique jusqu'au 31/12/2021. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Sont éligibles les PME, ayant employé moins de 250 salariés au cours de la période d'exonération et ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 M€. Critères d’éligibilité Les PME doivent procéder à : une extension ou création d'activité industrielle ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, une reconversion dans le même type d'activités, la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activité. Quelles sont les particularités ? Les zones d'aide à l'investissement des PME correspondent aux communes ou parties de communes qui ne sont pas classées en zone d'aide à finalité régionale. Montant de l'aide De quel type d’aide s’agit-il ? DDFIP ZAI - Zone d'Aide à l'Investissement des PME : Exonération de la CFE Page 1 sur 6 L'exonération de cotisation foncière des entreprises peut être totale ou partielle selon la délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI).