Siècles, 49 | 2020 Babeuf Et Le Babouvisme 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
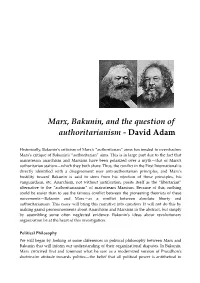
Marx, Bakunin, and the Question of Authoritarianism - David Adam
Marx, Bakunin, and the question of authoritarianism - David Adam Historically, Bakunin’s criticism of Marx’s “authoritarian” aims has tended to overshadow Marx’s critique of Bakunin’s “authoritarian” aims. This is in large part due to the fact that mainstream anarchism and Marxism have been polarized over a myth—that of Marx’s authoritarian statism—which they both share. Thus, the conflict in the First International is directly identified with a disagreement over anti-authoritarian principles, and Marx’s hostility toward Bakunin is said to stem from his rejection of these principles, his vanguardism, etc. Anarchism, not without justification, posits itself as the “libertarian” alternative to the “authoritarianism” of mainstream Marxism. Because of this, nothing could be easier than to see the famous conflict between the pioneering theorists of these movements—Bakunin and Marx—as a conflict between absolute liberty and authoritarianism. This essay will bring this narrative into question. It will not do this by making grand pronouncements about Anarchism and Marxism in the abstract, but simply by assembling some often neglected evidence. Bakunin’s ideas about revolutionary organization lie at the heart of this investigation. Political Philosophy We will begin by looking at some differences in political philosophy between Marx and Bakunin that will inform our understanding of their organizational disputes. In Bakunin, Marx criticized first and foremost what he saw as a modernized version of Proudhon’s doctrinaire attitude towards politics—the -
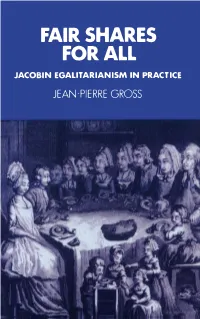
Fair Shares for All
FAIR SHARES FOR ALL JACOBIN EGALITARIANISM IN PRACT ICE JEAN-PIERRE GROSS This study explores the egalitarian policies pursued in the provinces during the radical phase of the French Revolution, but moves away from the habit of looking at such issues in terms of the Terror alone. It challenges revisionist readings of Jacobinism that dwell on its totalitarian potential or portray it as dangerously Utopian. The mainstream Jacobin agenda held out the promise of 'fair shares' and equal opportunities for all in a private-ownership market economy. It sought to achieve social justice without jeopardising human rights and tended thus to complement, rather than undermine, the liberal, individualist programme of the Revolution. The book stresses the relevance of the 'Enlightenment legacy', the close affinities between Girondins and Montagnards, the key role played by many lesser-known figures and the moral ascendancy of Robespierre. It reassesses the basic social and economic issues at stake in the Revolution, which cannot be adequately understood solely in terms of political discourse. Past and Present Publications Fair shares for all Past and Present Publications General Editor: JOANNA INNES, Somerville College, Oxford Past and Present Publications comprise books similar in character to the articles in the journal Past and Present. Whether the volumes in the series are collections of essays - some previously published, others new studies - or mono- graphs, they encompass a wide variety of scholarly and original works primarily concerned with social, economic and cultural changes, and their causes and consequences. They will appeal to both specialists and non-specialists and will endeavour to communicate the results of historical and allied research in readable and lively form. -

BUONARROTI's IDEAS on COMMUNISM and DICTATORSHIP Le Nom Seul De Buonarroti Est Une Doctrine
ARTHUR LEHNING BUONARROTI'S IDEAS ON COMMUNISM AND DICTATORSHIP Le nom seul de Buonarroti est une doctrine. Franzinetti, in ,,Le Radical", 24.9.1837. At the University of Pisa, where he studied law, Buonarroti had been acquainted with the 18th century social philosophers especially Hel- vetius, Mably, Rousseau and Morelly, who had moulded his social and political ideology. When the French Revolution broke out he was among the most courageous protagonists to defend its ideas: "J'atten- dais depuis longtemps le signal, il fut donne". In October 1789 he left his native Tuscany, "ivre de l'amour de la liberte, epris de la coura- geuse entreprise des Francais, indigne contre la tyrannie, et las de l'inquisition et des persecutions du despotisme", as he said later in his defence at Vendome. In Corsica he published an Italian paper in defence of the French Revolution, the Giornale Patriottico 1, and in November 1790 he obtained a post in the administration of the island as head of the "Bureau des domaines nationaux et du clerge". In this capacity he had to deal with the administration and sale of landed property. The rural economy of the island was based on a nearly equal distribution of very small holdings, there were hardly any labourers, and there existed a strong tradition of common interests and collective rights. In his Survey of Corsica Buonarroti wrote: "La communalite des biens semble garantir partout au pauvre le sentiment 1 The only complete copy known to exist is now in the Biblioteca Feltrinelli, Milan. Most biographical articles mention an Italian paper, l'Amico della Liberta Italiana, edited by Buonarroti in Corsica. -
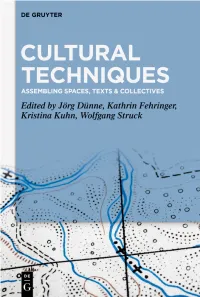
Cultural Techniques
Cultural Techniques Cultural Techniques Assembling Spaces, Texts & Collectives Edited by Jörg Dünne, Kathrin Fehringer, Kristina Kuhn, and Wolfgang Struck We acknowledge support by the German Research Foundation (DFG) and the Open Access Publication Fund of Humboldt-Universität zu Berlin. ISBN 978-3-11-064456-2 e-ISBN (PDF) 978-3-11-064704-4 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-064534-7 DOI https://doi.org/10.1515/9783110647044 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. For details go to: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Library of Congress Control Number: 2020939337 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2020 Jörg Dünne, Kathrin Fehringer, Kristina Kuhn, and Wolfgang Struck, published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Cover image: porpeller/iStock/Getty Images Plus Typesetting: Integra Software Services Pvt. Ltd. Printing and binding: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com Contents Jörg Dünne, Kathrin Fehringer, Kristina Kuhn, and Wolfgang Struck Introduction 1 Spaces Tom Ullrich Working on Barricades and Boulevards: Cultural Techniques of Revolution in Nineteenth-Century Paris 23 Jörg Dünne Cultural Techniques and Founding Fictions 47 Wolfgang Struck A Message in a Bottle 61 Gabriele Schabacher Waiting: Cultural Techniques, Media, and Infrastructures 73 Christoph Eggersglüß Orthopedics by the Roadside: Spikes and Studs as Devices of Social Normalization 87 Hannah Zindel Ballooning: Aeronautical Techniques from Montgolfier to Google 107 Texts/Bodies Bernhard Siegert Attached: The Object and the Collective 131 Michael Cuntz Monturen/montures: On Riding, Dressing, and Wearing. -

Buonarroti and His International Secret Societies
ARTHUR LEHNING BUONARROTI AND HIS INTERNATIONAL SECRET SOCIETIES On the 27th May 1797 the High Court at Vendome sentenced Babeuf to death and Buonarroti, then 36 years old, to deportation, but this being postponed there followed a long life of imprisonment and exile. Buonarroti led a mysterious life, and our knowledge about certain phases of his life and activities since Vendome is incomplete. Buonar- roti has, of course, always been known as one of the important actors of the conspiracy connected with the name of Babeuf, and as the author of a book, dealing with this conspiracy. This rare and famous book, published in 1828 1, was mainly regarded as the historical account of an eye-witness and participant of a post-thermidorian episode of the French Revolution. The book, however, was also a landmark in the historiography of the French Revolution, and did much for the revaluation and the rehabilitation of Robespierre and the revival of the Jacobin tradition under the Monarchy of July. By exposing the social implications of the Terror, and by a detailed account of the organisation and the methods and the aims of the conspiracy of 1796, the book became a textbook for the communist movement in the 1830's and fourties in France, and the fundamental source for its ideology. In fact, with the "Conspiration" started the Jacobin trend in European socialism. In speaking of his widespread influence 2 one has to consider differ- ent aspects: his communist ideology, his conspirative and insurrectio- nal methods and his theory of a revolutionary dictatorship. In what has always been called somewhat vaguely Babouvism and neo-Babouvism there has never been made a distinction between the ideas of Babeuf and Buonarroti, nor has the question ever been asked as to how far the 1 Conspiration pour l'egalite dite de Babeuf, Bruxelles 1828, 2 vol. -

Barricades: the War of the Streets in Revolutionary Paris, 1830-1848
Published on Reviews in History (https://reviews.history.ac.uk) Barricades: The War of the Streets in Revolutionary Paris, 1830- 1848 Review Number: 321 Publish date: Tuesday, 1 April, 2003 Author: Jill Harsin ISBN: 312294794X Date of Publication: 2002 Price: £25.00 Pages: 426pp. Publisher: Palgrave Place of Publication: Basingstoke Reviewer: Pamela Pilbeam This substantial volume is about more and less than the title indicates. Jill Harsin, known to specialists of nineteenth-century France for her earlier book, Policing Prostitution in Nineteenth-Century France (Princeton University Press; Princeton, 1985) has here produced a detailed narrative of the role of Paris artisans in revolution and popular unrest between 1830 and 1848. Do not turn to this book for a summary of the historiographical debate. Some of the works of most of the historians who have studied this subject appear in the bibliography, but the author prefers the original sources. The research base is impressive, extensive and rendered with meticulous thoroughness. Her territory is Paris and she has thoroughly studied a good range of newspapers, pamphlets and periodicals. She has ploughed manfully through the Gazette des Tribunaux, which records details of court proceedings, has worked on the extensive police and judicial files in the national archives (CC, BB18 and BB30 – hopefully before the Archives Nationales made life almost impossible for foreign researchers). She has even done some research into the army archives at Vincennes, which has been quite an effort in recent years. Excellent use is made of the multi-volume reprints of contemporary pamphlets and newspapers on nineteenth-century French Revolutions.(1) Memoirs, rather neglected by historians in recent years, have provided intriguing details. -

Masculinity in French Republican Socialist Rhetoric Randolph A
University of Wisconsin Milwaukee UWM Digital Commons Theses and Dissertations December 2018 A New Brand of Men: Masculinity in French Republican Socialist Rhetoric Randolph A. Miller University of Wisconsin-Milwaukee Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/etd Part of the European History Commons Recommended Citation Miller, Randolph A., "A New Brand of Men: Masculinity in French Republican Socialist Rhetoric" (2018). Theses and Dissertations. 2000. https://dc.uwm.edu/etd/2000 This Dissertation is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. A NEW BRAND OF MEN: MASCULINITY IN FRENCH REPUBLICAN SOCIALIST RHETORIC by Randolph Miller A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in History at The University of Wisconsin-Milwaukee December 2018 ABSTRACT A NEW BRAND OF MEN: MASCULINITY IN FRENCH REPUBLICAN SOCIALIST RHETORIC by Randolph Miller The University of Wisconsin-Milwaukee, 2018 Under the Supervision of Professor Carolyn Eichner Social theorist and activist, August Blanqui, used his appearance before court in 1832 to lay out an argument that condemned the present political and economic system and demanded emancipation of the male worker. During his monologue, along with his devastating portrayal of worker misery and systemic corruption, Blanqui made comparisons between the male bourgeoisie and the male proletariat. Recounting the recent overthrow of Charles X for his audience, Blanqui described the “glorious workers” as six feet tall, towering over a groveling bourgeoisie who praised them for their “selflessness and courage.” According to Blanqui, the workers, unlike the aristocracy of wealth who oppressed them, were both physically dominant and selfless—two features that indicated a superior masculinity in the minds of radicals. -

Class Struggle in the First French Republic Bourgeois and Bras Nus 1793-1795
Daniel Guerin Class Struggle in the First French Republic Bourgeois and Bras Nus 1793-1795 translated from the French by Ian Patterson First published in French in 1973 Copyright© Editions Gallimard 1973 This translation first published 1977 by Pluto Press Limited Unit 10 Spencer Court, 7 Chalcot Road, London NWl 8LH Copyright© Pluto Press 1977 ISBN 0 904383 44 X paperback 0 904383 30 X hardback Printed in England by Bristol Typesetting Company Limited Barton Manor, St Philips, Bristol Cover design by David King Contents Translator's Note/ vii Chronology / xi Preface to the English Language Edition / 1 Introduction/ 21 1. The Split to be A voided / 45 2. A Divorce in the Revolutionary Bourgeoisie / 73 3. Providing Support for the Poor I 94 4. Liquidation of the Enrages / 119 5. A Diversion Turns into an Upsurge/ 132 6. The Revolution Makes an About Turn/ 155 7. Strengthening the State/ 176 8. The Fall of the Hebertists / 195 9. Economic Retreat/ 218 10. The Fall of Danton, and its Reverberations / 234 11. Thennidor / 249 12. The Veil is Torn/ 268 Index/ 289 Translator's Note French terms have been translated wherever possible and explanatory phrases inserted where necessary. However, some aspects of revolutionary France demand fuller explanation. Revolutionary administration Under the law of 22 December 1789, which reorganised the electoral system, France was divided into 83 'departements', each of which was administered by an elected Council. Each Council appointed an Executive - or Directory - of eight mem bers, including a procureur-general-syndic who was responsible for the implementation and enforcement of law. -
![Annales Historiques De La Révolution Française, 370 | Octobre-Décembre 2012 [En Ligne], Mis En Ligne Le 01 Décembre 2015, Consulté Le 01 Juillet 2021](https://docslib.b-cdn.net/cover/0439/annales-historiques-de-la-r%C3%A9volution-fran%C3%A7aise-370-octobre-d%C3%A9cembre-2012-en-ligne-mis-en-ligne-le-01-d%C3%A9cembre-2015-consult%C3%A9-le-01-juillet-2021-4320439.webp)
Annales Historiques De La Révolution Française, 370 | Octobre-Décembre 2012 [En Ligne], Mis En Ligne Le 01 Décembre 2015, Consulté Le 01 Juillet 2021
Annales historiques de la Révolution française 370 | octobre-décembre 2012 Varia Édition électronique URL : https://journals.openedition.org/ahrf/12488 DOI : 10.4000/ahrf.12488 ISSN : 1952-403X Éditeur : Armand Colin, Société des études robespierristes Édition imprimée Date de publication : 1 décembre 2012 ISBN : 978-2-200-92762-2 ISSN : 0003-4436 Référence électronique Annales historiques de la Révolution française, 370 | octobre-décembre 2012 [En ligne], mis en ligne le 01 décembre 2015, consulté le 01 juillet 2021. URL : https://journals.openedition.org/ahrf/12488 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.12488 Ce document a été généré automatiquement le 1 juillet 2021. Tous droits réservés 1 SOMMAIRE Articles Le citoyen dans tous ses états : Rousseau au risque de Clio Monique Cottret La politisation des corporations et les révolutions municipales : le cas de Marseille en 1789 Laurent Henry « Des magistrats Républicains ne doivent s’occuper que de votre bonheur » Nathalie Alzas Indépendance, égalité et possession. Saint-Just et le « trinôme républicain » Fabrizio Calorenni Une espérance révolutionnaire en Moravie. L’imaginaire politique et philosophique de trois curés francophiles (1790-1803) Daniela Tinková Un conspirateur républicain-démocrate sous la restauration : Claude-François Cugnet de Montarlot. Origine de l’élaboration d’une culture révolutionnaire Laurent Nagy Thèse Entre textes parisiens et réalités locales : l’administration départementale du Jura (1790-1793) Aline Bouchard Regards croisés Les révolutions à l’épreuve du marché Leora Auslander, Charlotte Guichard, Colin Jones, Giorgio Riello et Daniel Roche Sources Une correspondance sépharade : 1794-96 Helen M. Davies Un inédit de Buonarroti : la « Réplique à la réponse de l’accusateur national » Stéphanie Roza Annales historiques de la Révolution française, 370 | octobre-décembre 2012 2 Comptes rendus Cécile OBLIGI, Robespierre. -

Revolutionary Insurgency and Revolutionary Republicanism
REVOLUTIONARY INSURGENCY AND REVOLUTIONARY REPUBLICANISM: ASPECTS OF THE FRENCH REVOLUTIONARY TRADITION FROM THE ADVENT OF THE JULY MONARCHY THROUGH THE REPRESSION OF THE PARIS COMMUNE SUBMITTED BY: DAVID A. SHAFER DEGREE: PhD COLLEGE: UNIVERSITY COLLEGE LONDON ProQuest Number: 10045641 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10045641 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 ABSTRACT During the greater part of the nineteenth century the French political, social and cultural landscapes continued to reverberate from the echoes of the French Revolution. On one level, the Revolution framed the parameters of political debate. However, on another level the Revolution represented the first time in French history when political activism appeared to open up boundless opportunities for effecting change. In large measure, this was due to the prominence of popular protest in the Revolution and its transformation after 1789. Popular protest was nothing new to France. In fact, it was ingrained in the popular mentalité as a response to grievances. That said, the scope of popular protest during the ancien régime tended to be quite limited and rarely transcended the immediate source of the dispute. -

French Revolution
W'liKEliS,,1NfitJl1lI' 25¢ No. 486 ·e~)(-523 29 September 1989 Smash Apartheid! For Workers Revolution! South Alrica: Blacks Dely Apartheid Elections As South Africa's whites trekked to the polls on September 6 to vote for the racist candidate of their choice, the country's oppressed and disenfran chised black majority registered its vote-and its power-in the factories and streets. Mines, mills, shops and schools were shut down and buses, trains and taxis idled as some two to three million black workers-far more than the number of whites votin-g staged a massive two-day stayaway strike to protest the apartheid elections. The London Independent (7 Septem ber) reported: "With 90 per cent of urban workers estimated to be on strike, Cape Town, like Johannesburg and Durban, was as deserted as on a Sunday, eloquently demonstrating the degree to which the country's economy depends on non-white labour. ... " Once again, the black proletariat has shown it has the power, standing at the head of all the oppressed, to bring down apartheid capitalism. The general strike capped a six-week "defiance campaign" against the apart heidelections. Organized by the Mass September 15-Ten thousand at Johannesburg police headquarters protest state terror against blacks in racist Democratic Movement (MOM), which elections. includes the now-banned United Dem ocratic Front and the Congress of South emergency" imposed three years ago tors, and riot police charged into groups Desmond Tutu and Allan Boesak. Cops African Trade Unions (COSATU), this and a frenzy of murderous repression of schoolchildren -peacefully demon invaded the offices of COSA TU and was the first sustained and most wide called out by National Party president strating, Whipping them with heavy the home of its general secretary, Jay spread wave of anti-apartheid protest F. -
The German Labour Movement, 1830S–1840S: Early Efforts at Political Transnationalism
Journal of Ethnic and Migration Studies ISSN: 1369-183X (Print) 1469-9451 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/cjms20 The German labour movement, 1830s–1840s: early efforts at political transnationalism Jürgen Schmidt To cite this article: Jürgen Schmidt (2019): The German labour movement, 1830s–1840s: early efforts at political transnationalism, Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2018.1554283 To link to this article: https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1554283 © 2019 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group Published online: 15 Jan 2019. Submit your article to this journal Article views: 307 View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=cjms20 JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1554283 The German labour movement, 1830s–1840s: early efforts at political transnationalism Jürgen Schmidt International Research Center “Work and Human Life Cycle in Global Perspective”, Humboldt-University, Berlin, Germany ABSTRACT KEYWORDS It is a key idea that the German Labour Movement originated in the German labour movement; early nineteenth century abroad. In the more liberal atmosphere of political remittances; Paris, Brussels, Geneva and London political refugees and travelling transnationalism; working journeymen came together and founded associations. This turn of class formation; political refugees events should, however, not be seen solely within the analytical framework of class formation but also as part of the civil societal development of a transnational movement that fought for the acceptance of the workers as ‘real citizens’.