L'institutionnalisation De L'opposition: Une Réalité Objective En Quête De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cameroon Assessment
Cameroon COUNTRY REPORT October 2003 Country Information & Policy Unit IMMIGRATION & NATIONALITY DIRECTORATE HOME OFFICE, UNITED KINGDOM Cameroon October 2003 CONTENTS 1. Scope of document 1.1 - 1.4 2. Geography 2.1 - 2.5 3. Economy 3.1 – 3.2 4. History 4.1 – 4.25 Summary of events since independence (1960) 4.1 – 4.22 - Paul Biya Presidency (1982 - Present) 4.5 – 4.12 - Elections (1996-1997) 4.13 – 4.18 - Elections (2002) 4.19 – 4.22 The Bakassi Issue 4.23 – 4.25 5. State Structures 5.1 – 5.39 The Constitution 5.1 – 5.8 - Citizenship and Nationality 5.3 – 5.8 Political System 5.9 – 5.12 - Relationship with Neighbouring Countries 5.12 Judiciary 5.13 – 5.17 Legal Rights/Detention 5.18 – 5.21 - Death Penalty 5.21 Internal Security 5.22 Prisons and Prison Conditions 5.23 – 5.28 Military Service 5.29 – 5.30 - Conscientious Objectors and Deserters 5.30 Medical Services 5.31 – 5.37 - HIV/AIDS 5.32 – 5.34 - Tuberculosis 5.35 - Mental Health 5.36 - People with disabilities 5.37 The Education System 5.37 – 5.39 Cameroon October 2003 6. HUMAN RIGHTS 6.A HUMAN RIGHTS ISSUES 6.1 – 6.59 Overview 6.1 – 6.13 - Arrest and Arbitrary Detention 6.3 – 6.4 - Torture and other Inhumane or Degrading Treatment 6.5 – 6.7 - Disappearances 6.8 - Arbitrary or unlawful killings 6.9 –6.10 - Arbitrary Interference with Privacy 6.11 - 6.12 - Security Forces – Human Rights Training 6.13 Freedom of Speech and the Media 6.14 – 6.25 - Journalists 6.22 – 6.25 Freedom of Religion 6.26 – 6.31 - The Practice of Witchcraft 6.31 Freedom of Assembly and Political Association 6.32 -
![Writing from the Margins [13 June 2018, Mougoue]](https://docslib.b-cdn.net/cover/7259/writing-from-the-margins-13-june-2018-mougoue-907259.webp)
Writing from the Margins [13 June 2018, Mougoue]
THIS IS A WORK IN PROGRESS. PLEASE DO NOT CITE OR CIRCULATE WITHOUT PERMISSION FROM THE AUTHOR C'EST UN TRAVAIL EN COURS DE RÉALISATION. VEUILLEZ NE PAS CITER OU FAIRE CIRCULER SANS LA PERMISSION DE L'AUTEUR WRITING FROM THE MARGINS: POLITICAL MASCULINITIES AND SEPARATIST (AUTO) BIOGRAPHIES IN CAMEROON (ECRIRE DES MARGES: LES MASCULINITÉS POLITIQUES ET LES (AUTO) BIOGRAPHIES SÉPARATISTES AU CAMEROUN) Jacqueline-Bethel Tchouta Mougoué, Baylor University Anglophone human rights activist Albert Mukong described his six-year imprisonment from 1970 to 1976 in his 2009 biography, Prisoner without a Crime, in painstaking detail.1 He describes his prison gendarmes as lawless and bent on humiliation; he describes frequent beatings, intimidation, and mental torture. He shares that one brutal beating from a gendarme left him hospitalized for days because he had refused to embrace President Ahidjo’s political party.2 But before all this he describes the soldier who escorted him to the capital into the custody of the Brigade Mixte Mobile, Ahidjo’s paramilitary secret police of Cameroon, thus: “[H]e was very civil and respectable in his conduct, maybe because he was Anglophone and also from Bamenda. He comported himself rather more [as] a bodyguard than a police escort for a detainee.”3 Mukong’s autobiography cast issues of Anglophone political identity and dignity within the framework of ongoing Anglophone social and political marginalization during the first two decades of Cameroon’s independence from British and French European rule. Historicizing the lives of such men illuminates individual agency and highlights how past events shaped the ideas and understanding of the world in which they lived. -

Le "Problème Anglophone" Au Cameroun Dans Les Années 1990
P. KONINGS Le U problème anglophone 11 au Cameroun dans les années I990 EPUIS peu, le (( problsme anglophone )) est devenu un pro- blème crucial pour 1’Etat camerounais postcolonial soucieux D de forger un Etat-nation stabilisé. Ce problème remonte à 1961 quand les élites politiques de deux territoires avec des legs coloniaux différents - l’un françai: et l’autre britannique - sont tombés d’accord pour former un Etat fédéral. Contrairement aux attentes des anglophones, le fédéralisme n’a pas permis une parité stricte pour ce qui concerne leur héri- tage culturel et ce qu’ils considèrent coinme leur identité d’anglo- phone. I1 s’est révélé n’être qu’une phase tran$toire de l’intégra- tion totale de la région anglophone dans un Etat unitaire forte- ment centralisé. Cette situation a graduellement favorisé une prise de conscience anglophone fondée sur le s5ntiment d‘être (( margi- nalisé D, (( exploité D et (( assimilé )> par un Etat dominé par les fran- cophones. Avec le processus de libéralisation politique des années 1990, une partie de l’élite anglophone s’organise pour protester contre sa prétendue position subordonnée et demande: une plus grande autonomie en réclamant d’abord le retour à 1’Etat fédéral et en adoptant ensuite des positions sécessionnistes devant le refus du régime de discuter d’une réforme constitutionnelle. Elle a par ailleurs essayé d’obtenir une reconnaissance internationale en se présentant comme une minorité opprimée dont le territoire a été (( annexé D. En réponse à ce défi, le gouvernement de M. Biya a minimisé, voire nié le (( problème anglophone n. -

Chronology of British Southern Cameroons Aka AMBAZONIA History
Chronology of British Southern Cameroons aka AMBAZONIA History 1884 to 1916 – German Occupation German Governors of German Kamerun 1884 Gustav Nachtigal 1887–1906 Jesko von Puttkamer - Built a 72-Bedroom home in Buea, Kamerun to convince his wife to move from Germany. The building still stands today. 1914–1916 Karl Ebermaier Cameroons - German Kamerun was an African colony of the German Empire from 1884 to 1916 comprising parts of todays' Cameroon, + parts of Nigeria, Tchad, Central African Republic, Congo, Gabon Most of German Kamerun shared between Britain and France 1914 - 26 September 1914 Occupation by Great Britain and France begins 1945 - Post World Wars - League of Nations => United Nations - Decolonization begins 1948 - UPC (Union des Populations Camerounaises) a party that wanted Independence from France with no strings IS CREATED in French Cameroun Actors: British Cameroons Colonial Officer i/c 1949 to 1 October 1954 Edward John Gibbons, Special Resident 1 October 1954 Autonomous territory within Colony and Protectorate of Nigeria 1 October 1954 to 1956 Edward John Gibbons, Commissioner 1956 to 1 October 1961 John Osbaldiston Field, Commissioner 1 June 1961 Northern British Cameroons incorporated into Federation of Nigeria 1 October 1961 Southern British Cameroons incorporated into Republic of Cameroon 1952 - The KNC (Kamerun National Congress) was established in 1952 as a merger of two pro- unification parties, the Kamerun United National Congress and the Cameroons National Federation. The party's leaders included E. M. L. Endeley, Salomon Tandeng Muna, John Ngu Foncha and Sampson George. However, with Endeley leading the party towards a pro-Nigerian stance, 1955 - Foncha led a breakaway group to form the Kamerun National Democratic Party (KNDP) in 1955. -
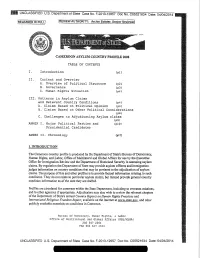
C. Challenges to Adjudicating Asylum Claims (P9) ANNEX T
of State 634 ~J::~ASED IN FULL] CAMEROON ASYLUM COUNTRY PROFll.,E 2008 TABLE OF CONTENTS r. Introduction (pI) II. Context and Overview A. Overview of Political Structure (p2) B. Governance (p3) C. Human Rights Situation (p4) III. Patterns in Asylum Claims and Relevant Country Conditions (p4) A. Claims Based on Political Opinion (p4) B. Claims Based on Other Political Considerations (p6) C. Challenges to Adjudicating Asylum claims (p9) ANNEX T. Major Political Parties and (pIO) Presidential Candidates ANNEX II. Chronology (pI2) I. INTRODUCTION The Cameroon country profile is produced by the Department of State's Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Office of Multilateral and Global Affairs for use by the Executive Omce for Immigration Review and the Department of Homeland Security in assessing asylum claims. By regulation the Department nfState may provide asylum officers. and immigration judges information on country conditions that may be pertinent to the adjudication of asylum claims. The purpose of this and other profiles is to provide factual information relating to such conditions. They do not relate to particular asylum claims, but instead provide general country condition information as of the date they are drafted. Profiles are circulated for comment within the State Department, including to overseas missions, and to other agencies if appropriate. Adjudicators may also wish to review the relevant chapters oflhe Department of State's annual Country ReporlS on Human Rights Practices and International Religious Freedom Report. available: on the lnternet at www.statc.gov) and other publicly available materials on conditions in Cameroon. Bureau of Dem~cracy, Hu.'1.ian Rights, t. -

Cameroon's Neopatrimonial Dilemma
Research Collection Working Paper Cameroon's neopatrimonial dilemma Author(s): Gabriel, Jürg Martin Publication Date: 1998 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-001990933 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Jürg Martin Gabriel Cameroon's Neopatrimonial Dilemma Beiträge Nr. 20 / August 1999 2., erweiterte Auflage Forschungsstelle für Internationale Beziehungen Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Table of Contents Introduction....................................................................................................................... 1 1. Politics ................................................................................................................................ 3 2. Economics ........................................................................................................................ 12 3. Public Administration..................................................................................................... 17 4. Neopatrimonialism and Cameroon................................................................................ 22 About the Author Jürg Martin Gabriel is currently Professor of International Relations at the Swiss Federal Insti- tute of Technology (Center for International Studies, CIS) in Zurich, Switzerland. He was previously a Professor of International Relations at the University of St. Gallen, -

PDF Download
Ethnicite et pouvoir au Nord-Cameroun1 ParIbrahim Mo uiche «Le Cameroun se reveJe une terre de la multiplicite et de la division socio-histo rique, le Heu des rendez-vous d'une variete insoup�onnable des forces centrifugeset antagonistes crampant face a face en une sorte de veillee d'armes permanente ou 2 l'evidence des particularismes est par trop evidente.» Centre de gravite du continent africain, le Cameroun ainsi que le decrit si bien Jean 3 Imbert , peut etre considere comme une Afrique en reduction et son etude est particuliere ment benetique pour qui veut s'initier aux problemes africains. Car, au point de jonction des regions geographiques occidentale, septentrionale et centrale, le territoire camerounais est le carrefour ou se rencontrent trois importantes regions culturelles: la Cöte du Guinee avec ses peuplades negritiques, le Soudan Occidental avec les Peuls et les peuplades arabes, le Congo avec les peuples de langue bantou. L'extreme complexite de la configura tion ethnique est a l'image de celle de I'Afrique. C'est pour cette raison que certains auteurs utilisent l'expression «Habit d'Arlequim> pour caracteriser une teile diversite. En fait, le Cameroun rappelle etrangement l'ex-Yougoslavie dont la situation peu enviable 4 peut se resumer en quelques chiffres ainsi que le stigmatise M. Jean-Pierre Fogui : deux alphabets (latin et cyrillique), trois grandes religions (orthodoxe, catholique et musulmane), cinq nationalites (Serbe, Croate, Slovene, Macedonienne et Montenegrine), six Republi ques (Serbie, Croatie, Macedoine, Montenegro, Bosnie-Herzegovine), sept voisins (Italie, Autriche, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Grece et Albanie). Le «Nord» du Cameroun est une zone de prairie tropieale au cIimat soudano-sahelien qui ne presente aue une unite geographique. -

Deuxième Partie
DEUXIÈME PARTIE L’INVENTAIRE DES PARTICULARITÉS LEXICALES 51 Signes et abréviations utilisés () encadre l’origine de la lexie […] indique une coupure dans la citation 1, 2, 3 : numéros correspondant aux unités de sens et de classes syntaxiques dans un article adj. qual. : adjectif qualificatif adv. : adverbe dir. : direct f. : féminin hist. : historique interj. : interjection intr. : intransitif loc. : locution m. : masculin n. : nom pr. : pronominal syn. : synonyme tr. : transitif v. : verbe verb. : verbal voc. : vocabulaire 53 A À quelle heure ! Loc. « Trop tard ! » Affaire n. f. « Activité rapportant de (Avec raillerie) ; « c’est nul ». l’argent de manière plus ou moins - tu n’as pas vu le radar ? légale ». Le frisson est grand, et dans - A quelle heure ! Dis donc laisse ces le monde des affaires, on a mis la choses des blancs. Il faut voir l’état de pédale douce face à l’incertitude nos routes. (Challenge Hebdo, n° 50, grandissante. (Le Popoli, n° 133, 1991 : 4). 2004 : 3). La CAN, c’est du bonheur L’ONEL a enfin décidé de publier le sans mélange pour beaucoup d’hom- rapport de la présidentielle 2004. À mes. Pas parce qu’ils ont l’occasion de quelle heure ! Alors que j’ai déjà vivre une passion, de vibrer en même bouffé jusqu’à ce que je calcule même temps que les filets quand un but est déjà le point d’achèvement du marqué. Non. La CAN offre la pos- Mandat ? (La Nouvelle Expression, n° sibilité de faire les affaires. (Came- 1728, 2006 : 3). Fréquent. roon tribune, n° 9019/5218, 2008 : 2). Fréquent. -

REVUE QUOTIDIENNE DE LA PRESSE Édition Du 25/02/16
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix – Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland ********** ********** MINISTERE DU TRAVAIL MINISTRY OF LABOUR ET DE LA SECURITE SOCIALE AND SOCIAL SECURITY ********** ********** SECRETARIAT GENERAL SECRETARIAT GENERAL ********** ********** CELLULE DE LA COMMUNICATION COMMUNICATION UNIT ********** ********* N°_____________/MINTSS/SG/CC/CEA1/CEA2 Yaoundé, le_____________ REVUE QUOTIDIENNE DE LA PRESSE Édition du 25/02/16 « Bonjour Augustes Lecteurs ! » QUELQUES UNES DES JOURNAUX PARUS CE MATIN APPELS A LA CANDIDATURE DE PAUL BIYA : L’UNDP, le MDR, l’ANDP et le FSNC DANS L’EMBARRAS (L’œil du Sahel). CHEFS TRADITIONNELS, SYNDICALISTES, DIPLÔMES DE L’ENAM…LES APPELS INSOLITES (Le Jour). RDPC : ILS ONT TENU TÊTE A PAUL BIYA (Mutations). ASSEMBLEE GENERALE DES AVOCATS : LE DOSSIER BRÛLANT DES ANGLOPHONES (La Nouvelle Expression). PORT AUTONOME DE DOUALA : LA LISTE DES 10 HAUTS CADRES CONVOQUÉS AU CONSUPE (Quotidien Emergence). OPERATION EPERVIER : GERVAIS MENDO ZE RECLAME 23 MILLIONS A LA CRTV (Le Quotidien de l’Economie). OPERATION EPERVIER : NKOTTO EMANE AVALE 9 MILLIARDS EN 5 ANS (La Météo). FERMETURE DE L’AEROPORT DE DOUALA : NSIMALEN PREND LE RELAIS (Cameroon Tribune). IBRAHIM MBOMBO NJOYA : LE MONARQUE QUI DEFIE LE PRINCE (Le Messager). COMMERCE INTRA-REGIONAL : L’AFRIQUE CENTRALE AU BAS DE L’ECHELLE (Le Quotidien de L’Economie). CACAO : TELCAR COCOA ET OLAM DOMINENT LES EXPORTATIONS (La Voix du Paysan). ELECTION A LA PRESIDENCE DE LA FIFA : TOMBI A ROKO SIDIKI ELECTEUR (Le Messager). DEVELOPPEMENT DE QUELQUES TITRES : POLITIQUE : APPELS À LA CANDIDATURE DE PAUL BIYA : L’UNDP, LE MDR, L’ANDP ET LE FSNC DANS L’EMBARRAS L’ŒIL DU SAHEL : Depuis quelques semaines, des motions et autres déclarations invitant le chef de l’Etat, par ailleurs président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), à se présenter lors du prochain scrutin présidentiel fusent de toutes parts à travers la République. -

Cameroon Version 4 Clean#2
CAMEROON ASSESSMENT October 2000 Country Information and Policy Unit CONTENTS I SCOPE OF DOCUMENT 1.1 - 1.5 II GEOGRAPHY 2.1 - 2.3 III HISTORY Recent Political History 3.1 - 3.17 The Economy 3.18 - 3.22 IV INSTRUMENTS OF THE STATE The Government 4.1 - 4.11 The Security Forces 4.12 - 4.14 The Judiciary 4.15 - 4.20 V HUMAN RIGHTS: GENERAL SITUATION 5.1 - 5.9 VI HUMAN RIGHTS: SPECIFIC ISSUES AND SPECIFIC GROUPS Freedom of Assembly and Association 6.1 - 6.2 Freedom of Speech and the Media 6.3 - 6.5 Freedom of Religion 6.6 - 6.11 Freedom of Travel 6.12 - 6.14 The Right of Citizens to Change Their Government 6.15 - 6.18 Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Punishment 6.19 Arbitrary Arrest and Detention 6.20 Interference with Privacy 6.21 - 6.23 Minorities and Ethnic Groups 6.24 - 6.31 Trade Unions and Workers Rights 6.32 - 6.34 1 Human Rights Groups 6.35 - 6.36 Women 6.36 - 6.41 Children 6.42 - 6.45 Treatment of Refugees 6.46 - 6.48 ANNEX A: POLITICAL ORGANISATIONS Pages 19 - 22 ANNEX B: PROMINENT PEOPLE Page 23 ANNEX C: CHRONOLOGY Pages 24 - 27 ANNEX D: BIBLIOGRAPHY Pages 28 - 29 I SCOPE OF DOCUMENT 1.1 This assessment has been produced by the Country Information and Policy Unit, Immigration and Nationality Directorate, Home Office, from information obtained from a variety of sources. 1.2 The assessment has been prepared for background purposes for those involved in the asylum determination process. -

ENTRE L'intérim ET LE DAUPHINAT Emmanuel MOUBITANG
LA SUCCESSION CONSTITUTIONNELLE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN : ENTRE L’INTÉRIM ET LE DAUPHINAT Emmanuel MOUBITANG ISSN 2276-5328 Article disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.revue-libre-de-droit.fr Comment citer cet article - How to cite this article: E. MOUBITANG : « La succession constitutionnelle du Président de la République du Cameroun : entre l’intérim et le dauphinat », Revue libre de Droit, 2019, pp. 14-50. © Revue libre de Droit Revue libre de Droit E. MOUBITANG La succession constitutionnelle du Président de la République du Cameroun : entre l’intérim et le dauphinat LA SUCCESSION CONSTITUTIONNELLE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN : ENTRE L’INTÉRIM ET LE DAUPHINAT Emmanuel Moubitang 1 Résumé : Toute succession engendre une guerre entre les prétendants en vue de gagner les faveurs de l'arbitre de la succession. Ainsi, les guerres de succession peuvent créer des fissures profondes au sein de l'appareil de l'État et du parti au pouvoir. La technique successorale avait été opportunément adoptée au début des années 1980 par des chefs d’États africains préoccupés par la survie des régimes qu'ils avaient bâtis. Au Cameroun, en cas de vacance de la Présidence de la République, « l’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, par le Président du Sénat ». Toutefois, la succession étant considérée comme un véritable « test de stabilité des régimes en développement », une question s’impose : entre l’intérim présidentiel et le dauphinat constitutionnel, quel est le modèle successoral susceptible de garantir la paix et la stabilité politique du Cameroun, en cas d'empêchement définitif du Chef de l'État Paul BIYA, âgé de 86 ans et visiblement sous le coup de l'usure du pouvoir ? L’analyse des compétences de l’intérimaire, les leçons du passé et surtout les affres de la crise socio-politique actuelle militent en faveur de sa disqualification au profit d’un Vice-président, dauphin constitutionnel. -

Opposition Politics and Electoral Democracy in Cameroon, 1992-2007
Africa Development, Vol. XXXIX, No. 2, 2014, pp. 103 – 116 © Council for the Development of Social Science Research in Africa, 2014 (ISSN 0850-3907) Opposition Politics and Electoral Democracy in Cameroon, 1992-2007 George Ngwane* Abstract This article seeks to assess the impact of electoral democracy in Cameroon especially in terms of the performance of the Opposition between 1992 and 2007, evaluate the internal shortcomings of opposition parties, and make a projection regarding a vibrant democratic space that will go beyond routine elections to speak to the issues preoccupying the Cameroonian masses. Résumé Cet article vise à évaluer l’impact de la démocratie électorale au Cameroun en particulier en termes de performance de l’opposition entre 1992 et 2007, à évaluer les lacunes internes des partis d’opposition, et à faire une projection concernant un espace démocratique dynamique qui ira au-delà des élections ordinaires pour aborder les questions qui préoccupent les masses camerounaises. Introduction The political history of modern Cameroon can be divided into four periods. The first was the period of total dependence on the colonial power which extended from 1884 to 1945 during which the country did not possess representative institutions. The second period stretched from 1945 to 1960/ 61 during which Cameroonians passed their apprenticeship in democracy. The third started on 1st January 1960, with the proclamation of independence in French Cameroon and the reunification of West and East Cameroons in 1961 in a federal structure, and the fourth saw the light of day on 20 May 1972 when the federal structure was abolished in what the then Head of State, Ahmadou Ahidjo termed the ‘Peaceful Revolution’ (Sobseh Emmanuel 2012:88).