Cahiers Balkaniques, 44
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Christians and Jews in Muslim Societies
Arabic and its Alternatives Christians and Jews in Muslim Societies Editorial Board Phillip Ackerman-Lieberman (Vanderbilt University, Nashville, USA) Bernard Heyberger (EHESS, Paris, France) VOLUME 5 The titles published in this series are listed at brill.com/cjms Arabic and its Alternatives Religious Minorities and Their Languages in the Emerging Nation States of the Middle East (1920–1950) Edited by Heleen Murre-van den Berg Karène Sanchez Summerer Tijmen C. Baarda LEIDEN | BOSTON Cover illustration: Assyrian School of Mosul, 1920s–1930s; courtesy Dr. Robin Beth Shamuel, Iraq. This is an open access title distributed under the terms of the CC BY-NC 4.0 license, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided no alterations are made and the original author(s) and source are credited. Further information and the complete license text can be found at https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ The terms of the CC license apply only to the original material. The use of material from other sources (indicated by a reference) such as diagrams, illustrations, photos and text samples may require further permission from the respective copyright holder. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Murre-van den Berg, H. L. (Hendrika Lena), 1964– illustrator. | Sanchez-Summerer, Karene, editor. | Baarda, Tijmen C., editor. Title: Arabic and its alternatives : religious minorities and their languages in the emerging nation states of the Middle East (1920–1950) / edited by Heleen Murre-van den Berg, Karène Sanchez, Tijmen C. Baarda. Description: Leiden ; Boston : Brill, 2020. | Series: Christians and Jews in Muslim societies, 2212–5523 ; vol. -

The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times
PROJEKT OKLADKI AKCEPT 2 pop:Layout 1 11/19/15 6:14 PM Page 1 The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges Our Times: Frontiers Humanity The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times: the Fron tie rs of HUMANITY International Interdisciplinary Doctoral Programme 2010-–2015 FREE COPY Project co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Programme Innovative Economy Faculty of “Artes Liberales” University of Warsaw The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times: the Frontiers of Humanity International Interdisciplinary Doctoral Programme 2010–2015 Warsaw 2015 Tis work was prepared within the project „Te Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times: the Frontiers of Humanity” supported by the Foundation for Polish Science – International PhD Programme, co-fnanced by the European Union within the European Regional Development Fund. Translation into English and proofreading Janina Surowiec and Christopher Culver Cover design Monika Ozdarska Typeseting Michał Kucharski All photos printed on the back cover and inside kindly provided by the Participants or downloaded from the ofcial website of the Programme (www.mpd.al.uw.edu.pl). © Faculty of “Artes Liberales,” University of Warsaw and the Authors, 2015 Faculty of “Artes Liberales” Nowy Świat 69 00-046 Warszawa www.al.uw.edu.pl Printed and bound by Zakład Grafczny Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa no. 906/2015 Contents Introductory note -

Diploma Work of Shabani Silvana and Hotza Cleyda
DIPLOMA WORK OF SHABANI SILVANA AND HOTZA CLEYDA SUPERVISED PROFESSOR : GIOURIS THEODORE PROLOGUE This paper addresses the issue of the National Bank of Greece, focusing on issues such as the course of time, from its inception until today and the ways in which its business activities affect the economic life of the country. The main analysis will be based on two pillars: a throwback to the proceedings of this financial institution from the first payment will be made, and then record all the ways of corporate governance. The completion of this work included the online survey and study of relevant articles and books, which will be listed at the end of the essay, the piece of literature. [2] CONTENTS PROLOGUE ............................................................................................................................ 2 CONTENTS............................................................................................................................. 3 IMPORT ................................................................................................................................. 4 CHAPTER 1: HISTORY OF THE NATIONAL BANK ...................................................................... 5 1.1Establishment ............................................................................................................... 5 1.2The period until the First World War ............................................................................. 5 1.3The period until the Second World War ....................................................................... -

La Liste Des Résistants Du Mouvement Libération-Nord
NOM (PSEUDO) PRENOM RESEAU/MOUVEMENT LIEU D’ACTIVITE DATE (ET LIEU) DE (FONCTION ET PROFESSION) NAISSANCE Marcel Eleuthère (fév 1944) Adrian Robert Libération-Nord (a participé à Marne 02/05/1897 à des attentats au dépôt de Anould (Vosges) Reims en décembre 1943), cheminot « Bonhomme » « Jacqueline » « Greffier » Eleuthère (avril 1943) « Jean le Nantais » Libération-Nord Cholet « Nord » Brouillard « Pierre », Colonel Eleuthère Région parisienne 15/04/1900, le André Cateau-Cambrésis (Nord) « Tardy » « Monique » « Thabut » ou « Tabut », Capitaine Solange, Eleuthère, première adjointe 08/06/1913, de son vrai nom Ferré de Jéhanne, Marie, du commandant Hubert de Ancenis (Loire- Bourgogne Léone Lagarde, du 01/10/1942 au Atlantique) 17/12/1943, arrêtée, le 17/12/1943, déportée en 1944, rapatriée, elle deviendra liquidateur bénévole du réseau Abadie Jeanne, Marie- Eleuthère, assistante sociale et 15/12/1911 à Joseph infirmière Montluçon Abeloos Paul, Hubert Eleuthère, ingénieur principal, 28/03/1899 à Paris chef de la division des Etudes, région du Sud-Ouest à la SNCF, membre du réseau Jade Abraham Hélène Libération-Nord Manche Absil, « Ceylan » Jean,Emmanuel Eleuthère (nov 1943), adjoint Saint-Quentin (Aisne) 04/10/1905 à au chef de sous-réseau de nov Amiens 1943 au 30/09/1944, moniteur d'E.P. 1 Acard Lydie Libération-Nord Seine-Inférieure Acarin Arthur Cohors Flandre occidentale, Belgique Acarin Marie-Jeanne Achaintre Robert Libération-Nord Manche Achiary Henriette Brutus, disparue Toulouse Ackermann Maurice Agent technique Seine Acreman Honoré, Gustave Libération-Nord, cultivateur Aube Adam Commandant Jacques Adam Georges Cinéaste Seine Adam Henri, Edouard Eleuthère, Fondateur du Champagne-Ardenne groupe Libé-Nord, fin 1942. -

Greece During the Second World War
GREECE DURING THE SECOND WORLD WAR It is indeed an unusual experience for an ancient historian to lecture on a theme of contemporary history. The experience is doubtless valuable for the ancient historian. Its value for contemporary historY may be most charitably regarded as indeterminate. Historians present will, I am sure, agree that the profession is beset with obstacles, frustrations and difficulties. But there is one difficulty which the ancient historian can assume he will not encounter; that is, to have his assertions challenged by eyewitnesses to the actual events. In this room there are indeed such eyewitnesses. Among them are Professor William H. McNeill, who wrote the first good and responsible book on Greece during the Second War,1 and Professor D.George Kousoulas, whose really admi rable historY of the Greek Communist partY is of a significance far exceeding the specifically Greek context.2 To both these scholars this lecture is greatly indebted. Those familiar with this period of Greek historY are aware of its fantastic complexity. This complexity explains the over-simplified and dogma tic character of what follows. The First World War was ignited by an incident in the Balkans. The Second World War was not. Throughout the difficult and increasingly dangerous years from 1918 to 1939 the Balkan nations, both victors and vanquished, faced extraordinary difficulties — the acquisition of new territories or the loss of old, the problems of minorities and exchanges of population, industri al and technological backwardness, the legacy of centuries of Ottoman rule, with the resulting economic difficulties which in turn produced increasing social unrest. -

Atatürk Döneminde Türkiye-Yunanistan Ilişkileri, 1923-1938
ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ, 1923-1938 Bestami S. BİLGİÇ* ÖZET Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük oranda 1919-1922 yılları arasında Yunanistan’a karşı yapılan bir savaş sonrasında kurulabilmiştir. 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması’yla Atina ile Ankara aralarındaki savaşa bir son vermiş ve barışı tesis etmeye çalışmışlardır. Ancak bir antlaşma imzalanmış olmasına rağmen iki ülke arasındaki ilişkiler normalleşmemiştir. Özel- likle Lozan’da hükme bağlanan nüfus mübadelesinin uygulanmasından kaynaklanan sorunlar- dan dolayı iki ülke arasındaki ilişkiler gerilimli bir seyir takip etmiştir. Daha sonra özellikle iki devlet adamının, Türkiye adına Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Yunanistan adına Eleftherios Venizelos’un girişimleri sayesinde 1930 yılından itibaren Türkiye ile Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri kurulabilmiştir. Atatürk’ün 1938 yılındaki vefatına kadar Türkiye ile Yu- nanistan kalıcı dostluk tesis edilmesi adına çaba göstermişler ve aralarındaki barışı tüm Balkan coğrafyasına teşmil etmeye çalışmışlardır. Anahtar Kelimeler: Atatürk, Venizelos, Türkiye, Yunanistan. * Doç. Dr., İpek Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara, TÜRKİYE. bsbilgic@ipek. edu.tr BESTAMİ S. BİLGİÇ 2 Bahar - 2015 TURKISH - GREEK RELATIONS IN ATATÜRK PERIOD, 1923 - 1938 ABSTRACT The Turkish Republic was founded after an arduous struggle against invading Greek forces between the years of 1919 and 1922. With the conclusion of the Lausanne Treaty in 1923, Ankara and Athens aimed at establishing peace amongst them. Even though a treaty was signed, norma- lization of bilateral relations did not ensue. Tense atmosphere persisted mainly due to problems that arose during the implementation of the exchange of populations which was part of the larger Lausanne settlement. Later on, nonetheless, starting with the year of 1930, good neighborly rela- tions between the two countries were established mainly thanks to endeavors of two statesmen, namely Mustafa Kemal Atatürk and Eleftherios Venizelos. -

George C. Bitros
WORKING PAPER SERIES 06-2017 Germany and Greece: A mapping of their great divide and its EU implications George C. Bitros Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203303‐5 / Fax: 210 8238249 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203303‐5 / Fax: (+30) 210 8238249 E‐mail: [email protected] / www.aueb.gr 1 Germany and Greece: A mapping of their great divide and its EU implications By George C. Bitros Emeritus Professor of Political Economy Athens University of Economics and Business Abstract The economic constitutions of Germany and Greece have resulted in the postwar period in two economies that are based on two vastly different philosophies. Germany has built a highly competitive, outward looking economy based essentially on the principles of the so-called “Social Market Economy”, whereas Greece has set up a “state-managed econ- omy” by drawing on the principles of central planning and administrative controls. This divide is equally stark, if assessed on the basis of the performance of the two economies. For, as it is known by now, Germany has become once again the powerhouse of Europe while Greece has gone bankrupt. As to the implications of this great divide for the future of the EU, its identification and mapping helps understand why convergence criteria on the basis of economic performance and living standards should be abandoned in favor of criteria based on the widening and deepening of the four European freedoms. A multi- speed Euroland enmeshed in these freedoms is going to be more democratic, more cohe- sive and a much happier union for the European citizens to call homeland. -

Pro-Contra VOL 3 P-Z.Indd
FUNDAfiIA EUROPEANÆ TITULESCU Pro øi Contra T I T U L E S C U Lucrare apærutæ cu sprijinul Administrafliei Fondului Cultural Naflional Pro øi Contra T I T U L E S C U ediflia a II°a revæzutæ øi adæugitæ Ediflie îngrijitæ, selecflie, cuvânt înainte øi postfaflæ, note biografice, adnotæri øi explicaflii, indice de GEORGE G. POTRA Volumul III FUNDAfiIA EUROPEANÆ TITULESCU Bucureøti, 2012 Redactor: Ana Potra Coperta: Victor Potra Culegere computerizatæ: Ana Potra Tehnoredactare: Ofelia Coøman Descrierea CIP a Bibliotecii Naflionale a României Pro øi contra Titulescu / ed. îngrijitæ, selecflie, cuvânt înainte øi postfaflæ, note biografice, adnotæri øi explicaflii, indice de George G. Potra. Ed. a 2a, rev. Bucureøti : Editura Fundaflia Europeanæ Titulescu, 2012 3 vol. ISBN 9786068091136 Vol. 3. 2012. Bibliogr. Index. ISBN 9786068091174 I. Potra, George G (ed. øt.) 94(498)”19” Titulescu,N. ISBN GENERAL: 978°606°8091°13°6 ISBN: 9786068091174 © Toate drepturile asupra prezentei ediflii aparflin autorului Idealul Creator vrea ca Împæræflia Cerurilor care este în noi sæ se realizeze în jurul nostru în lumea vizibilæ a materiei. Idealul Creator nu se mulflumeøte sæ sædeascæ în sufletul omenesc germenul credinflei întro viaflæ viitoare, unde înflelepciunea îøi va da mâna cu bunætatea; el cere mai ales eforturile necesare, oricât de mari ar fi ele, pentru a integra în materie toate elanurile instinctive ale sufletului omenesc înspre frumos øi înspre bine, pe care nu este de ajuns sæ le întrevedem, ci trebuie sæ øtim sæ le creæm! Idealul Creator nu face deosebire între spirit øi materie; el vede în cel dintâi geniul sculptorului, iar în cea dea doua marmura care se lasæ ølefuitæ pentru ca sæ aparæ în plinæ luminæ frumosul, ascuns mai înainte în stræfundurile sufletului omenesc.! Nicolae Titulescu J. -

Vol. 9, No. 2, Autumn 1974
Prtce 25 pence ~-~--- ~- -- -~--~~---- PAPERBACKS .. 28 Charlotte St 'I Mon, Tues, Wed, Thurs , 9 a, m.-6 p.m. London W1 I >~~~ Fri 9 a.m.-7.30 p.m. I!;;ii;.... Sat 9 a.m.-5 p.m. BOOKS PERIODICAlS NEWSPAPERS ,Come in and browse aroundl No obligation to buyl ] GOODGE ST _----'_ +TUBE We I.k forward TOTTENHAM CT RD to seeing vou! A JOURNAL OF INTERNATIONAL MARXISM VOLUME9 NUMBER2 AUTUMN 1974 EDITORS: TOM KEMP, CLIFF SLAUGHTER 51 Editorial Individuals and social relations: 53 Cyril Smith some observations on Marx's Grlllldrisse History of the Greek Civil War (part iii) 61 Greek Section of the Ie of the FI Book review: Strikes in FrWlQ; 85 Tom Kemp Manifesto of the International Committee 88 International Committee 7.7.74 Greece and Cyprus: a new stage of World Crisis 92 International Committee 6.9.74 PUBLISHED BY THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE FOURTH INTERNATIONAL 186A CLAPHAM HIGH STREET, LONDON, SW4 1UG. In tmlay's conditions of capitalist crisis, only the International Committee of the Fourth International stands on a record of fighting for revolutionary leadership in the working class. To carry forward this struggle now, when every revisionist tendency is striving to turn the working class back into the arms of the bureaucracy, an understanding of its history is essential. Founded in 1938 in conditions of crushing defeat for the working class, persecuted by the ruling class and the Stalinists, the F~urth International has survived only by the most ruthless struggle against liquidationism in its own ranks. These ff!ur volumes bring together the major documents of the struggle for Marxism, from 1951 onwards. -

The Unique Cultural & Innnovative Twelfty 1820
Chekhov reading The Seagull to the Moscow Art Theatre Group, Stanislavski, Olga Knipper THE UNIQUE CULTURAL & INNNOVATIVE TWELFTY 1820-1939, by JACQUES CORY 2 TABLE OF CONTENTS No. of Page INSPIRATION 5 INTRODUCTION 6 THE METHODOLOGY OF THE BOOK 8 CULTURE IN EUROPEAN LANGUAGES IN THE “CENTURY”/TWELFTY 1820-1939 14 LITERATURE 16 NOBEL PRIZES IN LITERATURE 16 CORY'S LIST OF BEST AUTHORS IN 1820-1939, WITH COMMENTS AND LISTS OF BOOKS 37 CORY'S LIST OF BEST AUTHORS IN TWELFTY 1820-1939 39 THE 3 MOST SIGNIFICANT LITERATURES – FRENCH, ENGLISH, GERMAN 39 THE 3 MORE SIGNIFICANT LITERATURES – SPANISH, RUSSIAN, ITALIAN 46 THE 10 SIGNIFICANT LITERATURES – PORTUGUESE, BRAZILIAN, DUTCH, CZECH, GREEK, POLISH, SWEDISH, NORWEGIAN, DANISH, FINNISH 50 12 OTHER EUROPEAN LITERATURES – ROMANIAN, TURKISH, HUNGARIAN, SERBIAN, CROATIAN, UKRAINIAN (20 EACH), AND IRISH GAELIC, BULGARIAN, ALBANIAN, ARMENIAN, GEORGIAN, LITHUANIAN (10 EACH) 56 TOTAL OF NOS. OF AUTHORS IN EUROPEAN LANGUAGES BY CLUSTERS 59 JEWISH LANGUAGES LITERATURES 60 LITERATURES IN NON-EUROPEAN LANGUAGES 74 CORY'S LIST OF THE BEST BOOKS IN LITERATURE IN 1860-1899 78 3 SURVEY ON THE MOST/MORE/SIGNIFICANT LITERATURE/ART/MUSIC IN THE ROMANTICISM/REALISM/MODERNISM ERAS 113 ROMANTICISM IN LITERATURE, ART AND MUSIC 113 Analysis of the Results of the Romantic Era 125 REALISM IN LITERATURE, ART AND MUSIC 128 Analysis of the Results of the Realism/Naturalism Era 150 MODERNISM IN LITERATURE, ART AND MUSIC 153 Analysis of the Results of the Modernism Era 168 Analysis of the Results of the Total Period of 1820-1939 -
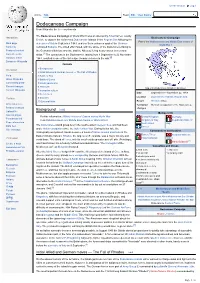
Dodecanese Campaign from Wikipedia, the Free Encyclopedia
Create account Log in Article Talk Read Edit View history Dodecanese Campaign From Wikipedia, the free encyclopedia The Dodecanese Campaign of World War II was an attempt by Allied forces, mostly Navigation Dodecanese Campaign British, to capture the Italian-held Dodecanese islands in the Aegean Sea following the Part of the Mediterranean and Middle East theatre of Main page surrender of Italy in September 1943, and use them as bases against the German- World War II Contents controlled Balkans. The Allied effort failed, with the whole of the Dodecanese falling to Featured content the Germans within two months, and the Allies suffering heavy losses in men and Current events ships.[3] The operations in the Dodecanese, lasting from 8 September to 22 November Random article 1943, resulted in one of the last major German victories in the war.[4] Donate to Wikipedia Contents 1 Background Interaction 2 Initial Allied and German moves — The Fall of Rhodes Help 3 Battle of Kos About Wikipedia 4 Battle of Leros Community portal 5 Naval operations Recent changes 6 Aftermath Map of the Dodecanese Islands (in dark blue) Contact Wikipedia 7 In popular culture Date September 8 – November 22, 1943 8 References Location Dodecanese Islands, Aegean Sea Toolbox 9 Sources 10 External links Result German victory What links here Territorial German occupation of the Dodecanese Related changes changes Background [edit] Upload file Belligerents Special pages Further information: Military history of Greece during World War United Kingdom Germany Permanent link II and Mediterranean and Middle East theatre of World War II Kingdom of Italy Republican State of Page information South Africa Italy The Dodecanese island group lies in the south-eastern Aegean Sea, and had been Data item Greece under Italian occupation since the Italo-Turkish War. -

The 1958 Good Offices Mission and Its Implications for French-American Relations Under the Fourth Republic
Portland State University PDXScholar Dissertations and Theses Dissertations and Theses 1970 The 1958 Good Offices Mission and Its Implications for French-American Relations Under the Fourth Republic Lorin James Anderson Portland State University Follow this and additional works at: https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds Part of the Diplomatic History Commons, European History Commons, and the United States History Commons Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Anderson, Lorin James, "The 1958 Good Offices Mission and Its Implications forr F ench-American Relations Under the Fourth Republic" (1970). Dissertations and Theses. Paper 1468. https://doi.org/10.15760/etd.1467 This Thesis is brought to you for free and open access. It has been accepted for inclusion in Dissertations and Theses by an authorized administrator of PDXScholar. Please contact us if we can make this document more accessible: [email protected]. AN ABSTRACT OF THE THBSIS Ol~ Lorin J'ames Anderson for the Master of Arts in History presented November 30, 1970. Title: The 1958 Good Offices Mission and its Implica tions for French-American Relations Under the Fourth Hepublic. APPROVED BY MEHllERS O~' THE THESIS CO.MNITTEE: Bernard Burke In both a general review of Franco-American re lations and in a more specific discussion of the Anglo American good offices mission to France in 1958, this thesis has attempted first, to analyze the foreign policies of France and the Uni.ted sta.tes which devel oped from the impact of the Second World Wa.r and, second, to describe Franco-American discord as primar ily a collision of foreign policy goals--or, even farther, as a basic collision in the national attitudes that shaped those goals--rather than as a result either of Communist harassment or of the clash of personalities.