La Construction Sociale De L'image De L'informatique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Women in Computing
History of Computing CSE P590A (UW) PP190/290-3 (UCB) CSE 290 291 (D00) Women in Computing Katherine Deibel University of Washington [email protected] 1 An Amazing Photo Philadelphia Inquirer, "Your Neighbors" article, 8/13/1957 2 Diversity Crisis in Computer Science Percentage of CS/IS Bachelor Degrees Awarded to Women National Center for Education Statistics, 2001 3 Goals of this talk ! Highlight the many accomplishments made by women in the computing field ! Learn their stories, both good and bad 4 Augusta Ada King, Countess of Lovelace ! Translated and extended Menabrea’s article on Babbage’s Analytical Engine ! Predicted computers could be used for music and graphics ! Wrote the first algorithm— how to compute Bernoulli numbers ! Developed notions of looping and subroutines 5 Garbage In, Garbage Out The Analytical Engine has no pretensions whatever to originate anything. It can do whatever we know how to order it to perform. It can follow analysis; but it has no power of anticipating any analytical relations or truths. — Ada Lovelace, Note G 6 On her genius and insight If you are as fastidious about the acts of your friendship as you are about those of your pen, I much fear I shall equally lose your friendship and your Notes. I am very reluctant to return your admirable & philosophic 'Note A.' Pray do not alter it… All this was impossible for you to know by intuition and the more I read your notes the more surprised I am at them and regret not having earlier explored so rich a vein of the noblest metal. -

Gender and Technology Looking to the Post
Gender and Technology Looking to the Post by Denise M. Sbortt have made towards technological there is evidence that women have progress and why these accomplish- even lost power with the introduc- Cet am'ck nowpark dcJ aspects qui se ments have often been ignored. This tion of new technologies. For exam- rapportent h litccks aux technologies, information helps us to understand ple, during the manuscript era of the aux occasions, h li'ntdrtt qu 'clles susci- why women are not embracing the Middle Ages, women managed to tenteth leuracceptationpar ksfcmmer current computer culture at the same exercise some degree of knowledge dans I'bistoire et par les femmes modemes. A ship in port is safe, but that is not what ships are for. Sail out to sea and do new things. -Admiral Grace Hopper, computer pioneer. Charting a course into the world of technology can be rough sailing for women. Today's computer culture is largely dominated by men and many women have yet to navigate these largely uncharted waters. New tech- nologies have become increasingly important and arguably necessary in some spheres of modern life. In light of this sea of change, it becomes imperative for women to heed the words ofAdmiral Hopper and set sail - - into new territory (Camp). With this message in mind, I have decided to explore the relationship of Gail Geltner, 'Women and Technologies," 1987 women and technology. My inquiry into this relationship is guided by rate as men and why women's voices and power in their roles as nuns. Dale two fundamental educational ques- have largely been left out of the dia- Spender points out that a fewwomen tions: what is needed to make good logue on the potential future uses of such as St. -

Baixar Baixar
PROTAGONISMO FEMININO NA COMPUTAÇÃO Desmistificando a Ausência de Mulheres Influentes na Área Tecnológica ISBN: 978-65-5825-001-2 PROTAGONISMO FEMININO NA COMPUTAÇÃO: DESMISTIFICANDO A AUSÊNCIA DE MULHERES INFLUENTES NA ÁREA TECNOLÓGICA Alana Morais Aline Morais (Organizadoras) Centro Universitário - UNIESP Cabedelo - PB 2020 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIESP Reitora Érika Marques de Almeida Lima Cavalcanti Pró-Reitora Acadêmica Iany Cavalcanti da Silva Barros Editor-chefe Cícero de Sousa Lacerda Editores assistentes Hercilio de Medeiros Sousa Josemary Marcionila F. R. de C. Rocha Editora-técnica Elaine Cristina de Brito Moreira Corpo Editorial Ana Margareth Sarmento – Estética Anneliese Heyden Cabral de Lira – Arquitetura Daniel Vitor da Silveira da Costa – Publicidade e Propaganda Érika Lira de Oliveira – Odontologia Ivanildo Félix da Silva Júnior – Pedagogia Jancelice dos Santos Santana – Enfermagem José Carlos Ferreira da Luz – Direito Juliana da Nóbrega Carreiro – Farmácia Larissa Nascimento dos Santos – Design de Interiores Luciano de Santana Medeiros – Administração Marcelo Fernandes de Sousa – Computação Márcia de Albuquerque Alves – Ciências Contábeis Maria da Penha de Lima Coutinho – Psicologia Paula Fernanda Barbosa de Araújo – Medicina Veterinária Rita de Cássia Alves Leal Cruz – Engenharia Rogério Márcio Luckwu dos Santos – Educação Física Zianne Farias Barros Barbosa –Nutrição Copyright © 2020 – Editora UNIESP É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos autorais (Lei no 9.610/1998) é crime estabelecido no artigo 184 do Código Penal. O conteúdo desta publicação é de inteira responsabilidade do(os) autor(es). Designer Gráfico: Samara Cintra Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Biblioteca Padre Joaquim Colaço Dourado (UNIESP) M828p Morais, Alana. -

Download Issue As
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA Tuesday April 6, 2021 Volume 67 Number 33 www.upenn.edu/almanac Graduate School Rankings 2022 Penn Medicine Researcher: $1 Million Grant to Expand COVID-19 Each year, U.S. News & World Report ranks Treatment Discovery Platform graduate and professional schools in business, David C. Fajgenbaum, an assistant professor treatments for well-designed clinical trials and to medicine, education, law, engineering and nursing. of translational medicine & human genetics and inform patient care. With funding from PICI, sev- Five of Penn’s Schools are in the top 10 list. Those the director of the Center for Cytokine Storm eral new tools are in development or have already in the top 30 are below; for more, see U.S. News’ Treatment & Laboratory at the Perelman School been built, including an open-access dashboard website: www.usnews.com. of Medicine at the University of Pennsylvania, that integrates data between studies and presents 2021 2022 was awarded $1 million by the Parker Insti- vital data points for prioritizing promising treat- Wharton School 1 2 Finance 1 1 tute for Cancer Immunotherapy (PICI) to ex- ments, such as the number of randomized control Real Estate - 1 pand the scope of the trials that have been completed, the number that Marketing 2 2 COVID-19 Registry are open, the number that achieved their primary Executive MBA 3 2 of Off-label & New endpoint, and others. Accounting 3 3 Agents (CORONA) “All of the really relevant and important data Business Analytics 5 3 project and build out is listed right next to each COVID-19 drug and Management 7 4 his team to accelerate kept up to date,” Dr. -
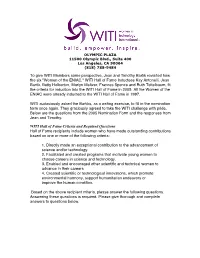
To Give WITI Members Some Perspective, Jean and Timothy
OLYMPIC PLAZA 11500 Olympic Blvd., Suite 400 Los Angeles, CA 90064 (818) 788-9484 To give WITI Members some perspective, Jean and Timothy Bartik revisited how the six "Women of the ENIAC," WITI Hall of Fame Inductees Kay Antonelli, Jean Bartik, Betty Holberton, Marlyn Meltzer, Frances Spence and Ruth Teitelbaum, fit the criteria for induction into the WITI Hall of Fame in 2005. All the Women of the ENIAC were already inducted to the WITI Hall of Fame in 1997. WITI audaciously asked the Bartiks, as a writing exercise, to fill in the nomination form once again. They graciously agreed to take the WITI challenge with pride. Below are the questions from the 2005 Nomination Form and the responses from Jean and Timothy. WITI Hall of Fame Criteria and Required Questions Hall of Fame recipients include women who have made outstanding contributions based on one or more of the following criteria: 1. Directly made an exceptional contribution to the advancement of science and/or technology. 2. Facilitated and created programs that motivate young women to choose careers in science and technology. 3. Enabled and encouraged other scientific and technical women to advance in their careers 4. Created scientific or technological innovations, which promote environmental harmony, support humanitarian endeavors or improve the human condition. Based on the above recipient criteria, please answer the following questions. Answering these questions is required. Please give thorough and complete answers to questions below. 1. Based on the criteria above, which of these criteria best describes the outstanding contributions of the nominee and why? The Women of the ENIAC, Kay Antonelli, Jean Bartik, Betty Holberton, Marlyn Meltzer, Frances Spence and Ruth Teitelbaum, directly made a contribution to the advancement of science and technology by developing the first programs or software for the first electronic computer, the ENIAC, in the mid 1940s. -

Ict: an Implementation Strategy in the Foothills School Division for the New
I.C.T.: AN IMPLEMENTATION STRATEGY IN THE FOOTHILLS SCHOOL DIVISION FOR THE NEW ELEMENTARY CURRICULUM WILLIAM EDWARD ARTHUR HOLMES B.Sc. Physical Education, Washington State University, 1987 B. Ed., University of Calgary, 1990 A Project Submitted to the Faculty of Education of The University of Lethbridge in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree MASTER OF EDUCATION LETHBRIDGE,ALBERTA January, 2002 Dedication This project is dedicated to my wife Cheryl and my daughters Jade and Keara, whose love and support make everything possible. I also dedicate this to my mom, dad and sister. I'm as proud of you, as you are of me. 111 Abstract ICT is the new Information and Communication Technology Curriculum, which has been mandated for use in schools as of September 1, 2000. Schools in Alberta have three years to fully integrate this program into their daily educational practices, not as a separate course but rather as a curriculum woven throughout the curricula. This project looks at the methods used to implement ICT in one school in the Foothills School Division. IV Acknowledgments I would like to extend my thanks to all of those people who have leant their expertise and assistance in helping me to create the largest volume of writing, which I have done thus far in my life. The work was incredible and now that the journey has been completed, I look back with pride at the work that I have done, unbelieving at the distance I have travelled and the work that I have done. Thanks to the professors and the Faculty of Education at the University of Lethbridge for renewing my interest in educational research. -

Engendering Technology Empowering Women Pascall, A.N
Tilburg University Engendering technology empowering women Pascall, A.N. Publication date: 2012 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication in Tilburg University Research Portal Citation for published version (APA): Pascall, A. N. (2012). Engendering technology empowering women. TiCC.Ph.D. Series 23. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 27. sep. 2021 ENGENDERING TECHNOLOGY EMPOWERING WOMEN PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan Tilburg University op gezag van de rector magnificus, prof. dr. Ph. Eijlander, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van een door het college voor promoties aangewezen commissie in de aula van de Universiteit op maandag 19 november 2012 om 14.15 uur door Athanacia Nancy Pascall geboren in Griekenland Promotores: Prof. dr. H. J. van den Herik Prof. dr. M. Diocaretz Beoordelingscommissie: Prof. dr. -

Refrigerator Ladies First Hardware Textbook RS-232
each new problem, a task that The textbook sold well, and can could take several days. be read online at http://bitsavers.trailing- May The ENIAC was a classified edge.com/pdf/era/High_Speed_ project in the early days, so the Computing_Devices_1950.pdf women were given very Refrigerator Ladies restrictive access to machine. The book's references mention May 1945 For instance, they had to devise three other early computing programs based on looking at texts: Prev: [May 31] Next: [Nov 30] the ENIAC's schematics. Berkeley, E.C., “Giant Brains”, Initially, six women were In the process, these women John Wiley, 1949 [June 30] selected to program the ENIAC pioneered the discipline of [Feb 15]: programming digital computers, Hartree, D.R., “Calculating developing techniques such as Instruments and Machines”, Betty Holberton (co-lead subroutine libraries. University Of Illinois Press, programmer); née Frances 1949 [March 27] Elizabeth Snyder. Born: Incredibly, their role had been [March 7], 1917; Philadelphia. largely forgotten by the 1980's, Wiener, Norbert, Died: Dec 8, 2001 until historian Kathy Kleiman “Cybernetics”, John Wiley, tried to find out about the 1948. [Nov 26] Jean Bartlik (co-lead women present in all the ENIAC Also, although “High-Speed programmer); née Betty Jean pictures. She remarked: “I was Computing Devices” was the Jennings. Born: [Dec. 27], told they were models - first book on hardware, the first 1924; Gentry County, Missouri. ‘Refrigerator Ladies’ - posing in on programming was “The Died: March 23, 2011 front of the machine to make it Preparation of Programs for an Kathleen “Kay” McNulty look good,” Electronic Digital Computer” Mauchly Antonelli; née Infact, three of the six – (1951), by Maurice Wilkes [June Kathleen Rita McNulty. -

The World's First Programmers, the Women of the ENIAC, to Come To
13351-D Riverside Drive #441 Sherman Oaks, CA 91423 818-788-9484 The World's First Programmers, the Women of the ENIAC, to come to NYC February 23 to speak about the history of women in computing and Harvard’s President Summer's recent controversial comments. New York City, January 31, 2005 -- Kathleen McNulty Mauchly Antonelli and Jean Jennings Bartik will speak at the February 23, NYC WITI Network Meeting on the history of women in computing and Harvard’s President Larry Summer's recent controversial remarks regarding the fitness of women for careers in technology and science. The WITI Hall of Fame will assemble at the WITI Tenth Anniversary Celebration of the WITI Hall of Fame on September 17, 2005 to honor the 2005 recipients to the WITI Hall of Fame. WITI will also honor the 55 recipients already inducted to the WITI Hall of Fame. ................................................................................................................................. To give WITI Members some perspective, Jean and Timothy Bartik revisited how the six "Women of the ENIAC," WITI Hall of Fame Inductees Kay Antonelli, Jean Bartik, Betty Holberton, Marlyn Meltzer, Frances Spence and Ruth Teitelbaum, fit the criteria for induction into the WITI Hall of Fame in 2005. All the Women of the ENIAC were already inducted to the WITI Hall of Fame in 1997. WITI audaciously asked the Bartiks, as a writing exercise, to fill in the nomination form once again. They graciously agreed to take the WITI challenge with pride. Below are the questions from the 2005 Nomination Form and the responses from Jean and Timothy. WITI Hall of Fame Criteria and Required Questions Hall of Fame recipients include women who have made outstanding contributions based on one or more of the following criteria: 1. -

Computer Ethics Historical Notes
Computer Ethics Historical Notes Norberto Patrignani 1 / 42 Imhotep, the First Engineer High priest of the Sun God Ra Chancellor to the Pharaoh Djoser Architect of the "step-pyramid" Imhotep (He who comes in peace) Pyramid of Djoser (2700 B.C.) Saqqara, Egypt 2 / 42 Data, Information and Knowledge Communication Revolutions 0 Ä -200.000 -100.000 Homo Sapiens biological Language support (WetWare) 3500 B.C. 0 1455 1950 Writing Printing paper support stone, paper support ... space/time diffusion ... Computer (Networks) silicon support ¼ arithmetic engine communication device 3 / 42 The Dream of a "Reasoning" Machine 4 / 42 Abacus, circa 300 B.C. Modern abacus Salamis tablet (originally thought to be a gaming board), used by the Babylonians circa 300 B.C., discovered in 1846 5 / 42 1274: Ramon Lull Ars Magna • • Ramon Lull (Raimundo Lulio) (1232-1315) - Ars Magna: a Logical Device/Method for arriving at True Knowledge ... - Logical Machines ... by moving a lever the Propositions would prove themselves to be True or False! Source: Gardner, Martin. "The Ars Magna of Ramon Lull." In Logic Machines, Diagrams and Boolean Algebra. New York: Dover Publications, 1968 6 / 42 1623: Wilhelm Schickard • The "Speeding Clock": 1st calculating machine (1623) • A machine for calculating astronomical tables Wilhelm Schickard (1592-1635) Replica of the "Speeding Clock" 7 / 42 1637: Rene© Descartes - Committed to using reason to prove the truth of God - "... Regarding logic, its syllogisms and most of its other precepts serve more to explain to others what one already knows, or even, like the art of Lully, to speak without judgment of those things one does not know, than to learn anything new" - You must doubt your senses (mind/body split) .. -

Year Name What She Did More Info 350 Hypatia of Alexandría Invented the Hydrometer 1793 H
Year Name What she did More info 350 Hypatia of Alexandría Invented the Hydrometer https://en.wikipedia.org/wiki/Hypatia 1793 Hannah Slater First US Woman to file a patent for her improvements to cotton sewing thread. Issued to "Mrs. Samuel Slater" https://en.wikipedia.org/wiki/Hannah_Slater 1809 Mary Dixon Kies American inventor, patented a technique to weave straw with silk and thread https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Dixon_Kies 1811 Sarah Maria Beach Invented a method for the safe piling of bridges https://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Guppy 1813 Tabitha Babitt American Toolmaker who invented the Circular Saw https://en.wikipedia.org/wiki/Tabitha_Babbit 1842 Ada Lovelace Considered the creator of the 1st Algorithm. The first programmer, male or female. https://en.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace 1858 Florence Nightingale British nurse that revolutionized information display thanks to her statistics & mathematics knowledge https://www.fundaciontelefonica.com/2015/11/06/mujeres-pioneras-ciencia-educacion/ After her husband (a former naval scientist) died, she developed some ideas from a notebook he had left unfinished and designed a 1859 Mary J. Coston working naval signal flare. https://www.engineergirl.org/42022/Mary_Coston 1872 Mª Elena Maseras i Ribera 1st woman to be admitted in a spanish university https://www.fundaciontelefonica.com/2015/11/06/mujeres-pioneras-ciencia-educacion/ 1873 Helen Augusta Blanchard Filed 28 patents, 22 of which had to do with sewing machines https://www.engineergirl.org/42010/Helen_Blanchard She would have been the 1st Ph.D. in Chemistry from MIT but she was denied it as the MIT teachers didn't want that place to go to a 1875 Ellen Henrietta Swallow Richards woman. -
VL-Manus UE 07
Um das Jahr 1941 lernten die Bilder zum ersten Mal „laufen“. Kurze Zeit darauf wurde in den USA auch schon der erste Computer entwickelt. http://de.wikipedia.org/wiki/Computervermittelte_Kommunikation#Entstehung_der_computervermittelten_Kommunikation Rechenmaschinen und Kassen Verschiedene Entwicklungen des 19. Jahrhunderts hatten bereits demonstriert, dass menschliche Aktivitäten wie das Rechnen ebenso durch Maschinen ausgeführt werden konnten. Ab 1900 entstanden mit Buchungs- und Fakturiermaschinen weitere spezielle Datenverarbeitungsmaschinen. Für statistische Auswertungen kam um 1890 in Österreich und den USA ein System von Maschinen auf, die auf Lochkarten gespeicherte Daten verarbeiten konnten. Bis dahin hatten Lochkarten beispielsweise zur Steuerung von Webstühlen gedient, nun bildeten sie die Grundlage für die schnelle Speicherung vieler Daten und deren zügige Auswertung. Besonders einflussreich waren die elektrischen Lochkartenauswertungsmaschinen des US-Amerikaners Herrman Hollerith. Die Lochkarte wurde hierdurch als Datenträger weltweit verbreitet. http://www.frauen-informatik-geschichte.de/index.php?id=13 Der Übergang zu Großrechenanlagen Bald galt es vor allem aus Personalmangel, die Effizienz der vorhandenen Rechenanlagen deutlich zu steigern, um den kriegsbedingten Bedarf abdecken zu können. Beispielsweise musste die massenweise Berechnung ballistischer Flugbahnen durchgeführt werden: Eine typische Zieltabelle erforderte die Berechnung von rund 3000 Geschossbahnen, was ca. 30 Tage Rechenarbeit für die (menschlichen) RechnerInnen