Allocution De La Juge Suzanne Côté : Réception De Bienvenue
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
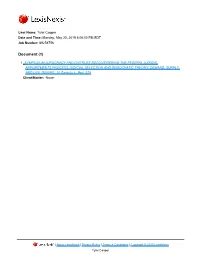
Symposium:Jurocracy and Distrust:Reconsidering The
User Name: Tyler Cooper Date and Time: Monday, May 20, 2019 6:05:00 PM EDT Job Number: 89258756 Document (1) 1. SYMPOSIUM:JUROCRACY AND DISTRUST:RECONSIDERING THE FEDERAL JUDICIAL APPOINTMENTS PROCESS:JUDICIAL SELECTION AND DEMOCRATIC THEORY: DEMAND, SUPPLY, AND LIFE TENURE, 26 Cardozo L. Rev. 579 Client/Matter: -None- | About LexisNexis | Privacy Policy | Terms & Conditions | Copyright © 2019 LexisNexis Tyler Cooper SYMPOSIUM:JUROCRACY AND DISTRUST:RECONSIDERING THE FEDERAL JUDICIAL APPOINTMENTS PROCESS:JUDICIAL SELECTION AND DEMOCRATIC THEORY: DEMAND, SUPPLY, AND LIFE TENURE January, 2005 Reporter 26 Cardozo L. Rev. 579 * Length: 27441 words Author: Judith Resnik* * Arthur Liman Professor of Law, Yale Law School. © Judith Resnik 2005. This article stems from presentations at the Symposium, Jurocracy, at the Benjamin N. Cardozo School of Law in March of 2004 and at the Symposium, Judicial Appointments in a Free and Democratic Society, at the University of Toronto Law School in April of 2004, and builds on my articles "Uncle Sam Modernizes his Justice System": Inventing the District Courts of the Twentieth Century, 90 Geo. L.J. 607 (2002), Trial as Error, Jurisdiction as Injury: Transforming the Meaning of Article III, 113 Harv. L. Rev. 924 (2000), and Changing Criteria for Judging Judges, 84 Nw. U. L. Rev. 889 (1990), as well as on testimony that I submitted to subcommittees of the United States Senate and of the Canadian House of Commons on the topic of judicial nominations. I benefited from comments of other participants, the exchanges at these symposia and hearings, and from discussions with Seyla Benhabib and Deborah Hensler. My thanks to Joseph Blocher, Andrew Goldstein, Paige Herwig, Johanna Kalb, Alison Mackenzie, Jennifer Peresie, Bertrall Ross, Kirby Smith, Laura Smolowe, and Steven Wu for research assistance, to Gene Coakley for all his efforts to locate relevant materials, and to Denny Curtis, Vicki Jackson, Roy Mersky, Roberta Romano, and Albert Yoon for helpful comments on earlier drafts. -

Special Series on the Federal Dimensions of Reforming the Supreme Court of Canada
SPECIAL SERIES ON THE FEDERAL DIMENSIONS OF REFORMING THE SUPREME COURT OF CANADA The Supreme Court of Canada: A Chronology of Change Jonathan Aiello Institute of Intergovernmental Relations School of Policy Studies, Queen’s University SC Working Paper 2011 21 May 1869 Intent on there being a final court of appeal in Canada following the Bill for creation of a Supreme country’s inception in 1867, John A. Macdonald, along with Court is withdrawn statesmen Télesphore Fournier, Alexander Mackenzie and Edward Blake propose a bill to establish the Supreme Court of Canada. However, the bill is withdrawn due to staunch support for the existing system under which disappointed litigants could appeal the decisions of Canadian courts to the Judicial Committee of the Privy Council (JCPC) sitting in London. 18 March 1870 A second attempt at establishing a final court of appeal is again Second bill for creation of a thwarted by traditionalists and Conservative members of Parliament Supreme Court is withdrawn from Quebec, although this time the bill passed first reading in the House. 8 April 1875 The third attempt is successful, thanks largely to the efforts of the Third bill for creation of a same leaders - John A. Macdonald, Télesphore Fournier, Alexander Supreme Court passes Mackenzie and Edward Blake. Governor General Sir O’Grady Haly gives the Supreme Court Act royal assent on September 17th. 30 September 1875 The Honourable William Johnstone Ritchie, Samuel Henry Strong, The first five puisne justices Jean-Thomas Taschereau, Télesphore Fournier, and William are appointed to the Court Alexander Henry are appointed puisne judges to the Supreme Court of Canada. -

Reforming the Supreme Court Appointment Process, 2004-2014: a 10-Year Democratic Audit 2014 Canliidocs 33319 Adam M
The Supreme Court Law Review: Osgoode’s Annual Constitutional Cases Conference Volume 67 (2014) Article 4 Reforming the Supreme Court Appointment Process, 2004-2014: A 10-Year Democratic Audit 2014 CanLIIDocs 33319 Adam M. Dodek Follow this and additional works at: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/sclr This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. Citation Information Dodek, Adam M.. "Reforming the Supreme Court Appointment Process, 2004-2014: A 10-Year Democratic Audit." The Supreme Court Law Review: Osgoode’s Annual Constitutional Cases Conference 67. (2014). http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/sclr/vol67/iss1/4 This Article is brought to you for free and open access by the Journals at Osgoode Digital Commons. It has been accepted for inclusion in The uS preme Court Law Review: Osgoode’s Annual Constitutional Cases Conference by an authorized editor of Osgoode Digital Commons. Reforming the Supreme Court Appointment Process, 2004-2014: A 10-Year Democratic Audit* Adam M. Dodek** 2014 CanLIIDocs 33319 The way in which Justice Rothstein was appointed marks an historic change in how we appoint judges in this country. It brought unprecedented openness and accountability to the process. The hearings allowed Canadians to get to know Justice Rothstein through their members of Parliament in a way that was not previously possible.1 — The Rt. Hon. Stephen Harper, PC [J]udicial appointments … [are] a critical part of the administration of justice in Canada … This is a legacy issue, and it will live on long after those who have the temporary stewardship of this position are no longer there. -

Diversifying the Bar: Lawyers Make History Biographies of Early and Exceptional Ontario Lawyers of Diverse Communities Arran
■ Diversifying the bar: lawyers make history Biographies of Early and Exceptional Ontario Lawyers of Diverse Communities Arranged By Year Called to the Bar, Part 2: 1941 to the Present Click here to download Biographies of Early and Exceptional Ontario Lawyers of Diverse Communities Arranged By Year Called to the Bar, Part 1: 1797 to 1941 For each lawyer, this document offers some or all of the following information: name gender year and place of birth, and year of death where applicable year called to the bar in Ontario (and/or, until 1889, the year admitted to the courts as a solicitor; from 1889, all lawyers admitted to practice were admitted as both barristers and solicitors, and all were called to the bar) whether appointed K.C. or Q.C. name of diverse community or heritage biographical notes name of nominating person or organization if relevant sources used in preparing the biography (note: living lawyers provided or edited and approved their own biographies including the names of their community or heritage) suggestions for further reading, and photo where available. The biographies are ordered chronologically, by year called to the bar, then alphabetically by last name. To reach a particular period, click on the following links: 1941-1950, 1951-1960, 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-. To download the biographies of lawyers called to the bar before 1941, please click Biographies of Early and Exceptional Ontario Lawyers of Diverse Communities Arranged By Year Called to the Bar, Part 2: 1941 to the Present For more information on the project, including the set of biographies arranged by diverse community rather than by year of call, please click here for the Diversifying the Bar: Lawyers Make History home page. -

International Journal of the Legal Profession Judging Gender
International Journal of the Legal Profession Judging gender: difference and dissent at the Supreme Court of Canada MARIE-CLAIRE BELLEAU* & REBECCA JOHNSON** ABSTRACT Over 25 years ago, Justice Bertha Wilson asked “Will women judges really make a difference?” Taking up her question, we consider the place of difference in gender and judging. Our focus is on those ‘differences of opinion’ between judges that take the form of written and published judicial dissent. We present and interrogate recent statistics about practices of dissent on the Supreme Court of Canada in relation to gender. The statistics are provocative, but do not provide straightforward answers about gender and judging. They do, however, pose new questions, and suggest the importance of better theorizing and exploring the space of dissent. 1. Introductory observations In a controversial 1990 speech, Justice Bertha Wilson, the first woman judge of the Supreme Court oF Canada, posed a question that has occupied many theorists of law: “Will women judges really make a diFFerence?” (Wilson, 1990). With the beneFit oF 25 years with women judges on Canada’s highest court, it is worth returning to Justice Wilson’s question. But in asking about judges, gender and diFFerence, we want to Foreground a particular kind of diFFerence often present For appellate judges: a ‘diFFerence of opinion’. All judges grapple constantly with the unavoidable tension at the heart oF law—a tension between the demands of stability and responsive change (Fitzpatrick, 2001). But the grappling is intensiFied For appellate judges, who bring multiple skills and divergent liFe experiences to bear on a single case. -

Canadian Judicial Nomination Processes and the Press: ‘Interesting, in a Sleepy Sort of Way’
Oñati Socio-legal Series, v. 4, n. 4 (2014) – Law in the Age of Media Logic ISSN: 2079-5971 Canadian Judicial Nomination Processes and the Press: ‘Interesting, in a Sleepy Sort of Way’ ∗ DAVID SCHNEIDERMAN Schneiderman, D., 2014. Canadian Judicial Nomination Processes and the Press: ‘Interesting, in a Sleepy Sort of Way’. Oñati Socio-legal Series [online], 4 (4), 685-708. Available from: http://ssrn.com/abstract=2511239 Abstract Most of the recent appointees to the Supreme Court of Canada have participated in a new Canadian judicial nomination process initiated by the current Conservative government. As originally formulated in early policy platforms, the process was intended to mimic features of US Senate judicial confirmation hearings and so would highlight the distinction (popular in US political discourse) between ‘applying’ and ‘making’ law. This led to widespread fears that any new public process would politicize judicial appointments and functions at the Supreme Court. The process turned out to be much more tepid than anticipated and so raises questions about what Canadians may have learned as a consequence of this new nomination process. This paper undertakes a qualitative analysis of reporting of four nomination processes from a select number of Canadian newspapers. The main object is to determine the degree to which readers might have been alerted to the distinction between law and politics or, put another way, between judicial activism and restraint. It turns out that this framing was not dominant in the coverage and that, instead, distinctive Canadian political preoccupations, like language politics, got channeled through this new political opportunity structure. -

THE BULLETIN College Creates Award to Honor Justice O’Connor
NUMBER 58 WINTer 2008 THE BULLETIN COLLEGE CREATES AWARD to honor JUSTICE O’CONNOR Retired Supreme Court Associate Jus- tice and Honorary Fellow Sandra Day O’Connor was present at the Annual Meeting in Denver to acknowledge and accept the College’s creation of the San- dra Day O’Connor Jurist Award. The College will present this award from time to time to a judge, federal or state, from the United States or Canada who has demonstrated exemplary judi- cial independence in the performance of his or her duties, sometimes in difficult or even dangerous circumstances. The Board of Regents chose to honor O’Connor in this way in recognition of her twenty-four year tenure on the Su- preme Court as its first female member and for her exemplary record of public service. A medal bearing her likeness will be presented to each future O’Connor Jurist recipient. During the ceremony, O’Connor was also presented with a sculptured likeness of her, created by Past President Warren Lightfoot. She has since donated that bust to the Su- Con’t on page 20 This Issue: 64 Pages In This Issue Letter to the Editorial Board I read with interest your article about the vanishing civil trial (Opinion: Before We Jump by E. Os- borne Ayscue, Jr., Summer 2007). I am familiar with issues that you mentioned and I have made several speeches about this over the last several years. It is surprising to me that the trial bar does not seem to be particularly concerned about what is happening. We are beginning to see lawyers with 10-15 years experience that call themselves trial lawyers and do not have a clue what they are doing in a courtroom. -

Does a Judge's Party of Appointment Or
Osgoode Hall Law Journal Article 3 Volume 45, Number 2 (Summer 2007) Does a Judge's Party of Appointment or Gender Matter to Case outcomes?: An Empirical Study of the Court of Appeal for Ontario James Stribopoulos Osgoode Hall Law School of York University Moin A. Yahya Follow this and additional works at: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj Part of the Judges Commons Article Citation Information Stribopoulos, James and Yahya, Moin A.. "Does a Judge's Party of Appointment or Gender Matter to Case outcomes?: An Empirical Study of the Court of Appeal for Ontario." Osgoode Hall Law Journal 45.2 (2007) : 315-363. http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol45/iss2/3 This Article is brought to you for free and open access by the Journals at Osgoode Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Osgoode Hall Law Journal by an authorized administrator of Osgoode Digital Commons. Does a Judge's Party of Appointment or Gender Matter to Case outcomes?: An Empirical Study of the Court of Appeal for Ontario Abstract A recent study by Cass Sunstein identified ideological differences in the votes cast by judges on the United States Courts of Appeals in certain types of cases. He found that these patterns varied depending on the ideology of an appellate judge's co-panelists. In this study, we undertake a similar examination of the busiest appellate court in Canada, the Court of Appeal for Ontario. This study collects data on the votes cast by individual judges in every reported decision between 1990 and 2003. Each case was cod6d by type, for example "criminal law," "constitutional law," or "private law." In addition, the votes cast by individual judges in each category were tracked based on variables such as the type of litigant, the political party that appointed the judge, and the judge's gender. -

2013-2014 Research Report Fringilla Blandit Mi Ac
2013-2014 Research Report fringilla blandit mi ac Faculty of Law, Common Law Section CommonLaw.uOttawa.ca 2013-2014 Research Report Common Law Section, Faculty of Law University of Ottawa Word from the Vice-Dean Research Looking back at the year 2013-2014 “As Vice-Dean Research, I am very proud of the accomplishments of our individual researchers and of the Common Law Section as a whole in 2013-14. As a result of the hard work of my predecessors in this office and the support from the Dean of the Common Law Section, we have succeeded in creating a culture of research excellence within this Faculty. That research excellence can be seen in the results and the recognition obtained by our researchers in 2013-14 which are documented in this report.” Adam Dodek Goals of the Research Office The role of the Office of the Vice-Dean Research of the Common Law Section of the Faculty of Law is to encourage and support the successful engagement and leadership of Faculty members in research. Research Highlights In 2013-2014, the Common Law Section of the Faculty of Law obtained a total of $2,259,000 in research funding for 80 new or existing research projects. These accomplishments affirm the Office's continued commitment to excellence in research and to providing a strong foundation of support to meet the five research priorities set out by the Vice Dean Research in 2011-2012, namely: Priority 1: To encourage and support Faculty applications for research funding especially federal government Tri-Council funding but also other sources of funding including the Law Foundation of Ontario, the Foundation for Legal Research, private foundations, government and international organizations. -

Revue De Droit 43.2.Indd
305 An Interview with the Honourable Louise Charron THE HONOURABLE LOUISE CHARRON The Honourable Louise Charron graduated from L’honorable Louise Charron a obtenu son diplôme the University of Ottawa’s Common Law Section de la Section de common law de l’Univer sité d’Ottawa in 1975. She worked in private practice and then as en 1975. Elle a exercé le droit dans un cabinet puis an Assistant Crown Attorney. Ms. Charron was also a occupé les fonctions de procureure adjointe de la a professor at the University of Ottawa’s French Couronne. Madame Charron a également été pro- Common Law Program from 1978 until 1988. She fesseure au Programme de common law en français was appointed to the bench in 1988 and served as de l’Université d’Ottawa de 1978 à 1988. Elle a été a trial judge in Ottawa until 1995, when she was nommée à la magistrature en 1988 où elle a exercé then appointed to the Court of Appeal for Ontario. la charge de juge de première instance à Ottawa Ms.Charron was appointed to the Supreme Court jusqu’en 1995. Elle a ensuite été nommée à la Cour of Canada in 2004 and retired in 2011. d’appel de l’Ontario. Madame Charron a été nom- In an interview covering the span of her career, mée à la Cour suprême du Canada en 2004 et a pris Ms.Charron refl ected on her legal career and shared sa retraite en 2011. some of the wisdom she gained from it.Throughout Au cours de cet entretien portant sur l’en- the interview, the Ottawa Law Review offers a look into semble de sa carrière, Madame Charron a fait part the choices that shaped Ms. -

'Atlantic Seat' on the Supreme Court of Canada: an Endangered Species?
Osgoode Hall Law School of York University Osgoode Digital Commons Research Papers, Working Papers, Conference All Papers Papers 2017 The Atl‘ antic Seat’ on the Supreme Court of Canada: An Endangered Species? Philip Girard Osgoode Hall Law School of York University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/all_papers Part of the Law Commons Repository Citation Girard, Philip, "The A‘ tlantic Seat’ on the Supreme Court of Canada: An Endangered Species?" (2017). All Papers. 277. https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/all_papers/277 This Working Paper is brought to you for free and open access by the Research Papers, Working Papers, Conference Papers at Osgoode Digital Commons. It has been accepted for inclusion in All Papers by an authorized administrator of Osgoode Digital Commons. “The ‘Atlantic Seat’ on the Supreme Court of Canada: An Endangered Species?” Philip Girard* I. Introduction The sigh of relief on the Atlantic coast could be heard all the way to Ottawa on October 17, 2016. On that day, Prime Minister Justin Trudeau announced the nomination of Justice Malcolm Rowe of the Newfoundland and Labrador Court of Appeal to the Supreme Court of Canada seat vacated by Justice Thomas Cromwell. Justice Cromwell’s replacement was to be the first appointed pursuant to a new process put in place by the Trudeau government. When that process was unveiled on August 2, 2016, Trudeau announced that the position would be open to any qualified Canadian lawyer or judge who was functionally bilingual and “representative of the diversity of our great country.” A further clarification stated that “[a]pplications are being accepted from across Canada in order to allow for a selection process that ensures outstanding individuals are considered for appointment to the Supreme Court of Canada,” confirming that Atlantic Canadians did not have a lock on the position.1 People on the east coast generally take most things in stride, but this proposed change created a considerable outcry. -
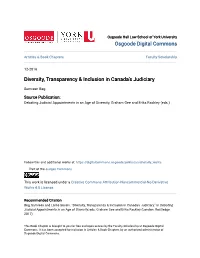
Diversity, Transparency & Inclusion in Canada's Judiciary
Osgoode Hall Law School of York University Osgoode Digital Commons Articles & Book Chapters Faculty Scholarship 12-2016 Diversity, Transparency & Inclusion in Canada’s Judiciary Samreen Beg Source Publication: Debating Judicial Appointments in an Age of Diversity, Graham Gee and Erika Rackley (eds.) Follow this and additional works at: https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly_works Part of the Judges Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. Recommended Citation Beg, Samreen and Lorne Sossin. "Diversity, Transparency & Inclusion in Canada’s Judiciary." In Debating Judicial Appointments in an Age of Diversity, eds. Graham Gee and Erika Rackley (London: Routledge 2017) This Book Chapter is brought to you for free and open access by the Faculty Scholarship at Osgoode Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Articles & Book Chapters by an authorized administrator of Osgoode Digital Commons. Diversity, Transparency & Inclusion in Canada’s Judiciary Samreen Beg and Lorne Sossin Introduction “Of 100 new federally appointed judges 98 are white, Globe finds”.1 This arresting headline from the Globe and Mail in 2012 created waves in the legal community and beyond. While it was known that the Canadian judiciary – particularly federal judicial appointments2 – suffered from problems related to diversity and inclusion, the extent of the problem had not been explicitly laid out before. The headline and report that followed not only highlighted the fact that the judiciary was not seeing any progress with respect to representation, but was actually regressing from gains that had been made in previous years. Canada is one of the most culturally, ethnically, religiously and linguistically diverse countries in the world.