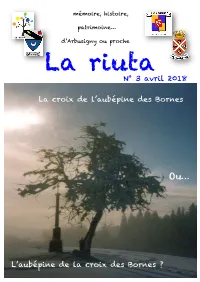Historique des Communes de Haute-Savoie REIGNIER-ESERY
En patois: Renyi. Surnom: lou Raffi (merdeux, diarrhéiques, à cause du cidre) par ceux d'Arthaz; (les Moquerands, moqueurs), féminin : (les Moquerandes).
La commune de Reignier est située sur la rive gauche de l'Arve (arua: eau courante), sur des terrasses d'alluvions fluvio-glaciaires et sur des coteaux bien exposés. C'est une bourgade à l'allure de petite ville, presque ancienne avec, le long de sa rue principale des maisons du siècle dernier, au moins à deux étages, mais cette impression est aujourd'hui trompeuse, car elle s'est rapidement, presque trop rapidement, peuplée depuis une vingtaine d'années. Elle s'est adjointe une "commune" plus rurale et agreste mais devenue résidentielle, Esery; et après un inévitable dépeuplement des hameaux au profit du chef-lieu, on voit ces lieux-dits et hameaux se repeupler sous l'effet de poussée démographique; et de plus, Genève n'est pas loin (13 km) et les frontaliers trouvent à Reignier d'excellentes conditions de séjour puis d'implantation.
La commune s'étage de 407 m au nord, près du lieu où le Viaison (de vas, préindoeuropéen = source) qui fait limite à l'ouest-nord-ouest avec MonnetierMornex, se jette dans l'Arve, ce même Arve bornant à l'est la commune de Reignier avec Arthaz et plus au sud Nangy à 830m, borne géodésique située au sud-ouest, près de la limite avec La Muraz à l'ouest et Pers-Jussy au sud. Enfin, au sud-est, c'est Scientrier qui jouxte Reignier.
La commune est composée d'une trentaine de hameaux et lieux-dits. La population s'est installée surtout le long des axes de circulation.
Près du village (hameau) de Saint-Ange, à l'orée d'un bois de chênes semé de blocs erratiques, se trouve le célèbre dolmen de Reignier, classé en 1887 parmi les monuments historiques. C'est une grande table en granit de 4,90 m sur 4,50 m supportée par trois dalles épaisses, longtemps qualifiées de celtique, donc celte. On sait maintenant que ce type de monument est antérieur à la venue des Celtes et qu'il appartient à la civilisation des mégalithes (=grosses pierres). On peut le dater de plus de 3'000 ans; lors de la fouille de 1843, on ne trouva pas d'objets intéressants autour de lui. Il a porté le nom de pierre des Morts ou pierre des Fées.
On a découvert plus loin des instruments en bronze dont une casserole de l'époque romaine. La voie romaine d'Etrembières à Annecy passait par le chemin des Châtaigniers, territoire d'Esery et franchissait la vallée du Viaison au pont du Loup. Le nom de Viaison (vas, préindoeuropéen) indique bien la présence d'un cours d'eau ou source; il paraît certain que la plus ancienne voie de communication de la région se dirigeait d'Esery à Arbusigny.
Des tombes anciennes formées de grosses dalles de mollasse ont été trouvées à Reignier, en particulier au village de Villy (surnom Villiacium, de Villius: homme à forte pilosité); elles semblent être des tombes burgondes, population implantée dans cette région depuis Genève et La Roche (cimetière burgonde très important) aux Ve - VIe siècles. On ne possède pas de renseignements précis sur l'origine de Reignier; on voit apparaître son nom au début du XIIIe siècle dans une enquête de l'évêque de Genève, Aymon. C'est d'ailleurs du prieuré clunisien de Saint-Victor de Genève que dépendait la nomination du curé de Reignier. Ce prieuré possédait une "grange", signification différente d'aujourd'hui; c'était un domaine rural, plus un certain nombre de serfs qui y vivaient et y travaillaient. Sur cette paroisse, il y avait d'autres propriétaires; ainsi l'abbaye de Filly (= Fillinges, nom d'homme galloromain) possédait une grande partie du village d'Arculinges (cf. acte de 1302).
La seigneurie de Reignier était répartie entre les comtes de Genève et les sires depuis barons du Faucigny. Les premiers étaient à Mornex (aujourd'hui partie de la commune voisine de Monnetier), les deuxièmes étaient maîtres du château de Boringe ou du point d'Arve. En 1319, il appartient à Humbert de Cholay. La paroisse dépendait alors de la châtellenie (châtelain: représentant du seigneur le plus souvent un non noble) de Crédoz (aujourd'hui commune de Cornier). Lorsqu'en 1355, le Genevois et le Faucigny furent réunis, cette division avait persisté. Nous verrons plus loin que d'autres seigneurs avaient des fiefs dans la paroisse.
En 1339, la châtellenie de Crédoz ou Crédo (crêt d'haut, souvent sous une éminence plus élevée) contrôlait 64 feux (320 habitants) dans cette paroisse.
Au XVe siècle, après la Grande Peste de 1348 dont les effets se poursuivirent pendant près d'un siècle, la population de la paroisse varie entre 180 feux (990 âmes) en 1412 et 130 feux (650 personnes) pour 1441, la paroisse de SaintRomain comptait alors de 9 à 14 feux (45 à 70 personnes).
Au XVIe siècle, les guerres qui opposaient la maison de Savoie, devenue entre 1401 et 1411 propriétaire (du Faucigny et du Genevois), causèrent de nombreux dommages et destructions; il en fut ainsi en 1591 du château de Polinge qui appartenait alors par mariage aux Chissé (cf. Sallanches), il fut brûlé mais reconstruit par Mgr de Granier, évêque d'Annecy-Genève, qui y mourut le 27 septembre 1602. Le château de Boringe ou du Pont d'Arve, qui contrôlait au Moyen Age un des passages les plus fréquentés de l'Arve et qui datait du XIIIe siècle, fut attaqué les 1er et 2 janvier 1591 par le baron de Sancy, chef des protestants français au service de Genève; il fit démanteler la place. Le pont s'écroula en 1594, il fut remplacé par un "pont neuf" un peu plus en aval. Le château de Syrier apparaît en 1178, avec un Aymond de Syrier, seigneur de l'entourage d'Henri de Faucigny; il passa aux Thoire, il fut également détruit en 1591 par les Franco-Genevois protestants. Il en fut de même de la petite église de Saint-Romain; elle fut reconstruite et fonctionna jusqu'en 1793. Cette paroisse comprenait aussi le château de Boringe, cité plus haut, et le château de Bellecombe qui devait dater, d'après son style, de l'époque romane (XIIe siècle). C'était un ensemble important qui contrôlait un passage de l'Arve; il a dû appartenir aux de Thoire, une branche des Faucigny; il fut également démantelé par des franco-Genevois.
En 1561, Reignier compte 240 feux (1'200 personnes), Saint-romain 8 feux (40 personnes). En 1580, l'évêque Justiniani comptait 180 feux (900 habitants) mais en 1606, lors de sa visite pastorale, François de Sales n'en trouve plus que 160 (800 habitants). Le curé Jean-Louis Sonnerat nous a laissé des notes intéressantes dès 1627, sur les registres de baptêmes, mariages et sépultures qu'il devait remettre à son évêque Mgr Jean-François de Sales (1578 - 1635), frère de Saint François. Ces visites pastorales faites par chaque évêque, à peu près tous les cinq ans, sont une source importante de renseignements sur la vie des paroisses.
En 1736, des voleurs pénètrent dans l'église et emportent trois vases sacrés. En 1743, Reignier compte 1045 âmes; en 1749, elle est détachée de l'intendance de Faucigny pour être rattachée à celle du Genevois.
En 1756, le secrétaire de la commune répond à l'intendant. Il dénombre 762 personnes réparties en 181 familles (coefficient: environ 4), les ressources sont du froment et des bleds (autres céréales), des forêts; il n'y a pas de friches mais on manque parfois de semences. Il y a deux moulins et une scierie hors d'état; le conseil contrôle deux ponts. Il n'y a pas d'émigration mais lors de la culture de la vigne, de la récolte des moissons, quelques ouvriers se louent à Genève.
En 1771, un écrit royal rend obligatoire aux habitants des communes le rachat des droits féodaux. Le 14 juin 1792, les 130 communiers décident de s'affranchir; 18 signent, les autres ne savent pas écrire. Les seigneurs du lieu doivent montrer leurs titres justifiant des droits, il leur faut dix ans pour les réunir; ces seigneurs étaient l'abbaye d'Entremont, les chanoines de la cathédrale, le prieur de Peillonnex, le comte d'Aviernoz, le sieur Vibert de Massongy, le comte d'Aisery (= Esery), le comte de la Val-d'Isère (cf. Savoie aujourd'hui), le marquis de Sales et les Chissé de Polinge. Nous sommes en 1782, il faut encore six ans, donc en 1788, pour fixer le montant du rachat. Il était bien trop élevé pour les communiers, la Révolution régla le problème en "libérant" la Savoie.
Reignier devient en 1792 chef-lieu de canton, les bourgeois commencent réellement à remplacer les nobles. André Burnier-Fontanel, issu d'une famille de notaires, avait déjà racheté le château de Villy en 1787. Ce château était une ancienne propriété des Vidomne (fonctionnaire du seigneur, pour la justice et les finances) de Chaumont. En 1448, Pierre de Vidomne, seigneur de Villy, était vassal (dépendant) de Thoire. Cet André Burnier-Fontanel, député suppléant à Chambéry, vota pour l'annexion à la France; il finira percepteur sous l'Empire; mais dès 1793, il avait proposé l'ouverture d'une école. La municipalité républicaine de Reignier, qui devait obtenir du curé Denarié et de ses vicaires la prestation du "serment constitutionnel" (voté en France en 1790), ne fit pas de zèle et laissa s'enfuir les prêtres dans le Valais, leur fournissant même des passeports
En 1783, Reignier compte 1062 personnes, Saint-Romain 68 âmes. Ce même Barnier, dans un rapport de 1806, nous permet d'apprécier les changements dans l'agriculture. Développement de la culture des pommes de terre, des fourrages (trèfles), donc du bétail et du fumier comme engrais, apparition d'une rotation des cultures évitant l'appauvrissement des sols. Reignier cultive toujours le froment, possède des boeufs de petite taille, mais en nombre insuffisant, pas de moutons; le beurre et le fromage sont réservés à la consommation locale, peu de légumes, pas de lin, un peu de chanvre vendu au marché de La Roche par les mal-lotis, et des fourrages.
C'est le froment vendu au marché de Genève et de Chêne (cf. aujourd'hui ChêneBougerie) et quelques mulets revendus dans les pays de montagne qui fournissent l'essentiel des revenus. L'habitat est malsain, Il n'y avait souvent que deux pièces, la cuisine ou outaz, et le poêle contigü que l'on peut chauffer en hiver et où l'on mange, on couche, on travaille, le plus souvent appelé "chambre".
En 1801, il y a 1138 habitants, ils sont 1166 quand, après la défaite de Napoléon 1er, la monarchie Sarde revient en 1815. La famille qui prédomine alors est celle des Constantin de Magny, un hameau porte leur nom. Il y avait deux châteaux, un très ancien, restauré, au moins du XIIIe siècle, qui passa aux Magny en 1622; un autre, dit la Colombe, très reconnaissable encore aujourd'hui, avec sa demi-tour ronde, son aspect massif de maison forte et ses fenêtres à meneaux. Louis de Magny fut syndic de Reignier (maire ou adjoint, à partir de 1738), son cousin représentait le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel 1er (1759 - 1824) auprès de la Confédération helvétique.
En 1802, lors du Concordat, la paroisse de Saint-Romain fut incorporée à celle de Reignier. En 1833, l'absorption de la commune de Saint-Romain est terminée et en 1838, la "nouvelle" commune compte 1'709 habitants.
En 1843, on commence la construction de la nouvelle église, la paroisse était dédiée à Saint Martin, donc ancienne. C'est le célèbre curé Rouge Joseph qui en exécute les plans; elle est achevée en 1845; le clocher est construit. C'est une belle construction bâtie sur une place vaste et ombragée à la sortie du bourg en direction d'Annemasse; elle est vaste avec un énorme porche à triple arcade surmonté d'un fronton, elle a la majesté des hôtels de ville construits à cette époque (triple nef, dôme, maître-autel de marbre noir dû aux frères Magne de Saint-Jeoire, décorée en trompe-l'oeil entre 1855 - 1868, pas très bien restaurée récemment). En 1854, on reconstruit le pont Neuf; en 1806 on aménage la route de Bellecombe; en 1874, on inaugure au bas de la commune le pont de Viaison.
En 1881, la population atteint son maximum de 1887 habitants puis, malgré la construction de l'hospice départemental en 1892, malgré l'implantation de 4 fruitières en 1896, (celle du chef-lieu traitait 2'500 quintaux de lait, celle d'Eculaz 1'420 quintaux, celle de Polinges 2000 quintaux, celle de la Crétaz 2'000 quintaux), la population diminue, elle n'est plus que de 1'693 habitants en 1911. Il y a 5 fruitières en 1907.
La guerre de 1914 - 1918 coûte la vie à 94 Reignerands, 11 tombent en 1939 - 1940, un en Indochine, 2 en Algérie.