Auditions Des Chefs D'état-Major Devant La Commission De La
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The French White Paper on Defence and National Security (2008) 3
FRENCH DEFENCE 2009 Texts and exercises by Philippe Rostaing : 1. French Defence Organization 2. French Defence Policy : the French White Paper on Defence and National Security (2008) 3. The French Army 4. The French Air Force 5. The French Navy 6. The French Gendarmerie 7. Intelligence and the French Intelligence Community Update : March 2009 1 1. French Defence Organization Read this text carefully. You will then be able to do the following exercises : President of the French Republic Prime Minister Defence Minister Armed Forces Chief of Staff Army Chief Air Force Navy Chief Gendarmerie of Staff Chief of of Staff Director- Staff General 1. The Constitution of October 4th,1958, gives the President of the French Republic the position of Commander-in-Chief of the Armed Forces (Article 15). In his capacity as guarantor of national independence, territorial integrity and treaty compliance (Article 5), he alone may decide to commit nuclear forces. Within specific councils under his authority (the Council of Ministers, the Defence Council), the President defines national defence policies and makes decisions in defence matters. He is responsible for appointing senior civilian and military officials (Article 13). 2. The French government determines and executes national policies and thus may use armed force (Article 20). The Prime Minister has responsibility for national defence. He implements the decisions made by the President and is supported by the General Secretariat for National Defence (SGDN) in charge of interdepartmental defence coordination. 3. The Defence Minister has authority over the Ministry of Defence and executes military defence policies. He reports directly to the Prime Minister. -

La Guyane Un Territoire Riche D’Enjeux Et D’Opportunités Pour La Marine Publicité Éditorial De La Guyane À L’Océan Indien : Des Marins Tout Autour Du Globe
www.colsbleus.fr LE MAGAZINE DE LA MARINE NATIONALE N° 3081 — AOÛT / SEPTEMBRE 2019 RENCONTRE AMIRAL DENIS BÉRAUD PAGE 31 VDU MISSION JEANNE D’ARC 2019 PAGE 34 HISTOIRE OPÉRATION TRIDENT PAGE 46 La Guyane Un territoire riche d’enjeux et d’opportunités pour la Marine Publicité Éditorial De la Guyane à l’océan Indien : des marins tout autour du globe our ce premier éditorial, je gendarmerie maritime pour lutter notamment vous invite en Guyane dont contre la pêche illégale, an de préserver l’actualité est marquée par la l’exploitation durable des ressources halieutiques mort accidentelle de trois de de la zone économique exclusive. Les unités de nos camarades de l’armée de la Marine sont récentes et illustrent la priorité Terre dans l’opération Harpie accordée à ce vaste espace maritime s’étendant de lutte contre l’orpaillage illégal. jusqu’à 350 nautiques des côtes guyanaises, Mes pensées vont vers leurs aux limites du plateau continental sur lequel la © J. RAPPIN/MN familles, leurs frères d’armes ainsi qu’aux blessés. France possède un droit exclusif d’exploitation. Capitaine de vaisseau PAu cœur de la forêt primaire d’Amazonie, la plus De l’autre côté du globe, la période estivale a Éric Lavault, directeur riche du monde par sa biodiversité, on trouve la été marquée par le retour du Charles de Gaulle de la publication plus longue frontière terrestre française, partagée et de son escorte européenne1 le 7 juillet. Parti avec le Brésil, le long du euve Oyapock. Son alter le 5 mars, le groupe aéronaval a apporté son ego, le euve Maroni, marque la frontière avec soutien à l’opération Chammal, puis a opéré en l’autre partenaire régional, le Surinam. -

Grands Fonds L'écho
L’éCHODES GRANDS FONDS L’enthousiasme est la seule vertu - Philippe Tailliez Magazine #88 - 2018 AMICALE DES PLONGEURS DÉMINEURS DE LA MARINE Sommaire EDITORIAL 3 DU PRÉSIDENT DE L’AMICALE LA DERNIÈRE PLONGÉE 5 DE NOS DISPARUS 6 BRÉVES DE L’AMICALE FORMATION POST-BAC 10 MAINTENANCE SUBAQUATIQUE ÉCOLE DE PLONGÉE 18 60 ANS D’HISTOIRE SÉCURITÉ CIVILE CAEN : 22 NEUTRALISATION DE 5 BOMBES À CHERBOURG GPD MANCHE : DEUX SUR TROIS, 24 PEUT MIEUX FAIRE 31 COMMANDO KIEFFER L’ AMICALE 36 DES PLONGEURS-DÉMINEURS Crédits photos : Médiathèque Marine Nationale, Sylvie Maillard Conflans Sainte Honorine, Centre de déminage de Caen, Agence 3MS Commando Kieffer, Edition - Communication - Evénementiel École de Plongée, 9, ZA Bompertuis - avenue d’Arménie Presse de la Manche 13120 GARDANNE 04 42 37 06 22 Responsable : Marc SALVADERO [email protected] Création : Eric PERRIN Imprimerie : Print Team Toute reproduction interdite. 1 Editorial Pierre Le Roux Président de l’Amicale des Plongeurs Démineurs • Satisfaire un besoin d’indépendance tous en cœur entonner le chant des dans le domaine de la plongée, nous de cours du brevet d’aptitude tech- dans l’action tout en se disciplinant Goélands !!! L’esprit d’équipe et la ne sommes pas tous égaux sur le nique de plongeur démineur (BAT), soi-même dans le respect de procé- joie qui se dégageait du groupe des plan physiologique, et cela n’est pas cette appréciation flatteuse mais réa- dures et de techniques apprises pa- jeunes diplômés augurent bien de une affaire de volonté mais aussi de liste n’est pas étrangère aux élèves du tiemment mais sûrement. -

Systèmes D'information Et De Communication
www.colsbleus.fr LE MAGAZINE DE LA MARINE NATIONALE N°3042 — SEPTEMBRE 2015 FOCUS LES ÉTAPES D’UN CONTREMINAGE PAGE 26 RENCONTRE CONTRE-AMIRAL BERNARD-ANTOINE MORIO DE L’ISLE PAGE 28 IMMERSION GOÉLETTE BELLE POULE, « HISSEZ HAUT ! » PAGE 42 " Systèmes - RD E 2,80 F: d’information et - 3042 de communication M 01396 ’ :HIKLNJ=[UW]U\:?d@a@o@c@k Des connexions au service des opérations Publicité Éditorial Plus vite, plus haut (débit), plus fort n 1916, la Kriegsmarine, tirant parti gagnent en discrétion, en portée et surtout en débit des récents perfectionnements d’information, acheminant désormais trois éléments des transmissions sans fil, parvient à indispensables aux opérations modernes : images, conjuguer l’action de ses forces voix et données. de surface et de ses sous-marins. L’arrivée des technologies de l’Internet a conféré aux Ces derniers, qui opéraient jusque-là SIC un caractère global, effaçant les barrières entre isolément contre les convois alliés les besoins opérationnels et ceux dévolus au soutien. dans l’Atlantique, voient leur efficacité Les réseaux, qui font désormais partie du quotidien © PASCAL DAGOIS/MN Capitaine de vaisseau décuplée. Un exemple parmi d’autres de l’importance de chaque marin à terre comme en mer, permettent Didier Piaton Edes transmissions – désormais érigées en systèmes d’améliorer l’efficacité. Le flux d’informations fait Directeur d’information et de communication (SIC) – pour gagner en réactivité et en synergie. L’adoption de stan- de la publication les forces aéronavales. Leur rôle, parfois méconnu, a dards communs permet une interopérabilité crois- toujours été capital. sante avec les forces navales alliées. -

L'aviso Des Assos
L'ACTU MARINE SEMAINE 21 L'aviso des assos L'actu de la semaine Mesdames, Messieurs les officiers généraux, Chers amis de la Marine, En ce contexte si particulier, n'hésitez Voici votre newsletter de la semaine 21 ! pas à nous faire part de vos initiatives, idées, astuces, projets que vous avez afin de maintenir le lien avec vos réseaux ! L'AVISO DES ASSOS Actualités Ministère des armées Réforme de la protection du secret de la défense nationale : la Marine nationale en première ligne « Mieux classifier pour mieux protéger » Le secret est un outil essentiel de défense des intérêts diplomatiques, économiques, stratégiques et sécuritaires de la France. Il permet de garantir la confidentialité de plus de cinq millions de documents sensibles qui portent sur des sujets aussi variés que la conduite de nos opérations militaires, la lutte contre le terrorisme, la protection de nos infrastructures vitales ou les technologies de l’industrie de défense. Fin 2015, la France a entrepris de rédiger une nouvelle édition de l’instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense et de la sécurité nationale n° 1300 (IGI 1300) travail mené sous l’égide du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Celle-ci entrera en vigueur le 1er juillet 2021 après une période d’appropriation qui a commencé à l’été 2020. Les points clefs de cette réforme sont notamment la simplification des niveaux des classifications, passant de trois à deux, le contingentement du secret « au plus juste besoin » pour le protéger plus strictement, et le renforcement de la protection des systèmes d’information. -

Version Remotorisée De Nos Exocet
A S S E M B L É E N A T I O N A L E X V e L É G I S L A T U R E Mercredi 3 juillet 2019 Compte rendu Séance de 9 heures 30 Compte rendu n° 46 Commission de la défense nationale et des forces armées SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019 — Audition de l’amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la marine. ............................................................................... 2 Présidence de M. Jean-Jacques Bridey, président — 2 — La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq. M. le président Jean-Jacques Bridey. Amiral, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd’hui pour faire un point avec vous sur l’état de la marine nationale, les opérations actuelles et vos attentes en matière d’équipements et de ressources humaines. Nous avons déjà reçu au cours de ce cycle d’auditions le chef d’état-major des armées, les chefs d’état-major de l’armée de terre et de l’armée de l’air, ainsi que le délégué général pour l’armement. Une de nos questions n’a d’ailleurs pas trouvé de réponse à l’issue de son audition, et c’est donc vers vous que nous nous tournerons pour éclaircir le problème en question. Je vous laisse la parole pour votre exposé liminaire ainsi que le commentaire d’un film que vous vous êtes proposé de nous projeter, avant que les commissaires puissent dans un second temps vous poser leurs questions. Amiral Christophe Prazuck. Monsieur le président, mesdames et Messieurs les députés, je suis flatté que ce soit avec mon intervention que se conclue le cycle d’auditions que vous évoquiez. -

En 2017, Le Budget De La Marine Nationale Est De 4 417 Millions D’Euros
DEFENSE Claire-Marine Pion Etat-major des opérations de la Marine, 60 Bd du Général Martial Valin, 75 509 Paris Cedex 15 Jérémy Drisch Etat-major des opérations de la Marine, 60 Bd du Général Martial Valin, 75 509 Paris Cedex 15 Messages clés : En 2017, le budget de la Marine nationale est de 4 417 millions d’euros. 38 296 militaires et civils travaillent pour la Marine nationale en 2016. Entre 2011 et 2016, la tendance à la baisse provient d’une politique de réduction des effectifs à mettre en perspective avec la politique budgétaire, jusqu’aux attaques terroristes de 2015 ayant entraîné un changement en termes de politique de sécurité et de sûreté. La ventilation des effectifs et du budget de la Marine par façade n’est pas possible techniquement. Les équipements de la Marine nationale en façade Atlantique (au sens du périmètre de compétences de la préfecture maritime de Brest) sont basés principalement à Brest, Lorient, Lanvéoc-Poulmic, Landivisiau et l’Ile Longue. I. Description et situation générale de l’activité à l’échelle nationale I.A. Organisation et missions de la Marine nationale L’état-major de la Marine définit et fait appliquer la politique générale de la Marine nationale, structurée autour de la force d’action navale, la force océanique stratégique, l’aéronautique navale et la force maritime des fusiliers marins et commandos, et la gendarmerie maritime. Les activités de la Marine nationale s’inscrivent dans une mission générale de sauvegarde maritime, de défense et de protection des intérêts de la France en mer, ou depuis la mer1. -

N° 3115 Assemblée Nationale
N° 3115 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 octobre 2015. AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES SUR LE PROJET DE LOI de finances pour 2016 (n° 3096) TOME V DÉFENSE PRÉPARATION ET EMPLOI DES FORCES : MARINE PAR M. GWENDAL ROUILLARD Député —— Voir le numéro : 3110 (annexe 12) — 3 — SOMMAIRE ___ Pages INTRODUCTION ........................................................................................................... 7 PREMIÈRE PARTIE : DES RESSOURCES ADAPTÉES AU NIVEAU D’INTENSITÉ OPÉRATIONNELLE ....................................................................... 9 I. UN BUDGET POUR 2016 CONSOLIDÉ, CONFORME À L’ACTUALISATION DE LA PROGRAMMATION .................................................. 9 A. LES CRÉDITS PRÉVUS POUR 2016 : UN BUDGET REVALORISÉ, NOTAMMENT AU PROFIT DE L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE ET DE L’ENTRETIEN PROGRAMMÉ DES MATÉRIELS ............................................ 10 1. L’évolution des crédits par sous-action .................................................................. 10 2. La répartition des crédits budgétaires par titre ........................................................ 12 B. LES OBJECTIFS DE PERFORMANCE .............................................................. 13 1. La mesure de la performance opérationnelle .......................................................... 13 2. Les indicateurs relatifs à l’activité et à la disponibilité des matériels .................... -

Commando Kieffer (Marine Nationale) — Wikipédia
Non connecté Discussion Contributions Créer un compte Se connecter Article Discussion Lire Modifier Modifier le code Voir l’historique Rechercher dans Wikipédia Commando Kieffer (Marine nationale) Pour l’article homonyme, voir Commandos Kieffer (France libre). Accueil Cet article est une ébauche concernant le domaine militaire. Portails thématiques Article au hasard Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Contact Le commando Kieffer est le sixième commando marine (FORFUSCO) créé au sein de la Marine nationale, en 2008 ; de plus il appartient aux forces Contribuer spéciales. Il porte le nom du capitaine de corvette Kieffer, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a formé et dirigé le 1er Bataillon de Fusiliers Commando Kieffer Débuter sur Wikipédia Marins Commandos, 177 commandos marine de la France libre qui ont participé au débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944. Aide Communauté Sommaire [masquer] Modifications récentes 1 Création Faire un don 2 Rôle 3 Historique de l’appellation Outils 4 Autres commandos marines Pages liées 4.1 En France Suivi des pages liées 4.2 À l'étranger Importer un fichier 5 Voir aussi Pages spéciales Lien permanent 5.1 Articles connexes Informations sur la 6 Références page 7 Liens externes Élément Wikidata Citer cette page Insigne du commando Kieffer. Création [ modifier | modifier le code ] Imprimer / exporter Branche Commandos marine Créer un livre La création du commando Kieffer a été prononcée le 8 mai 2008 par le président Nicolas Sarkozy lors des cérémonies commémorant la victoire du Type Force spéciale Télécharger comme 8 mai 1945, exceptionnellement décentralisées sur la plage de Ouistreham, précisément là où les commandos Kieffer de la France libre avaient PDF Fait partie de FORFUSCO débarqué le 6 juin 1944. -

Préparation Et Emploi Des Forces Programme 178
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 0 BUDGET GÉNÉRAL MISSION MINISTÉRIELLE 2 PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCES 0 ANNEXE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2 PRÉPARATION ET EMPLOI DES FORCES PROGRAMME 178 Préparation et emploi des forces PROGRAMME 178 PRÉPARATION ET EMPLOI DES FORCES MINISTRE CONCERNÉE : FLORENCE PARLY, MINISTRE DES ARMÉES Présentation stratégique du projet annuel de performances 4 Objectifs et indicateurs de performance 7 Présentation des crédits et des dépenses fiscales 24 Justification au premier euro 32 Opérateurs 138 4 PLF 2020 Préparation et emploi des forces Programme n° 178 PRÉSENTATION STRATÉGIQUE PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Général d'armée François LECOINTRE Chef d'état-major des armées Responsable du programme n° 178 : Préparation et emploi des forces Le programme 178 « Préparation et emploi des forces », sous la responsabilité du chef d’état-major des armées (CEMA), est au cœur de la mission « Défense ». Le CEMA assure la cohérence de l’état de préparation des forces. Il s’appuie sur les contrats opérationnels qui permettent de structurer le modèle d’armée correspondant à l’ambition de la loi de programmation militaire (LPM) à l’horizon 2030. L’engagement opérationnel des armées impose d’organiser le programme 178 de façon à pouvoir assurer simultanément la conduite des opérations ainsi que la préparation des forces dans un cadre organique cohérent. La structuration des actions et sous actions du programme répond à cette logique. L’année 2020 constitue la deuxième année d’exécution de la LPM 2019–2025. Elle permet la poursuite de la régénération des équipements fragilisés par un engagement opérationnel intense et l’amplification de leur modernisation avec la mise en service opérationnelle progressive de matériels nouveaux, dans les trois milieux. -

De Saint-Barth Issn : 1254-0110
1152- Jeudi 15 octobre 2015 LE JOURNAL Tél. : 05 90 27 65 19 - Fax : 05 90 27 91 60 www.journaldesaintbarth.com - [email protected] DE SAINT-BARTH ISSN : 1254-0110 Dans la perspective de la restauration de l’étang de Sain-Jean projetée par la Collectivité, des analyses ont commencé. P.4 La restauration de l’étang de Saint-Jean en projet Les rois de la pétanque à Saint-Barth ce week-end P.6 La fête de Corossol en images P.5 JSB- CTUALITÉS 15 octobre 2015 - n°1152 A 2 En bref Visite à Saint-Martin du nouveau patron des Fumer pollue ! armées aux Antilles Dimanche 11 octobre, l’opération de ramassage des mégots orga- nisée par Saint-Barth Essentiel a permis de retirer du paysage un plein sac de 120 litres de bouts de cigarettes. Uniquement de part et d’autre de la route entre le parking du Monoshop, à Marigot, et Grand Cul-de-sac. Un nouveau ramassage sera organisé le mois prochain, mercredi 11 novembre. Sur une portion au départ du Sereno, à Grand Cul-de-Sac, en direction de Grand Fond et Lorient. L’association de défense de l’environnement rappelle que les mégots de cigarettes, composés d’acétate de cellulose, «peuvent mettre jusqu’à quinze ans pour se décomposer dans la nature». Elle invite les fumeurs à utiliser des cendriers de poche. La présidente de Saint-Barth Essentiel, Hélène Bernier, souhaite- rait également que le jet d’un mégot de cigarette dans la nature soit verbalisé à Saint-Barthélemy comme c’est le cas à Paris, où il en coûte une amende de 68 euros depuis le 1er octobre. -
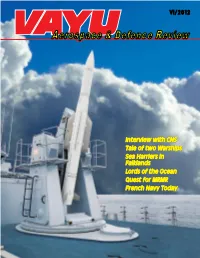
Vayu Issue VI Nov Dec 2012
VI/2012 ARerospace &Defence eview Interview with CNS Tale of two Warships Sea Harriers in Falklands Lords of the Ocean Quest for MRMR French Navy Today VI/2012 CFM VI/2012 VI/2012 Aerospace &Defence Review “Operating Across the Full flying Sea Harriers off the HMS New Helicopters, the various 27 Hermes this is the true story of aircraft and helicopter types Spectrum” how the VTOL carrier-based are identified. Interview with CNS In an exclusive interview with Tale of two Warships aircraft arguably tilted the tables Sea Harriers in Admiral DK Joshi, Chief of Falklands towards victory. In the article, In Lords of the Ocean Naval Staff on eve of Navy Day, Quest for MRMR The Silver Carrier, the 25 years French Navy Today the CNS reviews the Maritime of the INS Viraat (nee HMS Capabilities Perspective Plan for Hermes) are reviewed. 2012-2017 and enumerates his vision for the Indian Navy at the The Shtil-1 air defence system aboard INS Teg, end of the second decade of this showing a 9M317 missile on its launcher century. Deg Teg Fateh ! (photo by Angad Singh) 87 A pictorial essay by Angad Singh onboard the Talwar-class guided missile frigate INS Teg, during a EDITORIAL PANEL day’s sail in the Arabian Sea. MANAGING EDITOR Vikramjit Singh Chopra Lords of the Ocean 60 Vayu visited Boeing at their EDITORIAL ADVISOR Seattle facilities where the Admiral Arun Prakash Indian Navy’s new Boeing P-8Is are being built. This EDITORIAL PANEL 38 A Tale of two Warships new generation long range Pushpindar Singh Former CNS Admiral Arun maritime reconnaissance and Prakash reviews the near anti-submarine warfare aircraft Air Marshal Brijesh Jayal simultaneous induction of will join INAS 312 Albatross in Air Cdre.