Les Grands Procès De L'histoire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jean Jaurès – an Apostle of Peace in Pre-War Europe, 1905-1914
Assoc. Prof. Dr. Rossitza Tasheva, Sofia University Jean Jaurès – An Apostle of Peace in Pre-War Europe, 1905-1914 The decade preceding the outbreak of the Great War in 1914 was marked not only by an intensification of armaments and confrontations of the world powers in their quest to acquire new resources, markets and influence, but also by an increasingly growing international peace movement, supported by hundreds of thousands of people. They came from different social groups, but what united them all was their common dream of harmony and peace in society, their belief that progress should not be based on violence and wars as means of resolving the emerging conflicts ought to be abolished. The Hague Conventions for the pacific settlement of international disputes of 1899 and 1907 gave some hope for the realization of their vision of a peaceful world, but in fact these conventions were mainly intended to diminish the evils of militarized conflicts and not to prevent their outbreak or escalation. In the beginning of the twentieth century, one French philosopher, historian and politician, Jean Jaurès, vigorously joined in the search for means to prevent wars among nations. To all who were disappointed with the failure of the ongoing initiatives, he offered a new, different perspective: the organization of a mass movement for peace, which would involve not only the governments but also the nations, in which the international solidarity of working men and women would oppose the constant threat of war. Jaurès demonstrated an extraordinary and unique activity in the struggle which he undertook against colonialism and war. -

The War Imagined: 1890–1914
CHAPTER ONE The War Imagined: 1890–1914 GERD KRUMEICH (translated by Mark Jones) The years between 1900 and the outbreak of World War I are generally described as the “prewar” period. However, there is no consensus about what the term “prewar” really means or about the period it covers. Some scholars have begun with the Franco- Prussian war of 1870–1, but it is more common to see the years of the “scramble for Africa” and the “imperialist delirium” as the true prewar period.1 Even here, the precise starting point depends on national perspectives. For Germany, it might be taken as Kaiser Wilhelm’s policy of expansion on to the world stage (Weltpolitik) in the later 1890s, or the subsequent naval rivalry with Britain. For the French, the military alliance with Russia in 1893, or the First and Second Moroccan Crises of 1905 and 1911, make equally credible starting points. For Russia it is perhaps the recovery from the catastrophe of the Russo-Japanese War of 1904–5 and the 1905 revolution. I propose to divide the prewar period into a longer phase when enmities were cre- ated and a more immediate phase of acute tensions leading to the outbreak of hosti- lities. The first phase was defined by the gradual increase in international antagonism and the polarization of the European alliance system into two antagonistic blocks. The second phase was marked by an increasingly nervous disposition toward what was seen as the inevitability – and for some the desirability – of a war that would reshape the course of world development. -

Anuario IEHS 33(1).Pdf
Anuario · IEHS 33 (1) · 2018 ISSN-L 0326-9671 · Instituto de Estudios Histórico-Sociales Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional del Centro Tandil · Argentina Anuario · IEHS 33 (1) 1er semestre 2018 ISSN 0326-9671 (edición impresa) ISSN 2524-9339 (edición en línea) Anuario IEHS. Revista académica publicada por el Instituto de Estudios Histórico-Sociales «Prof. Juan Carlos Grosso» (Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires). Está dedicada a difundir los avances de la historia y de las ciencias sociales, centrada en las problemáticas de la historia argentina y americana. Para disponer de información adicional sobre el Anuario IEHS puede consultarse: http://anuarioiehs.unicen.edu.ar/. Anuario IEHS. Academic journal published by the Institute of Historical and Social Studies «Prof. Juan Carlos Grosso» (Faculty of Humanities, National University of Central Buenos Aires Province). The publication intends to spread the advances of history and social sciences, focused on the problematics of Argentine and American history. In order to have additional information about Anuario IEHS it can be consulted: http://anuarioiehs.unicen.edu.ar/. Directora Dra. Olga Echeverría (UNCPBA - CONICET) Secretaria de Redacción Dra. Melina Yangilevich (UNCPBA - CONICET) Editores de reseñas y notas críticas Dra. Paola Gallo (UNCPBA) & Dr. Lucas Bilbao (UNCPBA - CONICET) Editor técnico Lic. Ramiro Tomé (CONICET) Comité Editorial Dra. Marina Adamini (CONICET) Dr. Julio César Melon Pirro (UNCPBA - UNMdP) Prof. Susana Bianchi (Investigadora Honoraria del IEHS) Dr. Eduardo Míguez (UNCPBA - UNMdP) Dr. Marcello Carmagnani (El Colegio de México) Dr. Zacarías Moutoukias (Université de Paris VII) Dr. Mario Cerutti (Universidad Autónoma de Nuevo Dr. -

Humanization of the Enemy: the Pacifist Soldier and France in World War One
Humanization of the Enemy: The Pacifist Soldier and France in World War One By Daniel E. Stockman A culminating senior thesis submitted to the faculty of Dominican University of California in partial fulfillment of the requirements of the Bachelor of Arts in Humanities and Cultural Studies. San Rafael, CA May 2017 This thesis, written under the direction of the candidate’s thesis advisor and approved by the department chair, has been presented to and accepted by the Department of Humanities and Cultural Studies, Religion, Philosophy, in partial fulfillment of the requirements for the degree of the Bachelor of Arts in Humanities and Cultural Studies. The content and research methodologies presented in this work represent the work of the candidate alone. Daniel E. Stockman Candidate October/14/2016 Chase Clow, Ph.D. Department Chair October/14/2016 M. Patricia Dougherty, O.P., Ph.D. Thesis Reader October/14/2016 Copyright © 2016, by Daniel E. Stockman All Rights Reserved. Table of Contents List of Figures…………………………………………………....ii Abstract………………………………………………………….iii Introduction……………………………………………………....1 Historiography…………………………………………………...3 The French Third Republic and Militarization……………..........8 Sustaining Personal Humanity in War……………………...……15 Modern Parallels and the Pacifist Argument…………………….27 Conclusion……………………………………………………….32 Works Cited……………………………………………………...34 i List of Figures Figure 1. “Alsace-Lorraine.” Auguste Leroux circa 1918. Referenced from World War I and Propaganda by Troy R.E. Paddock (pp. 199). Figure 2. “Journée du Poilu.” Willette, Adolphe. Journée du Poilu. 1915. Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. Web. 25 Mar. 2016. < http://loc.gov/pictures/resource/cph.3f03978/> ii Abstract Not all French citizens were enthused by the prospect of war in 1914, nor were they all so willing to embrace a dehumanized view of the enemy. -

Raoul VILLAIN Né Le 19 Septembre 1885 À 19H À Reims Marne 51 Selon Acte N°2176 – AD51 En Ligne
Ce jeune nationaliste armé d’un révolver assassine Jean Jaurès le 31 juillet 1914 au Café du Croissant à Paris, à la veille du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Raoul VILLAIN Né le 19 septembre 1885 à 19h à Reims Marne 51 Selon acte n°2176 – AD51 en ligne Décédé le 14 septembre 1936 à Ibiza (archipel des Baléares) Lourde hérédité et psychologie fragile le portent vers le nationalisme extrémiste Son père est greffier en chef au tribunal civil de Reims et sa mère, atteinte d’aliénation mentale en 1887 est internée à l’asile de Châlons-sur-Marne tandis que sa grand-mère paternelle souffrait de délires mystiques. Son frère aîné Marcel, commis-greffier sera lieutenant aviateur et officier de la Légion d’honneur pour ses faits d’armes durant la Première guerre mondiale. Après des études chez les Jésuites, en octobre 1905 Raoul s’inscrit à l’Ecole nationale d’agriculture de Rennes dont il sort diplômé, classé 18e sur 44. Toutefois, il ne travaille que quelques semaines dans l’agriculture avant de rejoindre son père à Reims puis d’aller en Alsace avec le désir de préparer le baccalauréat tout en étant surveillant suppléant au collège Stanislas. Qualifié de « très doux, gentil et bien éduqué » par ceux qui l’approchent Incorporé en 1906, l’Armée le réforme un an plus tard. En 1912, il séjourne en Angleterre puis l’année suivante en Grèce. Finalement en juin 1914, il s’inscrit à l’Ecole du Louvre pour y étudier l’archéologie. « Sérieux, très doux, gentil, poli, bien éduqué, sans mauvaise fréquentation… » sont autant de qualificatifs donnés à son sujet tant lors de ses études qu’à l’occasion de son hébergement à l’étranger et même dans sa fiche de police. -
APPENDICES 342 Appendices
APPENDICES 342 Appendices Appendix 1: The Declaration of the Rights of Man and the Citizen (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) Approved by the National Assembly of France, 26 August 1789 The representatives of the French people, organized as a National Assembly, believing that the ignorance, neglect, or contempt of the rights of man are the sole cause of public calamities and of the corruption of governments, have determined to set forth in a solemn declaration the natural, inalienable, and sacred rights of man, in order that this declaration, being constantly before all the members of the Social body, shall remind them continually of their rights and duties; in order that the acts of the legislative power, as well as those of the executive power, may be compared at any moment with the objects and purposes of all political institutions and may thus be more respected, and, lastly, in order that the grievances of the citizens, based hereafter upon simple and incontestable principles, shall tend to the maintenance of the constitution and redound to the happiness of all. Therefore, the National Assembly recognizes and proclaims, in the presence and under the auspices of the Supreme Being, the following rights of man and of the citizen: Articles 1. Men are born and remain free and equal in rights. Social distinctions may be founded only upon the general good. 2. The aim of all political association is the preservation of the natural and imprescriptible rights of man. These rights are liberty, property, security, and resistance to oppression. 3. The principle of all sovereignty resides essentially in the nation. -

Vol. I No. 2, August 1934
(', ; THE NEW INTERNATIONAL A MONTHLY ORGAN OF REVOLUTIONARY MARXISM VOLUME 1 AUGUST 1934 NUMBER 2 Published once a month by the New International Publishing Association, Station D, Post Office Box II9, New York, N ew York. Subscription rates: $1.50 per year (I2 issues) ; $1.00 for seven issues. Canada and Foreign subscription rate: $1.75 per year. 1L~\ ~= SIIACHTMAN, Editor MARTIN ABERN, Busincss 1Y1 anager TAB LEO :r 'C 0 N TEN T S A111cr;ca and the War In the Pacific, by Jack ~V eber, 33' The Stalinists anc! Pacifism, by Arlle S7.(labcck. S4 ANew Turn to the United Front ........ " ...... " .. 35 Six Months of the Doumergue Regime .............. " 56 BGnapart:sm and Fascism ...... , ............ , 37 Murder for Profit: El Gran Chaco, by Jean llfcndcz .... 57 The Testament of Lenin, by Leon Tj'ots!?y ...... , 39 Banned! , .............. , , ............. , . .. 58 The Second International in the War, by Max Shachtman 43 DOCUMENTS AND DISCUSSION: THE CRISIS IN FASCISM : The Question of Organic Unity 111 France 1. The Events in Germany, by lYJauricc Spector .... 47 2. How It Happened in Italy, by I. C. H .. ... , , .... 48 The Pact ................ " ..................... 59 On the Slogan of "Disarmament", by N. Lenin ... ..... 50 Towards Organic Unity? by La V h'itc " ...... ,' .. 59 Diplomacy in the World War, by G. Vassilkovsky .. " .. 52 Organic Unity? Yes! by Linier ............ , ..... 60 BOOKS: Soule's Revolution, by Felix .M arrow ......... ', .... 61 Honky-Tonk, b:y Louis Berg .... ',.. , ............ A Legal Marxist, by JosePh C artc?' ., ............. ,. American Capacity, by T1/. E. G ....... , ........... I Inside Front Cover: For the Man on the Planet without a Visa. J nside Back Cover: At Home. -

The German Revolution, 1917-1923 (Historical Materialism Book Series
THE GERMAN REVOLUTION, 1917-1923 HISTORICAL MATERIALISM BOOK SERIES Editorial board PAUL BLACKLEDGE, Leeds - SEBASTIAN BUDGEN, Paris JIM KINCAID, Leeds - STATHIS KOUVELAKIS, Paris MARCEL VAN DER LINDEN, Amsterdam CHINA MIÉVILLE, London - PAUL REYNOLDS, Lancashire THE GERMAN REVOLUTION 1917-1923 By Pierre Broue´ Translated by John Archer and Edited by Ian Birchall and Brian Pearce With an Introduction by Eric D. Weitz BRILL LEIDEN • BOSTON 2005 This book is printed on acid-free paper. Original title: La révolution en Allemagne, 1917-1923 © Pierre Broué, Les Editions de Minuit, 1971 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Broué, Pierre. [Révolution en Allemagne, 1917-1923. English] The German Revolution / by Pierre Broué ; [translated by John Archer and edited by Ian Birchall and Brian Pearce]. p. cm. — (Historical materialism book series, ISSN 1570-1522 ; 5) Includes bibliographical references and index. ISBN 90-04-13940-0 (alk. paper) 1. Germany—Politics and government—1918-1933. 2. World War, 1914-1918—Germany. 3. Kommunistische Partei Deutschlands—History. 4. Germany—History—Revolution, 1918. I. Title. II. Series. DD240.B81613 2004 943.085—dc22 2004040884 ISSN 1570–1522 ISBN 90 04 13940 0 © Copyright 2005 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Authorization to photocopy items for internal or personal use is granted by Koninklijke Brill provided that the appropriate fees are paid directly to The Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Suite 910 Danvers, MA 01923, USA. -
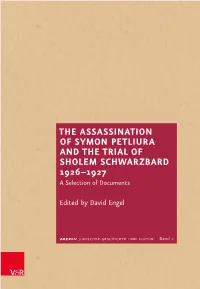
The Assassination of Symon Petliura and the Trial of Scholem Schwarzbard 1926–1927 a Selection of Documents
THE ASSASSINATION OF SYMON PETLIURA AND THE TRIAL OF SHOLEM SCHWARZBARD 1926–1927 A Selection of Documents Edited by David Engel The Assassination of Symon Petliura and the Trial of Sholem Schwarzbard 1926–1927 Schwarzbard of Sholem the Trial and Petliura of Symon Assassination The archiv jüdischer geschichte und kultur Band 2 David Engel 978-3-525-30195-1_Eber.indd 1 19.09.2018 14:52:56 Archiv jüdischer Geschichte und Kultur Archive of Jewish History and Culture Band/Volume 2 Im Auftrag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig On behalf of the Saxonian Academy of Sciences and Humanities at Leipzig herausgegeben/edited von/by Dan Diner Redaktion/editorial staff Frauke von Rohden Stefan Hofmann Markus Kirchhoff Ulrike Kramme Vandenhoeck & Ruprecht The Assassination of Symon Petliura and the Trial of Scholem Schwarzbard 1926–1927 A Selection of Documents Selected, translated, annotated, and introduced by David Engel The “Archive of Jewish History and Culture” is part of the research project “European Traditions – Encyclopedia of Jewish Cultures” at the Saxonian Academy of Sciences and Humanities at Leipzig. It is sponsored by the Academy program of the Federal Republic of Germany and the Free State of Saxony. The Academy program is coordinated by the Union of the German Academies of Sciences and Humanities. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data available online: https://dnb.de © 2016, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D37073 Göttingen Typesetting: Dörlemann Satz, Lemförde Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com ISSN 2566-6673 ISBN (Print) 978-3-525-31027-4 ISBN (PDF) 978-3-666-31027-0 https://doi.org/10.13109/9783666310270 This publication is licensed under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International license, at DOI 10.13109/9783666310270. -

Military History Anniversaries 1 Thru 15 August
Military History Anniversaries 1 thru 15 August Events in History over the next 15 day period that had U.S. military involvement or impacted in some way on U.S military operations or American interests worldwide Aug 01 1801 – Tripolitan War: The schooner USS Enterprise defeated the 14-gun Tripolitan corsair Tripoli after a fierce but one–sided battle. Aug 01 1907 – U.S. Army: Air Force Day » On this day the U.S. Army Signal Corps established a small Aeronautical Division to take care of all matters pertaining to military ballooning, air machines and all kindred subjects. The Signal corps began testing its first airplane at Fort Myers, Virginia, on August 20, 1908. After more testing with an improved Wright Flyer, the Army formerly accepted this airplane, identified as “Airplane No. 1,” on August 2, 1909. In early 1913, the Army ordered its aviators who were training in Augusta Georgia, and Palm Beach, Florida to Texas to take part in the 2nd Division maneuvers. In Galveston on 3 MAR, the chief Signal Oficer designated the assembled men and equipment the the “1st Provisional Aero Squadron” with Capt. Charles DeF. Chandler as squadron commander. They began flying activities a few days later. On 4 DEC, general orders redesignate the unit as the 1st Aero Squadron, effective 8 DEC. The first military unit of the U.S. Army devoted exclusively to aviation has remained continuously active since its creation. Air Force Day was established on August 1, 1947, by President Truman "in recognition of the personnel of the victorious Army Air Forces and all those who have developed and maintained our nation's air strength." August 1 was chosen to mark the 40th anniversary of the establishment, in 1907, of the Aeronautical Division in the Office of the Chief Signal Officer of the Army. -

Memorias De Un Revolucionario
(c) de la edición, Jean Rière y Traficantes de Sueños. (c) de la traducción, herederos de Tomás Segovia. (c) del texto, herederos de Victor Serge. Licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) Queremos agradecer a los editores de Veintisiete Letras la cesión de los trabajos que dieron a término en la excelente edición de esta editorial del año 2011. Primera edición a cargo de Jean Rière del último manuscrito de Víctor Serge: Mémoires d’un révolutionnaire (1901-1941), París, Le Seuil, 1978. Primera edición: mayo de 2019 Título: Memorias de un revolucionario Autor: Víctor Serge Edición: Jean Rière Traducción: del libro, Tomás Segovia; del prólogo y anexos de Jean Rière, Marisa Pérez Colina; del aparato crítico (notas) de Jean Rière, Mariana Pugliese. Maquetación y diseño de cubierta: Traficantes de Sueños Traficantes de Sueños C/ Duque de Alba, 13. 28012, Madrid. Tlf: 915320928. E-mail:[email protected] Impresión: Cofás artes gráficas ISBN: 978-84-949147-8-2 Depósito legal: M-15374-2019 MEMORIAS DE UN REVOLUCIONARIO VICTOR SERGE EDICIÓN, PRÓLOGO Y NOTAS: JEAN RIÈRE TRADUCCIÓN: TOMÁS SEGOVIA traficantes de sueños ÍNDICE Víctor Serge: una voz para el tiempo presente. Jean Rière 9 Nota del editor. Jean Rière 19 1. Mundo sin evasión posible (1906-1912) 25 2. Una razón para vivir: vencer (1912-1919) 81 3. El desaliento y el entusiasmo (1919-1920) 113 4. El peligro está en nosotros (1920-1921) 165 5. Europa en el viraje oscuro (1922-1926) 215 6. La revolución en el callejón sin salida (1926-1928) 275 7. -

Countdown to War.Pdf
Published by: The Irish Times Limited (Irish Times Books) © The Irish Times 2016. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without the prior written consent of The Irish Times Limited, or under terms agreed with the appropriate reprographic rights organisation or as expressly permitted by law. Contents The war to end all war ............................................................................................................... 4 Shots echoed round Europe ...................................................................................................... 6 Profile: Gavrilo Princip ............................................................................................................. 14 Redmond pledge that nationalists and unionists would fight together in first World War.... 16 What will the British do? ......................................................................................................... 21 From brink of civil war ............................................................................................................. 28 A duty to the French? .............................................................................................................. 33 Profile: Keir Hardie ................................................................................................................... 38 Profile: Sir Edward Grey ..........................................................................................................