Introduction
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hermann NAEHRING: Wlodzimierz NAHORNY: NAIMA: Mari
This discography is automatically generated by The JazzOmat Database System written by Thomas Wagner For private use only! ------------------------------------------ Hermann NAEHRING: "Großstadtkinder" Hermann Naehring -perc,marimba,vib; Dietrich Petzold -v; Jens Naumilkat -c; Wolfgang Musick -b; Jannis Sotos -g,bouzouki; Stefan Dohanetz -d; Henry Osterloh -tymp; recorded 1985 in Berlin 24817 SCHLAGZEILEN 6.37 Amiga 856138 Hermann Naehring -perc,marimba,vib; Dietrich Petzold -v; Jens Naumilkat -c; Wolfgang Musick -b; Jannis Sotos -g,bouzouki; Stefan Dohanetz -d; recorded 1985 in Berlin 24818 SOUJA 7.02 --- Hermann Naehring -perc,marimba,vib; Dietrich Petzold -v; Jens Naumilkat -c; Wolfgang Musick -b; Jannis Sotos -g,bouzouki; Volker Schlott -fl; recorded 1985 in Berlin A) Orangenflip B) Pink-Punk Frosch ist krank C) Crash 24819 GROSSSTADTKINDER ((Orangenflip / Pink-Punk, Frosch ist krank / Crash)) 11.34 --- Hermann Naehring -perc,marimba,vib; Dietrich Petzold -v; Jens Naumilkat -c; Wolfgang Musick -b; Jannis Sotos -g,bouzouki; recorded 1985 in Berlin 24820 PHRYGIA 7.35 --- 24821 RIMBANA 4.05 --- 24822 CLIFFORD 2.53 --- ------------------------------------------ Wlodzimierz NAHORNY: "Heart" Wlodzimierz Nahorny -as,p; Jacek Ostaszewski -b; Sergiusz Perkowski -d; recorded November 1967 in Warsaw 34847 BALLAD OF TWO HEARTS 2.45 Muza XL-0452 34848 A MONTH OF GOODWILL 7.03 --- 34849 MUNIAK'S HEART 5.48 --- 34850 LEAKS 4.30 --- 34851 AT THE CASHIER 4.55 --- 34852 IT DEPENDS FOR WHOM 4.57 --- 34853 A PEDANT'S LETTER 5.00 --- 34854 ON A HIGH PEAK -

Baptiste Trotignon, : Première Partie SAMEDI 19MAI–20H Fin Duconcert Vers 23H10
7/05/19 TROTIGNON:N 11/05/07 18:08 Page 1 SAMEDI 19 MAI – 20H Première partie : Baptiste Trotignon, piano solo entracte Deuxième partie : Michel Portal, clarinettes, saxophone, bandonéon Louis Sclavis, clarinettes, saxophone Daniel Humair, batterie Bojan Z., piano Bruno Chevillon, contrebasse Fin du concert vers 23h10. Samedi 19 mai Samedi 7/05/19 TROTIGNON:N 11/05/07 18:08 Page 2 7/05/19 TROTIGNON:N 11/05/07 18:08 Page 3 SAMEDI 19 MAI Baptiste Trotignon Un phrasé éblouissant de vélocité et de rigueur mêlées ; un lyrisme et une virtuosité parfaitement assumés ; une façon bien à lui de passer de climats intimistes jamais mièvres ni embrumés de romantisme frelaté à d’intenses séquences énergétiques, pleines d’arabesques virevoltantes toujours articulées avec une grande lisibilité et un souci constant de la mélodie : Baptiste Trotignon apparaît aujourd’hui incontestablement comme l’une des valeurs les plus sûres du nouveau piano jazz européen. Il faut dire qu’en ne cherchant jamais à brûler les étapes pour se propulser artificiellement sur le devant de la scène, Trotignon a fait de sa jeune carrière un modèle d’intelligence et d’équilibre entre sagesse et témérité. Élève de la classe jazz du Conservatoire de Paris (CNSMDP) après des études classiques conséquentes, Trotignon, dès le milieu des années quatre-vingt-dix, s’immerge totalement dans l’effervescente scène jazz parisienne et apprend le métier au fil de ses rencontres avec des musiciens comme Christian Escoudé, André Ceccarelli, Claudia Solal ou encore les frères Moutin… Créant son propre trio avec Clovis Nicolas à la contrebasse et Tony Rabeson à la batterie, il enregistre coup sur coup ses deux premiers disques en leader (Fluide en 2000 et Sightseeing l’année suivante) qui, par leur grâce juvénile mâtinée d’une surprenante maturité formelle, lui assurent aussitôt une belle renommée tant critique que publique. -

100 Titres Sur Le JAZZ — JUILLET 2007 SOMMAIRE
100 TITRES SUR LE JAZZ À plusieurs époques la France, par sa curiosité et son ouverture à l’Autre, en l’occurrence les hommes et les musiques de l’Afro-Amérique, a pu être considérée, hors des États-Unis, comme une « fille aînée » du juillet 2007 / jazz. Après une phase de sensibilisation à des « musiques nègres » °10 constituant une préhistoire du jazz (minstrels, Cake-walk pour Debussy, débarquement d’orchestres militaires américains en 1918, puis tour- Hors série n nées et bientôt immigration de musiciens afro-américains…), de jeunes pionniers, suivis et encouragés par une certaine avant-garde intellectuelle et artistique (Jean Cocteau, Jean Wiener…), entrepren- / Vient de paraître / nent, dans les années 1920, avec plus de passion que d’originalité, d’imiter et adapter le « message » d’outre-Atlantique. Si les traces phonographiques de leur enthousiasme, parfois talentueux, sont qua- CULTURESFRANCE siment inexistantes, on ne saurait oublier les désormais légendaires Léon Vauchant, tromboniste et arrangeur, dont les promesses musica- les allaient finalement se diluer dans les studios américains, et les chefs d’orchestre Ray Ventura, (qui, dès 1924, réunissait une formation de « Collégiens ») et Gregor (Krikor Kelekian), à qui l’on doit d’avoir Philippe Carles Journaliste professionnel depuis 1965, rédacteur en chef de Jazz Magazine (puis directeur de la rédaction à partir de 2006) et producteur radio (pour France Musique) depuis 1971, Philippe Carles, né le 2 mars 1941 à Alger (où il a commencé en 1958 des études de médecine, interrompues à Paris en 1964), est co-auteur avec Jean-Louis Comolli de Free Jazz/Black Power (Champ Libre, 1971, rééd. -

N°5 Un Numéro Photographié Par Guy 5, Rue De Charonne, Cour J
n°5 Un numéro photographié par Guy 5, rue de Charonne, cour J. Vigues, 75011 Paris - Tél 01 40 21 90 65 / Fax 01 40 21 82 30 - E-mail : Le Querrec «Je tiens le sujet de ma recherche constamment devant moi, et j’attends (Magnum) que les premières lueurs commencent à s’ouvrir lentement et peu à peu, Les chants du monde de jusqu’à se changer en une clarté pleine et entière.» Padovani Isaac Newton page 4 Arfi Du folklore imaginaire à l’expressionisme cinématographique page 5 Pascale Ferran filme Sam Rivers et Tony Hymas Le 31 mars Arte diffuse le premier huis clos en studio de l’histoire du jazz. page 6 Cours du Temps Chapitre II Bernard Vitet Sans mâcher ses mots, le trompettiste lève le voile S.M. Eisenstein Sam Rivers sur un demi-siècle Carmen Amaya Bernard Vitet de jazz et d’invention. page 12 CharlÉlie, Chris Marker, Violeta Ferrer, Gérard Miller... page 18 Nouveauté Un saxophoniste rare, Larry Schneider page 2 image par image Les Allumés du Jazz No 5 - 1er trimestre 2001 Page 1 What’s New ? > C.Bon / F.Méchali / > Andouma >Pierre Blanchard Andouma Volutes Y.Micenmacher La ballade du serran écriture Lydia Domancich (piano) Pierre Blanchard (violons), Joël Bouquet Christian Bon (guitares) Aïssata Kouyaté (chant) (piano, accordéon), Claude Mouton (contre- François Méchali (contrebasse) Pierre Marcault (percussions) basse), Robin Laurent (batterie), Miguel Youval Micenmacher (percussions) «anga» Diaz (percussions), et Ces trois musiciens aux parcours résolument Aboutissement d'une complicité de dix ans, le Arcollectiv’string Orchestra. singuliers partagent ici leur passion pour l'impro- duo piano - percussions d'Afrique de l'ouest visation autour de thèmes proposés par le guita- "La musique est lumineuse et met en évidence s'enrichit, pour ce cinquième album, d'une voix riste Christian Bon (qui a notamment travaillé l'originalité de ses talents de compositeur. -
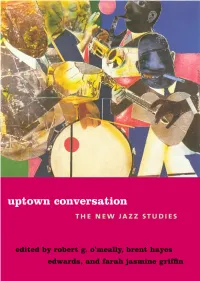
Uptown Conversation : the New Jazz Studies / Edited by Robert G
uptown conversation uptown conver columbia university press new york the new jazz studies sation edited by robert g. o’meally, brent hayes edwards, and farah jasmine griffin Columbia University Press Publishers Since 1893 New York Chichester, West Sussex Copyright © 2004 Robert G. O’Meally, Brent Hayes Edwards, and Farah Jasmine Griffin All rights reserved Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Uptown conversation : the new jazz studies / edited by Robert G. O’Meally, Brent Hayes Edwards, and Farah Jasmine Griffin. p. cm. Includes index. ISBN 0-231-12350-7 — ISBN 0-231-12351-5 1. Jazz—History and criticism. I. O’Meally, Robert G., 1948– II. Edwards, Brent Hayes. III. Griffin, Farah Jasmine. ML3507.U68 2004 781.65′09—dc22 2003067480 Columbia University Press books are printed on permanent and durable acid-free paper. Printed in the United States of America c 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 p 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 contents Acknowledgments ix Introductory Notes 1 Robert G. O’Meally, Brent Hayes Edwards, and Farah Jasmine Griffin part 1 Songs of the Unsung: The Darby Hicks History of Jazz 9 George Lipsitz “All the Things You Could Be by Now”: Charles Mingus Presents Charles Mingus and the Limits of Avant-Garde Jazz 27 Salim Washington Experimental Music in Black and White: The AACM in New York, 1970–1985 50 George Lewis When Malindy Sings: A Meditation on Black Women’s Vocality 102 Farah Jasmine Griffin Hipsters, Bluebloods, Rebels, and Hooligans: The Cultural Politics of the Newport Jazz Festival, 1954–1960 126 John Gennari Mainstreaming Monk: The Ellington Album 150 Mark Tucker The Man 166 John Szwed part 2 The Real Ambassadors 189 Penny M. -

Elica Complete Catalogue -.:: Elica Editions
elica complete catalogue Please click on on the item's title to access the order form Please also visit the elica page of BRUNO RICHARD / ELLES SONT THE SORTIE items for sale elica UPP-3210: CONFUSIONAL QUARTET: CONFUSIONAL QUARTET CD+ROM Futurism with its dynamic force, youthful spirit, attention to innovation and a bit of Italian histrionism; the sixties with their hopeful and playful atmosphere and their crisp and catchy music; Italy with its beautiful sun, beaches, Mediterranean brightness and laxity; minimalism with its focus on the deepness of details; all the things happening in Bologna in the late seventies, among some of the newest and most inventive experiences in film, performance, fashion and music. With these elements and a strong, confessed musical influence of an unlikely pair like Area and Devo some of the most original and fresh music ever was produced by the Confusional Quartet (Lucio Ardito, bass guitar; Gianni Cuoghi, drums; Enrico Serotti, electric guitar; Marco Bertoni, keyboards), with the help of the inventive craftmanship of their sound engineer Gianni Gitti. Composed as short, fast changing miniatures with crazy rhythms and outstandingly playful and catchy tunes, blending diverse musical genres, very nicely arranged and enriched by a creative use of the recording studio, the 24 pieces collected in this disc represent their almost complete recorded output (including alternative versions and a previously unpublished piece) and show a musical maturity which is quite amazing for a group in which three members out of four were at the time still under 18! As a special bonus, the disc features a video track with Gitti’s videoclip for the Quartet’s irreverent, almost cubist version of Mimmo Modugno’s internationally known classic Nel blu dipinto di blu (better known as Volare). -

MICHEL PORTAL Michel Portal
MICHEL PORTAL Michel Portal : clarinette basse, bandonéon « Le jazz n’est pas pour Michel Portal un style parmi d’autres : c’est sa façon bouleversante de vivre la musique, de considérer ses autres expériences musicales, de les brusquer, et, éventuellement, de les réinventer. » Francis Marmande (le Monde) Né à Bayonne en 1935, Michel Portal s’est rapidement imposé comme l’une des figures les plus importantes de la musique d’aujourd’hui. De formation classique, couronné de prix internationaux, il est un clarinettiste remarquable dans l’ensemble du répertoire de l’instrument (Mozart, Brahms, Schumann, Berg). Nourri de toutes les musiques, il pratique depuis l’enfance les musiques raditionnelles de sa région (le Pays Basque) et joue dans l’orchestre de Perez Prado. Il adopte vite le jazz comme référence et comme attitude. Accompagnateur au début des années soixante des grands chanteurs français comme Barbara ou Claude Nougaro, il participe parallèlement aux côtés de François Tusques et Bernard Vitet à la naissance du free jazz français puis fonde ses propres groupes avec John Surman, Stu Martin, Jean-Pierre Drouet, Barre Phillips, Howard Johnson, Jacques Thollot, Jean-François Jenny-Clark, Joachim Kühn, Aldo Romano. Ce vaste mouvement l’amène à partager la musique des Américains à Paris : Sunny Murray, Anthony Braxton ou Alan Silva. Il enregistre Alors (Futura), Our Meanings Our Feelings (EMI) et Splendid Yzlment (CBS). Il ne délaisse en rien la musique classique et enregistre abondamment. Il est par ailleurs interprète de prédilection des compositeurs contemporains comme Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio, Mauricio Kagel et fonde avec Vinko Globokar le New Phonic Art axé sur la création instantanée. -
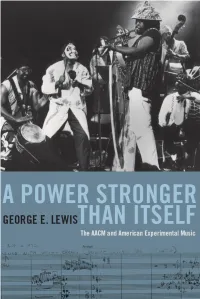
A Power Stronger Than Itself
A POWER STRONGER THAN ITSELF A POWER STRONGER GEORGE E. LEWIS THAN ITSELF The AACM and American Experimental Music The University of Chicago Press : : Chicago and London GEORGE E. LEWIS is the Edwin H. Case Professor of American Music at Columbia University. The University of Chicago Press, Chicago 60637 The University of Chicago Press, Ltd., London © 2008 by George E. Lewis All rights reserved. Published 2008 Printed in the United States of America 16 15 14 13 12 11 10 09 08 1 2 3 4 5 ISBN-13: 978-0-226-47695-7 (cloth) ISBN-10: 0-226-47695-2 (cloth) Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Lewis, George, 1952– A power stronger than itself : the AACM and American experimental music / George E. Lewis. p. cm. Includes bibliographical references (p. ), discography (p. ), and index. ISBN-13: 978-0-226-47695-7 (cloth : alk. paper) ISBN-10: 0-226-47695-2 (cloth : alk. paper) 1. Association for the Advancement of Creative Musicians—History. 2. African American jazz musicians—Illinois—Chicago. 3. Avant-garde (Music) —United States— History—20th century. 4. Jazz—History and criticism. I. Title. ML3508.8.C5L48 2007 781.6506Ј077311—dc22 2007044600 o The paper used in this publication meets the minimum requirements of the American National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1992. contents Preface: The AACM and American Experimentalism ix Acknowledgments xv Introduction: An AACM Book: Origins, Antecedents, Objectives, Methods xxiii Chapter Summaries xxxv 1 FOUNDATIONS AND PREHISTORY -

Programme Du Soir
2017 20:00 10.05.Grand Auditorium Mercredi / Mittwoch / Wednesday Jazz & beyond Quatuor Ébène & Michel Portal Michel Portal clarinet Quatuor Ébène Pierre Colombet, Gabriel Le Magadure violin Adrien Boisseau viola Raphaël Merlin cello Richard Héry drums Xavier Tribolet electronic music ~90’ without intermission Backstage 18:30 Salle de Musique de Chambre Film: Drôle d’oiseau de Stéphane Sinde (2012) (VO fr) – 60’ Soutenir l’excellence et le talent La culture de l’excellence est au cœur de notre offre, qu’il s’agisse de vous accompagner dans vos projets personnels ou de partager avec vous des passions communes. Indosuez Wealth Management se veut être une force positive. Au-delà de ses actions philanthropiques, notre Maison apporte son soutien à des talents naissants dans des domaines variés, parmi lesquels la musique. Notre découverte de jeunes talents venus de tous horizons, nous voulons la partager avec vous et renforcer ainsi le soutien que nous leur apportons. Ce soir à nouveau, nous espérons que vous serez à l’unisson avec nous. Aussi, nous sommes très heureux de vous accueillir pour le concert du Quatuor Ébène & Michel Portal. Leur première rencontre lors d’un festival de jazz s’est transformée en évidence pour les musiciens. Depuis, ils se retrouvent régulièrement sur scène pour des joutes musicales qui mêlent improvisation et interprétation libre de grandes œuvres du répertoire classique et jazz. Nous vous laissons les découvrir et vous souhaitons une excellente soirée. Olivier Chatain Administrateur délégué de CA Indosuez Wealth -

Free Music Production FMP: the Living Music
HAUS DER KUNST Free Music Production FMP: The Living Music STRETCH YOUR VIEW Einführung DE Diese Ausstellung widmet sich der Geschichte des Die Ausstellung dokumentiert in noch nicht dagewesenem Musiklabels Free Music Production (FMP), das von 1968 Umfang mithilfe von Fotografien, Postern, Flyern, Ori- bis 2010 als Berliner Plattform für die Produktion, Präsen- ginaldokumenten, Interviews sowie vielen noch nie zuvor tation und Dokumentation von Musik Unvergleichliches gesehen dokumentarischen Videos und bisher unveröffent- geleistet hat. Seit den späten 1950er-Jahren hatte es immer lichten Aufnahmen aus dem FMP-Archiv von Jost Gebers die 1 wieder Versuche von Musikern gegeben, ihre Produktions- verschiedenen FMP-Formate und stellt zudem auch die gesamte und Arbeitsbedingungen selbstbestimmt zu gestalten. So- Tonträgerproduktion vor. wohl in ihrer Langlebigkeit als auch in der Vielfältigkeit ihrer Unternehmungen ist die FMP bis heute einzigartig Heute, kurz vor dem 50-jährigen Jubiläum der FMP, wird klar, und in dieser Form vielleicht nur in Westberlin möglich dass die Free Music Production durch ihre Konsequenz und gewesen. ihre Öffnung für viele verschiedene Musiken und kulturelle Praktiken aus aller Welt zu den wesentlichsten kulturhis- Weil der Saxofonist Peter Brötzmann den Veranstaltern der torischen Beiträgen gehört, die Westberlin zur Kunst- und Berliner Jazztage (heute Jazzfest Berlin) nicht garantieren Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts geleistet hat. konnte, dass seine Gruppe in schwarzen Anzügen auftreten würde, und deshalb wieder ausgeladen wurde, organisierte er 1968 zusammen mit dem Bassisten Jost Gebers das erste Total Music Meeting (TMM). Wie schon zuvor in den Musikszenen der Vereinigten Staaten, ging es auch bei dieser Initia- tive darum, die Arbeitsbedingungen für junge Musiker zu ver- bessern. -

L'improvisation Libre
L’improvisation libre Christophe d’Alessandro To cite this version: Christophe d’Alessandro. L’improvisation libre. Orgues nouvelles, 2019, 44, pp.12-13. hal-02341301 HAL Id: hal-02341301 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02341301 Submitted on 31 Oct 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. L’improvisation libre Christophe d’Alessandro Orgues Nouvelles, N° 44, mars 2019, pp. 12-13 L’improvisation et la tradition savante européenne L’écriture domine la tradition savante européenne jusqu’au milieu du 20e siècle, en réservant l’improvisation aux musiques fonctionnelles ou populaires. L’improvisation est bien vivante dans les musiques traditionnelles ou le jazz. À l’organite on demande d’acCompagner, d’introduire, de commenter et varier un texte grégorien, et d’improviser les parties musiCales de l’office. TeChniquement proChe de l’improvisation, l’aCCompagnement ou harmonie pratique, est réservé aux pianistes : C’est l’héritage de la basse Continue, pour les besoins de l’opéra, des chœurs, des cours de danses. La situation change radicalement après 1945. L’œuvre désœuvrée et les musiques en action : œuvre ouverte, partition graphique La notion de « musique improvisée » manifeste la soif de liberté et de Création des compositeurs d’après guerre. -
Vincent Herring Eric Harland Hugh Steinmetz Tadd Dameron
AUGUST 2017—ISSUE 184 YOUR FREE GUIDE TO THE NYC JAZZ SCENE NYCJAZZRECORD.COM NELS CLINE music for lovers VINCENT ERIC HUGH TADD HERRING HARLAND STEINMETZ DAMERON Managing Editor: Laurence Donohue-Greene Editorial Director & Production Manager: Andrey Henkin To Contact: The New York City Jazz Record 66 Mt. Airy Road East AUGUST 2017—ISSUE 184 Croton-on-Hudson, NY 10520 United States Phone/Fax: 212-568-9628 NEw York@Night 4 Laurence Donohue-Greene: Interview : vincent herring 6 by alex henderson [email protected] Andrey Henkin: [email protected] Artist Feature : ERIC HARLAND 7 by marilyn lester General Inquiries: [email protected] ON The Cover : NELS CLINE 8 by john pietaro Advertising: [email protected] Encore : HUGH STEINMETZ by andrey henkin Calendar: 10 [email protected] VOXNews: Lest We Forget : TADD DAMERON 10 by stuart broomer [email protected] LAbel Spotlight : CIRCUM-DISC by ken waxman US Subscription rates: 12 issues, $40 11 Canada Subscription rates: 12 issues, $45 International Subscription rates: 12 issues, $50 For subscription assistance, send check, cash or VOXNEwS 11 by suzanne lorge money order to the address above or email [email protected] IN Memoriam Staff Writers 12 David R. Adler, Clifford Allen, Duck Baker, Fred Bouchard, Festival REport Stuart Broomer, Thomas Conrad, 13 Ken Dryden, Donald Elfman, Phil Freeman, Kurt Gottschalk, Tom Greenland, Anders Griffen, CD ReviewS 14 Alex Henderson, Marcia Hillman, Terrell Holmes, Robert Iannapollo, Suzanne Lorge, Mark Keresman, Miscellany 31 Marc Medwin, Ken Micallef, Russ Musto, John Pietaro, Joel Roberts, John Sharpe, Event Calendar 32 Elliott Simon, Andrew Vélez, Ken Waxman, Scott Yanow Contributing Writers Mathieu Bélanger, Robert Bush, Ori Dagan, Laurel Gross, A generation is loosely defined as those born within a ten-year period, given such colorful George Kanzler, Matthew Kassel, epithets as Baby Boomers, Gen-Xers and Millennials.