Philippe De Champaigne
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Naturalezas Muertas
naturalezas muertas siglos XVI al XXI de colecciones privadas “Naturalezas muertas en el coleccionismo privado español, siglos XVI al XXI” Exposición inaugural del Museo de Arte Contemporáneo “Infanta Elena”, con motivo del 50 aniversario de la Cooperativa “Virgen de las Viñas” de Tomelloso, Ciudad Real. Equipo organizador: Presidente de la Cooperativa: Rafael Torres Ugena Comisario de la Exposición: Fernando López Romero Fotógrafos del Catálogo: Raimundo de Campos Carlos Gutiérrez Agradecimientos: A todos los coleccionistas anónimos; a Pedro Jiménez y María Elizari, de la galería “Theotocopulos”; a la galería “Rafael Lozano” de Madrid; a Ángel Escorial, director de la galería “Arte Segovia”, con sede en La Granja. Edición de COOPERATIVA “VIRGEN DE LAS VIÑAS” Tomelloso Colabora con la impresión: DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL Imprime: Imprenta Provincial, Ciudad Real Depósito legal: CR-687-2011 naturalezas muertas siglos XVI al XXI de colecciones privadas Textos de Fernando López Romero Abogado Catálogo de la Exposición inaugural del Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena Tomelloso, 2011 S.A.R. LA INFANTA doña elena PALABRAS institucionales 13 El Presidente de la Cooperativa “Virgen de las Viñas” Es para mí un motivo de satisfacción poder inaugurar, como Presidente de la Cooperativa “Virgen de las Viñas”, el Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena que se ha construido en sus instalaciones. La exposición inaugural corresponde a colecciones privadas y, por tanto, nunca se han visto reunidas en una muestra pictórica. Hemos querido que sea de naturalezas muertas, de los siglos XVI al XXI, llevando cada una de ellas alguna representación de productos alimentarios que es lo que elabora esta empresa: vinos y aceites. -
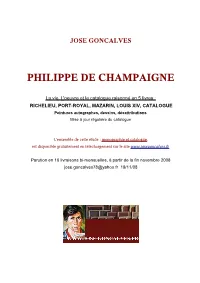
Philippe De Champaigne
JOSE GONCALVES PHILIPPE DE CHAMPAIGNE La vie, l 'oeuvre et le catalogue raisonné en 5 livres : RICHELIEU, PORT-ROYAL, MAZARIN, LOUIS XIV, CATALOGUE Peintures autographes, dessins, désattributions Mise à jour régulière du catalogue L'ensemble de cette étude : monographie et catalogue, est disponible gratuitement en téléchargement sur le site www.josegoncalves.fr Parution en 16 livraisons bi-mensuelles, à partir de la fin novembre 2008 [email protected] 19/11/08 PHILIPPE DE CHAMPAIGNE/ JOSE GONCALVES Sommaire Avant-propos Première partie : RICHELIEU (1602-1642) Chapitre 1 : les moyens de l'identité. Philippe de Champaigne, Rubens, Rembrandt et Vélasquez ; les Pays-Bas espagnols ; formation : Bouillon, Bourdeaux et Rubens ; la tradition flamande ; la peinture parisienne : Lallemand ; Le Prévôt des marchands de Montigny-Lencoup ; L'Adoration des Mages de Georges Lallemant ; premières œuvres de Philippe de Champaigne ; une constante volonté d'intégration. Notes Chapitre 2 : le palais du Luxembourg. Rubens : le cycle Médicis ; le décor du Luxembourg ; l'héritier des "droits" de Duchesne ; les toiles de Pont-sur-Seine ; les choix techniques de Philippe de Champaigne ; la réaction flamande : Saint Vincent et Saint Germain. Notes Chapitre 3 : la cage dorée. Le décor de l'église du Carmel et l'oratoire de la reine ; renouveau du sentiment religieux ; La Vierge du Rosaire ; la tenture de la Vie de la Vierge ; La Réception du Duc de Longueville et la Galerie des Hommes Illustres ; Le Vœu de Louis XIII ; les portraits de Richelieu. Notes Deuxième partie : PORT-ROYAL (1643-1652) Chapitre 4 : pourquoi et comment. Rupture ; le défaut de voyage en Italie et ses conséquences ; Poussin, le référent ; une suite homogène de portraits ; l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture. -

Le Musée Des Beaux-Arts De Lille
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LILLE Hervé Oursel Conservateur en Chef LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LILLE Ouvrage illustré de 295 reproductions édité avec le concours de la Ville de Lille et de la Direction des Musées de France Dessain et Tolra 10, rue Cassette, Paris 6 Couverture : Hubert Robert, Terrasse d'un palais à Rome (détail). © 1984 Dessain et Tolra, Paris. Dépôt légal : mars 1984. Imprimé en France par Maury Imprimeur S.A., 45330 MALESHERBES. ISBN 2-249-27664-1 Naissance et développement du Musée Considéré à juste titre comme l'un des plus collection de tableaux prélevés sur ceux du Louvre importants, sinon le premier des musées de province et de Versailles, en stipulant toutefois que « les en France par la richesse et la diversité de ses tableaux ne seront envoyés qu'après qu'il aura été collections — mais sur quels critères établir un disposé, aux frais de la commune, une galerie classement rigoureux et objectif, car comment convenable pour les recevoir ». Lille est du nombre. comparer vraiment des entités fondamentalement La municipalité se préoccupe donc de satisfaire aux différentes dans leur essence ? (ainsi, qui l'em- conditions requises et vote un crédit de 20 000 porte : Goya ou Sluter ?) — le Musée des Beaux- francs pour l'aménagement de l'ancienne église du Arts de Lille est aussi l'un des plus anciens. couvent des Récollets, dont elle souhaite pouvoir En effet, dès le 17 février 1792, le peintre Louis disposer à cette fin. Pourtant, ce n'est que le 15 Watteau, dit de Lille, le plus notable des artistes août 1809 que le musée y sera inauguré au premier locaux du XVIII siècle, propose aux administrateurs étage. -

Encyklopédia Kresťanského Umenia
Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia Anton Veľký - (356); tiež Anton z Komy, Anton Egyptský, Anton Pustovník, Anton opát; v angl. umení označovaný ako Anton opát; používaný opát, kresťanský svätec a pustovník, narodený v Egypte, kde potom, čo rozdal svoj majetok, strávil veľa rokov na púšti; zakladateľ asketického života; uzdravoval chorých počas epidémií v 11.st. (epidémia ruže známa ako oheň sv. Antonína); otec mníšstva; zobrazovaný ako fúzatý starec v mníšskej kutne s kapucňou, palicou v tvare písmena tau (pozri kríž egyptský antonský), tau sa objavuje v bielej alebo modrej aj na vrchnej strane jeho plášťa; v ruke drží zvonček a sprevádza ho prasa, ktoré má niekedy zvonček zavesený na krku (bravčová masť vraj používaná ako liek proti ohňu sv. Antona; v inom výklade zvonček na odháňanie zlých duchov a nepriamo odkaz na pokušenie sv. Antona; neskorokeltské reliéfy na krížoch s výjavmi zo života sv. Antona ovplyvnené koptským umením (abstrahovanie reálneho tvaru v spojení so symbolikou významu a kompozíciou horor vacui); postava Antonína jednou z postáv na stĺpe morovom; hlavným námetom so sv. Antonom je Pokušenie sv. Antona; pozri Pavol Pustovník; sviňa (Biedermann); koptské umenie; kríž antonský http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B 9_%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%96 http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/8602834641/in/photostream/ http://www.adolphus.nl/xus/antongameriknmusea.html C. Crivelli: Sv. Anton Veľký, sv. Hieronymus a sv. Ondrej (predela oltárneho triptychu, 1482) Heslo ANTON VEĽKÝ - AP Strana 1 z 55 Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia Sv. -

Cahiers De La Méditerranée, 95 | 2017 Les Peintures Flamandes Et Hollandaises Dans Les Collections D’Art Des Grimal
Cahiers de la Méditerranée 95 | 2017 La culture fasciste entre latinité et méditerranéité (1880-1940) Les peintures flamandes et hollandaises dans les collections d’art des Grimaldi de Monaco (XVIIe- e XVIII siècle) Francesca Bottacin Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/cdlm/9499 DOI : 10.4000/cdlm.9499 ISSN : 1773-0201 Éditeur Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine Édition imprimée Date de publication : 15 décembre 2017 Pagination : 253-276 ISSN : 0395-9317 Référence électronique Francesca Bottacin, « Les peintures flamandes et hollandaises dans les collections d’art des Grimaldi de Monaco (XVIIe-XVIIIe siècle) », Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 95 | 2017, mis en ligne le 15 juin 2018, consulté le 19 janvier 2021. URL : http://journals.openedition.org/cdlm/9499 ; DOI : https:// doi.org/10.4000/cdlm.9499 Ce document a été généré automatiquement le 19 janvier 2021. © Tous droits réservés Les peintures flamandes et hollandaises dans les collections d’art des Grimal... 1 Les peintures flamandes et hollandaises dans les collections d’art des Grimaldi de Monaco (XVIIe- XVIIIe siècle) Francesca Bottacin Je prie Monsieur de Malenfant de donner au porteur du present billet, le deux petit tableaux de Wandermer, que jay vu hier chez luy, le quel luy en payera le prix, dont il voudra bien de mettre le recu au bas de ce billet. à Paris, le premier decembre millesept cens trente neuf. Le Duc de Valentinois1 1 Que cette commande, signée par Jacques Ier lui-même, se réfère aux deux peintures de Jan Vermeer de Delft ne reste qu’une supposition alléchante, mais que ce souverain ait été un passionné d’art flamand et hollandais, est un fait avéré ; toutefois l’attirance de la famille Grimaldi pour les peintres néerlandais commence bien avant. -

Rubenianum Fund
2021 The Rubenianum Quarterly 1 From limbo to Venice, then to London and the Rubenshuis Towards new premises A highlight of the 2019 Word is out: in March, plans for a new building for exhibition at the Palazzo the Rubens House and the Rubenianum, designed by Ducale in Venice (‘From Titian Robbrecht & Daem architecten and located at Hopland 13, to Rubens. Masterpieces from were presented to the world. The building will serve as Flemish Collections’), this visitor entrance to the entire site, and accommodate visitor ravishing Portrait of a Lady facilities such as a bookshop, a café and an experience Holding a Chain is arguably centre. The present absence of such facilities had led to an one of the most exciting initial funding by Visit Flanders, which, in turn, incited the Rubens discoveries of the City of Antwerp to address all infrastructural needs on site. past decade and perhaps the These include several structural challenges that the finest portrait by the artist Rubenianum has faced for decades, such as the need for remaining in private hands. climate-controlled storage for the expanding research The picture is datable to collections. The new building will have state-of-the-art the beginning of Rubens’s storage rooms on four levels, as well as two library career, and was probably floors with study places, in a light and energy-efficient painted either during his architecture. The public reading room on the second floor will be accessible to all visitors via an eye-catching spiral short trip from Mantua to staircase, and will bring the Rubenianum collections Spain (between April 1603 within (visual and physical) reach of all, after their and January 1604), or not somewhat hidden life behind the garden wall. -

Dossier De Presse.Pdf
Dossier de presse Feuille à Feuille Estampe et images imprimées dans les collections des musées du Nord-Pas de Calais SERVICE DE PRESSE OBSERVATOIRE T 00 33 1 43 54 87 71 - F 00 33 1 45 43 38 53 – www.observatoire.fr Véronique Janneau / [email protected] Hélène Dalifard / [email protected] Cécile Salem / [email protected] ASSOCIATION DES CONSERVATEURS DES MUSEES DU NORD-PAS DE CALAIS T 00 33 3 28 33 66 52 – F 00 33 3 28 33 66 53 – www.musenor.com Eve Flament / [email protected] SOMMAIRE -Communiqué de presse -Programme et calendrier des expositions -Le label du Ministère de la Culture et de la Communication -Le prix de l’IFPDA (International Fine Print Dealers Association -L’Association de conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais -Présentaton des expositions et des musées participant à Feuille à Feuille Arras, musée des Beaux-Arts Calais, musée des Beaux-Arts et de la Dentelle Cambrai, musée des Beaux-Arts Le Cateau, musée départemental Matisse Douai, musée de la Chartreuse Dunkerque, Lieu d’Art et Action Contemporaine (LAAC) Gravelines, musée du Dessin et de l’Estampe Originale Lille, musée des Beaux-Arts (exposition présentée au musée de l’Hospice Comtesse) Saint-Omer, musée de l’Hôtel Sandelin Tourcoing, musée des Beaux-Arts Valenciennes, musée des Beaux-Arts Villeneuve d’Ascq, musée d’art moderne de Lille Métropole (exposition présentée à la Bibliothèque municipale de Lille) Communiqué de presse L’ÉVÉNEMENT L’opération Feuille à Feuille – estampe et images imprimées dans les collections des musées du Nord-Pas de Calais, labellisée Exposition d’intérêt national par le Ministère de la Culture et de la Communication, est un projet collectif et ambitieux combinant expositions, sensibilisation de tous les publics, et colloque scientifique international. -

The Montreal Museum of Fine Arts Annual Report 2008-2009
the Montreal MuseuM of fine arts annual RepoRt 2008-2009 ConseRvIng aRt FoR all to ShaRe / the Montreal Museum of Fine arts, true to its vocation of acquiring and promoting the work of Canadian and international artists past and present, has a mission to attract the broadest and most heterogeneous public possible, and to provide that public with first-hand access to a universal artistic heritage. CONTENTS / 1 chairMan’s report / 4 thank you, Bernard LaMarre / 5 triBute to a great Man / 6 director’s report / 11 exhiBition caLendar / 12 MuseuM Officers and Board oF trustees / 13 MuseuM committees / 14 MuseuM Foundation president’s report / 15 Officers, trustees and committees oF the MuseuM Foundation / 16 voLunteer association’s report / 17 Association oF voLunteer guides’ report / 18 arte Musica Foundation / 19 acquisitions / 46 FinanciaL stateMents oF the MuseuM / 61 FinanciaL stateMents oF the MuseuM Foundation / 67 a triBute to our donors / 69 sponsors / 70 proMotions / 71 MuseuM Ball / 75 MuseuM staff / Cover: Workshop of Baron François‑Pascal‑Simon Gérard Bust-length Portrait of Napoleon in Coronation Robes about 1805 Ben Weider Collection 2008.403 CHAIRMAn’S REPORT / A BAnner YeAr the 2008-2009 fiscal year has been a historic one for the environmentally responsible policy of sustainable develop- Museum. We have seen the start of the construction of the ment. With its green shift, the Museum shows yet again its new pavilion of Canadian Art, the restoration of a heritage determination to lead by example. Another sign of loyalty building that will become a concert hall, the acquisition of to the Museum is the fact that the number of Friends, or landmark works, most notably Ben Weider’s napoleonic Museum VIps, rose to 42,065, generating $280,000 in collection, inspiring exhibitions for new clienteles, and increased revenues. -

Arts Antiques Auctions - N° 486 P608061 €
ARTS ANTIQUES AUCTIONS - N° 486 P608061 € Musée de Tervuren Pierre Bruegel l’Ancien Trésors de la BRAFA La réouverture Recréer l’hiver En avant-première HIVER 2018-2019 N° 486 - 5,90 € Édition française Le Musée Chinois Koloman Moser du Château de Fontainebleau Un touche-à-tout de talent Otto Jakob Maurice Wyckaert MENSUEL ne paraît pas en janvier, en juillet ni août - 5,90 MENSUEL ne paraît pas en janvier, Des bijoux virtuoses Une rétrospective © Elzo Durt - MIMAmuseum © Elzo Visitez plus de 100 musées avec 1 pass. Vénus de Willendorf - moulage - coll. musée du Malgré-Tout © Musée du Malgré-Tout musée du Malgré-Tout de Willendorf - moulage coll. Vénus En vente pour 50 euros dans les musées participants ou sur passmusees.be Prix incl. TVA sous réserve de fautes d’impression éventuelles. Prix valable du 1/09/2018 au 31/03/2019. Consultez le site web pour les tarifs actuels. LIVE STYLE Nous concrétisons pour vous la recherche de l’exceptionnel en Belgique. Que ce soit en vente ou en location, venez déceler ce qui vous correspond parmi notre éventail de plus de 300 biens remarquables. Rendez-vous sur www.sothebysrealty.be BRUSSELS OFFICE Avenue Louise 200, B-1050 Brussels t+32 2 640 08 01 - [email protected] Uccle | Ref : 3323816 www.sothebysrealty.be Bien à découvrir sur Each Office is Independently Owned and Operated ADMINISTRATION, PUBLICITÉ, RÉDACTION, AGENDA Begijnhoflaan 464 G - 9000 Gand Tél. : 09/216.20.20 - Fax : 09/216.20.21 COLLECT [email protected] - www.collectaaa.be ING 310-0657650-76 ARTS ANTIQUES AUCTIONS HIVER 2018-2019 N° 486 IBAN BE91 3100 6576 5076 SWIFT BBRU BE BB TVA BE 432.544.477 Le patrimoine, pivot de l’identité PUBLICITÉ On le lira par ailleurs, à l’heure Secteur Art : Joris van Glabbeek de la réouverture dans une ver- Tél. -

Oude & Romantische Meesters
OUDE & ROMANTISCHE MEESTERS Loten met '*' zijn afgebeeld. Afmetingen tussen haakjes = totale afmetingen met kader/sokkel Schattingen niet vermeld indien lager dan € 500. 1. Datum van de veiling De openbare verkoping van de hierna geïnventariseerde goederen en kunstvoorwerpen zal plaatshebben op maandag 9 december om 19u dinsdag 10 december om 14u en om 19u in het Veilinghuis Bernaerts, Verlatstraat 16-22 te 2000 Antwerpen 2. Data van bezichtiging De liefhebbers kunnen de goederen en kunstvoorwerpen bezichtigen Verlatstraat 18 te 2000 Antwerpen op donderdag 5 december vrijdag 6 december zaterdag 7 december en zondag 8 december van 10 tot 18u 3. Data van afhaling Onmiddellijk na de veiling of op dinsdag 10 december van 9 tot 12u op woensdag 11 december van 9 tot 12u en van 13u30 tot 17u op donderdag 12 december van 9 tot 12u en van 13u30 tot 17u op vrijdag 13 december van 9 tot 12u en van 13u30 tot 17u en ten laatste op zaterdag 14 december van 10 tot 12u via Verlatstraat 18 4. Kosten 22 % 28 % via WebCast (registratie tot ten laatste zondag 8 december 2019, 18u) 30 % via Aftersale €2/ lot administratieve kost 5. Telefonische biedingen Geen telefonische biedingen onder € 500 Veilinghuis Bernaerts/ Hôtel de Ventes Bernaerts Verlatstraat 16-22 Museumstraat 23-25 2000 Antwerpen/ Anvers T +32 (0)3 248 19 21 F +32 (0)3 248 15 93 www.bernaerts.be [email protected] Biedingen/ Offres F +32 (0)3 248 15 93 E [email protected] Geen telefonische biedingen onder € 500. Pas d’enchères par téléphone pour des lots inférieurs à € 500. -

Encyklopédia Kresťanského Umenia
Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia Flámska apokalypsa - Apokalypsa flámska flámska gotika - flámska a burgundská tvorba 15.st. s príznačnými ostro lomenými, dramatickými záhybmi plášťov; pozri štýl lámaný flámska história - http://en.wikipedia.org/wiki/Category:History_of_Flanders flámska renesancia - pozri flámski primitívi http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_flamande http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_in_the_Low_Countries flámska škola - škola maľby, ktorá sa vyvinula v Holandsku od renesancie do počiatkov baroka; zahrnuje flámskych primitívov (1400-1500), flámsku renesanciu (1500-1584) a holandský zlatý vek maľby zo 17.st.; patrí sem mnoho maliarov, sochárov a architektov, z ktorých sú najznámejší Rembrandt van Rijn, Frans Hals, Johannes Vermeer, Jacob van Ruisdael, Antoon van Dyck a Jan Steen http://fr.wikipedia.org/wiki/École_hollandaise flámske maliarstvo - samostatný výtvarný prejav charakteristický pre južné provincie Flámska od 15.st. (J.van Dyck, R.van Weyden, Majster z Flémale); v 16.-17.st. vytvorený typický barokový exaltovaný flámsky prejav, ktorý svoj vrchol našiel v diele Rubensa; v jeho dielni pod vedením A.van Dycka, ktorý svojou portrétnou tvorbou ovplyvnil anglickú maľbu, patrili Rubensovi žiaci J.Jordaens (žáner, religiózne a mytologické obrazy), F.Snyders (kvetinové a ovocné zátišia, poľovnícke zápasy), A.Brouwer a D. Teniers Ml. (žáner); krajinárstvo v dvoch smeroch: kabinetná drobnomaľba (Jan Brueghel St.) a monumentálna tzv. bruselská dekoratívna maľba; flámska žánrová maľba 17.st. zobrazovala alegórie piatich zmyslov v podobe krčmových scén s pijanmi (Chuť), fajčiarmi fajok (Čuch), rozjarenými spevákmi s huslistom (Sluch); Hmat zobrazovaný ako muž, ktorý objíma ženu okolo pása, alebo ako ránhojič púšťajúci pacientovi žilou; vo flámskom maliarstve 18.st. sa iba obmieňali vzory z predchádzajúceho obdobia, v 19.st. -

Collection Des Hauts-De-France #4
MICRO-FOLIE PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES COLLECTION DES HAUTS-DE-FRANCE #4 CAHIER DE MÉDIATION GRAND LARGE—HAUTS-DE-FRANCE Musée de la Nacre et de la Tabletterie SOMMAIRE LA COLLECTION DES HAUTS-DE-FRANCE #4 4 QUELLES ŒUVRES DANS LE MUSÉE NUMÉRIQUE 5 COLLECTION DES HAUTS-DE-FRANCE EN MODE VISITEUR LIBRE 7 MUSÉE BOUCHER-DE-PERTHES 8 MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ARRAS 10 FORUM ANTIQUE DE BAVAY MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU DÉPARTEMENT DU NORD 13 MUDO - MUSÉE DE L’OISE 15 MUSÉE DE BOULOGNE-SUR-MER 17 MUSÉE CONDÉ - CHÂTEAU DE CHANTILLY 20 MUSÉES DE LA VILLE DE COMPIÈGNE 24 MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE LOCALE 28 MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE 30 FRAC GRAND LARGE - HAUTS-DE-FRANCE 32 MUSÉE DU DESSIN ET DE L’ESTAMPE ORIGINALE 36 MUSÉE DÉPARTEMENTAL MATISSE 38 CENTRE HISTORIQUE MINIER 42 MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE DE LILLE 45 MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE 48 MUSÉE ANTOINE LÉCUYER 51 MUSÉE DES PAPILLONS 53 MUSÉE DE SOISSONS 55 MUBA EUGÈNE LEROY 58 MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE L’OISE 60 LAM - LILLE MÉTROPOLE MUSÉE D’ART MODERNE, D’ART CONTEMPORAIN ET D’ART BRUT 63 PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE 68 MUSÉE DE L’HOSPICE COMTESSE 72 MUSÉE BENOÎT DE PUYDT 76 MUSÉES DE LA VILLE DE SAINT-OMER 79 COLLECTION DES HAUTS-DE-FRANCE EN MODE CONFÉRENCIER 81 LA COLLECTION DES HAUTS-DE-FRANCE #4 La Collection des Hauts-de-France #4 est la première collection régionale. Elle réunit 400 œuvres issues des institutions muséales suivantes : Carte de la région des Hauts-de-France FRAC GRAND LARGE - HAUTS-DE-FRANCE MUSÉE BENOÎT DE PUYDT Dunkerque Bailleul MUBA EUGÈNE