Lettre Technique Mer- Littoral N°1 Et 2, 2010 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
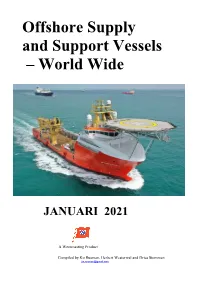
Logoboek 2021-01-26
Offshore Supply and Support Vessels – World Wide JANUARI 2021 A Westcoasting Product Compiled by Ko Rusman, Herbert Westerwal and Dries Stommen [email protected] 1 Fleet List explanatarory notes ABS Marine Services Pvt. Ltd., Chennai, India The fleet listings are shown under the operating groups. The vessel listings indicate: Column 1 – Name of vessel. Column 2 – Year of build. Column 3 – Gross tonnage. Column 4 – Deadweight tonnage. Column 5 – Break horsepower. Column 6 – Bollard pull. Column 7 – Vessel type. ABS Amelia 2010 2177 3250 5452 PSV FiFi 1 Column 8 – FiFi Class. ABS Anokhi 2005 1995 1700 6002 65 AHTS FiFi 1 Explanation column 7 Vessel types: Abu Qurrah Oil Well Maintenance Establishment, Abu Dhabi, UAE PSV –Platform Supply Vessel. AHTS –Anchor Handling Tug Supply. AHT –Anchor Handling Tug. DS –Diving Support Vessel. StBy –Safety Standby Vessel. MAIN –Maintenance Vessel. U-W –Utility Workboat. SEIS –Seismic Survey Vessel. RES –Research Vessel. OILW –Oilwell Stimulation Vessel. OilPol –Oil Pollution Vessel Al Nader 1970 275 687 1700 20 OILW MAIN –Maintenance Vessel. Al-Manarah 1971 275 687 1700 OILW W2W –Walk To Work Vessel. Al-Manarah 2 1998 769 1000 1250 OILW FRU –Floating Regasification Unit. ACSM Agencia Maritima S.L.U., Vigo, Spain Nautilus 2001 2401 3248 5302 PSV ACE Offshore Ltd., Hong Kong, China A & E Petrol Nigeria, Ltd., Warri, Nigeria Guangdong Yuexin 3270 2021 1930 1370 6400 75 AHTS Guangdong Yuexin 3271 2021 1930 1370 6400 75 AHTS O'Misan 1 1968 575 550 1700 PSV Acta Marine Group, Den Helder, Netherlands AAM -

Deepwater, Deep Ties, Deep Trouble: a State-Corporate Environmental Crime Analysis of the 2010 Gulf of Mexico Oil Spill
Western Michigan University ScholarWorks at WMU Dissertations Graduate College 8-2012 Deepwater, Deep Ties, Deep Trouble: A State-Corporate Environmental Crime Analysis of the 2010 Gulf of Mexico Oil Spill Elizabeth A. Bradshaw Western Michigan University, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.wmich.edu/dissertations Part of the Criminology and Criminal Justice Commons, Environmental Policy Commons, and the Politics and Social Change Commons Recommended Citation Bradshaw, Elizabeth A., "Deepwater, Deep Ties, Deep Trouble: A State-Corporate Environmental Crime Analysis of the 2010 Gulf of Mexico Oil Spill" (2012). Dissertations. 53. https://scholarworks.wmich.edu/dissertations/53 This Dissertation-Open Access is brought to you for free and open access by the Graduate College at ScholarWorks at WMU. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks at WMU. For more information, please contact [email protected]. DEEPWATER, DEEP TIES, DEEP TROUBLE: A STATE-CORPORATE ENVIRONMENTAL CRIME ANALYSIS OF THE 2010 GULF OF MEXICO OIL SPILL by Elizabeth A. Bradshaw A Dissertation Submitted to the Faculty of The Graduate College in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Sociology Advisor: Ronald C. Kramer, Ph.D. Western Michigan University Kalamazoo, Michigan August 2012 THE GRADUATE COLLEGE WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY KALAMAZOO, MICHIGAN Date June 29, 2012 WE HEREBY APPROVE THE DISSERTATION SUBMITTED BY Elizabeth A. Bradshaw ENTITLED Deepwater, Deep Ties, Deep Trouble: A State-Corporate Environmental Crime Analysis of the 2010 Gulf of Mexico Oil Spill AS PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF Doctor of Philosophy Sociology /^^y<^^<^ (Department) Ronald C^ramer, Ph.D Dissertatijzfh Beview Committer Sociology (Program) Gregory J. -

Serving & Upholding
2011 SINGAPORE SHIPPING ASSOCIATION / ANNUAL REVIEW 2010 Serving & Upholding SSA Annual Review 2010/2011 1 CONTENTS www.swire.com.sg Headquartered in Singapore - President’s Report - 3 Providing Integrated Services to Global Clients Council Members 2011/2013 - 7 Organisational Structure - 8 SSA Committees 2011/2013 - 9 Activities Report - 13 Port Statistics - 37 SSA Members - 38 Membership Particulars & Fleet Statistics - 42 - Listing of Ordinary Members - 43 - Listing of Associate Members - 89 Offshore Support SINGAPORE SHIPPING ASSOCIATION 59 Tras Street, Singapore 078998 Tel 6222 5238 I Fax 6222 5527 Email [email protected] Environmental Solutions Salvage Web www.ssa.org .sg Special thanks to our statistics contributors, advertisers, and the following companies for giving us permission to use their photographs: AET Tankers Pte Ltd, BW Maritime Pte Ltd, Epic Shipping (Singapore) Pte Ltd, Hong Lam Marine Pte Ltd, Jaya Holdings, Jurong Port Pte Ltd, Mentum.no, NTUC, Rickmers Trust Management Pte Ltd, Rickmers Shipmanagement (Singapore) Pte Ltd, Singapore Tourism Board, Swire Pacific Offshore Operations (Pte) Ltd, U.S. Naval Forces Central Command. This publication is published by the Singapore Shipping Association. No contents may be reproduced in part or in whole without the prior consent of the publisher. MICA (P) 054/07/2011 Wind Farm Installation Marine Seismic Support 2 SSA Annual Review 2010/2011 SSA Annual Review 2010/2011 3 PRESIDENT’S REPORT 2010/2011 ur he global economic climate today is very much an improved one as compared with the global economic recession experienced in 2009. Continued rapid OMission T economic developments and expansion in countries, such as China, India and Vietnam, have largely played key roles in maintaining buoyancy in the supply AS AN ASSOCIATION and demand of shipping services, particularly in Asia in the last one and a half years. -

Offshore Supply and Support Vessels – World Wide
Offshore Supply and Support Vessels – World Wide JANUARY 2018 A Westcoasting Product Compiled by Ko Rusman and Herbert Westerwal [email protected] 1 Fleet List explanatarory notes Adel Abdelkarim Mostafa Attia, Alexandria, Egypt The fleet listings are shown under the operating groups. See View 1974 399 853 3000 33 AHTS The vessel listings indicate: ABS Marine Services Pvt. Ltd., Chennai, India Column 1 – Name of vessel. Column 2 – Year of build. Column 3 – Gross tonnage. Column 4 – Deadweight tonnage. Column 5 – Break horsepower. Column 6 – Bollard pull. Column 7 – Vessel type. Column 8 – FiFi Class. Explanation column 7 Vessel types: ABS Anokhi 2005 1995 1700 6002 65 AHTS FiFi 1 PSV –Platform Supply Vessel. Celestial 2015 3467 4141 5574 PSV FiFi 1 AHTS –Anchor Handling Tug Supply Vessel. AHT –Anchor Handling Tug. Abu Dhabi Enterprises Co. Ltd., Tokyo, Japan DS –Diving Support Vessel. StBy –Safety Standby Vessel. A.D. Pegasus 2005 496 220 3552 45 AHTS MAIN –Maintenance Vessel. Ad Jupiter II 2006 1202 760 4138 50 AHTS U-W –Utility Workboat. SEIS –Seismic Survey Vessel. Abu Dhabi Petroleum Ports Operating Co., Abu Dhabi, UAE RES –Research Vessel. OILW –Oilwell Stimulation Vessel. OilPol –Oil Pollution Vessel MAIN –Maintenance Vessel. W2W –Walk To Work Vessel. FRU –Floating Regasification Unit. SalTug –Salvage Tug. Barracuda 1982 1275 1199 3000 DS FiFi 1 Gubab 1991 910 751 6658 AHT FiFi 1 Hamour 1991 910 751 6658 AHT FiFi 1 Heddi 1983 512 260 3400 AHT FiFi 1 Remah 1 2015 1419 1026 5600 60 DS FiFi 1 Tawam 1 2015 1421 697 5600 60 DS FiFi -

ISCO NEWSLETTER the Newsletter of the International Spill Response Community Issue 335, 21 May 2012
ISCO NEWSLETTER The Newsletter of the International Spill Response Community Issue 335, 21 May 2012 [email protected] http://www.spillcontrol.org FREE ADVERTISING News FOR ISCO AUSTRALIA: THREAT TO GREAT BARRIER REEF AVERTED. CORPORATE MEMBERS A tug has taken in tow the stricken bulk sugar carrier ID Integrity, which has been powerless and adrift in rough seas about 300km northeast of QUICK FINDER Cairns since last Friday. Click on these headings CONSULTANTS EQUIPMENT & MATERIALS RESPONSE ORGANISATIONS TRAINING PROVIDERS Clicking on any entry will display the advertiser’s website. Reach your Market Entries are FREE for ISCO Corporate Members. For non-members one entry is just May 20 - The Integrity has been turned around and the tug was slowly steaming GBP 500 per annum. southeast, away from the Great Barrier Reef and waiting for the much larger emergency rescue vessel the Pacific Responder to arrive from the Torres Straits. Banners should be submitted in JPG format, size approx. 490 x 120 pixels. Each entry in It took about an hour to get a towline aboard the Integrity. the directory will be hyperlinked so that one click will immediately display your own An Australian Maritime Safey Authority spokeswoman said it was expected website. about 3pm. It would take over the tow and a decision would be made on where it would be taken. A one time only charge of £20 will be made for uploading each entry or, if you haven’t a The area is notorious for its powerful trade winds and gusts have been recorded ready-to-upload banner, we can create one for you for only £70. -

Resources on Oil Spills, Response, and Restoration: a Selected
Library and Information Services Division Current References 2010-2, Revised Resources on Oil Spills, Response, and Restoration A Selected Bibliography Gulf of Mexico – Deepwater Horizon fire. U.S. Coast Guard photo Prepared by Anna Fiolek, Linda Pikula, and Brian Voss U.S. Dept. of Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Environmental Satellite, Data, and Information Service National Oceanographic Data Center Library and Information Services Division June 2010; Revised December 2010 Preface to December 2010 Update This 1st update of the Oil Spill Bibliography has been greatly enlarged and enhanced by including over 500 additional citations incorporated into the six sections of this document. The new resources cited pertain mainly to the Deepwater Horizon Oil Spill in the Gulf of Mexico and its impacts on the marine ecosystem and the coastal environment. This document is cumulative and replaces its earlier version, published in June 2010. The online access to Bibliography remains unchanged and is available online as Library and Information Services Division current references 2010-2 at: http://docs.lib.noaa.gov/noaa_documents/NESDIS/NODC/LISD/Central_Library/current _references/current_references_2010_2.pdf. Users can also find it through a search of the NOAA Library and Information Network Catalog (NOAALINC) at: http://www.lib.noaa.gov/uhtbin/webcat/. Unless noted otherwise, the publications listed in this Bibliography may be requested through your local library’s Interlibrary Loan (ILL) service. 2 Contents: Preface ………………………………………………………………………. p. 4 Acknowledgment …………………………………………………………... p. 5 Introduction ………………………………………………………………...... p. 6 Sections: I. Electronic Resources on Oil Spills, Response and Restoration ……. p. 7 -- 73 II. Selected Videos on Oil Spills, Response and Restoration in the NOAA Library Network ………………………………………. -
The Deepwater Horizon Disaster and Opening
Abstract “SURPRISE! YOU’RE DEAD!” THE DEEPWATER HORIZON DISASTER AND OPENING STATEMENTS IN THE COURT OF PUBLIC OPINION by Deborah M. Welsh November, 2014 Director of Dissertation: Dr. Donna J. Kain Major Department: English This dissertation explores the ways in which various powerful groups used different genres of opening statements to create and control the version of the reality of a high stakes situation, namely, the April 20, 2010 Deepwater Horizon disaster. Specifically, in the dissertation I identify and analyze the features and rhetorical moves that typify the genres of legal and non-legal opening statements, and focus on the communicative dynamics that define interactions between speakers and audiences in court opening statements, Congressional opening statements, and public press conference statements. I use critical discourse analysis and genre analysis to pinpoint the rhetorical moves used in each genre of opening statements. I make the claim that legal court opening statements use epideictic rhetoric to convince decision makers to act in a particular way. I also make visible the connections that exist between technical and professional communicators and the development of corporate business texts, focusing particularly on positive changes needed in the field, including increased participation in the construction of texts for businesses, and need for using their experience, expertise and ethics to also advocate for the common good. Keywords: opening statements, epideictic rhetoric, technical and professional communication, primacy, critical discourse analysis, genre theory “SURPRISE! YOU’RE DEAD!” THE DEEPWATER HORIZON DISASTER AND OPENING STATEMENTS IN THE COURT OF PUBLIC OPINION A Dissertation Presented To the Faculty of the Department of English East Carolina University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy by Deborah M. -

Black Tide the Devastating Impact of the Gulf Oil Spill
—continued from front flap— $25.95 USA/$29.95 CAN Petroleum Festival showcase the deeply intertwined THE DEVASTATING IMPACT It is the worst oil disaster in American history. An oil world of seafood and oil in the Gulf, even as the fi erce A searing look at the human face and gas monster lurking deep below the ocean kills jousting by BP CEO Tony Hayward, oil lobbyist Jack oof f tthe h e GULF OIL SPILL eleven men and destroys a multimillion-dollar rig, the Gerard, Governor Bobby Jindal, and President Barack of BP’s disaster in the Gulf Deepwater Horizon, before launching a deadly ram- Obama exposes the political-corporate straitjacket “We cannot allow the BP disaster to be pushed from public view the way BP used chemical page across the Gulf of Mexico and onto the shores confi ning us to a world governed by our deadly ad- dispersants to hide the oil. These remarkable stories—of loss, heroism, and culpability—are a and beaches of four states. The heads of the world’s diction to oil. vivid reminder that this catastrophe will be with us for decades, and that we have not yet made mightiest corporations and most powerful govern- It was a disaster that should never have happened, ments sit impotent for three long months in the face and one that has every possibility of occurring again if the changes necessary to prevent destruction in the future.” JUHASZ of the monster’s attack. Blasted by chemicals, a toxic those who are fi ghting for lasting change are not suc- —Naomi Klein, author of The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism BLACK TIDE THE DEVASTATING IMPACT IMPACT THE DEVASTATING DEVASTATING IMPACT oily stew remains fl oating in underwater plumes, cessful.