Morts Pour Raisons Diverses
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Autres Pertes Bacque James
MORTS POUR RAISONS DIVERSES Par James Bacque Enquête sur le traitement des prisonniers de guerre Allemands dans les camps Américains et Français à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Éditions de l'AAARGH 2004 Traduit de l'Anglais par CATHERINE LUDET Sand Cet ouvrage est la traduction du livre de langue Anglaise, paru sous le titre : OTHER LOSSES et publié par Stoddart Publishing Co. Limited, Toronto, Canada. I.S.B.N. 2-7107-0462-5 © James Bacque, 1989. © Éditions Sand, 1990, pour l'édition Française. À l'abbé Franz Stock et à Victor Gollancz Le pire des péchés envers nos semblables, voyez-vous, ce n'est pas de les haïr, mais c'est d'être indifférent à leur égard. En vérité, je vous le dis, c'est là l'essence de l'inhumanité. George Bernard Shaw, Le Disciple du Diable James Bacque, Morts Pour Raisons Diverses 1 Table des Matières Avertissement ----------------------------------------------------------------------------- 03 Chronologie des Principaux Événements Cités dans cet Ouvrage -------------------- 04 PRÉFACE ---------------------------------------------------------------------------------- 08 Introduction ------------------------------------------------------------------------------- 11 Chapitre 1 -- QUE FAIRE DE L'ALLEMAGNE ? -------------------------------------- 15 Chapitre 2 -- SANS ABRI ----------------------------------------------------------------- 25 Chapitre 3 -- PAS DE DÉCLARATION PUBLIQUE ---------------------------------- 39 Chapitre 4 -- LA CRUAUTÉ DU VAINQUEUR -------------------------------------- 50 Chapitre 5 -

Operation-Overlord.Pdf
A Guide To Historical Holdings In the Eisenhower Library Operation OVERLORD Compiled by Valoise Armstrong Page 4 INTRODUCTION This guide contains a listing of collections in the Dwight D. Eisenhower Library relating to the planning and execution of Operation Overlord, including documents relating to the D-Day Invasion of Normandy on June 6, 1944. That monumental event has been commemorated frequently since the end of the war and material related to those anniversary observances is also represented in these collections and listed in this guide. The overview of the manuscript collections describes the relationship between the creators and Operation Overlord and lists the types of relevant documents found within those collections. This is followed by a detailed folder list of the manuscript collections, list of relevant oral history transcripts, a list of related audiovisual materials, and a selected bibliography of printed materials. DWIGHT D. EISENHOWER LIBRARY Abilene, Kansas 67410 September 2006 Table of Contents Section Page Overview of Collections…………………………………………….5 Detailed Folder Lists……………………………………………….12 Oral History Transcripts……………………………………………41 Audiovisual: Still Photographs…………………………………….42 Audiovisual: Audio Recordings……………………………………43 Audiovisual: Motion Picture Film………………………………….44 Select Bibliography of Print Materials…………………………….49 Page 5 OO Page 6 Overview of Collections BARKER, RAY W.: Papers, 1943-1945 In 1942 General George Marshall ordered General Ray Barker to London to work with the British planners on the cross-channel invasion. His papers include minutes of meetings, reports and other related documents. BULKELEY, JOHN D.: Papers, 1928-1984 John Bulkeley, a career naval officer, graduated from the U.S. Naval Academy in 1933 and was serving in the Pacific at the start of World War II. -

Spring 1999 Manhallan, Kansas 66506-1002 Slephen E
WORLD WAR TWO STUDIES ASSOCIATION (formerly American Committee on the History ofthe Second World War) Donald S. Detwiler, Chairman Mark P. Parillo, Secretary and Department of History Newsletter Editor Southern Illinois University Department of History al Carbondale 208 Eisenhower Hall Carboodale, Illinois 6290 1-4519 Kansas State University [email protected] Manhattan, Kansas 66506-1002 785-532-0374 Permanent Directors FAX 785-532-7004 paril/[email protected] Charles F Delzell Vanderbilt University Susannah U. BllJce James Ehrman Arthur L. Funk Auocillte Editors Gainesville, Florida Department of Hislory 208 Eisenhower Hall H. Stuart Hughes NEWSLETTER Kansas State University University of California. Manhaltan, Kansas 66506- 1002 San Diego ISSN 0885-5668 Robin Higham. Archivist Terms expiring 1999 Department of History 208 Eisenhower Hall Dean C. Allard Kansas State University Naval Historical Center No. 61 Spring 1999 Manhallan, Kansas 66506-1002 Slephen E. Ambrose The WWTSA is ajJilialJ!d with: University of New Orleans American Historical Association Edward 1. Drea 400 A Street, S.E. Center of Military Hiswry Washington, D.C. 20003 hltp: IIwww.tIIlYlha.org Waldo Heinrichs San Diego State Unive~ity Contents Comite International d'Histoirc: de 1a Deuxieme Guerre Mondiale David Kahn Henry Rousso, Secretary General Great Neck, New York World War Two Studies Association Institut d'Histoire du Temps Present (Centre national de la recherche Carol M. Petillo General Information 2 scientifique [CNRS]) Boston College Ecole Normale Superieure de Cachan The Newsletter 2 61. avenue du President Wilson Ronald H. Spector 94235 Cachan Cedex, France George Washington University Annual Membership Dues 2 roussof{/Jihtp-cllrs.ens-cachan!r David F. -

Pows and Mias in Vietnam, 1965-73
A Guide to Historical Holdings in the Dwight D. Eisenhower Library PRISONERS OF WAR (POWs) AND PERSONNEL MISSING IN ACTION (MIAs) Compiled by David J. Haight Dwight D. Eisenhower Library Staff 1998 Introduction The Eisenhower Library’s holdings span portions of four major periods of international conflict: World War II, the Korean War, the Cold War era, and the Vietnam War. All of these conflicts involved military actions resulting in military and civilian personnel being captured and held prisoner with some individuals listed as missing and unaccounted for. Three of these wars are obvious choices for coverage in a guide such as this one. The Cold War era in the 1950s, however, if the Korean War is excluded, did not involve major air, land and sea battles generating large numbers of casualties. Instead, this period was characterized by intelligence gathering operations conducted in a veil of strict secrecy. Nevertheless, military personnel, aircraft, vessels and equipment were used and military actions occurred. These resulted in the confirmed capture or death of some personnel but also the disappearance without confirmation of the fate of others. The largest quantities of documentation covered by this guide pertain to World War II and the Korean War. Only a tiny quantity of materials in our holdings has been identified as pertaining to POW/MIAs during the Vietnam War period from 1959 to 1975. The most widely scattered and also the most heavily security-classified materials are those pertaining to Cold War reconnaissance operations. Because the Papers of Dwight Eisenhower and those of his military associates primarily document United States military operations, much of the material covered in this guide relates to United States military personnel or the handling of enemy prisoners of war captured by the United States and its allies during World War II and in Korea. -

Special Observers: a History of SPOBS and USAFBI, 1941-1942
Special Observers: A History of SPOBS and USAFBI, 1941-1942 BY © 2016 Richard H. Anderson Submitted to the graduate degree program in History and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. ________________________________ Chair: Adrian R. Lewis, Ph.D. ________________________________ Co-Chair: Theodore A. Wilson, Ph.D. ________________________________ Sheyda Jahanbani, Ph.D. ________________________________ Paul Atchley, Ph.D. ________________________________ John M. Curatola, Ph.D. Date Defended: 06 December 2016 ii The dissertation committee for Richard H. Anderson certifies that this is the approved version of the following dissertation: Special Observers: A History of SPOBS and USAFBI, 1941-1942 ________________________________ Chair: Adrian R. Lewis, Ph.D. ________________________________ Co-Chair: Theodore A. Wilson, Ph.D. Date approved: 06 December 2016 iii Abstract In late spring, 1941, a small group of U.S. Army officers traveled to Britain to plan for Anglo-American cooperation if and when the U.S. entered World War II. Because the United States was still a neutral country and to prevent potential enemies from knowing the group's purpose, the U.S. Army called its mission to Britain the "U.S. Army Special Observer Group" (SPOBS). From May, 1941 until June, 1942, SPOBS (known as U.S. Army Forces in the British Isles or USAFBI after January 8, 1942) developed plans with the British for establishing U.S forces in the British Isles. Changing strategic conditions however, made much of this work obsolete. As a result, the Allies had to develop new plans for establishing U.S. -

A Portrait of Glenn Miller
A PORTRAIT OF GLENN MILLER Alton Glenn Miller (1904-1944) Produced by: DENNIS M. SPRAGG Updated April 2018 1 Alton Glenn Miller, 1904-1944 Produced by Dennis M. Spragg, with commentary from the GMA George T. Simon (1912-2001) Collection and Papers, Edward F. Polic Papers and Christopher Way Collection. Foreword By Harry Lillis “Bing” Crosby (1904-1977) “As the years go by, I am increasingly grateful that I was a tiny part of the era of the great swing bands. This was the golden age of popular music for me. They were all great, but I have to think that the Glenn Miller band was the greatest. Unlike so many of the others, Glenn was not a virtuoso instrumental soloist. And so instead of his horn he did it with great personnel and innovative harmonic experiments producing a sound that was his and his alone. Glenn employed a harmonization that was new and vastly different. If I even attempted a description of what he did, I would be immediately adrift. I think it was the way he voiced his instruments. It was just beautiful. And when you heard the sound, it was recognizable and memorable. It was just Glenn Miller. Glenn as a person was just as memorable. He was a very good personal friend, from the early days on, ever since he performed on some of the records I made with the Dorsey Brothers Orchestra during the early stages of my career. During World War II we were united for the last time, when I sang in London with his great AAF Orchestra. -

First of U.S. Famit^Tarrive Today
First of U.S. FamiT^TArrive Today Official Parties at Port EUROPEAN EDITION THE SJm A For Hearty Welcome Forcci in the European Thetlar Sunday, April 28, 1946 Volume 2, Number 117 By ALLAN DREl'FUSS, Staff Writer BREMEN, April 27—A year and a day after victorious Kilian, 13 British troops marched into Bremen, U. S. forces in this northty Anthracite western German port city prepared to meet the spearhead of an army of some 30,000 wives and children of American military ToFaceTrial personnel expected to come to the European Theater in the Walkout Is next 10 months. The 250 women and 100 children scheduled to arrive at At Nauheim Bremerhaven tomorrow -night aboard the converted troop ship Threatened Thomas H. Barry represent the first European shipment of By the Associated Press The Stars and Stripes Bureau American dependents of servicemen permitted to rejoin their The ,UMW served notice on BAD NAUHEIM, April 27— husbands and fathers under the provisions of a recent War the nation's anthracite mine Col. James A. Kilian of Chi- Department directive. operators that they want con- cago, two majors, one captain, Tides and weather conditions permitting, the Barry will be met by a cessions similar to those de- two first lieutenants and eight party of five army processing officers, a Medical Corps officer and a CIG manded from the soft coal enlisted men are scheduled to agent, who will board the vessel from a Navy tug three hours before she be tried at Bad Nauheim in ties up at the Columbus quay, which formerly berthed some of the blue operators and are willing to ribbon liners of the North German Lloyd Line. -

Presidential Libraries Holdings Related to Prisoners of War And
Presidential Libraries Holdings Relating to Prisoners of War and Missing in Action N A T I O N A L A R C H I V E S A N D R E C O R D S A D M I N I S T R A T I O N WA S H I N G T O N , D C R E V I S E D 2 0 0 7 REFERENCE INFORMATION PAPER 1 0 4 Presidential Libraries Holdings Relating to Prisoners of War and Missing in Action REFERENCE INFORMATION PAPER 1 0 4 National Archives and Records Administration, Washington, DC Compiled by Dale C. Mayer Revised 2007 Mayer, Dale C. Presidential libraries holdings relating to prisoners of war and missing in action / compiled by Dale C. Mayer.– Rev. ed.– Washington, D.C. : National Archives and Records Administration, 2007. p. ; cm.– (Reference information paper ; 104) Includes index. 1. Prisoners of war – United States – Archives – Catalogs. 2. Missing in action – Archives – Catalogs. 3. Presidential libraries – United States – Catalogs. 4. United States – History, Military – 20th century – Sources – Bibliography – Catalogs. I. United States. National Archives and Records Administration. II. Title. Cover: The “Hanoi Hilton” prisonerofwar camp, where American POWs were held captive by the North Vietnamese. (342BVN117) Still Picture Branch, National Archives and Records Administration. c o n t e n t s Preface ix PART I: Introduction Topics Covered 1 Review of Restricted Materials 3 Using This Guide 5 PART II: World War II Herbert Hoover Library 8 Franklin D. Roosevelt Library 8 Harry S. -

Eisenhower.Pdf
HISTORICAL MATERIALS IN THE DWIGHT D. EISENHOWER LIBRARY OF INTEREST TO THE NAZI WAR CRIMES AND JAPANESE IMPERIAL GOVERNMENT RECORDS INTERAGENCY WORKING GROUP The Dwight D. Eisenhower Library holds a large quantity of documentation relating to World War II and to the Cold War era. Information relating to war crimes committed by Nazi Germany and by the Japanese Government during World War II can be found widely scattered within the Library's holdings. The Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records Interagency Working Group is mandated to identify, locate and, as necessary, declassify records pertaining to war crimes committed by Nazi Germany and Japan. In order to assist the Interagency Working Group in carrying out this mission, the Library staff endeavored to identify historical documentation within its holdings relating to this topic. The staff conducted its search as broadly and as thoroughly as staff time, resources, and intellectual control allowed and prepared this guide to assist interested members of the public in conducting research on documents relating generally to Nazi and Japanese war crimes. The search covered post- war references to such crimes, the use of individuals who may have been involved in such crimes for intelligence or other purposes, and the handling of captured enemy assets. Therefore, while much of the documentation described herein was originated during the years when the United States was involved in World War II (1939 to 1945) one marginal document originated prior to this period can be found and numerous post-war items are also covered, especially materials concerning United States handling of captured German and Japanese assets and correspondence relating to clemency for Japanese soldiers convicted and imprisoned for war crimes. -

The Secret Air War Over France
Disclaimer The views in this paper are entirely those of the author expressed under Air University principles of academic freedom and do not reflect official views of the School of Advanced Airpower Studies, Air University, the U.S. Air Force, or the Department of Defense. In accordance with Air Force Regulation 110-8, it is not copyrighted, but is the property of the United States Government ABSTRACT This paper presents an historical account of the operations of United States Army Air Forces (USAAF) special operations units in the French campaign of 1944. The purpose of this paper is two-fold. First, it is intended to be a brief history of the creation, development and combat record of these units. Second, it is intended for use as an example of the utility and effectiveness of air force special operations in high intensity conventional warfare. The narrative basically begins in early 1943, as the Western Allies began making plans for the cross-Channel invasion of Normandy. At the request of the Office of Strategic Services (OSS), the USAAF commands in the United Kingdom and North Africa secretly organized a small number of special operations squadrons for use in covert operations over France. Their overall mission was to provide specialized airlift for clandestine warfare activities intended to support the conventional ground forces during the critical days and weeks immediately after D- Day. From October 1943 through September 1944, these squadrons flew thousands of clandestine missions, parachuting guerrilla warfare teams and intelligence agents deep behind German lines, dropping weapons, ammunition, explosives and other supplies to French resistance fighters, and extracting teams from enemy territory. -

The Manlius School
History: The Manlius School The Manlius School was founded [as St. John’s School] in 1869 by the Rt. Rev. Frederic Dan Huntington, Bishop of the Protestant Episcopal Diocese of Central New York. On August 24th of that year the Bishop and nine other prominent citizens of Central New York met and incorporated St. John's School. A building of the former Manlius Academy, founded in 1835 in the Manlius Village, was chosen as the school's home (this building still stands in the village on the corner of Seneca and Academy Streets and is presently used for classrooms and meetings by the Catholic Church). The Academy building was taken over at an annual rental of one dollar a year and a large residence nearby was bought for additional dormitory space. Although considered a diocesan institution, there was no church ownership then or at any time since, but the self- perpetuating Board of Trustees was entirely composed of Episcopalians. The first class entered on October 1, 1869, with Bishop Huntington as President of the Board and Locke Richardson, A.M., a noted Shakespearian scholar, in active charge as Headmaster. Headmasters were changed frequently during the first few years, but Bishop Huntington retained his presidency until his death in 1904. In January 1871, the new building on the site of the present Comstock Hall was occupied. Constructed of brick, this was in its day a modern and suitable building for a civilian boarding school for sixty pupils. By 1880, attendance had dwindled and there came insolvency. In 1881, there was a new corporation, as "St. -
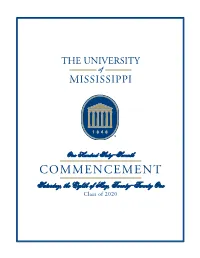
Commencement Program
THE UNIVERSITY of MISSISSIPPI One Hundred Sixty-Seventh COMMENCEMENT Saturday, the Eighth of May, Twenty-Twenty One Class of 2020 THE UNIVERSITY of MISSISSIPPI TM One Hundred Sixty-Seventh COMMENCEMENT Saturday, the Eighth of May, Twenty-Twenty One Class of 2020 Office of the Chancellor On behalf of the faculty and staff of the University of Mississippi, we extend a sincere welcome to the students, parents, families and friends gathered to celebrate Commencement for the Class of 2020. We are especially grateful to come together in person to recognize the spirit of our community and the academic accomplishments and dedication of our beloved graduates. Commencement is a time-honored tradition that recognizes the outstanding work and achievements of students and faculty. It is an exciting time for us, and we know this is a special occasion for all of you. Our students are the heart and soul of Ole Miss, and we take pride and inspiration in their accomplishments and growth. Today’s ceremony celebrates years of study, hard work and careful preparation, and we’re grateful that you have come to show your support, love and belief in these graduates. Our graduates accomplished so much during their time as Ole Miss students — they pursued their passions, maximized their potential and pushed their boundaries through outstanding learning opportunities and life-changing experiences. In addition, they endured the disruption caused by the pandemic, which has taught us all important life lessons about resilience and the need to be adaptable. Now, we can’t wait to see how they’ll continue to build personal legacies of achievement, service and leadership.