Aymeric Leroy
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sandspur, Vol 90, No 05, November 22, 1983
University of Central Florida STARS The Rollins Sandspur Newspapers and Weeklies of Central Florida 11-22-1983 Sandspur, Vol 90, No 05, November 22, 1983 Rollins College Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/cfm-sandspur University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Newspaper is brought to you for free and open access by the Newspapers and Weeklies of Central Florida at STARS. It has been accepted for inclusion in The Rollins Sandspur by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact [email protected]. STARS Citation Rollins College, "Sandspur, Vol 90, No 05, November 22, 1983" (1983). The Rollins Sandspur. 1616. https://stars.library.ucf.edu/cfm-sandspur/1616 Volume 90 Number 5 photo: jerry Uelsmann (story, page 5) Rollins College Sandspur, November 22,1983 pg. 2 The Haagen-Dazs Collection Haagen-Dazs presents the two straw mi Ik Nlv Arte shake A frosty smooth shake so thick and rich, Fine Lingerie • Foundations vou'll probably want two straws to drink it! Swimwear • Loungewear 218 Park Avenue N. Winter Park, FL 32789 Haagen-Dazs Telephone: 647-5519 ^^ Park Avenue 116 E. New England Ave. • Winter Park • 644-1611 Solar Heated Water fit FAIRBANKS EASTERN POLYCLEfiN GfiS fiND BEVERAGE Just One Block North Your Complete Laundromat of Rollins Campus Just One Block North * Discount Prices On Our of Rollins Campus Large Assortment of Domestic and Imported Beer Soda and Snacks Daily Newspapers and Magazines SELF SERVICE (New York Times, Wall Street Journal Orlando Sentinel) Wash And Dry FULL SERVICE Dry Cleaning Don't Forget To Check Oat Oar Wash, Dry. -

Omega Auctions Ltd Catalogue 28 Apr 2020
Omega Auctions Ltd Catalogue 28 Apr 2020 1 REGA PLANAR 3 TURNTABLE. A Rega Planar 3 8 ASSORTED INDIE/PUNK MEMORABILIA. turntable with Pro-Ject Phono box. £200.00 - Approximately 140 items to include: a Morrissey £300.00 Suedehead cassette tape (TCPOP 1618), a ticket 2 TECHNICS. Five items to include a Technics for Joe Strummer & Mescaleros at M.E.N. in Graphic Equalizer SH-8038, a Technics Stereo 2000, The Beta Band The Three E.P.'s set of 3 Cassette Deck RS-BX707, a Technics CD Player symbol window stickers, Lou Reed Fan Club SL-PG500A CD Player, a Columbia phonograph promotional sticker, Rock 'N' Roll Comics: R.E.M., player and a Sharp CP-304 speaker. £50.00 - Freak Brothers comic, a Mercenary Skank 1982 £80.00 A4 poster, a set of Kevin Cummins Archive 1: Liverpool postcards, some promo photographs to 3 ROKSAN XERXES TURNTABLE. A Roksan include: The Wedding Present, Teenage Fanclub, Xerxes turntable with Artemis tonearm. Includes The Grids, Flaming Lips, Lemonheads, all composite parts as issued, in original Therapy?The Wildhearts, The Playn Jayn, Ween, packaging and box. £500.00 - £800.00 72 repro Stone Roses/Inspiral Carpets 4 TECHNICS SU-8099K. A Technics Stereo photographs, a Global Underground promo pack Integrated Amplifier with cables. From the (luggage tag, sweets, soap, keyring bottle opener collection of former 10CC manager and music etc.), a Michael Jackson standee, a Universal industry veteran Ric Dixon - this is possibly a Studios Bates Motel promo shower cap, a prototype or one off model, with no information on Radiohead 'Meeting People Is Easy 10 Min Clip this specific serial number available. -

ALBUMS BARRY WHITE, "WHAT AM I GONNA DO with BLUE MAGIC, "LOVE HAS FOUND ITS WAY JOHN LENNON, "ROCK 'N' ROLL." '50S YOU" (Prod
DEDICATED TO THE NEEDS OF THE MUSIC RECORD INCUSTRY SLEEPERS ALBUMS BARRY WHITE, "WHAT AM I GONNA DO WITH BLUE MAGIC, "LOVE HAS FOUND ITS WAY JOHN LENNON, "ROCK 'N' ROLL." '50s YOU" (prod. by Barry White/Soul TO ME" (prod.by Baker,Harris, and'60schestnutsrevved up with Unitd. & Barry WhiteProd.)(Sa- Young/WMOT Prod. & BobbyEli) '70s savvy!Fast paced pleasers sat- Vette/January, BMI). In advance of (WMOT/Friday'sChild,BMI).The urate the Lennon/Spector produced set, his eagerly awaited fourth album, "Sideshow"men choosean up - which beats with fun fromstartto the White Knight of sensual soul tempo mood from their "Magic of finish. The entire album's boss, with the deliversatasteinsupersingles theBlue" album forarighteous niftiest nuggets being the Chuck Berry - fashion.He'sdoingmoregreat change of pace. Every ounce of their authored "You Can't Catch Me," Lee thingsinthe wake of currenthit bounce is weighted to provide them Dorsey's "Ya Ya" hit and "Be-Bop-A- string. 20th Century 2177. top pop and soul action. Atco 71::14. Lula." Apple SK -3419 (Capitol) (5.98). DIANA ROSS, "SORRY DOESN'T AILWAYS MAKE TAMIKO JONES, "TOUCH ME BABY (REACHING RETURN TO FOREVER FEATURING CHICK 1116111113FOICER IT RIGHT" (prod. by Michael Masser) OUT FOR YOUR LOVE)" (prod. by COREA, "NO MYSTERY." No whodunnits (Jobete,ASCAP;StoneDiamond, TamikoJones) (Bushka, ASCAP). here!This fabulous four man troupe BMI). Lyrical changes on the "Love Super song from JohnnyBristol's further establishes their barrier -break- Story" philosophy,country -tinged debut album helps the Jones gal ingcapabilitiesby transcending the with Masser-Holdridge arrange- to prove her solo power in an un- limitations of categorical classification ments, give Diana her first product deniably hit fashion. -

Book Review with TTU Libraries Cover Page
BOOK REVIEW: BEYOND AND BEFORE: THE FORMATIVE YEARS OF YES BY PETER BANKS The Texas Tech community has made this publication openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters to us. Citation Weiner, R.G. (2008). [Review of the book Beyond and Before: The Formative Years of Yes by Peter Banks]. Popular Music and Society, 31(1), 136-139. https://doi.org/10.1080/03007769908591748 Citable Link http://hdl.handle.net/2346/1546 Terms of Use CC-BY Title page template design credit to Harvard DASH. 136 Book Reviews Hammond’s myopic vision, his unrelenting determination, and his deep personal sorrows, but to his friends and supporters Hammond was a trying project. Perhaps, as Prial suggests, Hammond’s relationship to the Vanderbilts did him more good in his early years in music than his social skills. There are questions unanswered and undeveloped in this biography related to Hammond the man, such as his falling out with Aretha Franklin or his quick parting with Dylan. Each chapter of this book comes (another assault on your pocketbook) with a wonderful ‘‘discography’’ that should slow down the pace of reading but will contribute to a great start in building a library of American music of the 20th century. It is quite something how much music Hammond had a role in, and this portion of the book is an important reminder of the times and genres Hammond touched. As with all biographies there are problems and limitations. For those of us raised in the second half of the century, The Producer fails to deliver the same magic surrounding the discovery and signing of ‘‘our’’ heroes as it does around the early stars. -

Inga Magid Teaches Scissorfight “Keys for Kids”
March 2006 Volume 2 Issue 3 Blues ● Classical ● Country ● Folk ● Hip Hop ● Jazz ● Rock pronounced no-mah-so-nah Inga Magid Teaches Scissorfight “Keys For Kids” Michale Graves Matthew Stubbs Celebrated by his loving LowellRocks.com Benefit and very sneaky staff. Upcoming Shows Mar 18 10PM Rox's the Rock House 124 Main St(Rt 12) Oxford, MA Mar 31 10PM Character's Pub 246 Central St Gardner, MA RED MILL Apr 8 10PM KC's Tap/Club Cats 530 Broadway St(Rt 1) Pawtucket, RI Apr 6 9PM Character's Pub 246 Central St Gardner, MA Apr 15 9PM The Bullpen 1825 Acushnet Ave New Bedford, MA Apr 22 10PM Dee Dee's Lounge 297 Newport Ave Quincy, MA Apr 29 10PM Wild Spirits 1843 1st Ave New York, NY May 13 11PM KC's Tap/Club Cats 530 Broadway St(Rt 1) Pawtucket, RI July 7 11PM Character's Pub 246 Central St Gardner, MA GRAPHICS AD HERE www.geocities.com/whiskeychapel (508)234-5642 [email protected] Only 1 Issue Left! Unless You Advertise Bands get the word out about your new CD or gigs for only $65 Recording Studios, CD Du- plicators, T-Shirt Makers, Tattoo Studios, etc. Let’s Talk! [email protected] or (978) 258-2606 2 Table Of Contents The Buzz ................................ 5 Matt Stubbs ............................ 9 Publisher: Rig Painter Productions Dipthong ............................... 11 Scissorfight ........................... 12 Editor: Marc Friedman Michale Graves ..................... 13 Copy Editors: Jane B. Curran, Meg Crotty, Troll ...................................... 15 Amy Saunders, Jennifer Mottram, The LowellRocks.com Benefit 16 Marc Friedman, Sarah Kollett Inga Magid: Keys For Kids ... -

BEAM the OCCASIONAL UNOFFICIAL JOURNAL of the UNUSUAL SUSPECTS ISSUE #13 : APRIL 2018 May Tucker’S Ghost Be Smiling Upon Us
2 BEAM THE OCCASIONAL UNOFFICIAL JOURNAL OF THE UNUSUAL SUSPECTS ISSUE #13 : APRIL 2018 May Tucker’s Ghost be Smiling Upon Us THE BITCH IS BACK Stone cold sober, as a matter of fact. I had other plans for this editorial, this issue, and my part in it. Nic and I were hoping to get this ish out before Easter, and Follycon, so I could encourage people to vote for Johan Anglemark for TAFF, and Nic could root equally ardently for No Preference. Happily, y’all took my advice without my having to bother to give it. Well done you. Hell, I was hoping to finish at least one more chapter of my own TAFF “A bit too early for trip report before Follycon, because hey, coffee. I’ll have a twenty years to write your trip report, That’s Not Too Many! Yes, it’s been twenty Scotch” years since Intuition happened in This issue of BEAM is edited by Nic Farey and Ulrika O’Brien. 3342 Cape Cod Drive, Las Vegas, NV 89122, USA, email : [email protected] 418 Hazel Avenue N., Kent, WA 98030, USA, email : [email protected] 2 Manchester. Twenty years since they declared Scott and carl, who share Randy’s taste for fizzy peace in Northern Ireland. In some ways, it vinegar. I’m especially sorry to miss a chance to seems like an eyeblink. hang with the Fishlifters, which is all too rare a But life, as they say, is what happens while you’re treat. And of course I’ll miss all you other fine busy making other plans. -
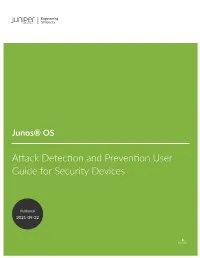
Junos® OS Attack Detection and Prevention User Guide for Security Devices Copyright © 2021 Juniper Networks, Inc
Junos® OS Attack Detection and Prevention User Guide for Security Devices Published 2021-09-22 ii Juniper Networks, Inc. 1133 Innovation Way Sunnyvale, California 94089 USA 408-745-2000 www.juniper.net Juniper Networks, the Juniper Networks logo, Juniper, and Junos are registered trademarks of Juniper Networks, Inc. in the United States and other countries. All other trademarks, service marks, registered marks, or registered service marks are the property of their respective owners. Juniper Networks assumes no responsibility for any inaccuracies in this document. Juniper Networks reserves the right to change, modify, transfer, or otherwise revise this publication without notice. Junos® OS Attack Detection and Prevention User Guide for Security Devices Copyright © 2021 Juniper Networks, Inc. All rights reserved. The information in this document is current as of the date on the title page. YEAR 2000 NOTICE Juniper Networks hardware and software products are Year 2000 compliant. Junos OS has no known time-related limitations through the year 2038. However, the NTP application is known to have some difficulty in the year 2036. END USER LICENSE AGREEMENT The Juniper Networks product that is the subject of this technical documentation consists of (or is intended for use with) Juniper Networks software. Use of such software is subject to the terms and conditions of the End User License Agreement ("EULA") posted at https://support.juniper.net/support/eula/. By downloading, installing or using such software, you agree to the terms and conditions -

The Concierge TIPS for TOURING HERE and ABROAD
N12 Travel Boston Sunday Globe AUGUST 23, 2020 The Concierge TIPS FOR TOURING HERE AND ABROAD TROUBLESHOOTER David Josef was Hawaiian supposed to be Airlines canceled in Italy right my flight but it now, but he’s won’t give me a making masks refund. instead Why not? By Christopher Elliott rules for ticket refunds. altham-based fashion designer extraordinaire GLOBE CORRESPONDENT Agent after agent repeated David Josef has always incorporated philanthropy Q. Hawaiian Airlines can- the same line: “We can’t re- into his work, but the COVID-19 pandemic has led celed my flight from San Jo- fund your ticket, but we’ll him to take that segment of his business to a new se, Calif., to Honolulu in give you a credit.” level through his creation of unique, often se- June. The airline rebooked Iunderstandwhyair- quin-embellishedW face masks. The Providence native has swapped me on another flight to a lines want to keep your out wedding dresses and ball gowns for face coverings he donates different airport at a differ- money at a time like this. to hospitals, nursing homes, and first responders. He also sells ent time. I spoke with an But rules are rules. And you masks to customers, who he said can’t get enough of his Ruth Bad- agent, who confirmed the know that if the tables were er Ginsberg design, or his seemingly innocent floral pattern that, change, but said the airline turned and you were asking upon closer inspection, has verbiage warning people (in very direct could not refund my money. -

The Syn – Trustworks
The Syn – Trustworks (49:23, CD, Umbrello Records / Nova Sales, 2016) Kürzlich ging es an dieser Stelle um Mabel Greer’s Toyshop, eine Vorläuferband von Yes. In dieselbe Kategorie fällt die 1965 gegründete Psychedelic- Beat-Band The Syn, denn bei ihr spielten Ende der 60er die Yes-Gründungsmitglieder Chris Squire und Peter Banks. The Syn bestritten unter anderem das legendäre erste Konzert vonJimi Hendrix im Londoner Marquee Club als Vorgruppe. Seit einigen Jahren sind The Syn unterbrochen von längeren Pausen wieder aktiv, als treibende Kraft steckt dahinter vor allem Sänger Steve Nardelli. Musikalisch erinnert nicht mehr viel an die Vergangenheit, auch der Yes-Bezug ist nahezu komplett verschwunden. Für ihr Comeback hatte die Band in Archiven nach Originalmaterial gestöbert, worauf 2005 – noch mit Chris Squire und Alan White – das beachtenswerte Album „Syndestructible“ erschien. 2009 scheiterten The Syn mit diversen Musikern aus dem Echolyn-Umfeld und Francis Dunnery (ex-It Bites) dann grandios mit „Big Sky“. Nach einigen Jahren Sendepause steht beim aktuellen Album „Trustworks“ zwar wieder The Syn drauf, jedoch steckt vor allem jede Menge Moon Safari drin. Bereits Ende 2010 hat die Zusammenarbeit begonnen, die The Syn zufolge ihren Psych Pop mit Moon Safaris sinfonischem Progressive Rock paart. Produziert von Jonas Reingold (u.a. The Flower Kings), fungiert die komplette Moon-Safari-Mannschaft hier nicht nur als Steve Nardellis Backingband – Moon Safari brachten sich auch beim Songwriting, bei der Produktion und mit ihren typischen Gesangsharmonien ein. Nardellis bluesige raue Stimme kommt allerdings nach wie vor zum Tragen. Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten ist die Verbindung zu YouTube blockiert worden. -

Journey at the Royal Festival Hall (2019)
LAST UK PERFORMANCE FEATURING THE ORION ORCHESTRA, THE ENGLISH CHAMBER CHOIR & THE ENGLISH ROCK ENSEMBLE, CONDUCTED BY GUY PROTHEROE NARRATED BY ROBERT POWELL, SPECIAL GUEST ALFIE BOE 13TH 14TH JULY 2019 LONDON ROYAL FESTIVAL HALL JOURNEY TO THE CENTRE OF THE EARTH A FEW WORDS FROM THE tonight as he will be the only person on stage, (apart from me), who was a part of the original KEYBOARD PLAYER ABOUT TONIGHT performances. His partner in vocal crime that hen I was 20 I often wondered what night, Gary Pickford-Hopkins, is sadly no I would be doing when I was 30 and longer with us and on the 2014 UK tour, Hayley when I was 30 I wondered what I Sanderson joined us and sang those original Wwould be doing when I was 40 and songs of Gary’s plus two new ones which she when I was 40 I wondered if I would even make immediately “made her own”. 50 and if so what on earth I would be doing. It Tony Fernandez, on drums, joined the turned out it was the same as when I was 20, English Rock Ensemble in 1975 and has been 30 and 40 and so I naturally presumed it would an integral part of the set up ever since. He and be the same when I was 50 and then 60 ...and it Matt Pegg, who joined in 2014, have formed was. Now, having reached 70, I a relationship in the rhythm am pleased to say that nothing section that is second to none has altered, apart that is from a (in getting to the bar). -

Synchroniser - Relay SYN-8
SYN-8 | Status 2017 - 12 - 01 Synchroniser - Relay SYN-8 Synchronisation between mains, generators or transformers Protective functions according to ANSI/IEEE C37.2: 12, 13, 14, 25, 27, 59, 81, 90 1/70 Synchroniser - R e l a y S Y N - 8 SYN-8 | Status 2017 - 12 - 01 Index 1 General Remarks ...................................................................................... 5 2 Safety Information ..................................................................................... 5 3 Measurement ............................................................................................. 6 3.1 Voltage Measurement ................................................................... 6 3.2 Frequency Measurement .............................................................. 6 3.3 3-phased mains (with or without Neutral Conductor) ..................... 6 3.4 1-phased Grids .............................................................................. 6 3.5 Behaviour at low Voltages ............................................................. 6 4 Installation ................................................................................................. 6 4.1 Mechanical Installation .................................................................. 6 4.2 Electrical Installation ...................................................................... 6 4.2.1 Connection Diagram ................................................................................. 7 4.3 Commissioning ............................................................................. -

Cash Box N.Y
October 28, 1978 xWMfi 7 Lm ;*j»V U4- * H5s* 'Vi * W ml ; *, 1 pi* *93wBr jr 1 1 / fj, J5 >THE W I Z Motion Picture/So about it You've heard it before, and well say it again: throughout the world of rock and roll, there's never been anything quite like this. In celebration of "Bat Out of Hell" 's first PE 34974 birthday, let's look at the record to see why 1978 belongs to Meat Loaf, and why Meat Loaf seems to be growing bigger and bigger as the weeks go by: • Double-platinum-plus album sales. • Gold single, “Two Out of Three Ain’t Bad’.’ • Over 15 million albums sold in the last 90 days. • Shipping at an average of 25,000 albums per day. • Additional 1.5 million albums sold internationally. • Total worldwide sales racing to sur- pass four million. ...and soon into 1979. The spectacular journey that took off with "Two put of Three Ain't Bad" now continues with the new Meat Loaf single, "You Took the Words Right Out of My Mouth. It s already a classic on hundreds of play lists all over the country. And in response to your continued sup- port, we're shipping it in anticipation of yet another Top-40 smash. “Bat Out of Her The double-platinum inaugural Meat Loaf album, with songs by Jim Steinman. Featuring the new single “You Took the Words Right Out of My Mouth V On Epic/Cleveland International Records and Tapes. Produced by Todd Rundgren. Management: David Sonenberg.