Les Emprunts De Potebnja À Lazarus : Essai D’Élucidation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

German Lutheran Missionaries and the Linguistic Description of Central Australian Languages 1890-1910
German Lutheran Missionaries and the linguistic description of Central Australian languages 1890-1910 David Campbell Moore B.A. (Hons.), M.A. This thesis is presented for the degree of Doctor of Philosophy of The University of Western Australia School of Social Sciences Linguistics 2019 ii Thesis Declaration I, David Campbell Moore, certify that: This thesis has been substantially accomplished during enrolment in this degree. This thesis does not contain material which has been submitted for the award of any other degree or diploma in my name, in any university or other tertiary institution. In the future, no part of this thesis will be used in a submission in my name, for any other degree or diploma in any university or other tertiary institution without the prior approval of The University of Western Australia and where applicable, any partner institution responsible for the joint-award of this degree. This thesis does not contain any material previously published or written by another person, except where due reference has been made in the text and, where relevant, in the Authorship Declaration that follows. This thesis does not violate or infringe any copyright, trademark, patent, or other rights whatsoever of any person. This thesis contains published work and/or work prepared for publication, some of which has been co-authored. Signature: 15th March 2019 iii Abstract This thesis establishes a basis for the scholarly interpretation and evaluation of early missionary descriptions of Aranda language by relating it to the missionaries’ training, to their goals, and to the theoretical and broader intellectual context of contemporary Germany and Australia. -

Chapter 2 Alternating Sounds and the Formal Franchise in Phonology James Mcelvenny University of Edinburgh
Chapter 2 Alternating sounds and the formal franchise in phonology James McElvenny University of Edinburgh A matter of some controversy in the intersecting worlds of late nineteenth-century linguistics and anthropology was the nature of “alternating sounds”. This phe- nomenon is the apparent tendency, long assumed to be characteristic of “primitive” languages, to freely vary the pronunciation of words, without any discernible sys- tem. Franz Boas (1858–1942), rebutting received opinion in the American anthro- pological establishment, denied the existence of this phenomenon, arguing that it was an artefact of observation. Georg von der Gabelentz (1840–1893), on the other hand, embraced the phenomenon and fashioned it into a critique of the compara- tive method as it was practised in Germany. Both Boas and Gabelentz – and indeed also their opponents – were well versed in the Humboldtian tradition of language scholarship, in particular as developed and transmitted by H. Steinthal (1823–1899). Although the late nineteenth-century debates surrounding alternating sounds were informed by a number of sources, this chapter argues that Steinthal’s writings served as a key point of reference and offered several motifs that were taken up by his scholarly successors. In addition, and most crucially, the chapter demonstrates that the positions at which the partic- ipants in these debates arrived were determined not so much by any simple tech- nical disagreements but by underlying philosophical differences and sociological factors. This episode in the joint history of linguistics and anthropology istelling for what it reveals about the dominant mindset and temperament of these disci- plines in relation to the formal analysis of the world’s languages. -

Philosophy in the Nineteenth Century
GEORGEMASON UNIVERSITY UNIVERSllY LIBRARIES THE OXFORD HANDBOOK OF GERMAN PHILOSOPHY IN THE NINETEENTH CENTURY ............................................................................................................................................................... Edited by MICHAEL N. FORSTER and KRISTIN GJESDAL OXFORD U N lV ERSITY PR ESS OXFORD UNIVERSITY PRESS Great Clarendon Street , Oxford, o:u 6oP, United Kingdom Oxford University Press is a depart ment of the t:niver,11r of Chford It furthers the University's obJective of excellence m n·s~·arch, s.:hol.1r,h1r , . and edu cation by publishing wor ldwide . Oxford is a regmereJ trade mJrk ,,t Oxford University Press m the IJK and in certain other countnc, © The several contribu tors 1015 The moral rights of the authors have been asserted First Edition pub!t,hed 10 2015 Impress ion 1 All rights reserved . No part of this publication may be rerroJuceJ. stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any mea ns, without the prior permiss ion in writing of Oxford University Press, or as npreHl y pcrm1tteJ by law, by licence or under terms agreed with the arpropr1ate repr oi:raph1,, rights organi zation. Enquiries concerning reproduction outsi de th e swre of the above should be sent to the Rights Department, Oxford tJ111vers1ty Pre,,, at the address above You must not circulate this work in any other form and you must impo se this same condit ion on any .icqu irt'r Published in the United States of America by Oxford University l're,s 198 Madison Avenue , New York, NY wo16, United StJ tes of Amer tCJ British Library Cataloguing in Puhlication l>Jta Data availa ble Library of Congress Control Numher: 2014946121 ISBN 978- 0 -19-969654 - 3 Printed and boun d by CPI Gro up (UK) Ltd, Croydon, CRO 4YY Links to thud party websites are provided by Oxford in !(OOJ faith anJ for information only. -
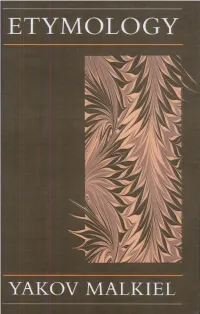
Etymology.Pdf
ETYMOLOGY ETYMOLOGY YAKOV MALKIEL Emeritus Professor, Department of Linguistics and Romance Philology Program, University of California, Berkeley CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS CAMBRIDGE university press Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, Delhi, Dubai, Tokyo, Mexico City Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York www.cambridge.org Information on this title: www.cambridge.org/9780521311663 © Cambridge University Press 1993 This publication is in copyright. Subject to statutory exception and to the provisions of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. First published 1993 A catalogue record for this publication is available from the British Library Library of Congress Cataloguing in Publication Data Malkiel, Yakov, 1914- Etymology / Yakov Malkiel p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0 521 32338 x (hardback). ISBN 0 521 31166 7 (paperback) 1. Language and languages — Etymology — History. I. Title P321.M341993 412 - dc2092-20773 92-20773 CIP ISBN 978-0-521-32338-3 Hardback ISBN 978-0-521-31166-3 Paperback Cambridge University Press has no responsibility for the persistence or accuracy of URLs for external or third-party internet websites referred to in this publication, and does not guarantee that any content on such websites is, or will remain, accurate or appropriate. Information regarding prices, travel timetables, and other factual information given in this work is correct at the time of first printing but Cambridge University Press does not guarantee the accuracy of such information thereafter. -

Völkerpsychologie in Germany
Introduction Völkerpsychologie in Germany Völkerpsychologie, or folk psychology, reflected some of the main currents within German academia in the nineteenth and early twentieth centuries. Its champions attempted to synthesize the empirical knowledge about the history and development of civilization that had been accumulated during the nine- teenth century, and tried to construct an academic discipline that would reflect the rapid political, economic and cultural changes of their contempo- rary society, and explain these in a comprehensive way. The success of the sciences provided an irresistible model for such an enterprise, as did the national movement in Prussia and the subsequent founding of a unified German nation state under Prussian auspices. The optimism and the belief in progress that characterized liberal thinking in the nineteenth century under- pinned the ‘project’ of folk psychology. Today the original aims of the ‘founders’ of Völkerpsychologie have been thoroughly forgotten. Instead, the term is widely associated with simplistic prejudices and stereotypes that might be common amongst journalists and political propagandists, but unworthy of serious academic contributions. Historians and literary critics easily dismiss folk psychology as a pseudo-sci- ence that presented speculations about ‘national characters’ as serious scholar- ship. They see folk psychology as an example of the perversion of science for political reasons, and treat it as little more than a chapter of the abuse of scholarship for political purposes. Thus, the contribution of folk psychology to the history of the social sciences has been regularly underestimated or even ignored. Similarly, Völkerpsychologie has not been included in the pedigree of the social sciences, and has rarely been studied in detail. -

Jewish Emancipation, Religious Individualisation, and Metropolitan Integration: a Case Study on Moses Mendelssohn and Moritz Lazarus
Sabine Sander Jewish emancipation, religious individualisation, and metropolitan integration: a case study on Moses Mendelssohn and Moritz Lazarus Beginning as a representation of the cosmos, a means of bringing heaven down to earth, the city became a symbol of the possible. (Mumford 1961, 31) Space, places and the topic of Bodenlosigkeit (homelessness, also bottomlessness) were always privileged topics in the reflections of Jewish scholars and artists – unsurprisingly, given the precarious ‘diasporic existence’ of the Jews, bonded by shared history and a shared destiny. The cities in Western Europe which had grown, prospered and served as vessels for economic, social and cultural crystal- lisation since the middle of the eighteenth century held out a particular promise for immigrant Jews. They offered them hope that they would be able to escape the physically cramped conditions and the intellectual narrowness of their shtetls and emancipate themselves step by step from the strictures of religion and tradi- tion, taking on a double identity as Jews and as Germans in the process. The path taken ‘out of the Ghetto’ (Katz 1973) by European Jews between 1750 and 1850 is closely interlinked with the emergence and development of the modern metropo- lis and with the processes of religious individualisation. The metropolis as a real and as a symbolic place creates an urban community made up of people from different social classes, professions, and geographical regions. In the light of the fact that metropolises were grasped as symbolic proxies of Utopia from an early stage onwards, it is startling that so little attention has been paid to the relationship between religious individualisation, Jewish eman- cipation, and metropolitan integration since the Haskalah. -

Hypology, Typology: the Gabelentz Puzzle
HYPOLOGY, TYPOLOGY: THE GABELENTZ PUZZLE FRANS PLANK 1. VOGUE WORDS It would be difficult to formulate the research Programme of linguistic typology more succinctly than in the following words from Georg von der Gabelentz's Die Sprachwissenschaft (1901: 481): Jede Sprache ist ein System, dessen sämmtliche Theile orga- nisch zusammenhängen und zusammenwirken. Man ahnt, keiner dieser Theile dürfte fehlen oder anders sein, ohne dass das Ganze verändert würde. Es scheint aber auch, als wären in der Sprach- physiognomie gewisse Züge entscheidender als andere. Diese Züge gälte es zu ermitteln; und dann müsste untersucht werden, welche andere Eigenthümlichkeiten regelmässig mit ihnen zusam- mentreffen. Ich denke an Eigenthümlichkeiten des Wort- und des Satzbaues, an die Bevorzugung oder Verwahrlosung gewisser grammatischer Kategorien. Ich kann, ich muss mir aber auch denken, dass alles dies zugleich mit dem Lautwesen irgendwie in Wechselwirkung stehe. Die Induction, die ich hier verlange, dürfte ungeheuer schwierig sein; und wenn und soweit sie gelingen sollte, wird es scharfen philosophischen Nachdenkens bedürfen, um hinter der Gesetzlichkeit die Gesetze, die wirkenden Mächte zu erkennen. Aber welcher Gewinn wäre es auch, wenn wir einer Sprache auf den Kopf zusagen dürften: Du hast das und das Einzelmerkmal, folglich hast du die und die weiteren Eigenschaften und den und den Gesammtcharakter! — wenn wir, wie es kühne Botaniker wohl versucht haben, aus dem Lindenblatte den Lindenbaum con- struiren konnten. Dürfte man ein ungeborenes Kind taufen, ich würde den Namen Typologie wählen. Hier sehe ich der allgemeinen Sprachwissenschaft eine Aufgabe gestellt, an deren Losung sie sich schon mit ihren heutigen Mitteln wagen darf. Hier würde sie Früchte zeitigen, die jenen der sprachgeschichtlichen Forschung an Reife nicht nachstehen, an Erkenntnisswerthe sie wohl übertreffen sollten. -

The Fate of Form in the Humboldtian Tradition: the Formungstrieb of Georg Von Der Gabelentz
The fate of form in the Humboldtian tradition: the Formungstrieb of Georg von der Gabelentz James McElvenny [email protected] This is the green open access copy of my paper in Language and Communication 47 (2016), 30-42. http://dx.doi.org/10.1016/j.langcom.2015.12.004 As always, only the published version is citable. In this case – and quite unusually – the published version is also actually better, since it corrects a few bibliographic errors and typos. In their finite generosity, Elsevier are offering free downloads of the published article until 4 March 2016 under the following link: http://authors.elsevier.com/a/1SNDlzlItk-Bv Presumably after that date the link will take you to their paywall. Abstract The multifaceted concept of ‘form’ plays a central tole in the linguistic work of Wilhelm von Humboldt (1767–1835), where it is deeply entwined with aesthetic questions. H. Steinthal’s (1823– 1899) interpretation of linguistic form, however, made it the servant of psychology. The Formungstrieb (drive to formation) of Georg von der Gabelentz (1840–1893) challenged Steinthal’s conception and placed a renewed emphasis on aesthetics. In this endeavour, Gabelentz drew on the work of such figures as August Friedrich Pott (1802–1887), Hans Conon von der Gabelentz (1807– 1874) and William Dwight Whitney (1827–1894). In this paper, we examine Gabelentz’ Formungstrieb and place it in its historical context. 1. Introduction A multifaceted concept with a range of applications, ‘form’ has a long history in Western philosophy, with especially strong ties to aesthetic theory (see Tatarkiewicz 1973).1 In the linguistic work of Wilhelm von Humboldt (1767–1835) and many of his followers, various notions of form serve a key role in conceptualising language. -
![European Journal of Pragmatism and American Philosophy, XI-1 | 2019, « European Pragmatism » [Online], Online Since 19 July 2019, Connection on 24 September 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/8251/european-journal-of-pragmatism-and-american-philosophy-xi-1-2019-%C2%AB-european-pragmatism-%C2%BB-online-online-since-19-july-2019-connection-on-24-september-2020-7748251.webp)
European Journal of Pragmatism and American Philosophy, XI-1 | 2019, « European Pragmatism » [Online], Online Since 19 July 2019, Connection on 24 September 2020
European Journal of Pragmatism and American Philosophy XI-1 | 2019 European Pragmatism Giovanni Maddalena and Friedrich Stadler (dir.) Electronic version URL: http://journals.openedition.org/ejpap/1459 DOI: 10.4000/ejpap.1459 ISSN: 2036-4091 Publisher Associazione Pragma Electronic reference Giovanni Maddalena and Friedrich Stadler (dir.), European Journal of Pragmatism and American Philosophy, XI-1 | 2019, « European Pragmatism » [Online], Online since 19 July 2019, connection on 24 September 2020. URL : http://journals.openedition.org/ejpap/1459 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ ejpap.1459 This text was automatically generated on 24 September 2020. Author retains copyright and grants the European Journal of Pragmatism and American Philosophy right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 1 TABLE OF CONTENTS Symposia. European Pragmatism Introduction to European Pragmatism Giovanni Maddalena and Friedrich Stadler Georg Simmel and Pragmatism Martin Kusch Wilhelm Jerusalem, the Social Element in his Pragmatism, and its Antecedent in Völkerpsychologie Thomas Uebel Ramsey, Pragmatism, and the Vienna Circle Cheryl Misak Pragmatism and the Birth of Subjective Probability Maria Carla Galavotti Lewis and Schlick Verificationism between Pragmatism and Logical Empiricism Massimo Ferrari Pragmatism in the Third Reich Heidegger and the Baumgarten Case Hans-Joachim Dahms Vailati, Papini, and the Synthetic Drive of Italian Pragmatism Giovanni -

Battle in the Mind Fields: Class 1
Battle in the Mind Fields: Class 1 John A Goldsmith June 21, 2019 Topic 1: The graphic genealogy and visual index 1. People, groups, influences, continuity (rupture? not so much) 2. Top to bottom: time. People at the top were born later than people at the bottom 3. Left to right: linguistics, philosophy, psychology. 4. Vienna Circle, Prague Circle, Gestalt psychology . Topic 2: The syllabus 1. What this course is all about: what you need to know to understand how we got here 2. The origins of modern linguistics 3. Philosophy and psychology. Auguste Comte, Ernst Mach, Wilhelm Wundt, Franz Brentano 4. Edward Sapir, Leonard Bloomfield; psychology in the United States 5. Roman Jakobson, Nicolas Trubetzkoy; Edmund Husserl 6. The Vienna Circle, the unity of science; cybernetics 7. American descriptivism: it was not what you think 8. Generative grammar: phonology, syntax, and the goals of the general theory Proposal 1: Reappropriating our history 1. Disciplines, barriers and moles 2. The eternal conversation 3. Some of our neighbors: philosophy, logic, and psychology 1 You do not understand the answer until you understand the question to which it was the answer. 1 Why did modern linguistics emerge in the 19th century? Topic 3: Six generations of linguists 1. Generation 1: Humboldt, Grimm, Rask, Bopp 2. Generation 2: Grassmann, Schleicher, Müller, William Dwight Whitney 3. Generation 3: Neogrammarians, Baudouin de Courtenay, Saussure 4. Generation 4: Trubetzkoy, Jakobson, Sapir, Bloomfield 5. Generation 5: Charles Hockett, Zellig Harris 6. Generation 6: Noam Chomsky, Morris Halle 1 Topic 4: Why is it so hard to read linguistics from the past? 1. -

The Reception of Wilhelm Von Humboldt's Linguistic Writings in The
Edinburgh Research Explorer The reception of Wilhelm von Humboldt’s linguistic writings in the Anglosphere, 1820 to the present Citation for published version: Joseph, J 2017, 'The reception of Wilhelm von Humboldt’s linguistic writings in the Anglosphere, 1820 to the present', Forum for Modern Language Studies, vol. 53, no. 1, cqw080, pp. 7-20. https://doi.org/10.1093/fmls/cqw080 Digital Object Identifier (DOI): 10.1093/fmls/cqw080 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: Forum for Modern Language Studies Publisher Rights Statement: This is a pre-copyedited, author-produced PDF of an article accepted for publication in Forum for Modern Language Studies following peer review. The version of recordJohn E. Joseph; The Reception of Wilhelm von Humboldt’s Linguistic Writings in the Anglosphere, 1820 TO THE present. Forum Mod Lang Stud 2017 cqw080. doi: 10.1093/fmls/cqw080 is available online at: https://academic.oup.com/fmls/article/2970287/The General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. -

Wilhelm Von Humboldt: a Critical Review on His Philosophy of Language, Theory and Practice of Education
JOURNAL OF CREATIVE WRITING VOLUME 2, ISSUE 2 2016, PP 21-29 ISSN 2410-6259 © DISC INTERNATIONAL Wilhelm Von Humboldt: A Critical Review on His Philosophy of Language, Theory And Practice of Education Arlini Binti Alias1 Abstract Wilhelm Von Humboldt was among those philosophers who used language as a tool to study the human mind and interpret human cultural differences. Humboldt equated language and thought as inseparable. His model of language can be summarized as follows: the character and structure of a language expresses the inner life and knowledge of its speakers, and that language must differ from one another in the same way and to the same degree as those who use them. Humboldt's approach to Allgemeine Bildung or well-rounded education was based on his own experience and lifelong learning process. The study of Humboldt’s work ‘helps to clarify the central problems and questions of recent educational theory as matters concerning all of us, and also help to resolve issues which require further theoretical and practical analysis’ (Benner,1990) Introduction Language is part of culture. In fact, it is the basic tool of learning. It represents our worldview and expresses the specific features of national mentality. Therefore, questions as such arise, “Do speakers 1 Lecturer, Department of Language, Communication and Culture, International Medical University, Malaysia, Email: [email protected] 22 JOURNAL OF CREATIVE WRITING: 2 (2), 2016 of different languages think differently? Are there distinct habits of thought and feeling that correspond to English, Malay, Arabic or any other language? Do speakers of different languages view the natural, social, and spiritual worlds with different lenses? Wilhelm von Humboldt was among those philosophers who attempted to find answers to these questions.