Les Clefs De Lecture Du PATRIMOINE RELIGIEUX.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Commune De Viane Dossier Communal Synthétique Des Risques
PRÉFECTURE DU TARN Commune de Viane Dossier Communal Synthétique des risques majeurs Information des populations © PRÉFECTURE DU TARN / SIDPC PRÉFECTURE DU TARN DOSSIER COMMUNAL SYNTHÉTIQUE COMMUNE DE VIANE - 2 - PRÉFECTURE DU TARN DOSSIER COMMUNAL SYNTHÉTIQUE COMMUNE DE VIANE Commune de Viane Dossier Communal Synthétique des Risques Majeurs Arrondissement de : CASTRES Ministère de l’écologie Canton de : LACAUNE et du développement durable N° INSEE : 81314 Préfecture du Tarn Population : 640 habitants Service interministériel de défense et de protection civile - 3 - PRÉFECTURE DU TARN DOSSIER COMMUNAL SYNTHÉTIQUE COMMUNE DE VIANE Ce dossier a été réalisé en collaboration avec le Service interministériel de défense et de protection civile de la Préfecture du Tarn, les services de l’État et du département. Préfecture du Tarn Service interministériel de défense et de protection civile Direction départementale de l’agriculture et de la forêt Direction départementale de l’équipement Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement Services départementaux de l’éducation nationale Service départemental d’incendie et de secours Ce dossier a été réalisé par : Magali PONS Docteur en Géographie Expert Consultant 8, rue Jugan F-34090 MONTPELLIER Tél. / Fax. : 04 67 72 02 67 [email protected] - 4 - PRÉFECTURE DU TARN DOSSIER COMMUNAL SYNTHÉTIQUE COMMUNE DE VIANE SOMMAIRE page • Préambule ………………………………………………………………………………………………………… 7 • Arrêté préfectoral …………………………………………………………………………………………… 8 • Risque majeur et information préventive ………………………………………………… 9 • Carte des zones à risque établie par les services de l'État …………………… 12 • Le risque INONDATION ………………………………………………………………………………… 15 1. Qu'est-ce qu'une inondation ? …………………………………………………………………… 15 2. Quels sont les risques d'inondation dans la commune ? ………………………… 16 3. Cartographie ……………………………………………………………………………………………… 18 4. -

Introduction
INTRODUCTION Contexte Les landes et les pelouses sèches représentent plus de 3200 ha sur le Pays Sidobre Monts de Lacaune (référence : Corine Land Cover 2000), soit l'équivalent de la surface de la commune du Bez. Dans les Monts de Lacaune, ces milieux de grande diversité biologique sont menacés et ont connu une forte régression au cours des dernières décénnies (disparition de 20 % des surfaces en 10 ans). Parmi les menaces qui pèsent sur les milieux secs figurent principalement l'arrêt du pâturage, consécutif à la déprise agricole dont les zones de montagne sont victimes. En effet, l'absence de gestion pastorale est une des causes de la fermeture plus ou moins rapide des parcelles engendrant une uniformisation du paysage et un appauvrissement de la biodiversité. De nombreuses landes ont également été enrésinées au cours des années 1950 à 1990 et, localement, des opérations de remise en culture ou en paturage (gyrobroyage et retournement du sol) ont conduit à la disparition des dernières landes d’un secteur. Face à ce constat, le Pays Sidobre - Monts de Lacaune, la Chambre d’Agriculture du Tarn, le Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées et la Ligue pour la Protection des Oiseaux du Tarn ont lancé un programme d’étude et de conservation de ces milieux secs remarquables. Objectifs La démarche consiste à proposer des mesures de gestion adaptées à chaque site sur la base d’inventaires naturalistes ciblés. Le but final est de signer une convention avec le(s) propriétaire(s)/gestionnaire(s) afin de mettre en place les mesures de gestion permettant la conservation des sites. -

Cheeses Part 2
Ref. Ares(2013)3642812 - 05/12/2013 VI/1551/95T Rev. 1 (PMON\EN\0054,wpd\l) Regulation (EEC) No 2081/92 APPLICATION FOR REGISTRATION: Art. 5 ( ) Art. 17 (X) PDO(X) PGI ( ) National application No 1. Responsible department in the Member State: I.N.D.O. - FOOD POLICY DIRECTORATE - FOOD SECRETARIAT OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD Address/ Dulcinea, 4, 28020 Madrid, Spain Tel. 347.19.67 Fax. 534.76.98 2. Applicant group: (a) Name: Consejo Regulador de la D.O. "IDIAZÁBAL" [Designation of Origin Regulating Body] (b) Address: Granja Modelo Arkaute - Apartado 46 - 01192 Arkaute (Álava), Spain (c) Composition: producer/processor ( X ) other ( ) 3. Name of product: "Queso Idiazábaľ [Idiazábal Cheese] 4. Type of product: (see list) Cheese - Class 1.3 5. Specification: (summary of Article 4) (a) Name: (see 3) "Idiazábal" Designation of Origin (b) Description: Full-fat, matured cheese, cured to half-cured; cylindrical with noticeably flat faces; hard rind and compact paste; weight 1-3 kg. (c) Geographical area: The production and processing areas consist of the Autonomous Community of the Basque Country and part of the Autonomous Community of Navarre. (d) Evidence: Milk with the characteristics described in Articles 5 and 6 from farms registered with the Regulating Body and situated in the production area; the raw material,processing and production are carried out in registered factories under Regulating Body control; the product goes on the market certified and guaranteed by the Regulating Body. (e) Method of production: Milk from "Lacha" and "Carranzana" ewes. Coagulation with rennet at a temperature of 28-32 °C; brine or dry salting; matured for at least 60 days. -

Liste Des Communes
Agel (Hérault) Hérépian (Hérault) Rosis (Hérault) Aiguefonde (Tarn) Joncels (Hérault) Rouairoux (Tarn) Aigues-Vives (Hérault) La Caunette (Hérault) Saint-Amancet (Tarn) Albine (Tarn) La Livinière (Hérault) Saint-Amans-Soult (Tarn) Anglès (Tarn) La Salvetat-sur-Agout Saint-Amans-Valtoret (Tarn) Arfons (Tarn) (Hérault) Saint-Etienne-d'Albagnan Aussillon (Tarn) La Tour-sur-Orb (Hérault) (Hérault) Avène (Hérault) Labastide-Rouairoux (Tarn) Saint-Etienne-d'Estrechoux Azillanet (Hérault) Labruguière (Tarn) (Hérault) Barre (Tarn) Lacabarède (Tarn) Saint-Geniès-de-Varensal Bédarieux (Hérault) Lacaune-les-Bains (Tarn) (Hérault) Berlats (Tarn) Lacaze (Tarn) Saint-Gervais-sur-Mare Berlou (Hérault) Lacrouzette (Tarn) (Hérault) Boisset (Hérault) Lamalou-les-Bains (Hérault) Saint-Jean-de-Minervois Boissezon (Tarn) Lamontélarié (Tarn) (Hérault) Bout-du-Pont-de-l'Arn (Tarn) Lasfaillades (Tarn) Saint-Julien (Hérault) Brassac-sur-Agout (Tarn) Le Bez (Tarn) Saint-Martin-de-L'Arçon Burlats (Tarn) Le Bousquet-d'Orb (Hérault) (Hérault) Cabrerolles (Hérault) Le Masnau-Massuguiès (Tarn) Saint-Nazaire-de-Ladarez Cambon-et-Salvergues Le Poujol-sur-Orb (Hérault) (Hérault) (Hérault) Le Pradal (Hérault) Saint-Pierre-de-Trivisy (Tarn) Cambounès (Tarn) Le Rialet (Tarn) Saint-Pons-de-Thomières Camplong (Hérault) Le Soulié (Hérault) (Hérault) Cassagnoles (Hérault) Le Vintrou (Tarn) Saint-Salvi-de-Carcavès (Tarn) Castanet-le-Haut (Hérault) Les Aires (Hérault) Saint-Salvy-de-La-Balme Caucalières (Tarn) Les -

Janvier 2016
Janvier 2016 Bonne Année à tous...les vœux de M. le maire Départ de la ronde des rochers Barrage de Rassisse Sommaire : Le Mot du Maire P. 2-4 Histoire d’eau L’année 2015 s’est terminée avec son cortège d’évènements terribles, de L’assainissement non collectif malheurs et de peines pour notre pays, pour ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Notre devise, tellement vraie et d’actualité mais hélas com- P. 5 Travaux - Rappels battue par les forces de l’obscurantisme et du fanatisme, doit être sans P. 6 Le secours catholique cesse dans nos esprits et dans nos actions. Voici venu le temps des souhaits, P. 7 La commission sociale le temps des vœux pour 2016. Je tiens donc au nom de toute l’équipe muni- P. 8 Le C.F.A. de Lacrouzette cipale à présenter à toutes et à tous les meilleurs vœux de santé, de prospé- P. 9 L’ ACMS rité et de bonheur pour 2016 tant sur le plan personnel que sur le plan col- P. 10-11 Les écoles lectif. De grandes évolutions, dans l’organisation territoriale sont en cours P. 12-14 Les associations (parfois à marche forcée) : le projet de schéma départemental de coopéra- tion intercommunale (SDCI) qui prévoit la fusion de la Communauté de P. 15-16 Dates et crouzétoleries Communes Sidobre Val d’Agoût avec celle de Vals et plateaux des Monts de Lacaune a été débattu tant en Conseil Municipal qu’en Conseil de Commu- Infos Mairie : nautés de Communes. Il a clairement été délibéré dans les deux instances que nous souhaitons rester sur un statu quo sans fusion et qu’éventuelle- Tél : 05.63.50.60.16 - Fax : 05.63.50.67.25 ment nous pourrions envisager d’intégrer Castelnau de Brassac, Ferrières, Mail : [email protected] le Margnès (commune nouvelle de Fontrieu) et Vabre. -

Circuit Moto Sidobre Et Monts De Lacaune
LE TARN À Circuit des Monts de Lacaune & du Sidobre MOTO entre lacs et montagne CIRCUIT DES Lacaune Brassac MONTS DE LACAUNE Col de la Bassine Lac de la RaviègeN & DU SIDOBRE Viane La Salvetat O E Lacaze Lac du Laouzas S et montagne 0 5 km entre lacs Vabre Murat sur Vèbre Roquecourbe Nages LE CIRCUIT DES Burlats Lacaune MONTS DE LACAUNE Lacrouzette & DU SIDOBRE entre lacs et montagne Ce circuit permet de découvrir les magnifiques paysages du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, réputé par la richesse de sa faune avicole. Le trajet suit les vallées et gorges du Gijou et de l’Agout ainsi la paisible haute vallée de la Vèbre. Les Lacs de Raviège et du Laouzas invitent à une halte pour Crémaussel profiter des activités nautiques et de la baignade. Ce circuit traverse le env. 150 km massif granitique du Sidobre, haut lieu géologique, et des zones forestières très étendues, qui alternent avec les www.tourisme-tarn.com grands pâturages de brébis de la race Lacaune, la seule race laitière acceptée pour la fabrication du Roquefort. Autres points forts du circuit, les témoignages du riche passé de ce territoire, comme le Pavillon d’Adélaïde à Burlats, le pont du 12 ème siècle à Brassac, les Châteaux de Lacaze et Nages, ou encore les statues-menhirs dans les alentours de Lacaune. Suivez-nous sur : www.facebook.com/tarntourisme.sudouest OFFICES DE TOURISME & bureaux @TourismeTarn d’information touristique sur le circuit circuits moto da z tous les ns les o Office de tourisme des Vabre - 81330 rouve ff ces Offce de tourisme Sens du circuit Monts de Lacaune Ret les bureaux d’information t de Limite du Parc naturel régional Rue vieille me et ouristiq ouvert à l’année touris ue. -

3B2 to Ps Tmp 1..96
1975L0271 — EN — 14.04.1998 — 014.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (France) (75/271/EEC) (OJ L 128, 19.5.1975, p. 33) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 76/401/EEC of 6 April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Commission Decision 77/3/EEC of 13 December 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Commission Decision 78/863/EEC of 9 October 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Commission Decision 81/408/EEC of 22 April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Commission Decision 83/121/EEC of 16 March 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Commission Decision 84/266/EEC of 8 May 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Commission Decision 85/138/EEC of 29 January 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Commission Decision 85/599/EEC of 12 December 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Commission Decision 86/129/EEC of 11 March 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Commission Decision 87/348/EEC of 11 June 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Commission Decision 89/565/EEC of 16 October 1989 L 308 17 25.10.1989 ►M13 Commission Decision 93/238/EEC of 7 April 1993 L 108 134 1.5.1993 ►M14 Commission Decision 97/158/EC of 13 February 1997 L 60 64 1.3.1997 ►M15 Commission Decision 98/280/EC of 8 April 1998 L 127 29 29.4.1998 Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 288, 20.10.1976, p. -

Sant-Valentin Aquí
# J E S O U T I E N S L E C O M M E R C E L O C A L SANT-VALENTIN AQUÍ idées cadeaux et séjours pour préparer votre St Valentin 2021 en Sidobre & vallées L I S T E N O N E X H A U S T I V E P R O P O S É E P A R L ' O F F I C E D E T O U R I S M E S I D O B R E V A L S E T P L A T E A U X E N S O U T I E N D E S P R O D U C T E U R S , A R T I S A N S E T C O M M E R C E S D E N O T R E T E R R I T O I R E P O U R P R É P A R E R V O T R E S T V A L E N T I N 2 0 2 1 Pour la St Valentin, je consomme local ! Dans cette période difficile, il est plus que jamais important de consommer local pour soutenir l'activité de notre territoire. Pourquoi acheter certains produits venant de loin, alors que ceux-ci peuvent se trouver ici, et permettre de sauvegarder des emplois ! Ce modeste petit catalogue numérique, est Suite à la crise sanitaire que nous connaissons réalisé par l'office de tourisme intercommunal actuellement, chacun d'entre nous a la Sidobre Vals et Plateaux. -

Sectorisation Collèges Par Commune-R2016
Sectorisations des collèges tarnais à la rentrée 2016 Commune de résidence collège de secteur DOURGNE DOURGNE DURFORT DOURGNE ESCOUSSENS LABRUGUIERE ESCROUX LACAUNE ESPERAUSSES BRASSAC FAUCH REALMONT FAUSSERGUES VALENCE-D'ALBIGEOIS FAYSSAC GAILLAC-CAMUS Date: 25/03/2016 FENOLS ALBI-BELLEVUE Commune de résidence Collège de secteur FIAC LAVAUR AGUTS PUYLAURENS FLORENTIN ALBI-BELLEVUE AIGUEFONDE MAZAMET-PAGNOL FRAISSINES ALBAN ALBAN ALBAN FONTRIEU BRASSAC ALBI FRAUSSEILLES CORDES-SUR-CIEL ALBINE LABASTIDE-ROUAIROUX FREJAIROLLES ALBI-BELLEVUE ALGANS-LASTENS LAVAUR FREJEVILLE VIELMUR-SUR-AGOUT ALMAYRAC BLAYE-A.MALROUX GAILLAC ALOS CORDES-SUR-CIEL GARREVAQUES PUYLAURENS AMARENS CORDES-SUR-CIEL GARRIGUES LAVAUR AMBIALET ALBAN GIJOUNET LACAUNE AMBRES LAVAUR GIROUSSENS ST-SULPICE ANDILLAC GAILLAC-CAMUS GRAULHET GRAULHET ANDOUQUE VALENCE-D'ALBIGEOIS GRAZAC RABASTENS ANGLES BRASSAC GUITALENS-LALBAREDE VIELMUR-SUR-AGOUT APPELLE PUYLAURENS ITZAC CORDES-SUR-CIEL ARFONS DOURGNE JONQUIERES LAUTREC ARIFAT REALMONT JOUQUEVIEL BLAYE-A.MALROUX ARTHES ST-JUERY LABARTHE-BLEYS CORDES-SUR-CIEL ASSAC VALENCE-D'ALBIGEOIS LABASTIDE-DE-LEVIS GAILLAC-CAMUS AUSSAC ALBI-BELLEVUE LABASTIDE-DENAT ALBI BALZAC AUSSILLON LABASTIDE-GABAUSSE BLAYE-A.MALROUX BANNIERES LAVAUR LABASTIDE-ROUAIROUX LABASTIDE-ROUAIROUX BARRE LACAUNE LABASTIDE-ST-GEORGES LAVAUR BEAUVAIS-SUR-TESCOU RABASTENS LABESSIERE-CANDEIL GRAULHET BELCASTEL LAVAUR LABOULBENE CASTRES-JAURES BELLEGARDE MARSAL SAINT JUERY LABOUTARIE REALMONT BELLESERRE DOURGNE LABRUGUIERE LABRUGUIERE BERLATS BRASSAC LACABAREDE -
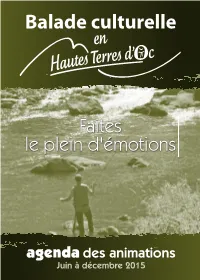
ANIMATIONS 2015-2.Indd
Balade culturelle Faites le plein d'émotions agenda des animations Juin à décembre 2015 Hautes Terres d’Oc Sommaire Vos interlocuteurs pour plus d’informations ... 2 à 4 Carte de situation ................................................. 16 et 17 La fête et le sport ......................................................5 à 15 La culture ....................................................................18 à 43 Hautes Terres d’Oc Vos interlocuteurs pour plus d’informations Bien sûr, toutes les initiatives ne sont pas répertoriées ici. Pour tout renseignement, confirmation de date, autres manifestations (belote, lotos, activités ouvertes au public…), équipements de loisirs, parc animalier, moulins, piscines, bases nautiques, centres équestres, Aventure Parc… renseignez-vous auprès des bureaux d’information touristique du territoire. Office de Tourisme Bureau d’information touristique de La Salvetat-sur-Agout de Lacaune-les-Bains Place des Archers - 34330 La Salvetat-sur-Agout Place du Général de Gaulle - 81230 Lacaune-les-Bains Tél. : 04 67 97 64 44 - Courriel : [email protected] Tél. : 05 63 37 04 98 - Courriel : [email protected] - - Site internet : www.salvetat-tourisme.fr Site internet : www.tourisme-montsdelacaune.com Bureau d’information touristique du lac du Laouzas Office de Tourisme Rieumontagné - 81320 Nages - Tél. : 05 63 37 06 01 des Monts de l’Espinouse Courriel : [email protected] - Le village - 34330 Fraïsse-sur-Agout Site internet : www.tourisme-montsdelacaune.com Tél. : 04 67 97 53 81 - Courriel : [email protected] Bureau d’information touristique de Murat-sur-Vèbre Site internet : www.ot-espinouse.fr - Ouvert de Mai à Septembre - 81320 Murat-sur-Vèbre Point info tourisme du Caroux Tél. : 05 63 37 47 47 - Courriel : [email protected] - Site internet : www.tourisme-montsdelacaune.com Col de Madale 34610 Rosis - Tél : 04 67 23 69 26 Courriel : [email protected] Bureau d’information touristique de Viane Site internet : rosis-languedoc.com Ouvert juillet et août - Place de la Mairie - 81530 Viane Tél. -

Commune De Senaux Dossier Communal Synthétique Des Risques
PRÉFECTURE DU TARN Commune de Senaux Dossier Communal Synthétique des risques majeurs Information des populations © PRÉFECTURE DU TARN / SIDPC PRÉFECTURE DU TARN DOSSIER COMMUNAL SYNTHÉTIQUE COMMUNE DE SENAUX - 2 - PRÉFECTURE DU TARN DOSSIER COMMUNAL SYNTHÉTIQUE COMMUNE DE SENAUX Commune de Senaux Dossier Communal Synthétique des Risques Majeurs Arrondissement de : CASTRES Ministère de l’écologie Canton de : LACAUNE et du développement durable N° INSEE : 81282 Préfecture du Tarn Population : 29 habitants Service interministériel de défense et de protection civile - 3 - PRÉFECTURE DU TARN DOSSIER COMMUNAL SYNTHÉTIQUE COMMUNE DE SENAUX Ce dossier a été réalisé en collaboration avec le Service interministériel de défense et de protection civile de la Préfecture du Tarn, les services de l’État et du département. Préfecture du Tarn Service interministériel de défense et de protection civile Direction départementale de l’agriculture et de la forêt Direction départementale de l’équipement Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement Services départementaux de l’éducation nationale Service départemental d’incendie et de secours Ce dossier a été réalisé par : Magali PONS Docteur en Géographie Expert Consultant 8, rue Jugan F-34090 MONTPELLIER Tél. / Fax. : 04 67 72 02 67 [email protected] - 4 - PRÉFECTURE DU TARN DOSSIER COMMUNAL SYNTHÉTIQUE COMMUNE DE SENAUX SOMMAIRE page • Préambule ………………………………………………………………………………………………………… 7 • Arrêté préfectoral …………………………………………………………………………………………… 8 • Risque majeur et information préventive ………………………………………………… 9 • Carte des zones à risque établie par les services de l'État …………………… 12 • Le risque INONDATION ………………………………………………………………………………… 15 1. Qu'est-ce qu'une inondation ? …………………………………………………………………… 15 2. Quels sont les risques d'inondation dans la commune ? ………………………… 16 3. Cartographie ……………………………………………………………………………………………… 18 4. -

Réalisé Le 24 Août 2018
ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET INFORMATION SUR LES SOLS : PRISE EN COMPTE DU RADON Lors de la vente ou de la mise en location d’un bien, les diagnostics techniques ont vocation à renseigner les acquéreurs et locataires sur la qualité du bien. Dans ce cadre, l’Etat des Risques Naturels et Technologiques (ERNT) a été renommé en 2018 « Etat des Servitudes Risques et d’Information sur les Sols » (ESRIS). Le radon est un gaz radioactif inodore et incolore présent naturellement dans le sol et les roches (régions granitiques et volcaniques principalement). L’exposition à ce gaz, notamment dans les bâtiments d’habitation, peut avoir des conséquences graves pour la santé. Un nouvel arrêté complète l’actuel imprimé d’une rubrique sur le risque de radon significatif, dont l’information des locataires et des acquéreurs est obligatoire depuis le 1er juillet 2017, le nouveau formulaire d’ESRIS doit être annexé au bail ou à la promesse de vente à partir du 3 août 2018 si le bien est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon. Le formulaire est téléchargeable à partir du site internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs. Un arrêté du 27 juin 2018 fixe la liste des communes du Tarn où la présence de radon est significative (zone 3), impliquant une information par le biais de l’ESRIS : Aiguefonde, Crespin, Le Garric, Murat/Vèbre, St-Julien-Gaulène, Albine,