Histoire De L'art
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapport D'activité 2019 Musées D'orsay Et De L'orangerie
Rapport d’activité 2019 Musées d’Orsay et de l’Orangerie Rapport d’activité 2019 Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie Sommaire Partie 1 Partie 3 Les musées d’Orsay Le public, au cœur de la politique et de l’Orangerie : des collections de l’EPMO 57 exceptionnelles 7 Un musée ouvert à tous 59 La vie des collections 9 L’offre adulte et grand public 59 Les acquisitions 9 L’offre de médiation famille et jeune Le réaccrochage des collections permanentes 9 public individuel 60 Les inventaires 10 L’offre pour les publics spécifiques 63 Le récolement 22 L’éducation artistique et culturelle 64 Les prêts et dépôts 22 Les outils numériques 65 La conservation préventive et la restauration 23 Les sites Internet 65 Le cabinet d’arts graphiques et de photographies 25 Les réseaux sociaux 65 Les accrochages d’arts graphiques Les productions audiovisuelles et numériques 66 et de photographies 25 Le public en 2019 : des visiteurs venus L’activité scientifique 30 en nombre et à fidéliser 69 Bibliothèques et documentations 30 Des records de fréquentation en 2019 69 Le pôle de données patrimoniales digitales 31 Le profil des visiteurs 69 Le projet de Centre de ressources La politique de fidélisation 70 et de recherche 32 Les activités de recherche et la formation des stagiaires 32 Partie 4 Les colloques et journées d’étude 32 L’EPMO, Un établissement tête de réseau : l’EPMO en région 33 un rayonnement croissant 71 Les expositions en région 33 Les partenariats privilégiés 34 Un rayonnement mondial 73 Orsay Grand Département 34 Les expositions -

Laloux & Moisant
Victor Laloux Armand Moisant Gares et édifices de l'âge industriel Victor Laloux Né à Tours en 1850 Mort à Paris en 1937 Armand Moisant Né à Neuillé Pont Pierre en 1838 Mort à Neuillé Pont Pierre en 1906 Laloux est un architecte du XIX ème siècle : il se doit d'utiliser les nouvelles techniques et matériaux de l'époque, mais, de formation classique il préfère dissimuler le métal par la pierre : c'est le cas pour la façade de la gare de Tours mais aussi de la gare d'Orsay à Paris. Il a beaucoup oeuvré pour sa ville natale de Tours qui lui doit : la gare, l'hôtel de ville et la basilique Saint Martin (reconstruite en 1890 suite à son effondrement). Sa réalisation la plus célèbre est la gare d'Orsay (1898) à Paris, transformée depuis 1986 en musée (ses collections présentent l'art occidental de 1848 à 1914 dans toute sa diversité : peinture, sculpture, arts décoratifs, art graphique, photographie, architecture...). Moisant est un ingénieur et industriel. Il s'illustra de 1870 à 1906 dans de grands travaux de constructions métalliques en France tels que le Bon Marché, le Grand Palais et autres travaux pour les expositions universelles de Paris, le métro aérien et la gare de Lyon à Paris, le pont du Midi à Lyon ainsi que dans les colonies et le monde entier. Durant ces années, Armand Moisant sera l'un des grands concurrents de Gustave Eiffel. En plus de son activité de constructions métalliques, Armand Moisant réalisera le Domaine de la Donneterie avec des exploitations agricoles modèles dans sa Touraine natale à laquelle il restera très attaché. -

Le Pont Alexandre III
Société des Artistes Français Grand Palais - Porte C - Avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris Le Pont Alexandre III Cet ouvrage d’art fut construit pour l’Exposition Universelle de 1900. Il avait, entre autres, pour objet de célébrer l’amitié franco-russe, marquée officiellement par la signature d’une alliance entre le Tsar Alexandre III et le Président Français Sadi Carnot en 1891. La première pierre fut posée par le tsar Nicolas II, la Tsarine, son épouse, et le Président Français Félix Faure le 7 octobre 1896. "1 sur 14" Son trajet a été choisi en vue de relier l’Esplanade des Invalides avec le Palais de L’Elysée en passant par les Petit et Grand Palais. C’est un pont métallique de 165m de long et de 40m de large, fait d’une arche unique. Il a été classé monument historique en 1975. Il porte l’inscription : « Le 14 avril 1900, E. Loubet, Président de la République Française a ouvert l’Exposition Universelle et inauguré la pont Alexandre III. » Un pont très semblable a été construit à Saint Pétersbourg, le Pont de la Trinité ou Troïsky pour célébrer l’Exposition Universelle de Paris. Outre les ingénieurs Jean Resal et Amédée Ally, les architectes Cassien-Bernard et Gaston Cousin, tous deux Sociétaires des Artistes Français ont participé à la construction de l’Ouvrage. Les sculptures, frises, et autres décorations ont été exécutées par des Sociétaires du Salon des Artistes Français. Citons : Georges Récipon (1860-1920), Emmanuel Frémiet (1824-1910), Jules Félix Coutan (1848-1939), Henri Désiré Gauquié (1858-1927), Grandzlin, Pierre Granet, Alfred Lenoir (1850-1920), Laurent Honoré Marqueste (1848-1920), André Paul Arthur Massoulle (1851-1920), Gustave Michel (1851-1924), Léopold Morice (1846-1919), Abel Poulin, Léopold Clément Steiner (1853-1899). -
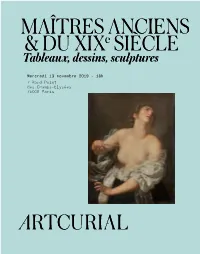
Maîtres Anciens & Du Xixe Siècle | 13.11.2019
RTCURIAL MAÎTRES ANCIENS e & DU XIX SIÈCLE Tableaux, dessins, sculptures SIÈCLE Mercredi 13 novembre 2019 - 18h e 7 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris MAÎTRES ANCIENS & DU XIX DU & ANCIENS MAÎTRES MAÎTRES ANCIENS & DU XIXe SIÈCLE Mercredi 13 novembre 2019 - 18h artcurial.com Mercredi 13 novembre 2019 - 18h 3949 RTCURIAL RTCURIAL lot n°38, École italienne, probablement Milan, vers 1600, Saint Ambroise (détail) p.67 MAÎTRES ANCIENS & DU XIXe SIÈCLE Tableaux, dessins, sculptures Mercredi 13 novembre 2019 - 18h 7 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris lot n°38, École italienne, probablement Milan, vers 1600, Saint Ambroise (détail) p.67 lot n°109, Cornelis Kick, Bouquet de fleurs sur un entablement (détail) p.170 Assistez en direct aux ventes aux enchères d’Artcurial et enchérissez comme si vous y étiez, c’est ce que vous offre le service Artcurial Live Bid. Pour s’inscrire : www.artcurial.com 13 novembre 2019 18h. Paris RTCURIAL Maîtres anciens & du XIXe siècle 3 INDEX lot n°66, Allemagne du Sud, première partie du XVIe siècle, La Vierge à l'Enfant (détail) p.106 ÉCOLE VÉNITIENNE DU XVIe S. – 35 MOLENAER, Bartholomeus - 92 A ÉCOLE VÉNITIENNE DU XVIIIe S. – 54 MONOGRAMMISTE JF – 82 ADAM, Franz – 167 EHRENBERG, Wilhelm Schubert - 119 MOREAU, Auguste – 173 AELST, Willem van – 80 Espagne, 2nde PARTIE DU XVIIe S. - 42 MOREAU, Mathurin – 170 ALLEMAGNE DU SUD, XVIe siècle - 66 EUROPE CENTRALE FIN DU XVIe – DÉBUT MOUCHERON, Frederik de - 94 ANDALOUSIE DÉBUT DU XVIIe S. – 41 DU XVIIe S. - 57 ANQUETIN, Louis – 185 AST, Balthasar van der - 76 O F ORLEY, Richard van - 118 FAES, Peter – 135 B FLEURY, Antoine-Claude – 24, 25 BARYE, Antoine-Louis – 146, 149, FORNENBURGH, Jan Baptist van – 90 P 150, 151, 152 FRAGONARD, Jean-Honoré – 19, 20 PAYS-BAS, XVIe S. -

Encyklopédia Kresťanského Umenia
Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia Francúzi - francúzski ľudia Francúzska akadémia - Académie Francaise francúzska antikva - antikva francúzska francúzska architektúra - pozri Style Plantagenet, ranyonantná gotika/ Style rayonant, flamboantná gotika/Style flamboant, Louis Quatorze, Louis Quinze/Style rocaille, Louis Seize/luiséz, deuxiéme renaissance, francúzska novogotika; lucarne, klenba angevinská http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Architecture_en_France francúzska architektúra gotická - pozri gotický sloh, katedrála, opus francigenum http://www.sacred-destinations.com/france/france-cathedrals http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Architecture_gothique_en_France http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Architetture_gotiche_della_Francia francúzska architektúra podľa štýlu - http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Architecture_en_France_par_style francúzska architektúra románska - http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Architecture_romane_en_France francúzska architektúra 12.st. - http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Arquitectura_en_Francia_del_siglo_XII francúzska kultúra - http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Culture_en_France francúzska minca - minca francúzska francúzska novogotika - historizujúci sloh 2.pol.19.storočia; pozri historizmus Francúzska revolúcia - pozri Veľká francúzska revolúcia francúzska rímskokatolícka cirkev - http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Roman_Catholic_Church_in_France francúzska tlač - tlač francúzska francúzska záhrada - francúzsky park francúzske -

Pont Alexandre-III
Pont Alexandre-III Le pont Alexandre-III est un pont franchissant la Seine entre le 7e et le 8e arrondissement de Paris. Pont Alexandre-III Sommaire Situation et accès Origine du nom Historique Le projet La réalisation Description Pont Alexandre-III vu de l’amont. Caractéristiques Décoration Géographie Iconographie Pays France Cinéma Région Île-de-France Musique Département Paris Sport Commune Paris Galerie Coordonnées 48° 51′ 49″ N, Notes géographiques 2° 18′ 49″ E Références Fonction Bibliographie Franchit La Seine Voir aussi Caractéristiques techniques Articles connexes Liens externes Type Pont en arc Longueur 152 m Largeur 30 m Situation et accès Matériau(x) Acier Ce site est desservi par la station de métro Invalides. En outre, il est Construction desservi par la gare des Invalides de la ligne C du RER. Construction 1897-1900 Le pont Alexandre-III est situé à Paris, il traverse la Seine entre le 7e et le Inauguration 1900 8e arrondissement. Architecte(s) Cassien-Bernard, Cousin, Il se trouve entre le pont de la Concorde et le pont des Invalides. Résal, Alby Il relie l'esplanade des Invalides et l'avenue Winston-Churchill, où se Historique trouvent le Petit Palais et le Grand Palais. Protection Classé MH (1975)1 Origine du nom Géolocalisation sur la carte : France Ce pont porte le nom du tsar de Russie Alexandre III (1845-1894). Historique Le projet Inauguré pour l'Exposition universelle 2 de Paris en 1900 , le pont était destiné à symboliser l'amitié franco-russe, instaurée par la signature de l'alliance conclue en 1891 entre l’empereur Alexandre III (1845-1894) et le Pose de la première président de la République française pierre du pont Sadi Carnot. -

Alexandre Laporte (1850-1904)
Université de Toulouse II – Le Mirail UFR Histoire, Arts et Archéologie Département Histoire de l’art et Archéologie Alexandre Laporte (1850-1904) Sculpteur toulousain par Florence Dumas Mémoire présenté pour l’obtention du master II Histoire de l’art et Patrimoine sous la direction de Messieurs Jean Nayrolles et Louis Peyrusse. Juin 2013 AVANT-PROPOS Nous avons vu lors du mémoire de master I, l’importance de Laporte dans le paysage artistique de Toulouse entre 1880 et 1900. Grâce aux documents familiaux fournis par Isabelle Laporte de Colonges, l’artiste est devenu presque vivant avec son portrait sur la première de couverture de ce mémoire, mais aussi avec les souvenirs familiaux et œuvres conservées au sein de la famille de l’architecte, son ami. Dans ce deuxième mémoire, j’ai choisi de ne pas remontrer toutes les illustrations déjà présentes dans le premier opus mais seulement les plus emblématiques de son œuvre tout en cherchant le plus possible à comparer Laporte à ses contemporains. Ce que j’ai fait via les illustrations à la fin de ce document. En 2010, nous avions découvert avec Anne Jourdain, le buste de Ponsin-Andarahy par Laporte dans les réserves de l’Ecole des beaux-arts de Toulouse. Je cherchais à aller plus loin, car la façade est, du Capitole m’intriguait avec un fronton et huit allégories en moins. Laporte y aurait réalisé « La Guerre et l’Industrie ». Je décidais de contacter l’atelier de restauration de la ville de Toulouse qui avait certainement une partie des réponses à mes questionnements. En effet, dans les réserves de la ville, se trouvaient endormis les blocs des allégories recherchées. -

3 Heures Avec Le Père-Lachaise
flourensGrasources Pierre Besson 9, rue STENDHAL, paris 20è 2 Pour mon Héloïse à moi Pour Jules 3 « Où est la très sage Héloïse Pour qui fut chastré et puis moine Pierre Esbaillart à Sainct-Denys. » (François Villon) « Les bourgeois se souciaient peu d'être enterrés à Vaugirard ; cela sentait le pauvre. Le Père-Lachaise, à la bonne heure ! Être enterré au Père-Lachaise, c'est comme avoir des meubles en acajou. L'élégance se reconnaît là. » (Victor Hugo, Les misérables) « Un mort, c’est bien, c’est complet. C’est terminé. […] On n’est pas complet quand on n’est pas mort. » (Boris Vian, L’herbe rouge) « J'ai mis ma tenue la plus sombre Et mon masque d'enterrement Pour conduire au royaum' des ombres Un paquet de vieux ossements La terr' n'a jamais produit, certes De canaille plus consommée Cependant, nous pleurons sa perte Elle est morte, elle est embaumée Il est toujours joli, le temps passé Un' fois qu'ils ont cassé leur pipe On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés Les morts sont tous des braves types. » (Georges Brassens, Le temps passé) 4 Dossier « Pe re-Lachaise » ou « Le tout nouveau conducteur au cimetie re du Pe re-Lachaise » V-2019-10 Table des matie res 1. Avant-propos ............................................................................................................................ 7 2. La place Gambetta .................................................................................................................... 9 3. Les origines du Père-Lachaise ................................................................................................ -
Commissariat Général. Exposition Universelle De 1900 À Paris
Commissariat général. Exposition universelle de 1900 à Paris. Documents iconographiques. Inventaire méthodique des éléments iconographiques de la sous-série F/12. Établi par Magalie Bonnet, sous la direction de Clémence Lescuyer, conservateur du patrimoine. Première édition électronique Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2017 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054343 Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Ce document est écrit en français. Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales. 2 Mentions de révision : • novembre 2020: IR révisé : ajouts d'images numérisées (photographies) et réorganisation du plan de classement (répertoire numérique > répertoire méthodique) 3 Archives nationales (France) INTRODUCTION Niveau de description pièce Intitulé Exposition universelle de 1900 à Paris. Documents iconographiques. Date(s) extrême(s) 1892-1901 Importance matérielle et support 44 articles Localisation physique Pierrefitte-sur-Seine Conditions d'accès Librement communicable sous réserve du règlement de la salle de lecture. Les documents iconographiques relatifs au pont Alexandre III ont fait l'objet d'une numérisation en 2017 et sont directement accessibles depuis la salle des inventaires virtuelle. Il en est de même pour les photographies, numérisées en 2019. Conditions d'utilisation Reproduction selon le règlement en vigueur aux Archives nationales. DESCRIPTION Présentation du contenu Le 13 juillet 1892, le président Carnot décrète qu'"une exposition universelle des oeuvres d'art et des produits industriels ou agricoles s'ouvrirait à Paris le 5 mai 1900 et serait close le 31 octobre suivant". -

Simboluri Astăzi Necesare
PATRIMONIU 299 MONUMENTE ÎNLĂTURATE, SIMBOLURI ASTĂZI NECESARE Virgiliu Z. Teodorescu Monumentele, prin faptul că sunt destinate a perpetua memoria marilor momente ale unei naţiuni arăt periodic scara lor morală. Ele indică cel mai înalt punct la care un avânt naţional a ridicat o generaţiune şi invită, prin aceasta însuşi, generaţiunile următoare a face sforţările necesare pentru a se menţine sau a se pune la un asemenea nivel. Constantin Esarcu 1 Conjunctura profundelor prefaceri pe multiple planuri ale societăţii româneşti în ultimele decenii ale secolului al XIX-iea şi primele din veacul următor a generat, printre multe altele, şi necesitatea aducerii în forul public a unor reprezentative monumente pentru cinstirea celor care au „Bine meritat de la Patrie !", formulă consacrată2 la timpul respectiv pentru a aprecia faptele meritorii ale celor care, prin gând şi fapte, au contribuit la realizarea treptelor parcurse spre edificarea statului naţional independent, unitar al românilor. Drumul n-a fost uşor, fiind un domeniu cvasi inexistent anterior, însă cei care s-au format la şcolile apusului au sesizat profundul impact produs de asemenea prezenţe în forul public întru afirmarea conştiinţei civice. Printre aceştia s-a situat 3 ca o distinctă personalitate Eugeniu Carada , el însuşi în clipele de răgaz acordate cugetării găsind în modelajul în lut posibilităţi de recreare benefică. Prezenţă cu contribuţii deosebite la respectivele prefaceri ale societăţii româneşti s-a implicat în contactarea unor artişti plastici care s-au soldat cu o benefică finalitate, integrând în forul public valoroase şi semnificative monumente. În această comunicare ne limităm 4 la a evoca relaţia durabilă cu sculptorul francez Ernest Henri Dubois , considerând că cele realizate la timpul respectiv au avut menirea de a răspunde unor necesităţi generate de aprecierea colectivă.