Histoire De La Psychanalyse Au Canada
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

NEW TITLES in BIOETHICS Annual Cumulation Volume 20, 1994
NATIONAL REFERENCE CENTER FOR BIOETHICS LITERATURE THE JOSEPH AND ROSE KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS GEORGETOWN UNIVERSITY, WASHINGTON, DC 20057 NEW TITLES IN BIOETHICS Annual Cumulation Volume 20, 1994 (Includes Syllabus Exchange Catalog) Lucinda Fitch Huttlinger, Editor Gregory P. Cammett, Managing Editor ISSN 0361-6347 A NOTE TO OUR READERS . Funding for the purchase of the materials cited in NEW TITLES IN BIOETHICS was severely reduced in September 1994. We are grateful for your donations, as well as your recom mendations to your publishers to forward review copies to the Editor. In addition to being listed here, all English-language titles accepted for the collection will be considered for inclusion in the BIOETHICSLINE database, produced at the Kennedy Institute of Ethics under contract with the National Library of Medicine. Your efforts to support this publication and the dissemination of bioethics information in general are sincerely appreciated. NEW TITLES IN BIOETHICS is published four times Inquiries regarding NEW TITLES IN BIOETHICS per year (quarterly) by the National Reference Center should be addressed to: for Bioethics Literature, Kennedy Institute of Ethics. Gregory Cammett, Managing Editor Annual Cumulations are published in the following year (regarding subscriptions and claims) as separate publications. NEW TITLES IN BIOETHICS is a listing by subject of recent additions OR to the National Reference Center's collection. (The subject classification scheme is reproduced in full with Lucinda Fitch Huttlinger, Editor each issue; it can also be found at the end of the (regarding review copies, gifts, and exchanges) cumulated edition.) With the exception of syllabi listed NEW TITLES IN BIOETHICS as part of our Syllabus Exchange program, and docu National Reference Center for Bioethics ments in the section New Publications from the Ken Literature nedy Institute of Ethics, materials listed herein are not Kennedy Institute of Ethics available from the National Reference Center. -

CURRICULUM VITAE, Research
PATRICK BRIAN SMITH 2300 Sherbrooke East, Apt. 3, Montreal, Quebec, H2K1E5 +1(514) 431-5252 [email protected] https://www.concordia.ca/finearts/cinema/faculty.html?fpid=patrick-smith TEACHING & RESEARCH INTERESTS Documentary Film Theory Contemporary Political Cinema New Media Visual Cultures Spatial Theory Global Media Industries Film and Media Histories Media and Human Rights EDUCATION 2020 Ph.D. Concordia University, Film and Moving Image Studies Supervised by Dr. Luca Caminati Title: Capital, Carcerality, Borders: Documentary’s Spatial Turn 2012 M.A. King’s College London, Film Studies Supervised by Dr. Jinhee Choi. 2011 B.A. Anglia Ruskin University Cambridge, Film Studies, magna cum laude Supervised by Dr. Tina Kendall. AWARDS, GRANTS & FELLOWSHIPS 2020 GSA Conference Funding Award, $100. Graduate Students’ Association, Concordia University. 2019 Fine Arts Travel Award, $350. Faculty of Fine Arts, Concordia University. Concordia Accelerator Award, $5000. School of Graduate Studies, Concordia University. 2018 Doctoral Research Award, totalling $28,000. Quebec Fund for Research, Society and Culture (Fonds de recherche du Québec, Société et culture- FRQSC), Quebec Government (2018-2019). DeSeve Foundation Scholarship, $1000. Mel Hoppenheim School of Cinema, Concordia University. Graduate Student Mobility Award, $2000. School of Graduate Studies, Concordia University. 2016 Conference and Exposition Awards, totaling $11,891.25. School of Graduate Studies, Concordia University (2016-2019). Concordia Stand-Out Graduate Research Award, $1000. School of Graduate Studies, Concordia University. Fine Arts Travel Award, $500. Faculty of Fine Arts, Concordia University. 2014 Frederick Lowy Scholars Fellowship, $15,000, renewable for three years. School of Graduate Studies, Concordia University (2014-2017). International Tuition Fee Remission Award, $12,599.25, renewable for three years. -
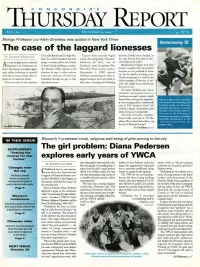
The Case of the Laggard Lionesses
0 N C 0 R D I A,S SDAY ~PORT VOL. 20 . OCTOBER I9, I995 • N ° 6 Biology Professor Luc-Alain Giraldeau was quoted in New York Times The case of the laggard lionesses Concordia Behavioural Ecology Pro Experts have recently begun territory. (Males aren't studied, in BY JACQUIE CHARLTON fessor Luc-Alain Giraldeau has been noting the intriguingly "altruistic" this case, because they have no terri s every biologist knows, altruistic trying to answer, and so far at least, behaviour of lions, one of. torial rights in the pride.) A behaviour is an evolutionary cul he hasn't found anything to contra Giraldeau's areas of expertise. The Behavioural ecologists have been de-sac. But how can we explain appar dict Darwin. What appears to be New York T imes science section trying to explain why the parasitic lionesses are not punished or driven ently selfless behaviour in animals? altruism, he says, is often only an (September 5, 1995) quoted out by the harder-working ones. And why do human beings often act elaborate structure of behaviour Giraldeau commenting on work on They're wondering if it could be the purely out of concern for others? established through the ages to help laggard lionesses, those who shirk on elusive example of altruism in ani These are some of the questions individuals survive. their share of hunting and defending mals that might turn evolutionary theory on its ear. Not quite, Giraldeau says. Lions' behaviour corresponds more to a "producer-scrounger" scenario, which dictates that as long as an opportuni ty for scrounging exists, someone will take it. -

Concordia University Rector's Report 2000-01
Le présent fichier est une publication en ligne reçue en dépôt légal, convertie en format PDF et archivée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. L’information contenue dans le fichier peut donc être périmée et certains liens externes peuvent être inactifs. Version visionnée sur le site Internet d’origine le 9 octobre 2008. Section du dépôt légal What best characterizes the University’s work during the past academic year is the concept of building on a sound foundation. We have ambitious plans for Concordia University and these depend for their success on the extent to which we prepare the ground and the infrastructure that will permit them to rise to unprecedented heights. No doubt the construction analogy was stimulated by the official groundbreaking for our new Loyola Science Complex at the end of the 2000–2001 academic year. By the time the Concordia University community and our friends read this, the foundations for the Science Complex will have been completed and the first of our new buildings will indeed have risen above the ground. And this will be followed by the erection of new buildings on the Sir George Williams Campus for the Faculties of Engineering and Computer Science, Fine Arts and the John Molson School of Business and the relocation of humanities and social science departments into renovated space in the Hall and McConnell Buildings. We expect all these buildings to have solid foundations. However, I intend the ‘foundation’ analogy to mean much more. Although the badly needed new facilities being built and planned are indeed important, even more important are the activities that will take place within them. -
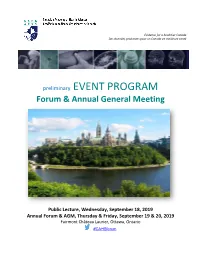
Preliminary EVENT PROGRAM Forum & Annual General Meeting
Evidence for a healthier Canada Des données probantes pour un Canada en meilleure santé preliminary EVENT PROGRAM Forum & Annual General Meeting Public Lecture, Wednesday, September 18, 2019 Annual Forum & AGM, Thursday & Friday, September 19 & 20, 2019 Fairmont Château Laurier, Ottawa, Ontario #CAHSforum TIMEFRAMES & LOCATIONS Wednesday, September 18, 2019 16:00-18:00 RECEPTION PUBLIC LECTURE Location: DRAWING ROOM Thursday, September 19, 2019 07:00-07:55 REGISTRATION & BREAKFAST Location: DRAWING ROOM FOYER 08:00-10:30 MAJOR FORUM Location: DRAWING ROOM 10:30-11:00 BREAK 11:00-12:00 MAJOR FORUM Location: DRAWING ROOM 12:00-13:15 LUNCHEON Location: LAURIER BALLROOM 2019 Recipient BARTHA KNOPPERS, PHD, ADE, OC, OQ, FRSC, FCAHS 13:30-17:00 MAJOR FORUM Location: DRAWING ROOM 18:00-19:00 RECEPTION Location: LAURIER BALLROOM FOYER Business attire 19:00-22:00 DINNER & EVENING PROGRAM Location: LAURIER BALLROOM Business attire DISTINGUISHED FELLOW FELLOW INDUCTION CEREMONY Friday, September 20, 2019 07:00-07:55 NEW FELLOW ORIENTATION Location: Renaissance Room, Mezzanine Breakfast served in meeting room 07:00-07:55 BREAKFAST LOCATION: DRAWING ROOM FOYER 08:00-10:00 AWARD LECTURES 10:00-10:30 BREAK 10:30-12:30 ANNUAL GENERAL MEETING 12:30 CLOSE OF SESSION MISSION, VISION, VALUES MISSION To inform policy and practice by mobilizing the best scientific minds to provide independent and timely evidence-based assessments of critical health challenges affecting Canadians VISION Informed actionable solutions that improve the health of Canadians VALUES CAHS is: Collaborative; Unbiased; Transparent; Expert; Strategic Independent OUR PROMISE The CAHS pledges to serve Canadians by volunteering the time and expertise of our Fellows in conducting independent, unbiased, expert assessments on health- related topics of major importance to Canada. -

Premier Announces $97-Million Grant to Concordia Integrated Complex Reflects Quebec's Excellence in Engineering and the Visual Arts: Bernard Landry
c ·oncorctia~s Vol. 26, No. 14 April 11, 2002 pr.concordia.ca/ctr Premier announces $97-million grant to Concordia Integrated complex reflects Quebec's excellence in engineering and the visual arts: Bernard Landry BY B ARB ARA B LAC K Both men spoke warmly and at some conference that the shovels could Western Europe. He knew from a 6,000 students currently enrolled. length, and were given a standing hit the ground in a matter of weeks. recent private visit with the Rector The new integrated complex, for e Quebec government has ovation. Premier Landry made a wide-rang that Concordia "is not really an Eng which Concordia is raising $68 mil T.given $97 million to Concordia The grant comprises $57 million ing speech in which he said that the lish-language university" - it serves lion of the projected $165 million for the construction of a downtown from the Ministry of Education, $25 building represents "the two pillars of anglophones, allophone and fran needed, will enable the university to building to house the Faculty of million that the university has already Quebec's distinctive character," cophones alike, and has what is accept 500 more students, and will Engineering and Computer Science been promised for getting out of namely, higher technology and excel probably the most diverse student reduce the number of buildings in and the visual arts component of the rented space, and $15 million .from lence in the arts. He said the large body in Canada. which engineering and computer sci Faculty of Fine Arts. the Ministry of Research, Science and grant is in line with the government's The English-speaking community, ence classes are given from 13 to only Premier Bernard Landry and Edu Technology for research infrastruc belief in stimulating economic he concluded, is "a precious jewel" two. -

Conferences, Friendly Competition at Engineering Week
Concorctia~s I Voll~ 2611) No~ J.2 March J.4" 2002 pr.conc:ordi.a .. cca./'ct.r Conferences, friendly competition at Engineering Week ational Engineering Week was was co-sponsored by Microsoft Cana Timothy C. Lethbridge, of the Uni accessibility, and is working with year. Displays by the Society of Auto celebrated over two weeks at da. It coincides with the graduation versity of Ottawa, addressed software Alzheimer's patients in his research. motive Engineers and other student Concordia, as the Engineering and this term from Concordia of Que engineering as an emerging branch of The annual Women in Engineering groups filled the atrium of the library Computer Science Students Associa bec's first software engineers. engineering. W. Morven Gentleman, and Computer Science Conference complex and the mezzanine. On tion (ECA) and its member associa There were four speakers from from Dalhousie University, talked organized for young women from March 9 , students celebrated the tions staged a variety of events, ind us try. Among the academic about the need for software engineer Montreal-area high schools was as best of academic and student life ranging from fierce but friendly speakers were Concordia's Peter Gro ing to be multidisciplinary. lively as ever, and this year students with their football tournament, fol sports contests to a conference with gono, who discussed the demands Jacob Slonim, also from Dalhousie, organized a separate tour for Grade 4 lowed by the annual awards ban the theme Design for Change. , put on teachers by the rapid evolu addressed issues that relate to the students. -

Osler Library Newsletter
OSLER LIBRARY NEWSLETTER McGILL UNIVERSITY, MONTREAL, CANADA No.52 - June 1986 THE SIR WILLIAM OSLER HOSPITAL OF The author of the leading article in this issue, Carl Spadoni, McMASTER UNIVERSITY, HAMILTON is a very welcome newcomer to the Osler LibraryNewsletter. He is the Archivist of the Health Sciences Library at McMas- A name proposed but not used ter University in Hamilton, Ontario. URING THE SUMMER of 1969 the following two questions: (1) Do you feel the name when construction of what is now McMaster University should be used in the official designa- the McMaster University Medi- tion of the hospital, i.e. McMaster University Hospital?; cal Centre was well underway, (2) The name The Sir William Osler Hospital of McMaster Dr. J .R. Evans, Vice-Presidentof University, Hamilton has been suggested. Do you feel this the Division of Health Sciences, is an appropriate designation? wrote enthusiastically to the Pres- The results of the questionnaire were not quite what Dr. ident of McMaster University, Evans expected. Many people misinterpreted the first ques- Dr. H.G. Thode, proposing that the Health Sciences Centre tion and answered as if the actual designation, McMaster be called the Sir William Osler Hospital of McMaster Uni- University Hospital, was up for consideration in the compet- versity, Hamilton. Dr. Evans outlined various reasons for ition with the proposed Osler name. Many respondents felt such a name. Osler had lived and gone to school in Dundas, that the Osler name was original, appropriately sentimental, close by Hamilton, from age seven to fourteen. (Dr. Evans and appealing - a befitting tribute to a local son who had did not mention that Osler had been expelled from the school made good. -

MAY 24, 2001 Http:/ /Pr.Concordia.Ca/Ctr
's ort VOL. 25, N° 17 MAY 24, 2001 http:/ /pr.concordia.ca/ctr / Lydia Sharman wins teaching award Excavation for the new science complex begins next Dr. Lowy's achievements recognized pagel page& pagel Construction begins on Concordia's science complex BY BARBARA BLACK site from West Broadway to Sher cated in the refitted Drummond ments, the Centre for Functional departments located at Loyola will brooke St. Building. Genomics and the Centre for keep them abreast of developments. onstruction is starting on the The existing parking lot near the Excavation is expected to take Research in Molecular Modelling, as If you have queries about the pro Csite of the new science complex Bryan Building will be temporarily place June through July, and by mid well as a major part of the Psycholo ject, please contact Eugenia Xenos, on Concordia's Loyola Campus. Very relocated behind the TJ Building, the August, workers should be pouring gy Department. University Web site coordinator, at soon, an eight-foot construction performance arts annex at 7315 Ter concrete foundations for the new A newsletter is being planned to [email protected] or 848- fence is going up around the site, rebonne St. building. The excavation company, keep area residents informed about 4279. Ann M. Bennett, Assistant to enclosing the Bryan Building and the By the first week of June, the occu L.A. Hebert, plans to work through the construction project. Webcams the Executive Director of the Rector's adjacent parking lot. pants of the Bryan Building (the the traditional mid-summer construc will follow its progress from the top Cabinet, will have special responsi The fence will help keep the dust Communication Studies and Journal tion holiday. -

Academics Against Israel and the Jews
ACADEMICS AGAINST ISRAEL AND THE JEWS AAca_02.indbca_02.indb 1 003/11/20073/11/2007 114:47:114:47:11 Books by the Same Author Revaluing Italy, with Lorenzo Necci (Italian), 1992 Environment and Confusion: An Introduction to a Messy Subject, 1993 Israel’s New Future: Interviews, 1994 The State as a Business: Do-It-Yourself Political Forecasting (Italian), 1994 Judaism, Environmentalism and the Environment, 1998 The Environment in the Jewish Tradition: A Sustainable World (Hebrew), 2002 Europe’s Crumbling Myths: The Post-Holocaust Origins of Today’s Anti-Semitism, 2003 American Jewry’s Challenge: Conversations Confronting the 21st Century, 2004 Israel and Europe: An Expanding Abyss? 2005 European-Israeli Relations: Between Confusion and Change? 2006 Books Edited The New Clothes of European Anti-Semitism, with Shmuel Trigano (French), 2004 Monograph The Autumn 2005 Riots in France: Their Possible Impact on Israel and the Jews, 2006 AAca_02.indbca_02.indb 2 003/11/20073/11/2007 114:47:154:47:15 ACADEMICS AGAINST ISRAEL AND THE JEWS Edited by Manfred Gerstenfeld Jerusalem Center for Public Affairs AAca_02.indbca_02.indb 3 003/11/20073/11/2007 114:47:154:47:15 Copyright © 2007 by Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA) and Manfred Gerstenfeld All rights reserved No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or recording, or by any information storage and retrieval system—except for brief quotations in critical articles or reviews—without written permission from the JCPA, 13 Tel Hai Street, Jerusalem, 92107, Israel. Tel: +972 2 561 9281, Fax: + 972 2 561 9112. -

C:Mcgillibmautnewslet02jan
MAUT – APBM Newsletter www.mcgill.ca/maut/ McGILL ASSOCIATION OF UNIVERSITY TEACHERS Vol 28 No 2 January janvier 2002 ASSOCIATION DES PROFESSEUR(E)S ET BIBLIOTHECAIRES DE McGILL In This Issue Editor’s Remarks Editor’s remarks..................................... 1 MAUT Fall General Meeting November 28, 2001 — Fall General Meeting– President’s Report ................................... 3 Review Report of Vice-President (Internal) ........ 5 RALPH HARRIS, MAUT VP COMMUNICATIONS Report of Vice-President (External) ........ 7 MAUT Council adopted a new format for the Fall General Meeting held in the McGill Report of the Vice-President Faculty Club whereby a buffet lunch was served at 11:30 and the meeting started pretty much (Communications) ................................ 9 on time at 12:00 noon to a packed house of about 120 people sitting in rows. Despite the Membership Committee Report ............. 10 challenge of balancing a plate of food, while trying to hold a cup of coffee and eat and still shake hands with friends, this format seemed superior to the previous one of having people sit CAUT Mortgage Rates ........................... 10 at tables during the meeting. Appointments to the Ranks of Professor and Council also fine-tuned the agenda trying to increase the prominence of matters that Associate Professor Emeritus, Librarian would be of interest to existing, younger staff in keeping with our recruitment efforts. Roger and Associate Librarian Emeritus ....... 11 Prichard, President of MAUT, chaired the meeting, and brought the whole thing to a satisfac- Proposed Changes to Administrative tory close a few minutes after 2:00 pm. Handbook (Grey Book) ........................ 13 Some of the key issues raised in reports are briefly described below. -

More Money Needed to Support Students: C Ote
0 N C 0 R D I A,S SDAY _____ PORT VOL. 2I SEPTEMBER 26, I996 N " 2 More money needed to support students: c ote of almost $5,000 per year. ships (awarded after first year). BY PHILIP FINE Unfortunately, Concordia has not McGill, more healthy in that catego hirty million dollars will need to been shoring up much of that differ- . ry as well, ranked first; it can offer a Tbe raised by Concordia to catch ence. This past academic year, fully whopping 28 times more than up to the student assistance provided 97.7 per cent of Concordia's student Concordia to its students. by other universities, the Director of financial aid came from provincial The low ranking can be blamed Financial Aid and Awards told and federal sources. partly on the fact that the University Concordia's Board of Governors. The University ranked low in stu is only 26 years old, and that it "We need to secure additional dent assistance when compared to doesn't teach medicine or law, which resources for student support," Roger other institutions of its size. In terms produce high-earning alumni. Cote said at the Board's Sept. 11 of entrance scholarships, Concordia Finishing touches are being made meeting. A $30-million endowment ranked fifteenth out of a total of 19 to the table of needs for Concordia's universities surveyed (17 in Ontario Capital Campaign, and Rector lr would translate into an extra $1.5 ::, million after investment, and interest and two in Qyebec). The other Qye Frederick Lowy has promised that it ~ bec university, McGill, ranked fourth will give high priority to putting ~ on the capital would be given to z struggling students.