Camille, Camille, Camille
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fitzgerald in the Late 1910S: War and Women Richard M
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Duquesne University: Digital Commons Duquesne University Duquesne Scholarship Collection Electronic Theses and Dissertations 2009 Fitzgerald in the Late 1910s: War and Women Richard M. Clark Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/etd Recommended Citation Clark, R. (2009). Fitzgerald in the Late 1910s: War and Women (Doctoral dissertation, Duquesne University). Retrieved from https://dsc.duq.edu/etd/416 This Immediate Access is brought to you for free and open access by Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of Duquesne Scholarship Collection. For more information, please contact [email protected]. FITZGERALD IN THE LATE 1910s: WAR AND WOMEN A Dissertation Submitted to the McAnulty College and Graduate School Duquesne University In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy By Richard M. Clark August 2009 Copyright by Richard M. Clark 2009 FITZGERALD IN THE LATE 1910s: WAR AND WOMEN By Richard M. Clark Approved July 21, 2009 ________________________________ ________________________________ Linda Kinnahan, Ph.D. Greg Barnhisel, Ph.D. Professor of English Assistant Professor of English (Dissertation Director) (2nd Reader) ________________________________ ________________________________ Frederick Newberry, Ph.D. Magali Cornier Michael, Ph.D. Professor of English Professor of English (1st Reader) (Chair, Department of English) ________________________________ Christopher M. Duncan, Ph.D. Dean, McAnulty College and Graduate School of Liberal Arts iii ABSTRACT FITZGERALD IN THE LATE 1910s: WAR AND WOMEN By Richard M. Clark August 2009 Dissertation supervised by Professor Linda Kinnahan This dissertation analyzes historical and cultural factors that influenced F. -

Compte Rendu Du Conseil De Quartier Du Plateau
Conseil de quartier PLATEAU Réunion du 14 septembre 2015 COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU Lundi 14 septembre 2015 Collège César Franck Présents : Mme Karine BADONNEL, M. Patrick CABON, Mme Noëlle CANTAUT, M. Laurent CARO, Mme Maryvonne CLÉMENT-KLEIN, M. Bernard DANY, Mme Françoise DE SAINTE MARIE, Mme Catherine DESCHATRETTE, Mme Sophie DURAND, M. Hamed FADILI, M. François FROMONT, M. Michel GAILLARDIN, Mme Jeanne GUEGUEN, M. Renaud HOFFMANN, Mme Martine JAYOT, Mme Evelyne LAURY-PINEDA, M. José KLEIN, Mme LEDOUARIN, Mme Monique LERMYTE, M. Michel LERMYTE, M. René LORDON, M. Laurent MARINARO, Mme Martine ONILLON, Mme Edith PAJOT, Mme Pascale PAQUOT, M. Gérald PÉCASTAINGS, M. Guy PERRAGUIN, M. Hugues RANDRIATSOA, Mme Fatima TABABI, M. Kacem TABABI, Mme Marie-Odile TIEFENBACH, M. Mickaël VIDEAU, M. Jean-Marc WEULERSSE Excusés : M. Claude BERTRAND, Mme Nicole DEMOUGIN, M. Patrice HOUDEBINE, Mme Martine MORIN, M. Fabrice MORIN Secrétaire de séance : M. Sébastien MASSON, service Démocratie Locale et Vie de Quartier (DLVQ) Présidente de séance : Mme Catherine DESCHATRETTE Élus : • M. Guillaume CARISTAN, adjoint au maire, délégué à la démocratie locale, à la vie des quartiers et aux nouvelles technologies et adjoint chargé du quartier Le Plateau, • Léonardo SFERRAZZA, adjoint au maire chargé de l’espace public, voirie et cimetière. Représentants des services de la mairie : • M. Marc CARPENTIER, M. Sébastien MASSON (DLVQ), • M. Sébastien PERNOT (Police Municipale) Compte rendu validé par le Conseil de quartier Page 1 sur 9 Conseil de quartier PLATEAU Réunion du 14 septembre 2015 L’ordre du jour est le suivant : • Ouverture de la réunion par M. Guillaume CARISTAN, adjoint chargé du quartier Plateau • Désignation / élection du président de séance • Validation du compte-rendu de la séance du 11 mai 2015 • Présentation par M. -

Auction: Sunday, February 21, 2016 Lot# 1: STEUBEN THREADED
6/25/2018 A.N. Abell Auction Company Auction: Sunday, February 21, 2016 Lot# 1: STEUBEN THREADED GLASS FAN VASE with blue threading on a pale orange ground and inscribed Steuben on base 8 inches wide; 9 inches high Estimate: 400/600 Lot# 2: STEUBEN AURENE GLASS TRUMPET VASE calcite and Aurene glass, with golden iridescent color 6 1/4 inches diameter; 5 3/4 inches high Estimate: 400/600 Lot# 3: PAIR OF STEUBEN AURENE GLASS FLUTED VASES both with golden iridescent color and signed Steuben Aurene below 5 1/2 inches high; 5 inches diameter Estimate: 400/600 Lot# 4: STEUBEN AURENE BLUE COMPOTE signed and numbered 2642 below 8 inches high Estimate: 800/1,200 http://abell.com/catalogs/feb2016sundaysalecatalogue.html 1/112 6/25/2018 A.N. Abell Auction Company Lot# 5: AFTER ANTOINE-LOUIS BARYE: "PANTHERE DE TUNIS" patinated bronze on a marble base Provenance: the Estate of Sam Simon, benefiting the Sam Simon Charitable Giving Foundation The Sam Simon Charitable Giving Foundation has two main emphases of giving: Animals & Poverty Alleviation and Disaster Relief. The Foundation supports organizations that work to protect animals, prevent animal cruelty and raise awareness of issues of maltreatment of animals as well as organizations that work towards the eradication of poverty, poor health and malnutrition. In addition, The Sam Simon Charitable Giving Foundation will provide ongoing support to Mr. Simon's two private operating foundations: The Sam Simon Charitable Foundation http://www.samsimonfoundation.com/ http://ssfmobileclinic.org/ The Sam Simon -

“Open Veins of Latin America” by Eduardo Galeano
OPEN VEINS OF LATIN AMERICA 1 also by EDUARDO GALEANO Days and Nights of Love and War Memory of Fire: Volume I, Genesis Volume II, Faces and Masks Volume III, Century of the Wind The Book of Embraces 2 Eduardo Galeano OPEN VEINS of LATIN AMERICA FIVE CENTURIES OF THE PILLAGE 0F A CONTINENT Translated by Cedric Belfrage 25TH ANNIVERSARY EDITION FOREWARD by Isabel Allende LATIN AMERICA BUREAU London 3 Copyright © 1973,1997 by Monthly Review Press All Rights Reserved Originally published as Las venas abiertas de America Latina by Siglo XXI Editores, Mexico, copyright © 1971 by Siglo XXI Editores Library of Congress Cataloging-in-Publishing Data Galeano, Eduardo H., 1940- [Venas abiertas de America Latina, English] Open veins of Latin America : five centuries or the pillage of a continent / Eduardo Galeano ; translated by Cedric Belfrage. — 25th anniversary ed. / foreword by Isabel Allende. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-85345-991-6 (pbk.:alk.paper).— ISBN 0-85345-990-8 (cloth) 1. Latin America— Economic conditions. 1. Title. HC125.G25313 1997 330.98— dc21 97-44750 CIP Monthly Review Press 122 West 27th Street New York, NY 10001 Manufactured in the United States of America 4 “We have maintained a silence closely resembling stupidity”. --From the Revolutionary Proclamation of the Junta Tuitiva, La Paz, July 16, 1809 5 Contents FOREWORD BY ISABEL ALLENDE ..........................................................IX FROM IN DEFENSE OF THE WORD ........................................................XIV ACKNOWLEDGEMENT… … ..........................................................................X INTRODUCTION: 120 MILLION CHILDRENIN THE EYE OF THE HURRICANE .....................................................… ...........1 PART I: MANKIND'S POVERTY AS A CONSEQUENCE OF THE WEALTH OF THE LAND 1. -
Religious Change and Plateau Indians: 1500 -1850
W&M ScholarWorks Dissertations, Theses, and Masters Projects Theses, Dissertations, & Master Projects 2000 Religious change and Plateau Indians: 1500 -1850 Larry Cebula College of William & Mary - Arts & Sciences Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/etd Part of the History of Religion Commons, Religious Thought, Theology and Philosophy of Religion Commons, and the United States History Commons Recommended Citation Cebula, Larry, "Religious change and Plateau Indians: 1500 -1850" (2000). Dissertations, Theses, and Masters Projects. Paper 1539623971. https://dx.doi.org/doi:10.21220/s2-tjsq-7h32 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, & Master Projects at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Dissertations, Theses, and Masters Projects by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy subm itted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. -

Camille Claudel 1915
MARS 13 Mensuel OJD : 159650 55 RUE TRAVERSIERE 75012 PARIS - 01 44 67 30 00 Surface approx. (cm²) : 1203 Page 1/4 TADRART Eléments de recherche : CAMILLE CLAUDEL 1915 : film de Bruno Dumon, toutes citations 1229855300502/GFP/MFG/2 MARS 13 Mensuel OJD : 159650 55 RUE TRAVERSIERE 75012 PARIS - 01 44 67 30 00 Surface approx. (cm²) : 1203 Page 2/4 INTERVIEW PERDRE LE NORD Juliette Binoche dans le rôle cle Camille Claudel Un nom, une date. Lorsque BRUNO et à la rudesse d'acteurs non profes- DUMONT s'attaque au genre balisé sionnels (La Vie de Jésus, L'Huma- du biopic, cela ressemble à ce qu'a nité, Hors Satan), a choisi Juliette réussi à faire Maurice Pialat avec Binoche pour incarner, dans un son Van Gogh. Le réalisateur filme jeu dépouillé, une artiste en pleine un temps resserré, celui qui voit chute. Il a demande à des patientes Camille Claudel, internée dans un d'un centre hospitalier de la région asile de Provence, attendre avec d'apparaître aux côtés de l'actrice. A fièvre la visite de son frère, l'écri- la fois témoignage quasi-documen- vain Paul Claudel. En 1915, Camille taire sur le quotidien de l'interne- Claudel ne sait pas qu'elle va pas- ment, mise en scène implacable de ser le reste de sa vie enfermée et la paranoïa et récit d'un destin en qu'elle ne sculptera plus jamais. train de se figer, Camille Claudel, Bruno Dumont, habitué aux pay- 1915 offre des visages changeants. sages désolés du Nord de la France Entretien avec un maître du portrait. -

Dossier Pédagogique
Sommaire ______________________ Rodin, biographie 2 à 5 ______________________ Les jardins de l’hôtel Biron 6 à 7 ______________________ De l’hôtel Biron au musée Rodin 8 ______________________ Meudon : la villa des Brillants et le musée 9 ______________________ Les techniques de la sculpture 1O à 14 Le modelage 1O Le moulage 11 La fonte à la cire perdue 12 à 13 La taille du marbre 14 ______________________ La modernité de Rodin 15 à 17 La fragmentation 15 L’assemblage 16 L’agrandissement 17 ______________________ Lexique 18 à 19 ____________________ Bibliographie 2O Le service culturel du musée Rodin bénéficie du soutien de la fondation Annenberg. Kasebier Gertrud, Rodin devant La Porte de l’enfer, 19O6, Ph. 249 © musée Rodin 2 Rodin, biographie ______________________ 184O _____________________ 35 ans 1875 Naissance le 12 novembre d’Auguste Rodin à Paris dans une famille parisienne modeste. Voyage d’étude en Italie où il s’enthousiasme pour l’œuvre de Michel-Ange. Les allusions et emprunts à son art sont perceptibles dans son œuvre aussi bien dans les attitudes des corps sculptés que dans ______________________ 14 ans 1854 le travail du marbre, jouant du contraste entre les surfaces polies et celles à peine dégrossies. Élève médiocre mais très tôt passionné par le dessin, il entre à l’école spéciale de dessin et de mathématiques, dite « la Petite École » (future école des Arts décoratifs) où l’on forme les artistes ______________________ 37 ans 1877 et artisans qui conçoivent et réalisent les nombreux éléments d’ornementation embellissant les Rentré à Bruxelles, Rodin modèle sa première œuvre majeure, l’Âge d’airain (salle 3) qu’il expose à places et les immeubles. -

Annual Report 2018
2018 ANNUAL REPORT ART & EDUCATION W. Russell G. Byers Jr. BOARD OF TRUSTEES COMMITTEE Buffy Cafritz (as of September 30, 2018) Frederick W. Beinecke Calvin Cafritz Chairman Leo A. Daly III Earl A. Powell III Gregory W. Fazakerley Mitchell P. Rales Juliet C. Folger Sharon P. Rockefeller Marina Kellen French David M. Rubenstein Norma Lee Funger Andrew M. Saul Whitney Ganz Sarah M. Gewirz FINANCE COMMITTEE Lenore Greenberg Mitchell P. Rales Andrew S. Gundlach Chairman Jane M. Hamilton Steven T. Mnuchin Secretary of the Treasury Richard C. Hedreen Teresa Heinz Frederick W. Beinecke Sharon P. Rockefeller Frederick W. Beinecke Sharon P. Rockefeller Helen Lee Henderson Chairman President David M. Rubenstein Betsy K. Karel Andrew M. Saul Kasper Linda H. Kaufman Kyle J. Krause AUDIT COMMITTEE David W. Laughlin Andrew M. Saul Chairman Reid V. MacDonald Frederick W. Beinecke Nancy Marks Mitchell P. Rales Jacqueline B. Mars Sharon P. Rockefeller Constance J. Milstein David M. Rubenstein Scott Nathan Mitchell P. Rales David M. Rubenstein John G. Pappajohn Sally Engelhard Pingree TRUSTEES EMERITI William A. Prezant Julian Ganz, Jr. Diana C. Prince Alexander M. Laughlin Hilary Geary Ross David O. Maxwell Roger W. Sant Victoria P. Sant † Thomas A. Saunders III John Wilmerding Fern M. Schad Leonard L. Silverstein † EXECUTIVE OFFICERS Albert H. Small Frederick W. Beinecke Michelle Smith President Andrew M. Saul John G. Roberts Jr. Benjamin F. Stapleton III Chief Justice of the Earl A. Powell III United States Director Stephen G. Stein Franklin Kelly Luther M. Stovall Deputy Director and Alexa Davidson Suskin Chief Curator Diana Walker Darrell R. -

Literacy Coaching Continuum in an Era of K-12 Core Standards
Literacy Coaching Continuum in an era of K-12 core standards Enrique A. Puig College of Education and Human Performance University of Central Florida The kiss, Rodin Session objective: The thinker, Rodin Developing A Common Language • Text • Zone of Proximal Development • Zone of Ventral Development • Zone of Distal Development • Pedagogy • Andragogy • Hebegogy Original hunger, Rodin English Language Arts & Literacy in History/Social Studies, Science, and Technical Subjects College & Career Readiness Anchor Standards Key ideas & details 1. Read closely 2. Determine central themes 3. Analyze interaction of elements Craft & structure 4. Interpret meanings and tone 5. Analyze structure 6. Assess point of view Integration of knowledge & ideas 7. Integrate and evaluate content 8. Evaluate argument 9. Analyze intertextuality Range & complexity 10. Comprehend increasing complexity The thinker, Rodin English Language Arts & Literacy in History/Social Studies, Science, and Technical Subjects College & Career Readiness Anchor Standards for Writing Text Types and Purposes 1. Write arguments 2. Write informative/explanatory texts 3. Write narratives Production and Distribution of Writing 4. Produce clear and coherent writing 5. Develop and strengthen writing 6. Use technology Research to Build and Present Knowledge 7. Conduct research projects based on focused questions 8. Gather relevant information from multiple sources 9. Draw evidence from literary or informational texts Range of Writing 10. Write routinely for a range of purposes, and audiences Lovers’ hands, Rodin Standards for Mathematical Practice 1. Make sense of problems and persevere in solving them. 2. Reason abstractly and quantitatively. 3. Construct viable arguments and critique the reasoning of others. 4. Model with mathematics. 5. Use appropriate tools strategically. -

Jacques Doillon Vincent Lindon Izïa Higelin Séverine Caneele
LES FILMS DU LENDEMAIN ET ARTÉMIS PRODUCTIONS PRESENTENT V INCENT L INDON I ZïA H IGELIN S ÉVERINE C ANEELE RODIN UN FILM DE J ACQUES D OILLON PHOTO © SHANNA BESSON / LES FILMS DU LENDEMAIN. IMAGE CHRISTOPHE BEAUCARNE AFC,SBC SON ERWAN KERZANET MIXAGE THOMAS GAUDER COSTUMES PASCALINE CHAVANNE DÉCORS KATIA WYSZKOP ASSISTANT MISE EN SCÈNE NICOLAS GUILLEMINOT DIRECTION DE PRODUCTION AUDE CATHELIN MONTAGE FRÉDERIC FICHEFET MUSIQUE ORIGINALE PHILIPPE SARDE AVEC LE SOUTIEN DE LA SACEM PRODUIT PAR KRISTINA LARSEN COPRODUIT PAR PATRICK QUINET PRODUCTEUR ASSOCIÉ CHARLES S. COHEN UNE COPRODUCTION FRANCO-BELGE LES FILMS DU LENDEMAIN ARTÉMIS PRODUCTIONS EN COPRODUCTION AVEC WILD BUNCH FRANCE 3 CINÉMA RTBF (TÉLÉVISION BELGE) VOO & Be tv SHELTER PROD AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET DE LA PROCIREP EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE RODIN AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+ DE CINÉ+ DE FRANCE TÉLÉVISIONS DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE AVEC LE SOUTIEN DE TAXSHELTER.BE DE ING DU TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE BELGIQUE EN ASSOCIATION AVEC PALATINE ÉTOILE 14 ET SOFITVCINE 4 VENTES INTERNATIONALES WILD BUNCH DISTRIBUTION WILD BUNCH Rodin I 1 Un film produit par Les Films du Lendemain et Artémis Productions, en coproduction avec Wild Bunch et France 3 Cinéma Un film de Jacques Doillon Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele SORTIE LE 24 MAI 2017 France / Durée : 119’ / Image : 2.39 / Son : 5.1 DISTRIBUTION RELATIONS PRESSE Wild Bunch Distribution Marie-Christine Damiens 65 rue de Dunkerque - 75009 Paris 13 rue Yves -
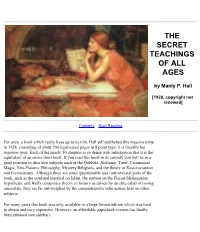
Secret Teachings of All Ages Index
THE SECRET TEACHINGS OF ALL AGES by Manly P. Hall [1928, copyright not renewed] Contents Start Reading For once, a book which really lives up to its title. Hall self-published this massive tome in 1928, consisting of about 200 legal-sized pages in 8 point type; it is literally his magnum opus. Each of the nearly 50 chapters is so dense with information that it is the equivalent of an entire short book. If you read this book in its entirety you will be in a good position to dive into subjects such as the Qabbala, Alchemy, Tarot, Ceremonial Magic, Neo-Platonic Philosophy, Mystery Religions, and the theory of Rosicrucianism and Freemasonry. Although there are some questionable and controversial parts of the book, such as the outdated material on Islam, the portion on the Bacon-Shakespeare hypothesis, and Hall's conspiracy theory of history as driven by an elite cabal of roving immortals, they are far out-weighed by the comprehensive information here on other subjects. For many years this book was only available in a large format edition which was hard to obtain and very expensive. However, an affordable paperback version has finally been released (see sidebar). PRODUCTION NOTES: I worked on this huge project episodically from 2001 to June 2004. This because of the poor OCR quality, which was due to the miniscule type and large blocks of italics; this necessitated retyping many parts of the text manually. To give an idea of how massive this project was, the proof file for this is 2 megabytes, about 8 times the size of a normal 200 page book. -

Miami Vice Edited by Jacob O'rourke, David Dennis, Mike
WHAQ (Washington High Academic Questionfest) III: Miami Vice Edited by Jacob O’Rourke, David Dennis, Mike Etzkorn, Bradley McLain, Ashwin Ramaswami and Chandler West Written by current and former members of the teams at Washington and Miami Valley; Aleija Rodriguez; Ganon Evans, and Max Shatan Packet 8 Tossups 1. The speaker of this poem dismisses a remark as “stock and store / caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster / followed fast” and asks a visitor to tell him “what thy lordly name is on the Night’s Plutonian shore.” That same visitor in this poem is implored “is there balm in (*) Gilead [“gill-ee-ad”]?” while he perches on a “bust of Pallas.” This poem’s speaker laments the loss of his beloved Lenore, and this poem begins “once upon a midnight dreary.” For 10 points, name this poem about a bird that caws “nevermore,” written by Edgar Allan Poe. ANSWER: The Raven <American Lit> <Mike Etzkorn> 2. This ruler’s “leatheren” cannon was so light, it could be drawn and served by two men. This monarch nearly drowned in the Battle of Vittsjö [“vitts-yoh”], and he acquired the province of Kexholm in the Treaty of Stolbovo after winning the Ingrian War. This man regained control of Livonia from Poland in the Truce of Altmark. This monarch relied heavily on his chancellor, Axel (*) Oxenstierna. This monarch commanded the army that defeated Count Tilly at the Battle of Breitenfeld before he was killed during a cavalry charge at the Battle of Lützen [“loot-zen”]. For 10 points, name this “Lion of the North,” a king of Sweden during the Thirty Years’ War.