Attentat a La Dignite Du Parlement-Viol Dans L'enceinte De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

History of Quebec. Cleophas Edouard Leclerc
834 HISTORY OF QUEBEC. as President of the Quebec Association of Architects, which post he now fills with much acceptability. To !?how he has a comprehensive knowledge of the principles and details of building construction and architecture, it is sufficient to enumerate the following magnificent buildings he has de- signed in Montreal, which stand for the beautification of the city, namely, the Board of Trade Building, Montreal Amateur Athletic Association, Olivet Baptist Church, the new Medical Building of McGill University, and the Children's Memorial Hospital, now in course of construction. Mr. Brown has also constructed several large manufacturing and com- mercial establishments, among which may be mentioned the following plants: The Standard Shirt Company, Southam Building on Alexander Street, Jenkins Bros., Limited, and the Canadian Spool Cotton Company at Maisonneuve, the latter being the Canadian business of the firm of J. & P. Coates, of Paisley, Scotland. Mr. Brown is a member of the Architectural League of New York and a member of the Montreal Board of Trade. Both his public and private life have been characterized by the utmost fidelity of duty, and he stands as a high type of honorable citizenship and straight- forward manhood, enjoying the confidence and winning the respect of all with whom he has been brought in contact in business life. In 1900 Mr. Brown married Harriet Fairbairn Eobb, second daughter of William Robb, City Treasurer, Montreal. He is a member of the Canada Club, the Manitou Club, the Beaconsfield Golf Club, and the Royal St. Lawrence Yacht Club. CLEOPHAS EDOUARD LECLERC. Cleophas Edouard Leclerc, Notary and Justice of the Peace, Montreal, has the distinction of being a direct descendant of Abraham Martin, the of Scottish pilot and historical character after whom the Plains Abraham at Quebec were named. -

Proquest Dissertations
001 4M UNIVERSITE DOTTAWA ÉCOLE DES 3RADUÉS LE PROCESSUS D'EXTINCTION DU REGLEMENT 17 EN ONTARIO par: François Beaulne Thèse présentée au Département de Sciences Politiques de l'Université d'Ottawa en vue de l'obtention du diplôme de M. A. en Science Politique «t**»* UBRAJHtS ^^ Ottawa, Canada, 1970 UNIVERSITY OF OTTAWA SCHOOL OF GRADUATE STUDIES UMINumber:EC55154 INFORMATION TO USERS The quality of this reproduction is dépendent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleed-through, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send a complète manuscript and there are missing pages, thèse will be noted. AIso, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. UMI® UMIMicroformEC55154 Copyright 2011 by ProQuest LLC Ail rights reserved. This microform édition is protected against unauthorized copying under Title 17. United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 AnnArbor, Ml 48106-1346 UNIVERSITÉ D OTTAWA ÉCOLE DES 3RADUES RECONNAISSANCE Cette thèse a été préparée sous la direction de James Hurley, professeur au Département de Science Politique de l'Université d'Ottawa. Les conseils de M. Louis Charbonneau ainsi que l'accès aux archives de l'Association Canadienne Française d'Ontario grâce à l'amabilité de M. Roger Charbonneau ont facilité la poursuite des recherches. UNIVERSITE OF OTTAVSA - SCHOOL OF GRADUATE STuDIEs UNIVERSITÉ D OTTAWA - ÉCOLE D ES GR A D U ES CURRICULUM STUDIORUM François Beaulne est né a Ottawa le 2 8 novembre 1946. -
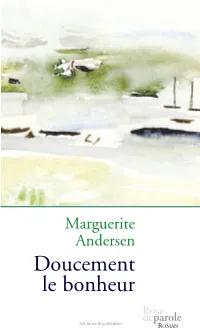
Doucement Le Bonheur
« Elle se sent petite dans cette salle presque vide, devant ce magistrat dans sa robe noire au collet blanc amidonné, assis derrière une sorte de pupitre surélevé. Elle se sent petite et empotée, tant lui pèse cette histoire que, depuis le 16 février, elle a été obligée de ra- conter tant de fois déjà. À sa tante, puis à son père, aux policiers le jour de la plainte, au médecin légiste quelques jours plus tard… Andersen Marguerite Tous ces hommes qui veulent savoir tous ces détails sordides, qui l’interrogent sans se rendre compte qu’elle n’en peut plus de leurs questions pénétrantes comme le sexe d’un homme. » En 1929, Louis Mathias Auger, un jeune Marguerite député fédéral de 27 ans, est accusé d'avoir Andersen commis un viol dans l'enceinte du Parlement. le bonheur Sa victime, Laurence Martel, porte plainte. Doucement Dans Doucement le bonheur, Marguerite Andersen reprend les épisodes marquants de Marguerite le bonheur cette histoire vraie, puis invente pour ces deux personnes une reprise de la vie après le drame. Andersen Doucement parole Prise de Prise Doucement deparole le bonheur ROMAN C.P. 550, Sudbury (Ontario) CANADA P3E 4R2 Prise 705-675-6491 http://pdp.recf.ca Extrait de la publication deparole ROMAN Extrait de la publication PdP_intSeTaire_101027.indd 6 27/10/10 11:59:07 DOUCEMENT LE BONHEUR MEP Doucement le bonheur.indb 1 10/09/06 21:24:58 De la même auteure FICTION Parallèles, roman, Sudbury, Prise de parole, 2004, finaliste prix du Gouverneur général et prix Trillium. Bleu sur blanc, récit poétique, Sudbury, Prise de parole, 2000, finaliste prix du Consulat général de France à Toronto et prix Trillium. -

Dernière Séance De La Saison De L'association Technologique
— ABOMPEMENTS td Publié par Le SYNDIOAT D'OEU- VRES BOCIALES LIMITER. Quotidien FES Bureaux: Angle des rues Gsor- - Canads + + + » « o ar 5.00 ges ot Dalbousie, Ottawa, Ont. Ottawa, par poste € < ax 8.00 TELEPHONES: Services du jour: Etats-Unis . » . do; a» 7.00 Rideau 514 —Sarvice de nuit. Union Postale ¢« << a Administration: Rideau 514 Hebdomadaire”. | Nouvellistes: Rideau 515 —As- Canada . «2 se 0 es OB gogjation d'Education: Rideau Etats-Unis ei Union Postale -~ \ ‘L’AVENIR EST A CEUX QUI LUTTENT"® — Deux sous le numéro 1lème Année No 138 - OTTAWA, SAMEDI, LE 16 JUIN, 1923 ! J DIX CANDIDATS FARAY-LE-MONIAL INCERTITUDE : CANADIENS FRANGAI MENACE PAR LE FEU ——— PARIS, 16. —Un commen- cement d'incendié a failli dé- SUR LE MARCHÉ | | truire la magnifique basili- FONT LA LUTTE DANS HUIT CONTES que de Paray-le-Monia] au cours de la nuit. L’alarme | a été immédiatement donnée DE LONDRES | et les flammes ont été rapi- Le Dr Hurtubise dans Sudbury fait une campagne très | dement éteintes. Aucun ob- ; jet de valeur n’a été perdu. active et sera élu contre M. Chas. McCrea, conser- 1 Cette basilique a été cons- truite en 1004 et a été par- Les valeurs industrielles vateur — Dans le Nouvel-Ontario nous faisons la tiellement reconstruite au sont sans vigueur — Les lutte dans Sudbury, Cochrane et Chutes à l’Estur- 12e siècle. ms emprunts étrangers se geon — Dans l’Est nous avons des candidats à Ot- placent facilement. Obli- tawa, Russell et Prescott et dans le Sud dans Essex- gations de la L. R. Steel. -

COMPLETE Day
ALEXANDRIA, ONTARIO, FRIDAY NOVEMBER 8, 1907 JNO 41 A beautiful monument of Scotch DOAIINIONVILLE granite has been erected in the Max- THE ville cemetery here to the memory COUNTY AND DiSTRiCT ot the late Mr. Duncan McLeod. Mrs. J. D. McIntosh and Miss Mar- PARTICULAR Our local teachers during the short ion returned home on Monday alt^ O UR FALL STOCKS NOW Thanksgiving holiday were the guests LANCASTER daughter of J. D. Wightman, of this spending the Thanksgiving holidays HOUSE W I FE place. She had been in Montreal for of relatives, Mr. McIntosh visiting with friends in Ottawa. about two months where she was tak Morrisburg, the Misses Cameron and Mrs. Robertson, ol Montreal, spent en ill with typhoid fever. She arriv- Grant their respective homes. the week end the guest of Mrs. James demands the best to be found Miss Kate McArthur paid South ed home about two weeks ago and her Miss Hattie Currier, of Dominion- Clark. Lancaster friends a visit on Wednes- on the market. condition became worse until Wednes- ville. on Monday of this week lelt for Mrs. B. Mansell entertained a num- COMPLETE day. day morning when she passed peace- Portage La Prairie, where she pur- ber of friends on Friday evening. All Rev. C. B. Ross and family, of 1^- We have the good things fully away. Deceased was a bright poses taking a course in stenography. report a very pleasant evening. chine, spent the week end at ‘‘Gair- young lady and exceedingly popular Mrs. McDonald left on Monday of J. J. Anderson was In Alexandria that will help her to make the ney,”' South Lancaster. -

Poissons ! L. P. Beàulne
fef i». Mi JOURNAL HEBDOMADAIRE, LIBERAL. HAWKESBURY, ONT., VENDREDI LE 17 FEVRIER 1911. ABONNEMENT $1.00 PAR ANNEE: TNEL DE PRESCOTT Bnrnal Hebdomadaire, Libéral, Notre Pont. Avis a nos Lecteurs. Tribune Libre m i le vendredi de chaque semaine par Afin de jeter du discrédit sur Au directeur du Sentinel. W, Propriétaire. BRUNO BOUVRETTE, Directeur Nous adressons notre premier nu notre député au fédéral, un certain I Nos hôteliers attendent avec an à Hawkesbnry, Ont., me Principale Est. méro daus toutes les paroisses des xiété la date du 28 courant pour, groupe de personnages plutôt mal comtés de Prescott, Kussel, Vau- POISSONS ! Téléphone No. 2. savoir si alors la decision de la j informés que mal Intentionnés, ont dreuil, et espérons recevoir l'appui Pmcnt—An Canada fl 00 par anné». Et .rs-Unis et Union,Postale S1.S0. cour d'appel a rendu jugement en lancé ce canard, que si le pont in- de tous les amis de la cause libé rale. leurs faveurs. On se rappelle que terproviucial n'était pas déjà en Mr. le juge Constantineau, lors du HAWKESBURY, ONT, LE 17 FEVRIER mu. Nous serions heureux de recevoir construction, il fallait en imputer] décompte des bulletins ajourna la POISSONS FRAIS—12c la lb. Pur miel trèffle—10c la lb. toute correspondance sur des sujets la cause à M. Edmond Proulx, qui cour à cette date. Huitres de choix. d'actualité, pourvu qu'elle soit Serons-nous Bien Accueillis ? après avoir obtenu les $50 000 pro signée d'un nom responsable. Il semble que les effets de cette fameuse loi de la "Local Option" . -
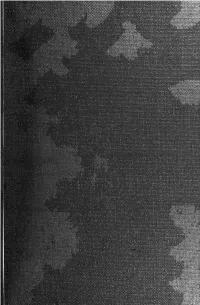
Journals of the Legislative Assmbly of the Province of Ontario, 1927, Being the First Session Of
JOURNALS OF THE Legislative Assembly OF THE PROVINCE OF ONTARIO FROM THE 2ND FEBRUARY TO 5ra APRIL, 1927, BOTH DAYS INCLUSIVE IN THE SEVENTEENTH YEAR OF THE REIGN OF OUR SOVEREIGN LORD KING GEORGE V BEING THE First Session of the Seventeenth Legislature of Ontario SESSION 1927 PRINTED BY ORDER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY VOL. LXI PROVINCE OF ONTARIO TORONTO Printed and Published by the Printer to the King's Most Excellent Majesty 1927 INDEX TO THE SIXTY-FIRST VOLUME 17 GEORGE V, 1927 CCOUNTS, PUBLIC: See Public Accounts. ADDRESS : See Lieutenant-Governor. ADJOURNMENT FOR PROROGATION, 211. ADMINISTRATION BUILDING: See East Block. ADOPTION OF CHILDREN, ACT RESPECTING: See Children. ADVISORY BOARD: Highway See under Highway Advisory Board. AGRICULTURE AND COLONIZATION : Committee on, authorized, 10; appointed, 27. Report 178. AGRICULTURE, DEPARTMENT OF: Report for 1926, 182. (Sessional Paper No. 21.) Statistical Report, 1926, 183. (Sessional Paper No. 22.) AGRICULTURE INQUIRY COMMITTEE : 1. Question (No. 26), as to total cost to Province, 51. 2. Question (No. 24), as to any action by Government towards closer co- operation with other provinces for Imperial Marketing, 50. 3. Question (No. 28), as to any action by Government towards establishing a co-operative council, 51. AGRICULTURAL WINTER FAIR, THE ROYAL: See Winter Fair. ALLEGIANCE, MEMBERS OATH OF, 2. ALMONTE, TOWN OF: Petition for an Act respecting, 11. Reported, 66. Bill (No. 26) introduced and referred to Ontario Railway and Municipal Board, 72. Reported and referred to Private Bills Committee, 95. Reported, 124. Second reading, 127. House in Committee, 135. Third reading, 139. Royal Assent, 5l6. (17 Geo. -

Central Railway of Canada
Local Railway Items from Area Papers - Central of Canada Railway 12/09/1902 Eastern Ontario Review Central of Canada Plantagenet Plantagenet The engineers who are surveying a route from Hawkesbury village to South Indian crossed the South Nation River several miles south of this cillage and hugged the low banks of this stream in South Plantagenet for several miles. This will do away with grades but is likely to be submerged for sometime in the spring of the year whenthe South Nation flood is on. 25/12/1903 Eastern Ontario Review Central of Canada An Electric Railway A company with a capital of $500,000 contemplates the building of an electric railway from Montreal to Ottawa. The line will run through the fertile and picturesque counties of Jacques Cartier, Laval, Two Mountains and Argenteuil. Leaving Montreal, the cars will run in the direction of La Bord a Plouffe, then towards Saint Dorothee, St. Joseph, and St. Placide. The line will follow the shore of the Ottawa river on most of the route. Between Carillon and Grenville the line conects with the Shefford Railway, and the crossing of the Ottawa river at Grenville will be effected by means of a bridge already built. The line will then be continued through the Counties of Prescott and Russell. 20/07/1906 Eastern Ontario Review Central of Canada Surveys are in progress for a fourth line of railway between Ottawa and Montreal. The Central Ontario road, which was chartered last session, is making the trial surveys. The company has a charter for a line from Lake Huron to Montreal and the idea is to operate the road by electricity.