Architectes Et Photographes Au Xixe Siècle
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
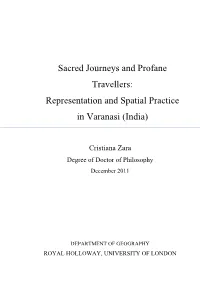
Representation and Spatial Practice in Varanasi (India)
Sacred Journeys and Profane Travellers: Representation and Spatial Practice in Varanasi (India) Cristiana Zara Degree of Doctor of Philosophy December 2011 DEPARTMENT OF GEOGRAPHY ROYAL HOLLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON Declaration of Authorship I Cristiana Zara hereby declare that this thesis and the work presented in it is entirely my own. Where I have consulted the work of others, this is always clearly stated. 2 ABSTRACT This thesis is concerned with tourist representations and practices in India. Orientalist aesthetics have often associated this country with notions of spirituality and mysticism; tourist narratives sustain and reinforce such representations by describing India as a land of ancient rituals and timeless traditions. The visual construction of India’s ‘spiritual landscapes’ has been largely deployed as a powerful tool for subduing the unfamiliar Other within reassuring epistemological categories. However, tourism research has recently become interested in exploring the role of tourist practices in landscape production. Not only do tourists ‘gaze upon’ landscapes, they also script landscapes through practices and performances. By focusing on the case of Varanasi, the Indian pilgrimage city on the banks of the Ganges, this thesis shows how tourist practices (re)produce and make sense of the city’s ‘sacredscape’. Special attention is paid to the riverfront, which epitomizes the cultural and spiritual significance ascribed to the city. Both Hindu and tourist narratives depict the riverfront as embodying a special power, a unique meaning, whether this uniqueness is held to be a ‘spiritual’ or a ‘picturesque’ one. The thesis analyses the city’s riverfront as the place where tourist, ritual, and day-to-day activities are played out and negotiated, and where the aesthetics of landscape is confronted with the materialities and the practices inherent to this place. -

Vente Du Vendredi 13 Juin 2014
NUS Vente du Vendredi 13 juin 2014 284 284. Alexis GOÜIN (New-York 1799/1800-Paris 1855) Augustine. Vers 1852-1854. Daguerréotype stéréoscopique colorié. Mention sur le côté gauche « A. GOÜIN, 37 R. LOUIS LE GRAND ». 8,5 x 17,2 cm. Chaque vue : 6,5 x 5,6 cm. Provenance : Ancienne collection Serge Nazarieff. Alexis Goüin est un des pionniers du daguerréotype et du stéréoscope. Son expérience de peintre marque ses photographies par la subtilité de ses rehauts de couleurs. Littérature : « Early Erotic Photography », Taschen, 1993. Voir notice 102 page 107 au sujet du modèle Augustine. 4 000 / 5 000 € 285. Alexis GOÜIN (New-York 1799/1800-Paris 1855) 285 La robe bleue et or : modèle en tenue d’apparat. Vers 1851. Daguerréotype stéréoscopique colorié. Mention d’un nom illisible au dos. 8,5 x 17 cm. Chaque vue : 6,5 x 5,6 cm. La pose aristocratique, la richesse des réhauts à l’or et la finesse des détails sont caractéristiques de l’œuvre d’Alexis Goüin. 2 000 / 3 000 € 286. Alexis GOÜIN (New-York 1799/1800-Paris 1855) La robe bleue et or : modèle en tenue d’apparat, vue de dos. Vers 1851. Daguerréotype stéréoscopique colorié. 8,5 x 17 cm. Chaque vue : 6,5 x 5,6 cm. La pose aristocratique, la richesse des réhauts à l’or et la finesse des détails sont caractéristiques de l’œuvre d’Alexis Goüin. 2 000 / 3 000 € 286 ENGHIEN 89 NUS 287. Alexis GOÜIN (New-York 1799/1800-Paris 1855) Le décolleté : femme penchée en avant dans une belle robe bleue. -

17, Rue De Beaune - Paris
GÉRARD LÉVY 17, rue de Beaune - Paris PREMIÈRES ET DERNIÈRES COLLECTIONS Ventes les 1& 2 Juin 2021 PREMIÈRES ET DERNIÈRES COLLECTIONS Mardi 1 Juin 2021 & Mercredi 2 juin 2021 Paris — e Salle VV • 3 rue Rossini – Paris IX — Mardi 1er juin — Éventails – Asie 14h Mercredi 2 juin — Photographie 11h : Livres spécialisés 14h : Photographies — Expositions Vendredi 28 mai de 11h à 18h Samedi 29 mai de 11h à 18h Lundi 31 mai de 11h à 18h — Intégralité des lots sur www.millon.com Département Experts Sommaire Aurélie van SAENE ÉVENTAILS VENTE DU MARDI 1ER JUIN VENTE DU MARDI 1ER JUIN [email protected] — Georgina LETOURMY-BORDIER Expert SFEP-CEDEA Partie 1 : Eventails Partie 1 : Eventails ASIE Expert près de la Cour d’Appel de Versailles — +33 ()6 14 67 60 35 e e Anna KERVIEL XX Europe du XVII au XX [email protected] TaHsi CHANG ASIE XX Livres et documentations spécialisées [email protected] — Jean GAUCHET XX Extreme Orient PHOTOGRAPHIE — PHOTOGRAPHIE Joséphine BOYER — Partie 2 : Asie Partie 2 : Asie +33 (0)1 87 03 04 70 Christophe GOERY [email protected] + 33 (0)6 16 02 64 91 XX Asie [email protected] XX Livres et documentations spécialisés Département Collections & Personnalités VENTE DU MERCREDI 2 JUIN VENTE DU MERCREDI 2 JUIN COMMISSAIRE-PRISEUR — Mayeul de la HAMAYDE Photographies Photographies T : +33 (0)6 63 92 04 19 [email protected] XX Partie 1 : Livres spécialisés page CONTACT POUR TOUT RENSEIGNEMENTS, XX Partie 2 : Photographies pages — ORDRES D’ACHATS, Pauline RIBEYRE RAPPORTS [email protected] — Aurélie van SAENE [email protected] Présentation du Département Millon Collection et personnalités Commissaire-Priseur Mayeul de la HAMAYDE T : +33 (0)6 63 92 04 19 [email protected] Toute l’équipe MILLION-RIBEYRE remercie affectueusement patricia, alex et daniel Pour tous les élans du cœur et de savoir partagés 2 - 1 L’Amour gouverne le monde, fin XVIIe-début du XVIIIe siècle - Feuille d’éventail mise au rectangle, peinte à la gouache et vernie. -

Collection Pierre Marc Richard
PARIS - DROUOT - RICHELIEU - 25 MARS 2015 COLLECTION PIERRE MARC RICHARD BEAUSSANT LEFÈVRE ierre MarcRichard Collection P BEAUSSANT LEFÈVRE BEAUSSANT P ARI Photographies desXIX Photographies S - PERTINENCES RÉTINIENNES PERTINENCES DRO Commissaires-Priseurs U OT -M ER C REDI e etXX 25M e siècles AR S 2015 PERTINENCES RÉTINIENNES Photographies des XIXe et XXe siècles Collection Pierre Marc Richard VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES MERCREDI 25 MARS 2015 à 14 h Par le ministère de : Mes Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE Commissaires-Priseurs Assistés de Michel IMBAULT BEAUSSANT LEFÈVRE Société de ventes volontaires Siren n° 443 080 338 - Agrément n° 2002-108 32, rue Drouot - 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40 www.beaussant-lefevre.com / [email protected] Philippe JACQUIER Expert Lumière des Roses - 12/14 rue J.-J. Rousseau - 93100 Montreuil Tél. : 01 48 70 02 02 E-mail : [email protected] PARIS - DROUOT RICHELIEU - Salle no 2 9, rue Drouot, 75009 Paris, Tél. : 01 48 00 20 00 - Fax : 01 48 00 20 33 EXPOSITIONS PRIVÉES : Chez l’expert : du lundi 2 mars au vendredi 13 mars 2015 sur rendez-vous À l’étude : du lundi 16 mars au vendredi 20 mars 2015 EXPOSITIONS PUBLIQUES À L’HÔTEL DROUOT : Mardi 24 mars 2015 de 11 h à 18 h Mercredi 25 mars 2015 de 11 h à 12 h Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 02 En couverture, reproduction du lot n° 33 « [Si toutes les images m’intéressaient], je serais devenu fou depuis longtemps [...] Ce qui m’intéresse, ce n’est pas ce qui est le plus beau, [mais] la puissance - la dynamis des Grecs - dans les images : images “extrêmes ”, si vous voulez. -

La Photographie Avec Les Arts. Histoire D'une Collection
Anne-Marie GARCIA LA PHOTOGRAPHIE Beaux-Arts de Paris éditions AVEC LES ARTS Photographies de : Samuel Adam-Salomon, Albert, Fratelli Alinari, Jean Andrieu, Vasco Ascolini, Eugène Atget, Édouard Baldus, Jean-François Bauret, Antonio Beato, E. Bernard, Paul Berthier, Frères Bisson, Frédéric Boissonnas, Félix Bonfils, Adriano de Bonis, Adolphe Braun, Giacomo Brogi, Giacomo Caneva, Charles Carey, Ferdinand Carlier, Bruno Cattani, Alphonse Chalot, Désiré Charnay, Marcel Chrétien, Émile Colliau, Pierre Collin, Eugène Constant, Adolphe Dallemagne, Simon David, Édouard Delessert, Delmaet & Durandelle, Louis Jean Delton, Cesare Di Liborio, Eugène Adolphe Disdéri, Dornac, Maxime Du Camp, Duchenne de Boulogne, Tancrède-R. Dumas, Jean Dumeteau, E. Durand, Constant Alexandre Famin, Albert Fernique, Comte Frédéric Flachéron, Alphonse Fortier, Franck, Furne & Tournier, Gilles Gerbaud, Charles Gillot, Maison Giraudon, Ken Gonzales-Day, Hermann Heid, Louis Igout, André Kertész, Keystone View Company, Bogdan Konopka, Joseph Kühn, Pierre Lampué, Jean Laurent, Daniel Lebée, Edmond Lecadre, Gustave Le Gray, Georges ou Gabriel Lékégian, Alphonse Liébert, Albert Londe, Gaudenzio Marconi, Étienne Jules Marey, Charles Marville, Léopold Mercier, Charles Louis Michelez, Séraphin Médéric Mieusement, Félix Moulin, Eadweard Muybridge, Paul Nadar, Carlo Naya, Charles Nègre, Frères Neurdein, Aimé Noiret, Louis Pamard, Pierre Petit, Eugène Piot, Édouard Pourchet, Pompeo Pozzi, Provence, Michel Quétin, Achille Quinet, Arthur Radiguet, Charles Reutlinger, Paul Richer, -

In the Service of the Sacred Developmentfor Conservation by Kozhikode B/Oy Ramachandran Bachelor in Architecture B.M.S
In the Service of the Sacred Developmentfor Conservation by KoZhikode B/oy Ramachandran Bachelor in Architecture B.M.S. College of Engineering Bangalore, India February, 1995 Submitted to the Department ofArchitecture in partialfufillmentof the requirementsforthe degree of Master of Science in Architecture Studies at the Massachusetts Institute of Technology June, 1998 @ KorZhikode B/oy Ramachandran 1998. All rights reserved. The author hereby grants to M.IT. permission to reproduce and distributepublicly paper and electronic copies of this thesis document in whole or in part. Signature of the Author KoiZhikode B/oy 3ofachandran Department Architecture June, 1998 Certified by - Julian Beinart v \j Professor ofArchitecture Thesis Co-Advisor Certified by Attilio Petruccioli Visiting Associate Professor Aga Khan Professor of Designfor Islamic Culture Thesis Co-Advisor Accepted by\ Roy Strickland Associate Professor ofArchitecture Chairman, Department Committee on GraduateStudents In the Senice of Ihe Saced 1 L!BiM -E - 3 StanfordAnderson Professor ofHistory andArchitecture Head of Department Reader In the Senice of/the Sacred Suni Mummy & Pappa & Prem In the Senice of/the Sacred Contents Acknowledgements 5 Abstract 6 Introduction 9 Part One A ColonialEnterprise From the Portuguese(1509) to The Port Trust (1873) 11 Part Two Banganga: Religious Core Existing Conditions & Challenges 25 Part Three PreservingA Legay The HeritageAdvisory Committee & Drawing Precinct Boundaries 31 Part Four Developmentfor Conservation Opportunities &Design interventions 36 PartFive Conclusions 44 Appendix Maps 46 Bibliography Illustration Credits In the Service of the Sacred A cknowledgements Thanks to Harshad Bhatia, for his wonderful Master's thesis project on Banganga, and his constant support all through, Prof. Julian Beinart, for making me think beyond good drawings and towards application, Prof. -

Etats Rapides
RECAP OP Description Repris Vendu 1 [DAGUERRÉOTYPE]. Femme au tambourin, sculpture dans un jardin. Années 1840. Dagu 1 400 2 [DAGUERRÉOTYPE]. Notre-Dame de Paris (vue inversée). Paris. Années 1840. Daguerr 8 500 3 [DAGUERRÉOTYPE]. Notre-Dame de Paris et ancienne passerelle de la Cité (vue inve 5 000 5 Charles MARVILLE [Charles François BOSSU dit] (1816-1879). Portail septentrional 700 6 Alphonse FORTIER (1825-1882). Abside de Notre-Dame , Le pavillon de l’horloge au 350 10 Hippolyte BAYARD [Attribué à] (1801-1887). Toits de Paris vers les moulins de Mo 5 000 11 Armand Hippolyte Louis FIZEAU (1819-1896). Vues des toits de Paris, prises depui 2 800 12 Alphonse FORTIER (1825-1882). Église Sainte-Geneviève , Église Saint-Étienne du 800 16 Gustave LE GRAY (1820-1884). L’obélisque place de la Concorde, vue vers les Tuil 1 200 20 Gustave LE GRAY (1820-1884). Saint-Germain-l’Auxerrois, portail. Paris. 1859. Ép 3 000 21 Gustave LE GRAY (1820-1884). Pavillon Richelieu , Pavillon Sully. Palais du Louv 4 000 22 Gustave LE GRAY (1820-1884). Carrousel du Louvre et palais des Tuileries. Paris. 1 000 25 Édouard-Denis BALDUS (1813-1889). Le Louvre, pavillon Richelieu. Paris. 1853. Ép 750 27 Louis Désiré BLANQUART-ÉVRARD (1802-1872). Abside de l’église de Notre-Dame , Ar 800 28 BAYARD & RENARD, COLLIN, MARVILLE, FORTIER. Pavillon de l’horloge au Louvre , Éc 750 29 Charles MARVILLE [Charles François BOSSU dit] (1813-1879) et Henri Le SECQ (1818 2 100 30 Louis Désiré BLANQUART-ÉVRARD (1802-1872) - Charles MARVILLE (1813-1879). Arc de 4 100 31 Louis Alphonse POITEVIN (1819-1882). -

Lettres & Manuscrits Autographes
LETTRES & MANUSCRITS AUTOGRAPHES DESSINS - AQUARELLES - PHOTOGRAPHIES JEUDI 8 JUILLET 2021 PHOTOGRAPHIES - DESSINS - AUTOGRAPHES INFORMATIONS ET SERVICES POUR CETTE VENTE SELARL AGUTTES & PERRINE commissaire-priseur judiciaire RESPONSABLE DE LA VENTE SOPHIE PERRINE [email protected] EXPERT POUR CETTE VENTE THIERRY BODIN Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art Tél.: +33 (0)1 45 48 25 31 [email protected] RENSEIGNEMENTS & RETRAIT DES ACHATS Uniquement sur rendez-vous MAUD VIGNON Tél.: +33 (0) 1 47 45 91 59 [email protected] Assistée de Henri Lafaye [email protected] FACTURATION ACHETEURS Tél. : +33 (0)1 41 92 06 41 [email protected] ORDRE D’ACHAT [email protected] RELATIONS PRESSE SÉBASTIEN FERNANDES Tél. : +33 (0)1 47 45 93 05 [email protected] 42 LETTRES & MANUSCRITS AUTOGRAPHES DESSINS - AQUARELLES - PHOTOGRAPHIES APRÈS LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ ARISTOPHIL JEUDI 8 JUILLET 2021, 14H30 NEUILLY-SUR-SEINE EXPOSITION PUBLIQUE NEUILLY-SUR-SEINE VENDREDI 2 JUILLET : 10H - 13H ET 14H - 17H DU LUNDI 5 AU MERCREDI 7 JUILLET : 10H - 13H ET 14H - 18H JEUDI 8 JUILLET : 10H - 12H CATALOGUE COMPLET ET RÉSULTATS VISIBLES SUR WWW.COLLECTIONS-ARISTOPHIL.COM ENCHÉRISSEZ EN LIVE SUR SELARL AGUTTES & PERRINE - COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE Neuilly-sur-Seine • Paris • Lyon • Aix-en-Provence • Bruxelles Suivez-nous | aguttes.com/newsletter | 1 LES COLLECTIONS ARISTOPHIL EN QUELQUES MOTS Importance C’est aujourd’hui la plus belle collection de manuscrits et autographes au monde compte tenu de la rareté et des origines illustres des œuvres qui la composent. Nombre Plus de 130 000 œuvres constituent le fonds Aristophil. L’ensemble de la collection a été trié, inventorié, authentifié, classé et conservé dans des conditions optimales, en ligne avec les normes de la BNF. -

Photographies Anciennes 216 244 253 286
FRANCE - CHARTRES - GALERIE DE CHARTRES SAMEDI 25 MAI 2019 CHARTRES PHOTOGRAPHIES ANCIENNES 216 244 253 286 303 322 329 337 374 381 En couverture : n° 366 FRANCE - CHARTRES - GALERIE DE CHARTRES LA VENTE A LIEU À LA GALERIE DE CHARTRES ivoire 7 rue Collin d’Harleville – 28000 Chartres CHARTRES SAMEDI 25 MAI 2019 À 10H30 ET À14H Photographies anciennes Ancienne collection Gilbert Gimon À 10h30 : n° 1 à 150 Objets ayant rapport avec la photographie. Rares documents. Livres anciens avec photographies. Documentation moderne. Lots de photographies diverses dont plaques de verre mono et stéréo et autochromes. À 14h : n° 201 à 500 DAGUERRÉOTYPES - AMBROTYPES - PROCÉDÉS CARTES DE VISITE ET VUES STÉRÉO EXCEPTIONNEL ENSEMBLE D’ALBUMS DE VOYAGE RÉGIONALISME FRANÇAIS ET DIVERS Expert : M. Arnaud Delas - Tél. 00 44 797 31 23 398 VENTE EN LIVE SUR Liste et photographies visibles sur www.ivoire-chartres.com – www.interencheres.com/28001 www.live.interencheres.com Adresse de nos bureaux : GALERIE DE CHARTRES – Sarl. Société de vente volontaire – Agrément n° 2002-180 Mes Jean-Pierre LELIEVRE - Pascal MAICHE - Alain PARIS Commissaires priseurs associés 10, rue Claude Bernard – ZA du Coudray – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex E-mail : [email protected] 349 SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES ASSOCIEES | IVOIRE FRANCE | Conditions de la vente et de paiement Expositions à la Galerie de Chartres – La vente a lieu aux enchères publiques. – Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères : VENDREDI 24 MAI DE 14H À 18H 20 % TTC SAMEDI 25 MAI DE 9H À 12H – Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l'examen des objets. -

TERCERA PARTE. La Relación Entre Fotografía Y Etnografía En El Origen De La Etnología Académica Francesa
El escalpelo, la pluma y la cámara. Imagen y objeto en la constitución de la etnología académica francesa. INTRODUCCIÓN. PRIMERA PARTE. Fotografía y etnografía. 1.1- De la pintura a la fotografía. Características del nuevo procedimiento. 1.2- La fotografía y sus aplicaciones científicas. El momento Daguerre y la defensa del daguerrotipo por François Arago. 1.3- Fotografía y antropología. 1.3.1- Introducción. 1.3.2- Antropología física y aplicación de la fotografía a los estudios radiológicos. 1.3.3- Fotografía etnográfica y confusión de géneros. El desplazamiento de los antropólogos sobre el terreno y el terreno en la propia casa. 1.3.4- Sociedades de sabios de París y museos de Antropología. 1.3.5- Políticas coloniales y papel de la fotografía en su legitimación. SEGUNDA PARTE. El fin de siglo y los usos públicos de la fotografía por la nueva antropología científica. 2.1- Dos hitos importantes en el desarrollo de la fotografía etno- antropológica; el momento Kodak y la reproducción de imágenes en prensa, revistas ilustradas, fotolibros y publicaciones antropológicas. 2.2- Exposiciones coloniales: Exotismo y colonialismo en la puesta en escena de la alteridad exótica. 2.3- La Exposición Colonial de 1931. Imagen y política colonial. 1 TERCERA PARTE. La relación entre fotografía y etnografía en el origen de la etnología académica francesa. 3.1- Marcel Griaule. La construcción de una disciplina. 3.2- La Misión Dakar-Djibouti en el contexto social, artístico y político de la Francia de entreguerras. 3.2.1- El Instituto de Etnología de la Universidad de París y la profesionalización de la etnografía. -

Envisioning South Asian: Texts, Scholarship, Legacies
Envisioning South Asian: Texts, Scholarship, Legacies Lenses Eyeglasses A. K. Ramanujan Papers A. K. Ramanujan’s Passport, 1959 A. K. Ramanujan Papers A. K. Ramanujan’s Passport, 1973 A. K. Ramanujan Papers Glimpses of the Past MS 1330 Ink and opaque watercolor on paper Pashto [19th c?] Codex Manuscript Collection MS 341 Razmnāma Ink opaque watercolor and gold on paper Persian [mid-18th c] Codex Manuscript Collection MS 1078 Abdullah Khan Bahadur Firuz Jang (fl. 17th c.) Farasnāma-i hindī Opaque watercolor on paper Persian [18th c] Codex Manuscript Collection CrMS 27 Puncī ralage potā Palm leaf ms Pali/Sinhalese [c. 1800] Codex Manuscripts MS 1686 Bhadrakalpikā sūtra ink on black paper Tibetan [n.d.] Codex Manuscript Collection Bhadrabahu Kalpasūtra Folio from an illustrated Jain ms Ink and color on paper Prakrit [n.d.] William and Marianne Sollach, Collection of Prints and Drawings: “People with Books” MS 1687 Vājasaneyī saṃhitā [n.d.] Codex Manuscript Collection MS1664 Tibetan gter-ma [n.d.] Codex Manuscript Collection Buddhaghosa (5th c) Samantapāsādikā (chapter entitled Pārājika-kaṇḍa-aṭṭhakathā-pāṭha) Regenstein Library, General Collections Asia in the Eyes of Europe: Imaging, Exploring, Mapping Maps G7630 1878 .A5 Afghanistan, Belutschistan und angrenzende Gebiete Gotha: Justus Perthes. 1878 University of Chicago Library Map Collection G7630 1878 .H3 R. Hausermann Théâtre du conflit Anglo-Afghan Paris: Imp. Becquet. 1878 University of Chicago Library Map Collection G7630 1878 .S70 Stanford’s Shilling Map of Afghanistan and Adjoining Countries London: Edward Stanford. 1878 University of Chicago Library Map Collection G7630 1879.C3 Carte de l’Afghanistan et des frontières nord-ouest de l’Inde et sud de la Russie d’Asie Paris: Librairie Ch. -

Edwin Lord Weeks: an American Artist in North Africa and South Asia
Edwin Lord Weeks: An American Artist in North Africa and South Asia Dana M. Garvey A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Washington 2013 Reading Committee: Susan Casteras, Chair René Bravmann Stuart Lingo Program Authorized to Offer Degree: Art History ©Copyright 2013 Dana M. Garvey University of Washington Abstract Edwin Lord Weeks: An American Artist in North Africa and South Asia Dana M. Garvey Chair of the Supervisory Committee: Professor Susan Casteras Art History Artist, adventurer, travel writer and cultural commentator Edwin Lord Weeks (1849– 1903) was one of America's most celebrated expatriate artists. From the 1870s through the 1890s the Boston native and Paris resident traveled throughout Spain, Syria, Egypt, Morocco, Turkey, Persia and India, venturing well beyond "the Orient" familiar to many of his professional colleagues. His scenes of Egypt and Morocco established early successes in France and America. Travels to India beginning in 1882 inspired a new vision of that region centered on its monumental architecture, colorful street life and vibrant culture. His fresh, bold images of India distinguished Weeks from rival American and European Orientalist painters, established his mature reputation, and brought sustained international acclaim. The dissertation situates Weeks' life and work in a broad socio-political context. For the first time, Weeks' reputation as an intrepid "artist-adventurer" is examined relative to critical and popular reception, the construction of artistic identity, the interdependence of text and image, and the evolving definition of the modern American artist. Original research confirms, clarifies and augments Weeks' biography.