Les Personnels De L'enseignement Du Québec : 1930-1990
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Quebec Education: the Unfinished Revolution
Norman Henchty Quebec Education: The Unfinished Revolution Profound changes have taken place in the Province of Quebec since 1960. The period is described as the Quiet Revo lution and like all genuine revolutions change penetrated deeply into every aspect of the society - the identity, the culture, the institutions, and the people. The French-speaking Quebecer was once defined by his attachment to tradition, his allegiance to the Church, his elitist view of society, his distrust of change, and his detachment from the economic life of the continent. But a new definition has been emerging over the last decade: concern for the present, adherence to a secular and political ethic, an egalitarian view of society, a commit ment to change, an engagement in the technology and econ omics of the post-industrial state. As the identity of the French Quebecer alters, the tradi tional assumptions on which the English Quebecer has oper ated no longer hold. His economic and social cocoon has been broken open and he finds himself a member of a minority group, a stranger in a strange land. His identity is trans formed and in an ironic way he exchanges places with the French: it is now the English Quebecer who worries about the survival of his culture and language, who seeks his security in tradition, who stands on his constitutional rights. As identities change, so do cultures and institutions. Churches and convents, once the citadels of power, become shrines of a history turned aside; the theology and history of the classical college become the sociology and informatique of the Cegeps; the triumvirate of doctor-lawyer-priest becomes that of bureaucrat-accountant-animateur . -

Policy on Educational Success a Love of Learning, a Chance to Succeed
POLICY ON EDUCATIONAL SUCCESS A LOVE OF LEARNING, A CHANCE TO SUCCEED POLICY ON EDUCATIONAL SUCCESS A LOVE OF LEARNING, A CHANCE TO SUCCEED This document is available on the Ministère’s website at education.gouv.qc.ca. © Gouvernement du Québec Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ISBN 978-2-550-78835-5 (version imprimée) ISBN 978-2-550-78836-2 (PDF) (English edition: ISBN 978-2-550-78838-6) Legal deposit – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017 MESSAGE FROM THE PREMIER In Québec, education is a priority. Indeed, it is the key required to build a more prosperous and innovative society. In a changing world, it is a quintessential asset needed to meet challenges associated with all sectors of activity, to ensure the well-being of the population and to increase prosperity both individually and as a society. However, our education system, like our society, must adapt to the changes that each new generation brings. To provide Québec with an educational model for the 21st century, our government has toiled daily to more effectively manage our public finances and develop our economy. This has given us much greater latitude to make substantial new investments in school renovations and to offer the best possible services to our young people, both today and in the future. We have also embarked on a major review process centred on the idea of educational success. What must we do, we asked, to ensure that each young person has the means to develop his or her full potential in school and, subsequently, to contribute fully to our society? During the public consultations held in the fall of 2016, everyone had an opportunity to express their views on the matter. -

The Hidden Ally: How the Canadian Supreme Court Has Advanced the Vitality of the Francophone Quebec Community
The Hidden Ally: How the Canadian Supreme Court Has Advanced the Vitality of the Francophone Québec Community DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Douglas S. Roberts, B.A., J.D., M.A. Graduate Program in French and Italian The Ohio State University 2015 Dissertation Committee: Professor Wynne Wong, Advisor Professor Danielle Marx-Scouras, Advisor Professor Jennifer Willging Copyright by Douglas S. Roberts 2015 Abstract Since the adoption of the Charter of Rights and Freedoms in 1982, the Canadian Supreme Court has become a much more powerful and influential player in the Canadian political and social landscape. As such, the Court has struck down certain sections of the Charter of the French Language (Bill 101) as contrary to the Constitution, 1867 and the Charter of Rights and Freedoms. In Ford v. Québec, [1988] 2 S.C.R. 712, for instance, the Court found unconstitutional that portion of Bill 101 that required commercial signage to be in French only. After the decision was announced, public riots broke out in Montreal. As a result of this decision, one could conclude that the Court has, in fact, resisted Québec‘s attempts to protect and promote its own language and culture. In this dissertation, however, I argue that this perception is not justified, primarily because it fails to recognize how Canadian federalism protects diversity within the Confederation. Contrary to the initial public reaction to the Ford case, my contention is that the Court has, in fact, advanced and protected the vitality of Francophone Québec by developing three fundamental principles. -

Historical Background of the English-Language Cegeps of Quebec
Reginald Edwards McGili University Historical Background of the English-Language CEGEPs of Quebec Abstract This article presents a detailed background of the political and social changes that existed before and during the time that Quebec' s CEGEP system came into existence. The objective of the article is ta proville both a general history of the educational changes in Quebec in the 1960s (and the subse quent opening ofthe French-language CEGEPs) and the eventual opening of Dawson College, the first English-language CEGEP, in September 1969. Commentary on political, social, and economic conditions add additional insights into Quebec' s present college and university education. Résumé Cet article décrit de façon détaillée le contexte tks modifications politiques et sociales survenues qvant et pendant la mise en place du réseau tk cégeps au Québec. L'article vise à retracer tk façon générale les change ments survenus dans le domaine tk l'éducation au Québec au cour~ tks années 60 (qui ont mené à la création tks cégepsfrancophones) ainsi que la création du Coll~ge Dawson, premier cégep anglophone, en september 1969. L'examen tk la conjoncture politique, sociale et économique tk cette périotk nous permet tk mieux comprendre l'enseignement collégial et universitaire actuellement dispensé au Québec. "Great Oaks from Little Acorns Grow" is a statement redolent of Horatio Alger or Samuel Smiles, a phrase once beloved of entrepreneurs, business sehools, and commercial intere8ts; it was seldom applied to educa tional matters, nor to changes within educational systems. Nevertheless two Orders in Council, devices used by governments to proceed without public McGill Journal of Education, Vol. -
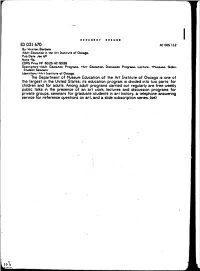
Public Talks in the Presence of an Art Work, Lectures. and Discussion Programs
00C111411N? *N$UNN ED 031 670 AC 005 112 By -Wriston, Barbara Adult Education in the Art Institute of Chicago. Pub Date Jan 69 Note-9p. EDRS Price MF -S025 HC-S0.55 Descriptors-Adult Education Programs, *Art Education, Discussion Programs, Lecture, Museums, Slides, Student Seminars identifiers -*Art Institute of Chicago The Department of Museum Education of the Art Institute of Chicago is one of the largest in the United States; its education program is divided into two parts: for children and for adults. Among adult programs carried out regularly are free weekly public talks in the presence of an art work, lectures. and discussion programs for private groups, seminars for graduate students in art history, a telephone answering service for reference questions on art, and a slide subscription series. (se) U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION & WELFARE OFFICE OF EDUCATION THIS DOCUMENT HAS SEEN REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM THE PERSON OR ORGANIZATION ORIGINATING IT.POINTS OF VIEW OR OPINIONS STATED DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL OFFICE OF EDUCATION POSITION OR POLICY. ADULT EDUCATION in the ART INSTITUTE OF CHICAGO (Revised from an article written by Barbara 1Nriston, Head, Museum Education for the Illinois Sesquicentennial, January, 1969) Art museums are composed of many parts and have several functions; principally the acquisition, conservation, publication and interpretation of works of art. In a large museum there are departments for each of the several disciplines, for example: Western European painting, Oriental art, the Decorative Arts, Prints and Drawings, as well as departments for conservation, education, and other public services. The Art Institute of Chicago in common with most other American museums believes strongly in the roleoffmuseum education for adults and children, not only for the citizens of Chicago and the State of Illinois, but the rest of the country, and indeed the world. -

A Comparative Analysis of Two Contemporary Educational Documents: Parent Commission Report (Quebec) and Kothari Commission Report (India)
DOCUMENT RESUME ED 129 656 SO 009 418 AUTHOR Kattackal, Joseph A. TITLE A Comparative Analysis of Two Contemporary Educational Documents: Parent Commission Report (Quebec) and Kothari Commission Report (India). PUB DATE 76 NOTE 39p.; Paper presented at the Annual Conference of the Comparative and International Education Society (Quebec City, Quebec, May 23-June 5,1976) EDRS PRICE MF-$0.83 HC-$2.06 Plus Postage. DESCRIPTORS Asian Studies; *Cr,mparative Analysis; *Comparative Education; Cross Cultural Studies; Cultural Factors; *Educational Development; Educational History; Educational Legislation; Educational Objectives; Educational Planning; Educational Policy; Elementary Secondary Education; *Foreign Countries; Program Descriptions; Program Evaluation; Public Education; Relevance (Education); Success Factors ABSTRACT Two contemporary education documents are ,7ompared and a discussion of recommendation implementation is presented. The first document, the Report of the Royal Commission of Inquiryon Education in the Province of Quebec, 1963-1966 (the Parent CommissionReport) presents an overview of the educational system in Quebec. The second document, the Report of Education Commission 1964-66, Ministryof Education, Government of India (The Kothari Commission Report) stresses the cultural, economic, and political forces which influence education in India. Dissimilarities between the Province of Quebec and the Republic of India are enumerated andcommon political and historical factors of the two areas are compared. Each document is divided into three parts and deals with pedagogicalstructure, educational legislation, specific educational achievements,stages and sectors of education, educational reconstruction, and the degree and type of changes which have ensued since publication ofthe reports. The author concludes that the Parent Commission Reportwas well received generally but that many of the expectations raisedby the report remain unfulfilled. -

The Activity School: Rationale and Historical Antece'dents E
THE ACTIVITY SCHOOL: RATIONALE AND HISTORICAL ANTECE'DENTS E. GAULT FINLEY Introduction The Parent Commission on Education in the Province of Quebec has already recommended to the Government that the école active should constitute the basic pedagogical principle for the Provincial educational system. To the Commissioners, the "activist school" entails an institution where pedagogical efforts reflect a twin principle of child psychology - namely, the child is "essentially an active being and it is through use that his capacities develop and his personality expands." 1 In recommending "genuinely child-centered education" in which the pupil's natural curiosity is to be utilized to develop intel lectual and moral autonomy, the Parent Commission criticizes the traditional school for generally limiting itself "to more immediate goals" and not striving "to cultivate the spirit of initiative and any feeling of responsibility." 2 The present article is based on Gustav G. Schoenchen's The Activity School: A Basic Philo8ophy for Teachers 3 (an adap tation of his 1939 doctoral dissertation at New York Univer sity) and aims to review a major section of this significant and relevant treatise. Schoenchen's book consists of three ma jor parts: 1- Historical and Philosophical; 2- Methodology; 3- Application. The following analysis is primarily drawn from Part 1 which sets forth the basic historical antecedents of the activity school. Emphasis is upon those individuals in Europe whose writings and practices contributed to the under lying principles of what has come to be called activity peda gogy. Rationale Offering the analogy of a mathematician as he approaches a Iimit - "always progressing but never arriving" - Schoen chen contends that in order to include aIl valid subordinate aims (both now and in the future), the supreme aim of the activity school must be human perfection. -

Le Présent Fichier Est Une Publication En Ligne Reçue En Dépôt Légal, Convertie En Format PDF Et Archivée Par Bibliothèque Et Archives Nationales Du Québec
Le présent fichier est une publication en ligne reçue en dépôt légal, convertie en format PDF et archivée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. L’information contenue dans le fichier peut donc être périmée et certains liens externes peuvent être inactifs. Version visionnée sur le site Internet d’origine le 12 août 2013 Section du dépôt légal FALL 1972 VOL VII NO. 2 QUEBEC EDUCATION Edltorl.1 93 J.L ••d N.H. Quebec Educatio.. : The U.. fi ..i.hed Revoluti... 95 N........ H8IIChey Quebec'. Cegepl: Promi.. • .. d Re.lity 119 A... DenÏl ...d Johll U,Id. Evolution rée..... 48 l'e .. Mitlle ......t .upéaoleur québéeoi. 135 Germalll Gauthier Power .lId P.rticipatlon 149 P.ul Gal ...her ln Edue.tI.... 1 Reform Ch ...... In the Teoehi ... Pro .....o.. 166 Iobert E. Lavery The Edueatlonol Llterature of the Quiet Revolutio. 175 AMré E. Le ....e ItetroIpective on the Por.... Report 119 Matclelhoyu F. .uteo. Louil-PhUippe Àudet .H HI. Work 205 léal G. Boul ..... RevIMn 211 Hend"" ••111. W.,lChal. H_wih:, ••d Stev_ FaU 1972 Vol. VII No. 2 McGiII Jownal of Education Editorial Bo.d Edltor 'Margaret Gillett Managing Edltor Ronald H. Tali Member Justine Harris Member Jan Lobelle Member Martin O'Hara Member Gillian Rejskind Review Editor Hermione Shantz Member (ex-officio) Wayne Hall Guest Editora John Lipkin and Norman Henchey Circulation 'Martha Tetreault The McGiII Journal of Education is published twice a year, in the Spring and Fall. Subscrip tion rates, post paid: 3 years - $5.00; 2 y~ars - $4.00; 1 year - $3.00. -

Rocherspeech-E-Nonotes-2009:Layout 1
D ISTINGUISHED ACADEMIC AWARD 2009 Truth as a Value and a Practice: A Perpetual Issue in Post- Secondary Education GUY ROCHER PROFESSOR OF SOCIOLOGY / UNIVERSITY OF MONTREAL AWARD ACCEPTANCE ADDRESS Guy Rocher had a classical education at Collège de l’Assomption (1935–1943). He received his M.A. in sociology from Université Laval in 1950, and his Ph.D. from Harvard University in 1958. He began his teaching career at Université Laval in 1952. In 1960, the Université de Montréal invited him to become the chair of the sociology department, a position he held for five years (1960–1965). During that time, he also served as vice-dean of social sciences (1962–1967). In 1961 the Government of Quebec appointed him to the Royal Commission of Inquiry on Education (Parent Commission), charged with reforming Quebec’s education system. Between 1977 and 1983, Guy Rocher took leave twice from his university career to serve in the Government of Quebec as associate secretary-general to the Cabinet and deputy minister, first for cultural development (1977–1979) and later for social develop- ment (1981–1982). In this role, he was active in the development of language policy (White Paper and Charter of the French Lan - guage), cultural policy (White Paper on Cultural Development) and scientific research policy (Green Paper). For more than 25 years, Guy Rocher has been associated with the law faculty’s Centre de recherche en droit public, where he has pursued research in the sociology of law, ethics and other means of social regulation. He has published some 20 books, more than 200 scientific articles and book chapters and has presented his ideas at numerous conferences to a wide range of audiences. -

The Effect of Quebec's Cegeps on Total Years of Schooling
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Fortin, Pierre; Mishagina, Natalia Working Paper The effect of Quebec's CEGEPs on total years of schooling Document de travail, No. 2020-08 Provided in Cooperation with: Department of Economics, School of Management Sciences (ESG UQAM), University of Quebec in Montreal Suggested Citation: Fortin, Pierre; Mishagina, Natalia (2020) : The effect of Quebec's CEGEPs on total years of schooling, Document de travail, No. 2020-08, Université du Québec à Montréal, École des sciences de la gestion (ESG UQAM), Département des sciences économiques, Montréal This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/234808 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu DOCUMENT DE TRAVAIL / WORKING PAPER No. -

Types of Relations Between States and Organized Teachers As Exemplified in Education Reform
i Université de Montréal Types of relations between states and organized teachers as exemplified in education reform par Shirley M. Humphries Département d’études en éducation et d’administration de l’éducation Faculté des sciences de l’éducation Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Philosophiæ Doctor (Ph.D.) en sciences de l’éducation option administration de l’éducation novembre 2001 © Shirley M. Humphries, 2001 ii Université de Montréal Faculté des études supérieures Cette thèse intitulée: “Types of relations between states and organized teachers as exemplified in education reform” présentée par: Shirley M. Humphries a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes: Philippe Dupuis .......…........................……………… président-rapporteur Claude Lessard..……………...................….............. directeur de recherche Terri Seddon ..........………………...............................…..membre du jury Nina Bascia…....…………….............................……..examinateur externe Mona-Josée Gagnon...................................représentant du doyen de la FES Thèse acceptée le 27 juin 2002. iii SOMMAIRE Partout dans le monde industrialisé, le regroupement des enseignants des écoles publiques a eu un impact sur l’élection des gouvernements et des officiers scolaires (là où ils sont élus), sur les politiques éducatives et sur l’organisation scolaire. Par ailleurs, les institutions nationales et les politiques éducatives façonnent les stratégies d’action accessibles aux associations d’enseignants. Une bonne compréhension de l’influence des relations entre l’état et les associations d’enseignants sur la nature et le processus de réforme scolaire peut aider les gouvernements et les syndicats d’enseignants à apprécier l’importance de leurs rôles respectifs dans la réforme de l’éducation et le maintien des sociétés démocratiques. -

L'histoire À L'école, Matière À Débats…
L’histoire à l’école, matière à débats… Analyse des sources de controverses entourant les réformes de programmes d’histoire du Québec au secondaire (1961- 2013) Thèse Olivier Lemieux Doctorat en administration et politiques de l'éducation Philosophiæ doctor (Ph. D.) Québec, Canada © Olivier Lemieux, 2019 L’histoire à l’école, matière à débats… Analyse des sources de controverses entourant les réformes de programmes d’histoire du Québec au secondaire (1961-2013) Thèse Olivier Lemieux Sous la direction de : Abdoulaye Anne, directeur de recherche Jean-François Cardin, codirecteur de recherche Résumé Prenant pour point de départ la controverse de 2006 qui touche au programme d’Histoire et éducation à la citoyenneté de deuxième cycle du secondaire, cette thèse porte sur les finalités et les enjeux associés à l’enseignement de l’histoire du Québec. Plus précisément, elle jette un regard sur les sources de controverses qui entourent les réformes des programmes d’histoire du Québec au secondaire depuis la mise sur pied de la Commission Parent (1961) jusqu’à la création du Comité Beauchemin-Fahmy-Eid (2013), et ce, en se penchant sur trois principales étapes, soit la consultation, l’élaboration de programme et les réactions et/ou l’évaluation. Notre analyse s’appuie sur dix-huit entrevues menées auprès d’acteurs-clefs et sur un corpus formé d’archives de fonds publics et privés, de mémoires déposés dans le cadre des consultations publiques, de documents officiels et d’articles de journaux. Pour analyser ce corpus, nous nous appuyons sur un modèle identifiant les principaux enjeux au cœur de la controverse de 2006, chacun au centre d’une confrontation entre deux référentiels globaux ou sectoriels.