George Cukor L'art De Faire Briller L'acteur Dossier
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Who's Who at Metro-Goldwyn-Mayer (1939)
W H LU * ★ M T R 0 G 0 L D W Y N LU ★ ★ M A Y R MyiWL- * METRO GOLDWYN ■ MAYER INDEX... UJluii STARS ... FEATURED PLAYERS DIRECTORS Astaire. Fred .... 12 Lynn, Leni. 66 Barrymore. Lionel . 13 Massey, Ilona .67 Beery Wallace 14 McPhail, Douglas 68 Cantor, Eddie . 15 Morgan, Frank 69 Crawford, Joan . 16 Morriss, Ann 70 Donat, Robert . 17 Murphy, George 71 Eddy, Nelson ... 18 Neal, Tom. 72 Gable, Clark . 19 O'Keefe, Dennis 73 Garbo, Greta . 20 O'Sullivan, Maureen 74 Garland, Judy. 21 Owen, Reginald 75 Garson, Greer. .... 22 Parker, Cecilia. 76 Lamarr, Hedy .... 23 Pendleton, Nat. 77 Loy, Myrna . 24 Pidgeon, Walter 78 MacDonald, Jeanette 25 Preisser, June 79 Marx Bros. —. 26 Reynolds, Gene. 80 Montgomery, Robert .... 27 Rice, Florence . 81 Powell, Eleanor . 28 Rutherford, Ann ... 82 Powell, William .... 29 Sothern, Ann. 83 Rainer Luise. .... 30 Stone, Lewis. 84 Rooney, Mickey . 31 Turner, Lana 85 Russell, Rosalind .... 32 Weidler, Virginia. 86 Shearer, Norma . 33 Weissmuller, John 87 Stewart, James .... 34 Young, Robert. 88 Sullavan, Margaret .... 35 Yule, Joe.. 89 Taylor, Robert . 36 Berkeley, Busby . 92 Tracy, Spencer . 37 Bucquet, Harold S. 93 Ayres, Lew. 40 Borzage, Frank 94 Bowman, Lee . 41 Brown, Clarence 95 Bruce, Virginia . 42 Buzzell, Eddie 96 Burke, Billie 43 Conway, Jack 97 Carroll, John 44 Cukor, George. 98 Carver, Lynne 45 Fenton, Leslie 99 Castle, Don 46 Fleming, Victor .100 Curtis, Alan 47 LeRoy, Mervyn 101 Day, Laraine 48 Lubitsch, Ernst.102 Douglas, Melvyn 49 McLeod, Norman Z. 103 Frants, Dalies . 50 Marin, Edwin L. .104 George, Florence 51 Potter, H. -

Annual Report and Accounts 2004/2005
THE BFI PRESENTSANNUAL REPORT AND ACCOUNTS 2004/2005 WWW.BFI.ORG.UK The bfi annual report 2004-2005 2 The British Film Institute at a glance 4 Director’s foreword 9 The bfi’s cultural commitment 13 Governors’ report 13 – 20 Reaching out (13) What you saw (13) Big screen, little screen (14) bfi online (14) Working with our partners (15) Where you saw it (16) Big, bigger, biggest (16) Accessibility (18) Festivals (19) Looking forward: Aims for 2005–2006 Reaching out 22 – 25 Looking after the past to enrich the future (24) Consciousness raising (25) Looking forward: Aims for 2005–2006 Film and TV heritage 26 – 27 Archive Spectacular The Mitchell & Kenyon Collection 28 – 31 Lifelong learning (30) Best practice (30) bfi National Library (30) Sight & Sound (31) bfi Publishing (31) Looking forward: Aims for 2005–2006 Lifelong learning 32 – 35 About the bfi (33) Summary of legal objectives (33) Partnerships and collaborations 36 – 42 How the bfi is governed (37) Governors (37/38) Methods of appointment (39) Organisational structure (40) Statement of Governors’ responsibilities (41) bfi Executive (42) Risk management statement 43 – 54 Financial review (44) Statement of financial activities (45) Consolidated and charity balance sheets (46) Consolidated cash flow statement (47) Reference details (52) Independent auditors’ report 55 – 74 Appendices The bfi annual report 2004-2005 The bfi annual report 2004-2005 The British Film Institute at a glance What we do How we did: The British Film .4 million Up 46% People saw a film distributed Visits to -

Welcome Home Mr Swanson Swedish Emigrants and Swedishness on Film Wallengren, Ann-Kristin; Merton, Charlotte
Welcome Home Mr Swanson Swedish Emigrants and Swedishness on Film Wallengren, Ann-Kristin; Merton, Charlotte 2014 Document Version: Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication Citation for published version (APA): Wallengren, A-K., & Merton, C., (TRANS.) (2014). Welcome Home Mr Swanson: Swedish Emigrants and Swedishness on Film. Nordic Academic Press. Total number of authors: 2 General rights Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply: Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/ Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. LUND UNIVERSITY PO Box 117 221 00 Lund +46 46-222 00 00 welcome home mr swanson Welcome Home Mr Swanson Swedish Emigrants and Swedishness on Film Ann-Kristin Wallengren Translated by Charlotte Merton nordic academic press Welcome Home Mr Swanson Swedish Emigrants and Swedishness on Film Ann-Kristin Wallengren Translated by Charlotte Merton nordic academic press This book presents the results of the research project ‘Film and the Swedish Welfare State’, funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation. -

Film Directors by Deborah Hunn
Film Directors by Deborah Hunn Encyclopedia Copyright © 2015, glbtq, Inc. A portrait of actor Jack Entry Copyright © 2002, glbtq, Inc. Larson (left) with director Reprinted from http://www.glbtq.com James Bridges and their dog Max by Stathis Gay, lesbian and bisexual film directors have been a vital creative presence in cinema Orphanos. Courtesy Stathis since the medium's inception over one hundred years ago. Until the last two decades, Orphanos.Copyright © however, mainstream directors kept their work (and not infrequently their lives) Stathis Orphanos.All discreetly closeted, while the films of underground and experimental creators, Rights Reserved. although often confrontational in theme and technique, had limited circulation and financial support. More recently, new queer filmmakers have capitalized on increased (although by no means unproblematic) public acceptance to win critical recognition and commercial viability for their projects. The Hollywood Golden Era In the so-called Golden Era of Hollywood, there were a number of famous directors privately known for their alternative sexual preferences. These included George Cukor, Edmund Goulding, Mitchell Leisen, F.W. Murnau, Mauritz Stiller, James Whale, and Dorothy Arzner, who functioned with varying degrees of success in the industry. Cukor (1899-1983) is primarily famous as a prolific and assured director of women's films. His sexuality was a well known secret in Hollywood, and while it did not do substantial harm to his career, it is generally believed that his "fairy" reputation cost him the directorship of Gone With the Wind (1939), following objections from macho star Clark Gable. Although Cukor's work never overtly addresses gay issues, later critics and viewers have come to appreciate its many queer subtexts: Katharine Hepburn's cross dressing in Sylvia Scarlett (1935); the gloriously camp bitchiness in the dress and dialogue of the all women cast of The Women (1939); the effete figure of Kip in the classic Adam's Rib (1948). -

032343 Born Yesterday Insert.Indd
among others. He is a Senior Fight Director with OUR SPONSORS ABOUT CENTER REPERTORY COMPANY Dueling Arts International and a founding member of Dueling Arts San Francisco. He is currently Chevron (Season Sponsor) has been the Center REP is the resident, professional theatre CENTER REPERTORY COMPANY teaching combat related classes at Berkeley Rep leading corporate sponsor of Center REP and company of the Lesher Center for the Arts. Our season Michael Butler, Artistic Director Scott Denison, Managing Director School of Theatre. the Lesher Center for the Arts for the past nine consists of six productions a year – a variety of musicals, LYNNE SOFFER (Dialect Coach) has coached years. In fact, Chevron has been a partner of dramas and comedies, both classic and contemporary, over 250 theater productions at A.C.T., Berkeley the LCA since the beginning, providing funding that continually strive to reach new levels of artistic presents Rep, Magic Theatre, Marin Theater Company, for capital improvements, event sponsorships excellence and professional standards. Theatreworks, Cal Shakes, San Jose Rep and SF and more. Chevron generously supports every Our mission is to celebrate the power of the human Opera among others including ten for Center REP. Center REP show throughout the season, and imagination by producing emotionally engaging, Her regional credits include the Old Globe, Dallas is the primary sponsor for events including Theater Center, Arizona Theatre Company, the intellectually involving, and visually astonishing Arena Stage, Seattle Rep and the world premier the Chevron Family Theatre Festival in July. live theatre, and through Outreach and Education of The Laramie Project at the Denver Center. -

Ms Coll\Wheeler, R. Wheeler, Roger, Collector. Theatrical
Ms Coll\Wheeler, R. Wheeler, Roger, collector. Theatrical memorabilia, 1770-1940. 15 linear ft. (ca. 12,800 items in 32 boxes). Biography: Proprietor of Rare Old Programs, Newtonville, Mass. Summary: Theatrical memorabilia such as programs, playbills, photographs, engravings, and prints. Although there are some playbills as early as 1770, most of the material is from the 19th and 20th centuries. In addition to plays there is some material relating to concerts, operettas, musical comedies, musical revues, and movies. The majority of the collection centers around Shakespeare. Included with an unbound copy of each play (The Edinburgh Shakespeare Folio Edition) there are portraits, engravings, and photographs of actors in their roles; playbills; programs; cast lists; other types of illustrative material; reviews of various productions; and other printed material. Such well known names as George Arliss, Sarah Bernhardt, the Booths, John Drew, the Barrymores, and William Gillette are included in this collection. Organization: Arranged. Finding aids: Contents list, 19p. Restrictions on use: Collection is shelved offsite and requires 48 hours for access. Available for faculty, students, and researchers engaged in scholarly or publication projects. Permission to publish materials must be obtained in writing from the Librarian for Rare Books and Manuscripts. 1. Arliss, George, 1868-1946. 2. Bernhardt, Sarah, 1844-1923. 3. Booth, Edwin, 1833-1893. 4. Booth, John Wilkes, 1838-1865. 5. Booth, Junius Brutus, 1796-1852. 6. Drew, John, 1827-1862. 7. Drew, John, 1853-1927. 8. Barrymore, Lionel, 1878-1954. 9. Barrymore, Ethel, 1879-1959. 10. Barrymore, Georgiana Drew, 1856- 1893. 11. Barrymore, John, 1882-1942. 12. Barrymore, Maurice, 1848-1904. -
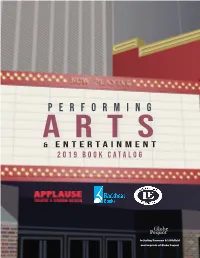
P E R F O R M I N G
PERFORMING & Entertainment 2019 BOOK CATALOG Including Rowman & Littlefield and Imprints of Globe Pequot CONTENTS Performing Arts & Entertainment Catalog 2019 FILM & THEATER 1 1 Featured Titles 13 Biography 28 Reference 52 Drama 76 History & Criticism 82 General MUSIC 92 92 Featured Titles 106 Biography 124 History & Criticism 132 General 174 Order Form How to Order (Inside Back Cover) Film and Theater / FEATURED TITLES FORTHCOMING ACTION ACTION A Primer on Playing Action for Actors By Hugh O’Gorman ACTION ACTION Acting Is Action addresses one of the essential components of acting, Playing Action. The book is divided into two parts: A Primer on Playing Action for Actors “Context” and “Practice.” The Context section provides a thorough examination of the theory behind the core elements of Playing Action. The Practice section provides a step-by-step rehearsal guide for actors to integrate Playing Action into their By Hugh O’Gorman preparation process. Acting Is Action is a place to begin for actors: a foundation, a ground plan for how to get started and how to build the core of a performance. More precisely, it provides a practical guide for actors, directors, and teachers in the technique of Playing Action, and it addresses a niche void in the world of actor training by illuminating what exactly to do in the moment-to-moment act of the acting task. March, 2020 • Art/Performance • 184 pages • 6 x 9 • CQ: TK • 978-1-4950-9749-2 • $24.95 • Paper APPLAUSE NEW BOLLYWOOD FAQ All That’s Left to Know About the Greatest Film Story Never Told By Piyush Roy Bollywood FAQ provides a thrilling, entertaining, and intellectually stimulating joy ride into the vibrant, colorful, and multi- emotional universe of the world’s most prolific (over 30 000 film titles) and most-watched film industry (at 3 billion-plus ticket sales). -

Rencontre Avec George Cukor Gene D
Document généré le 28 sept. 2021 02:59 Séquences La revue de cinéma Rencontre avec George Cukor Gene D. Phillips Numéro 108, avril 1982 URI : https://id.erudit.org/iderudit/51019ac Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) La revue Séquences Inc. ISSN 0037-2412 (imprimé) 1923-5100 (numérique) Découvrir la revue Citer ce document Phillips, G. D. (1982). Rencontre avec George Cukor. Séquences, (108), 4–9. Tous droits réservés © La revue Séquences Inc., 1982 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ *• \ ... rencontre avec GEORGE CUKOR SÉQUENCES 108 « Mesdames et messieurs, la prise était bonne, mais, si vous le voulez bien, nous allons la reprendre sur un tempo plus rapide, pour le plaisir de la chose. » Le réalisateur s'exprime sur un ton à la fois courtois et autoritaire, tout en frappant sa jambe avec le scénario roulé en spirale, comme s'il s'agissait d'une cra vache. Il s'appelle George Cukor, il a quatre-vingts ans et il est en train de diriger le tournage de Rich and Famous <'>. La prise en charge de ce film a fait de lui le cinéaste le plus âgé à avoir jamais réalisé un film pour un grand studio. -

George Cukor Et La Critique Réal La Rochelle
Document généré le 26 sept. 2021 05:56 Séquences La revue de cinéma George Cukor et la critique Réal La Rochelle Le cinéma imaginaire II Numéro 55, décembre 1968 URI : https://id.erudit.org/iderudit/51632ac Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) La revue Séquences Inc. ISSN 0037-2412 (imprimé) 1923-5100 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article La Rochelle, R. (1968). George Cukor et la critique. Séquences, (55), 57–60. Tous droits réservés © La revue Séquences Inc., 1968 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ \-jeorae K^ukor et la critit ue Los Angeles, 28 juin 1968. voir au travail aux studios de la Monsieur Gilbert Maggi, Fox, où il prépare actuellement un Revue Séquences, film avec Rex Harrison, sur un Montréal. scénario de John Osborne. J'ai vu notre cher Cukor cet En attendant Cukor dans ses après-midi, à sa demeure de Bever jardins rococo-américains, je me ley Hills. C'est une chance particu suis rappelé notre rétrospective- lière d'avoir pu le rencontrer chez "hommage" de l'an dernier, quel lui, mais je vais regretter seulement soin nous avions mis à la prépara qu'il m'ait été impossible de lé tion d'un programme entièrement DECEMBRE 1968 57 consacré à ce grand réalisateur a- au Québec face au cinéma améri méricain, dont nous aimons les cain, ainsi que le paradoxe dans le films, mais que trop peu de mem quel nous nageons : ou bien nos bres de nos ciné-clubs prennent la cinéphiles boudent le cinéma amé peine de voir et de comprendre; ricain, en lui préférant exclusive je revoyais rapidement notre géné ment l'européen ou .. -
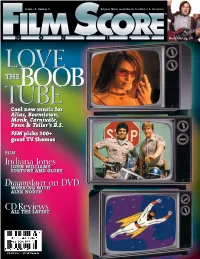
Click to Download
Volume 8, Number 8 Original Music Soundtracks for Movies & Television Rock On! pg. 10 LOVE thEBOOB TUBE Cool new music for Alias, Boomtown, Monk, Carnivàle, Penn & Teller’s B.S. FSM picks 100+ great great TTV themes plus Indiana Jones JO JOhN WIllIAMs’’ FOR FORtuNE an and GlORY Dragonslayer on DVD WORKING WORKING WIth A AlEX NORth CD Reviews A ALL THE L LAtEST $4.95 U.S. • $5.95 Canada CONTENTS SEPTEMBER 2003 DEPARTMENTS COVER STORY 2 Editorial 20 We Love the Boob Tube The Man From F.S.M. Video store geeks shouldn’t have all the fun; that’s why we decided to gather the staff picks for our by-no- 4 News means-complete list of favorite TV themes. Music Swappers, the By the FSM staff Emmys and more. 5 Record Label 24 Still Kicking Round-up Think there’s no more good music being written for tele- What’s on the way. vision? Think again. We talk to five composers who are 5 Now Playing taking on tough deadlines and tight budgets, and still The Man in the hat. Movies and CDs in coming up with interesting scores. 12 release. By Jeff Bond 7 Upcoming Film Assignments 24 Alias Who’s writing what 25 Penn & Teller’s Bullshit! for whom. 8 The Shopping List 27 Malcolm in the Middle Recent releases worth a second look. 28 Carnivale & Monk 8 Pukas 29 Boomtown The Appleseed Saga, Part 1. FEATURES 9 Mail Bag The Last Bond 12 Fortune and Glory Letter Ever. The man in the hat is back—the Indiana Jones trilogy has been issued on DVD! To commemorate this event, we’re 24 The girl in the blue dress. -

Джоñ€Ð´Ð¶ Кñžðºð¾ñ€ Филм ÑпиÑÑšðº (ФÐ
Джордж Кюкор Филм ÑÐ ¿Ð¸ÑÑ ŠÐº (ФилмографиÑ) Susan and God https://bg.listvote.com/lists/film/movies/susan-and-god-2061328/actors Romeo and Juliet on screen https://bg.listvote.com/lists/film/movies/romeo-and-juliet-on-screen-4010240/actors Tarnished Lady https://bg.listvote.com/lists/film/movies/tarnished-lady-3794581/actors Girls About Town https://bg.listvote.com/lists/film/movies/girls-about-town-1504117/actors Grumpy https://bg.listvote.com/lists/film/movies/grumpy-3777253/actors Romeo and Juliet https://bg.listvote.com/lists/film/movies/romeo-and-juliet-1081181/actors No More Ladies https://bg.listvote.com/lists/film/movies/no-more-ladies-116349/actors David Copperfield https://bg.listvote.com/lists/film/movies/david-copperfield-1174069/actors The Blue Bird https://bg.listvote.com/lists/film/movies/the-blue-bird-1198394/actors Desire Me https://bg.listvote.com/lists/film/movies/desire-me-1200732/actors A Double Life https://bg.listvote.com/lists/film/movies/a-double-life-1232912/actors Edward, My Son https://bg.listvote.com/lists/film/movies/edward%2C-my-son-1291456/actors One Hour with You https://bg.listvote.com/lists/film/movies/one-hour-with-you-1306660/actors Let's Make Love https://bg.listvote.com/lists/film/movies/let%27s-make-love-1348409/actors The Actress https://bg.listvote.com/lists/film/movies/the-actress-1373591/actors Lust for Life https://bg.listvote.com/lists/film/movies/lust-for-life-1423854/actors The Animal Kingdom https://bg.listvote.com/lists/film/movies/the-animal-kingdom-1514624/actors -

Garbo Talks, a Comedy-Drama About Fan Worship
The Museum of Modern Art Department of Film 11 West 53 Street, New York, N.Y. 10019 Tel: 212-708-9400 Cable: MODERNART Telex: 62370 MODART #47 FOR IMMEDIATE RELEASE GARB0 TALKS (AND LAUGHS, AS WELL) AT THE MUSEUM OF MODERN ART AT SCREENINGS OCTOBER 12 AND 22 Last spring, director Sidney Lumet took over part of The Museum of Modern Art as a location for his latest film, Garbo Talks, a comedy-drama about fan worship. For one episode of the film, Lumet created the opening night of a fictitious Museum retrospective of this legendary actress's work, complete with a screening of Ninotchka and a reception packed with celebrities. This month, MGM/UA will premiere Garbo Talks. In a case of life imitating art, the Department of Film will show two of the best-remembered films from the Garbo canon during October--George Cukor's Cami lie and Ernst Lubitsch's Ninotchka--with the kind co-operation of MGM/UA. Unlike the episode in Lumet's film, these screenings will be real and open to the public. Tickets to the Museum's films are free with admission ($4.50 for adults, $3 for students, $2 for senior citizens) and are available first-come, first-served on the day of the screening. For further information, the public may call (212) 708-9500. October 1984 SCHEDULE Fri. Oct. 12 2:30 Ninotchka. 1939. Ernst Lubitsch. With Greta Garbo, Melvyn Douglas, Ina Claire. (MGM/UA) 110 min. 6:00 Camille. 1936. George Cukor. With Greta Garbo, Robert Taylor, Lionel Barrymore. (MGM/UA) 111 min.