Danuta Mucha
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

¿Cuál Chopin? *
¿CUÁL CHOPIN? * Thomas Higgins Hoy día, los pianistas tienen a su disposición un gran número de edicio nes musicales de Chopin. En este artículo -descriptivo y analítico- serán exami nadas sólo las ediciones de mayor circulación o las que tengan un específico interés académico. Bajo este criterio podemos agrupar más de media docena de ediciones: l . Las Obras Completas de Fryderyk Chopin (Varsovia-Cracovia: Publicaciones de Música Polaca, 1949), a la que nos referiremos de ahora en adelante como la Edición Polaca Completa. Veintiséis volúmenes editados por Paderewsi0 , Bronarski y Turcinski. 2. La Edición Nacional Polaca (Varsovia: Przedstawicielstwo Wydawructwo Polskich, 1967). Baladas editadas por Jan Ekier. 3. La Edición Wiener Vrtext (Viena: Edición Universal, 19 3). Preludios edi tados por Bemard Hansen, con guías interpretativas de Jorg Demus; Estudio op.lO y 25. n'oís Nouvelles Etudes editados por Paul Badura Skoda; Impromp tus y Scherzos editados por Jan Ekier. 4. La Edición Henle Vrtext (Duisburg-Munich:Henle erlag, 195 . Doce volúmenes; el primero, agotado, y el último, editado por Ewald Zimmennan. 5. Dos colecciones de Schi.nner, una editada por Karol MiJnili , -posiblemente reimpresión de su edición para Kistner (Leipzig, 18 9: 1 vol. y Leipzig, 1 17 vol.-), por ejemplo: Preludios, copyright de Schimler 191-; l:l otr:I. editada por Rafael Joseffy, por ejemplo: los Estudios copyright de hirmer 1 1 . • Wbose ChoPin? 19th Ccntul)/ Music 1981. 01. ,pag. QUODLIBET éstas hay que añadir una última, muy inferior, casi un libelo, que es la edición de los Estudios, por Arthur Friedheim. A pesar de su ínfima calidad, Schrirmer aftrma en su Music Teacher's Pocket Memo Book de 1977 que fue la quinta edición más vendida de las músicas para piano. -
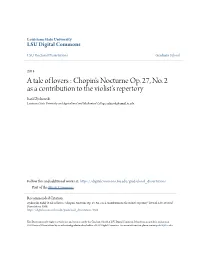
Chopin's Nocturne Op. 27, No. 2 As a Contribution to the Violist's
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2014 A tale of lovers : Chopin's Nocturne Op. 27, No. 2 as a contribution to the violist's repertory Rafal Zyskowski Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the Music Commons Recommended Citation Zyskowski, Rafal, "A tale of lovers : Chopin's Nocturne Op. 27, No. 2 as a contribution to the violist's repertory" (2014). LSU Doctoral Dissertations. 3366. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/3366 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. A TALE OF LOVERS: CHOPIN’S NOCTURNE OP. 27, NO. 2 AS A CONTRIBUTION TO THE VIOLIST’S REPERTORY A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts in The School of Music by Rafal Zyskowski B.M., Louisiana State University, 2008 M.M., Indiana University, 2010 May 2014 ©2014 Rafal Zyskowski All rights reserved ii Dedicated to Ms. Dorothy Harman, my best friend ever iii ACKNOWLEDGMENTS As always in life, the final outcome of our work results from a contribution that was made in one way or another by a great number of people. Thus, I want to express my gratitude to at least some of them. -

Interpreting Tempo and Rubato in Chopin's Music
Interpreting tempo and rubato in Chopin’s music: A matter of tradition or individual style? Li-San Ting A thesis in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of New South Wales School of the Arts and Media Faculty of Arts and Social Sciences June 2013 ABSTRACT The main goal of this thesis is to gain a greater understanding of Chopin performance and interpretation, particularly in relation to tempo and rubato. This thesis is a comparative study between pianists who are associated with the Chopin tradition, primarily the Polish pianists of the early twentieth century, along with French pianists who are connected to Chopin via pedagogical lineage, and several modern pianists playing on period instruments. Through a detailed analysis of tempo and rubato in selected recordings, this thesis will explore the notions of tradition and individuality in Chopin playing, based on principles of pianism and pedagogy that emerge in Chopin’s writings, his composition, and his students’ accounts. Many pianists and teachers assume that a tradition in playing Chopin exists but the basis for this notion is often not made clear. Certain pianists are considered part of the Chopin tradition because of their indirect pedagogical connection to Chopin. I will investigate claims about tradition in Chopin playing in relation to tempo and rubato and highlight similarities and differences in the playing of pianists of the same or different nationality, pedagogical line or era. I will reveal how the literature on Chopin’s principles regarding tempo and rubato relates to any common or unique traits found in selected recordings. -

Chopin and Poland Cory Mckay Departments of Music and Computer Science University of Guelph Guelph, Ontario, Canada, N1G 2W 1
Chopin and Poland Cory McKay Departments of Music and Computer Science University of Guelph Guelph, Ontario, Canada, N1G 2W 1 The nineteenth century was a time when he had a Polish mother and was raised in people were looking for something new and Poland, his father was French. Finally, there exciting in the arts. The Romantics valued is no doubt that Chopin was trained exten- the exotic and many artists, writers and sively in the conventional musical styles of composers created works that conjured im- western Europe while growing up in Poland. ages of distant places, in terms of both time It is thus understandable that at first glance and location. Nationalist movements were some would see the Polish influence on rising up all over Europe, leading to an em- Chopin's music as trivial. Indeed, there cer- phasis on distinctive cultural styles in music tainly are compositions of his which show rather than an international homogeneity. very little Polish influence. However, upon Fryderyk Franciszek Chopin used this op- further investigation, it becomes clear that portunity to go beyond the conventions of the music that he heard in Poland while his time and introduce music that had the growing up did indeed have a persistent and unique character of his native Poland to the pervasive influence on a large proportion of ears of western Europe. Chopin wrote music his music. with a distinctly Polish flare that was influ- The Polish influence is most obviously ential in the Polish nationalist movement. seen in Chopin's polonaises and mazurkas, Before proceeding to discuss the politi- both of which are traditional Polish dance cal aspect of Chopin's work, it is first neces- forms. -

Whose Chopin? Politics and Patriotism in a Song to Remember (1945)
Whose Chopin? Politics and Patriotism in A Song to Remember (1945) John C. Tibbetts Columbia Pictures launched with characteristic puffery its early 1945 release, A Song to Remember, a dramatized biography of nineteenth-century composer Frederic Chopin. "A Song to Remember is destined to rank with the greatest attractions since motion pictures began," boasted a publicity statement, "—seven years of never-ending effort to bring you a glorious new landmark in motion picture achievement."1 Variety subsequently enthused, "This dramatization of the life and times of Frederic Chopin, the Polish musician-patriot, is the most exciting presentation of an artist yet achieved on the screen."2 These accolades proved to be misleading, however. Viewers expecting a "life" of Chopin encountered a very different kind of film. Instead of an historical chronicle of Chopin's life, times, and music, A Song to Remember, to the dismay of several critics, reconstituted the story as a wartime resistance drama targeted more to World War II popular audiences at home and abroad than to enthusiasts of nineteenth-century music history.3 As such, the film belongs to a group of Hollywood wartime propaganda pictures mandated in 1942-1945 by the Office of War Information (OWI) and its Bureau of Motion Pictures (BMP)—and subject, like all films of the time, to the censorial constraints of the Production Code Administration (PCA)—to stress ideology and affirmation in the cause of democracy and to depict the global conflict as a "people's war." No longer was it satisfactory for Hollywood to interpret the war on the rudimentary level of a 0026-3079/2005/4601-115$2.50/0 American Studies, 46:1 (Spring 2005): 115-142 115 116 JohnC.Tibbetts Figure 1: Merle Oberon's "George Sand" made love to Cornel Wilde's "Frederic Chopin" in the 1945 Columbia release, A Song to Remember(couvtQsy Photofest). -

Discover Warsaw
DISCOVER WARSAW #discoverwarsaw #discoverwarsaw #discoverwarsaw #discoverwarsaw #discoverwarsaw #discoverwarsaw #discoverwarsaw #discoverwarsaw #discoverwarsaw #discoverwarsaw #discoverwarsaw #discoverwarsaw #discoverwarsaw #discoverwarsaw #discoverwarsaw #discoverwarsaw WELCOME TO WARSAW! If you are looking for open people, fascinating history, great fun and unique flavours, you've come to the right place. Our city offers you everything that will make your trip unforgettable. We have created this guide so that you can choose the best places that are most interesting for you. The beautiful Old Town and interactive museums? The wild river bank in the heart of the city? Cultural events? Or maybe pulsating nightlife and Michelin-star restaurants? Whatever your passions and interests, you'll find hundreds of great suggestions for a perfect stay. IT'S TIME TO DISCOVER WARSAW! CONTENTS: 1. Warsaw in 1 day 5 2. Warsaw in 2 days 7 3. Warsaw in 3 days 11 4. Royal Warsaw 19 5. Warsaw fights! 23 6. Warsaw Judaica 27 7. Fryderyk Chopin’s Warsaw 31 8. The Vistula ‘District’ 35 9. Warsaw Praga 39 10. In the footsteps of socialist-realist Warsaw 43 11. What to eat? 46 12. Where to eat? 49 13. Nightlife 53 14. Shopping 55 15. Cultural events 57 16. Practical information 60 1 WARSAW 1, 2, 3... 5 2 3 5 5 1 3 4 3 4 WARSAW IN 1 DAY Here are the top attractions that you can’t miss during a one-day trip to Warsaw! Start with a walk in the centre, see the UNESCO-listed Old Town and the enchanting Royal Łazienki Park, and at the end of the day relax by the Vistula River. -

The Use of the Polish Folk Music Elements and the Fantasy Elements in the Polish Fantasy on Original Themes In
THE USE OF THE POLISH FOLK MUSIC ELEMENTS AND THE FANTASY ELEMENTS IN THE POLISH FANTASY ON ORIGINAL THEMES IN G-SHARP MINOR FOR PIANO AND ORCHESTRA OPUS 19 BY IGNACY JAN PADEREWSKI Yun Jung Choi, B.A., M.M. Dissertation Prepared for the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS UNIVERSITY OF NORTH TEXAS May 2007 APPROVED: Adam Wodnicki, Major Professor Jeffrey Snider, Minor Professor Joseph Banowetz, Committee Member Graham Phipps, Director of Graduate Studies in the College of Music James C. Scott, Dean of the College of Music Sandra L. Terrell, Dean of the Robert B. Toulouse School of Graduate Studies Choi, Yun Jung, The Use of the Polish Folk Music Elements and the Fantasy Elements in the Polish Fantasy on Original Themes in G-sharp Minor for Piano and Orchestra, Opus 19 by Ignacy Jan Paderewski. Doctor of Musical Arts (Performance), May 2007, 105 pp., 5 tables, 65 examples, references, 97 titles. The primary purpose of this study is to address performance issues in the Polish Fantasy, Op. 19, by examining characteristics of Polish folk dances and how they are incorporated in this unique work by Paderewski. The study includes a comprehensive history of the fantasy in order to understand how Paderewski used various codified generic aspects of the solo piano fantasy, as well as those of the one-movement concerto introduced by nineteenth-century composers such as Weber and Liszt. Given that the Polish Fantasy, Op. 19, as well as most of Paderewski’s compositions, have been performed more frequently in the last twenty years, an analysis of the combination of the three characteristic aspects of the Polish Fantasy, Op.19 - Polish folk music, the generic rhetoric of a fantasy and the one- movement concerto - would aid scholars and performers alike in better understanding the composition’s engagement with various traditions and how best to make decisions about those traditions when approaching the work in a concert setting. -

Fredric Chopin
Music – Stories of Composers - Chopin Fredric Chopin The very night he was born, little Frederic Chopin heard music. Peasants from the neighborhood played a happy serenade outside the window of Madame Chopin’s room. They had brought their fiddles and horns, their singers and flutes, and the starry night air tingled with the gaiety of Polish songs and dances. It was February, 1810, in the village of Zelazowa-Wola, about thirty miles from Warsaw. Justine and Nicolas Chopin were happily married. Nicolas was French by birth and education; Justine was a beautiful Polish girl he had met when he came to work in Poland. The family atmosphere combined French and Polish language and customs. At the time of Frederic’s birth, his family lived a busy, stimulating life on a great country estate. There Nicolas tutored the children of a noble family. So Frederic Chopin was one of the few great composers who enjoyed a happy childhood with a comfortable home and loving parents. He also had two adoring older sisters. One day soon after the baby boy learned to crawl, Louise, the second sister, ran to her mother. “Mama, come quickly! Something must be wrong with Frederic. Yesterday and today, he crawls only as far as the piano. Then he sits there, not making a sound! He won’t move.” Madame Chopin picked up her skirts and ran. Frederic smiled when he saw his mother coming. Then he leaned as close to the piano strings as he could get, and listened intently. “Frederic, are you all right?” asked Madame Chopin, the way mothers always talk to babies, as if they could answer back. -

SPRING 2013 Allan Park – Northwest Chopin Council VOLUME XXIII/NUMBER 1 Scholarship Committee TABLE of CONTENTS Dr
The Semi-Annual Magazine of the Chopin Foundation of the USA CHOPIN FOUNDATION OF THE UNITED STATES, INC. Officers & Directors Krzysztof Penderecki Honorary Chairman Blanka A. Rosenstiel - Founder & President Olga Melin - Vice President Dr. William J. Hipp - Treasurer Rebecca Baez - Secretary Dr. Adam Aleksander - Artistic Advisor Jadwiga Viga Gewert - Executive Director Directors Agustin Anievas, , Roberta O. Chaplin, Douglas C. Evans, Rosa-Rita Gonzalez, Renate Ryan, Lorraine Sonnabend Regional Councils Mack McCray – San Francisco Chopin Council SPRING 2013 Allan Park – Northwest Chopin Council VOLUME XXIII/NUMBER 1 Scholarship Committee TABLE OF CONTENTS Dr. Adam Aleksander, Agustin Anievas, Dr. Hanna Cyba Message from the Founder and President ................................................................................... 2 Advisory Board Bonnie Barrett – Yamaha Artist Services Chopin Foundation Donors and Contributors ............................................................................... 3 Dr. Shelton Berg – University of Miami Frost School of Music Ron Losby – Steinway & Sons Message from the Executive Director .......................................................................................... 4 International Artistic Advisory Council Agustin Anievas, Martha Argerich, Emanuel Ax, Jeffrey N. Babcock, Highlights from our Recent Concerts ........................................................................................... 5 John Bayless, Luiz Fernando Benedini, John Corigliano, Ivan Davis, Christopher T. Dunworth, -

Fryderyk Franciszek Chopin
Fryderyk Franciszek Chopin A life-long nostalgia for Poland in compositions of the most outstanding Polish composer The first piece of music composed by Chopin was a Polonaise and the last one a Mazurka, both national Polish Dances. The two pieces are indicative of the composer’s love for his homeland, that is so often expressed in his music. Fryderyk Chopin was living in exile, and separation from Poland was the essence of his inspiration. Chopin was born in the village of Żelazowa Wola, on 1 March, 1810. His father, Mikołaj Chopin was French and came to Poland at the age of sixteen; his mother, Tekla Justyna Krzyżanowska was Polish. When Fryderyk was barely 1 year old the family moved to Warsaw. Chopin was exposed to music since his early childhood. His mother was a singer and played the piano, his father played the flute and violin, and his sister was a pianist. Young Fryderyk grew up with love and care and he had a happy childhood. At the age of 6, Chopin started regular piano classes. His teacher – Wojciech Żywny quickly realized that his student was extremely talented and therefore started grooming him in the skills of piano playing. He was introduced to the music of Johann Sebastian Bach and Wolfgang Amadeus Mozart. From the beginning Chopin revealed a sense of musical improvisation. His early compositions were mostly polonaises, marches and variations. His father would often help him in notating his musical ideas. As a young performer and composer, Fryderyk was hosted at the concerts of Warsaw’s aristocracy including noble families such as Czartoryscy or Zamoyscy. -
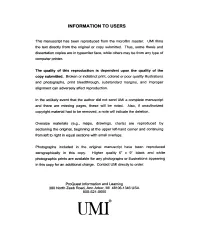
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6” x 9” black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. ProQuest Information and Leaming 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 UMI UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE A PEDAGOGICAL GUIDE TO THE 25 ETUDES MÉLODIQUES OPUS 45 OF STEPHEN HELLER A Document SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS By LARISSA MARIE KIEFER Norman, Oklahoma 2001 UMI Number: 3009547 UMI UMI Microform 3009547 Copyright 2001 by Bell & Howell Information and Leaming Company. -

Included Services: CHOPIN EXCLUSIVE TOUR / Tour CODE A
Included services: CHOPIN EXCLUSIVE TOUR / Tour CODE A-6 • accommodation at Sofitel Victoria, 5* hotel - Warsaw [4 nights including buffet breakfast] Guaranteed Date 2020 • transportation by deluxe motor coach (up to 49pax) or minibus (up to 19 pax) throughout all the tour • English speaking tour escort throughout all the tour Starting dates in Warsaw Ending dates in Warsaw • Welcome and farewell dinner (3 meals with water+ coffee/tea) Wednesday Sunday • Lunch in Restaurant Przepis na KOMPOT • local guide for a visits of Warsaw October 21 October 25 • Entrance fees: Chopin Museum, Wilanow Palace, POLIN Museum, Żelazowa Wola, Nieborow • Chopin concert in the Museum of Archdiocese • Chocolate tasting • Concert of Finalists of Frederic Chopin Piano Competition • Ballet performance or opera at the Warsaw Opera House Mazurkas Travel Exclusive CHOPIN GUARANTEED DEPARTURE TOUR OCTOBER 21-25 / 2020 Guaranteed Prices 2020 Price per person in twin/double room EUR 992 Single room supplement EUR 299 Mazurkas Travel T: + 48 22 536 46 00 ul. Wojska Polskiego 27 www.mazurkas.com.pl 01-515 Warszawa [email protected] October 21 / 2020 - Wednesday October 22 / 2015 - Thursday October 23 / 2020 - Friday October 24 / 2020 - Saturday WARSAW WARSAW WARSAW WARSAW-ZELAZOWA WOLA- WARSAW (Welcome dinner) (Breakfast) (Breakfast) (Breakfast, lunch & farEwell dinner) After arrival, you will be met and transferred to your hotel in See the Krasinski Palace with the Chopin Drawing Room Morning visit to one of the most splendid residence of Drive to Zelazowa Wola. This is where on February 22, 1810 the heart of the city. where Chopin performed his etudes, some polonaises, and Warsaw, the Wilanow Palace and Royal Gardens.