Rapport Final De L'évaluation Finale Washplus170316
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bulletin Sap N°377
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI ------------***------------ ------------***------------ COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi ------------***------------ SYSTEME D’ALERTE PRECOCE (S.A.P) BP. 2660, Bamako-Mali Tel :(223) 20 80 10 28 ; Adresse email : [email protected] /[email protected] Adresse Site Web : www.sapmali.com BULLETIN SAP N°377 Mars 2019 Présentation du Système d’Alerte Précoce (S.A.P) du MALI PRESENTATION DU SAP Le SAP est un système de collecte permanente d’informations sur la situation alimentaire. Sa mission consiste essentiellement à fournir à l’ensemble du système de sécurité alimentaire du pays les informations nécessaires à une affectation optimale du stock national de sécurité dans le cadre d'opérations d'aides alimentaires ciblées ou à une utilisation efficiente des fonds de sécurité alimentaire dans des actions d’atténuation d’insécurité alimentaire. Son objectif est de déterminer suffisamment à l'avance les populations les plus vulnérables risquant de connaître des difficultés alimentaires et/ou nutritionnelles, de dire les raisons du risque, de dire à partir de quand, pour combien de temps, avec quelle intensité et quelles sont les actions d’atténuation possibles. Les informations sont recueillies auprès des services administratifs, techniques, de la société civile et des élus locaux depuis les communes vers les chefs-lieux de cercles, les chefs-lieux de Régions et enfin Bamako. Au niveau de chaque chef-lieu de Région, l'équipe régionale SAP chargée du recueil des informations est appuyée par la Direction Régionale de la Planification, de la Statistique, de l’Informatique, de l’Aménagement du Territoire et de la Population. -

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune
FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune Effectiveness Prepared for United States Agency for International Development (USAID) Mali Mission, Democracy and Governance (DG) Team Prepared by Dr. Lynette Wood, Team Leader Leslie Fox, Senior Democracy and Governance Specialist ARD, Inc. 159 Bank Street, Third Floor Burlington, VT 05401 USA Telephone: (802) 658-3890 FAX: (802) 658-4247 in cooperation with Bakary Doumbia, Survey and Data Management Specialist InfoStat, Bamako, Mali under the USAID Broadening Access and Strengthening Input Market Systems (BASIS) indefinite quantity contract November 2000 Table of Contents ACRONYMS AND ABBREVIATIONS.......................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY............................................................................................... ii 1 INDICATORS OF AN EFFECTIVE COMMUNE............................................... 1 1.1 THE DEMOCRATIC GOVERNANCE STRATEGIC OBJECTIVE..............................................1 1.2 THE EFFECTIVE COMMUNE: A DEVELOPMENT HYPOTHESIS..........................................2 1.2.1 The Development Problem: The Sound of One Hand Clapping ............................ 3 1.3 THE STRATEGIC GOAL – THE COMMUNE AS AN EFFECTIVE ARENA OF DEMOCRATIC LOCAL GOVERNANCE ............................................................................4 1.3.1 The Logic Underlying the Strategic Goal........................................................... 4 1.3.2 Illustrative Indicators: Measuring Performance at the -

M700kv1905mlia1l-Mliadm22305
! ! ! ! ! RÉGION DE MOPTI - MALI ! Map No: MLIADM22305 ! ! 5°0'W 4°0'W ! ! 3°0'W 2°0'W 1°0'W Kondi ! 7 Kirchamba L a c F a t i Diré ! ! Tienkour M O P T I ! Lac Oro Haib Tonka ! ! Tombouctou Tindirma ! ! Saréyamou ! ! Daka T O M B O U C T O U Adiora Sonima L ! M A U R I T A N I E ! a Salakoira Kidal c Banikane N N ' T ' 0 a Kidal 0 ° g P ° 6 6 a 1 1 d j i ! Tombouctou 7 P Mony Gao Gao Niafunké ! P ! ! Gologo ! Boli ! Soumpi Koulikouro ! Bambara-Maoude Kayes ! Saraferé P Gossi ! ! ! ! Kayes Diou Ségou ! Koumaïra Bouramagan Kel Zangoye P d a Koulikoro Segou Ta n P c ! Dianka-Daga a ! Rouna ^ ! L ! Dianké Douguel ! Bamako ! ougoundo Leré ! Lac A ! Biro Sikasso Kormou ! Goue ! Sikasso P ! N'Gorkou N'Gouma ! ! ! Horewendou Bia !Sah ! Inadiatafane Koundjoum Simassi ! ! Zoumoultane-N'Gouma ! ! Baraou Kel Tadack M'Bentie ! Kora ! Tiel-Baro ! N'Daba ! ! Ambiri-Habe Bouta ! ! Djo!ndo ! Aoure Faou D O U E N T Z A ! ! ! ! Hanguirde ! Gathi-Loumo ! Oualo Kersani ! Tambeni ! Deri Yogoro ! Handane ! Modioko Dari ! Herao ! Korientzé ! Kanfa Beria G A O Fraction Sormon Youwarou ! Ourou! hama ! ! ! ! ! Guidio-Saré Tiecourare ! Tondibango Kadigui ! Bore-Maures ! Tanal ! Diona Boumbanke Y O U W A R O U ! ! ! ! Kiri Bilanto ! ! Nampala ! Banguita ! bo Sendegué Degue -Dé Hombori Seydou Daka ! o Gamni! d ! la Fraction Sanango a Kikara Na! ki ! ! Ga!na W ! ! Kelma c Go!ui a Te!ye Kadi!oure L ! Kerengo Diambara-Mouda ! Gorol-N! okara Bangou ! ! ! Dogo Gnimignama Sare Kouye ! Gafiti ! ! ! Boré Bossosso ! Ouro-Mamou ! Koby Tioguel ! Kobou Kamarama Da!llah Pringa! -

World Bank Document
PROCUREMENT PLAN (Textual Part) Project information: [Mali] [Reinsertion of Ex-Combatants Project] [P157233] Project Implementation agency: [Project Implementation Unit (PIU) of the National Disarmament, Demobilization, and Reinsertion Commission (NDDRC)] Public Disclosure Authorized Date of the Procurement Plan: [01/28/2018] Period covered by this Procurement Plan: [02/15/2018 to 07/28/2019] Preamble In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project. Public Disclosure Authorized This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP. The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP. National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables Public Disclosure Authorized in STEP), the country’s own procurement procedures may be used. When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the [Decree No. 2015-3721 /MEF-SG dated October 22, 2015], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

Bamako, Le 5 Avril 2017 Adama SISSOUMA Chevalier De L'ordre
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION REPUBLIQUE DU MALI TERRITORIAL, DE LA DECENTRALISATION Un Peuple-Un But-Une Foi ET DE LA REFORME DE L'ETAT *************** ******************* SECRETARIAT GENERAL ******************* LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ENSEIGNANT DANS LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PAR ORDRE DE MERITE Session de 2017 NIVEAU :ENSEIGNEMENT NORMAL SPECIALITE : Anglais PRENOMS NOM SEXE RANG REGION CENTRE SALLE PLACEN° LIEU_NAISS DATE_NAISS 1 9 Souleymane FOMBA M 00/00/1985 Decnekoro GS JEAN RICHARS 5 1 2 7 Moussa Hassane SIDIBE M Vers 1989 Ansongo GAO 10 2 Fe Bamako, Le 5 Avril 2017 P/MINISTRE P.O Le Secrétariat Général Adama SISSOUMA Chevalier de l'Ordre National Concours direct de recretement d' enseignants dans la fonction publique des collectivites territoriales, Enseignement Normal Anglais session 2017 1/1 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION REPUBLIQUE DU MALI TERRITORIAL, DE LA DECENTRALISATION Un Peuple-Un But-Une Foi ET DE LA REFORME DE L'ETAT *************** ******************* SECRETARIAT GENERAL ******************* LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ENSEIGNANT DANS LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PAR ORDRE DE MERITE Session de 2017 NIVEAU :ENSEIGNEMENT NORMAL SPECIALITE : Arabe PRENOMS NOM SEXE RANG REGION CENTRE SALLE PLACEN° LIEU_NAISS DATE_NAISS 1 9 Mahamadou KONTA M 20/05/1987 Bamako GS JEAN CHICHARD 7 25 2 9 Abdoul Hamid BENGALY M 00/001982 Kléla GS JEAN CHICHARD 7 5 3 9 Mouna Aïcha HAIDARA M 20/03/1984 BAMAKO GS JEAN CHICHARD -

Régions De SEGOU Et MOPTI République Du Mali P! !
Régions de SEGOU et MOPTI République du Mali P! ! Tin Aicha Minkiri Essakane TOMBOUCTOUC! Madiakoye o Carte de la ville de Ségou M'Bouna Bintagoungou Bourem-Inaly Adarmalane Toya ! Aglal Razelma Kel Tachaharte Hangabera Douekiré ! Hel Check Hamed Garbakoira Gargando Dangha Kanèye Kel Mahla P! Doukouria Tinguéréguif Gari Goundam Arham Kondi Kirchamba o Bourem Sidi Amar ! Lerneb ! Tienkour Chichane Ouest ! ! DiréP Berabiché Haib ! ! Peulguelgobe Daka Ali Tonka Tindirma Saréyamou Adiora Daka Salakoira Sonima Banikane ! ! Daka Fifo Tondidarou Ouro ! ! Foulanes NiafounkoéP! Tingoura ! Soumpi Bambara-Maoude Kel Hassia Saraferé Gossi ! Koumaïra ! Kanioumé Dianké ! Leré Ikawalatenes Kormou © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA N'Gorkou N'Gouma Inadiatafane Sah ! ! Iforgas Mohamed MAURITANIE Diabata Ambiri-Habe ! Akotaf Oska Gathi-Loumo ! ! Agawelene ! ! ! ! Nourani Oullad Mellouk Guirel Boua Moussoulé ! Mame-Yadass ! Korientzé Samanko ! Fraction Lalladji P! Guidio-Saré Youwarou ! Diona ! N'Daki Tanal Gueneibé Nampala Hombori ! ! Sendegué Zoumané Banguita Kikara o ! ! Diaweli Dogo Kérengo ! P! ! Sabary Boré Nokara ! Deberé Dallah Boulel Boni Kérena Dialloubé Pétaka ! ! Rekerkaye DouentzaP! o Boumboum ! Borko Semmi Konna Togueré-Coumbé ! Dogani-Beré Dagabory ! Dianwely-Maoundé ! ! Boudjiguiré Tongo-Tongo ! Djoundjileré ! Akor ! Dioura Diamabacourou Dionki Boundou-Herou Mabrouck Kebé ! Kargue Dogofryba K12 Sokora Deh Sokolo Damada Berdosso Sampara Kendé ! Diabaly Kendié Mondoro-Habe Kobou Sougui Manaco Deguéré Guiré ! ! Kadial ! Diondori -
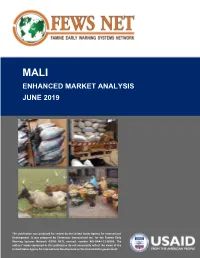
Mali Enhanced Market Analysis 2019
FEWS NET Mali Enhanced Market Analysis 2019 MALI ENHANCED MARKET ANALYSIS JUNE 2019 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Chemonics International Inc. for the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), contract number AID-OAA-I-12-00006. The authors’Famine views Early expressed Warning inSystem this publications Network do not necessarily reflect the views of the 1 United States Agency for International Development or the United States government. FEWS NET Mali Enhanced Market Analysis 2019 About FEWS NET Created in response to the 1984 famines in East and West Africa, the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) provides early warning and integrated, forward-looking analysis of the many factors that contribute to food insecurity. FEWS NET aims to inform decision makers and contribute to their emergency response planning; support partners in conducting early warning analysis and forecasting; and provide technical assistance to partner-led initiatives. To learn more about the FEWS NET project, please visit www.fews.net. Disclaimer This publication was prepared under the United States Agency for International Development Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) Indefinite Quantity Contract, AID-OAA-I-12-00006. The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States government. Acknowledgments FEWS NET gratefully acknowledges the network of partners in Mali who contributed their time, analysis, and data to make this report possible. Recommended Citation FEWS NET. 2019. Mali Enhanced Market Analysis. Washington, DC: FEWS NET. -

Jean GALLAIS (1967), Le Delta Intérieur Du Niger, Étude De Géographie Régionale, IFAN-Dakar, 2 Tomes, 621 Pages
Jean GALLAIS (1967), Le delta intérieur du Niger, étude de géographie régionale, IFAN-Dakar, 2 tomes, 621 pages. EXTRAITS… Pages 77-98 CHAPITRE III L’ÉTABLISSEMENT DES PEUPLES ET LEUR ORGANISATION POLITIQUE L’histoire événementielle fournit une des bases objectives de la connaissance régionale. L’ordre et les conditions de mise en place des divers peuples demeurent des faits majeurs d’organisation humaine actuelle, puisque faute d’assimilation réciproque, chacun d’eux a conservé personnalité. L’organisation politique, ou les désordres, expliquent largement, là comme ailleurs, les regroupements ou les lacunes du peuplement. Vouloir parler « objectivement » d’histoire est une entreprise partout délicate, et particulièrement difficile lorsque les archives sont orales. Les événements sont remémorés selon une chronique populaire, interprétative au plus haut point. Chacun des peuples de la région possède sa « geste ». Il raconte avec la fabulation minutieuse de la légende une époque qui dans le passé comme un corps dans le vide. Les déroulements antérieurs ou postérieurs demeurent obscurs, inintéressants, somme toute inexistants. Quelques sources écrites nous aident à réunir ces diverses chroniques en un rythme historique : tarikh arabes, récits des premiers voyageurs européens. Ils sont insuffisants pour compenser certaines lacunes et dans faisceau de traditions orales de longues nuits d’ignorance séparent certains épisodes fugitifs où l’histoire semble s’alourdir, s’accélérer. Cette discontinuité du temps résulte d’une volonté d’oubli qui efface de la mémoire collective certaines époques. Dans les derniers déroulements du passé cette volonté d’oubli s’affirme à deux reprises. Une première fois lorsque l’Islam triomphe dans la région au 19e siècle sous le règne de Cheikou-Ahmadou, la Dina 1 dont le début en 1818 est la véritable hégire régionale. -

Programme National De Developpement Des Plateformes Multifonctionnelles Pour La Lutte Contre La Pauvrete 2017 - 2021
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME RÉPUBLIQUE DU MALI DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SECRETARIAT GENERAL PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DES PLATEFORMES MULTIFONCTIONNELLES POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 2017 - 2021 Durée : 5 ans (2017 - 2021) Couverture géographique : Territoire National Coût de réalisation: 55 497 925 000 FCFA • Contribution du gouvernement : 8 558 525 000 FCFA • Contribution des bénéficiaires : 2 500 000 000 FCFA • Financements et Partenariats à rechercher : 44 439 400 000 FCFA Novembre 2016 Table des matières Sigles et Abréviations .......................................................................................................................................... 4 RESUME DU PROGRAMME ................................................................................................................... 6 Résumé exécutif .................................................................................................................................................. 7 1.2. Problématiques et enjeux ......................................................................................................................... 13 1.3. Objectifs de développement et cadrage politique .................................................................................... 14 II. STRATEGIES ET POLITIQUES NATIONALES ET SECTORIELLES ........................................................................... 15 2.1. Stratégies et Politiques nationales ............................................................................................................ -

Pnr 2015 Plan Distribution De
Tableau de Compilation des interventions Semences Vivrières mise à jour du 03 juin 2015 Total semences (t) Total semences (t) No. total de la Total ménages Total Semences (t) Total ménages Total semences (t) COMMUNES population en Save The Save The CERCLE CICR CICR FAO REGIONS 2015 (SAP) FAO Children Children TOMBOUCTOU 67 032 ALAFIA 15 844 BER 23 273 1 164 23,28 BOUREM-INALY 14 239 1 168 23,36 LAFIA 9 514 854 17,08 TOMBOUCTOU SALAM 26 335 TOMBOUCTOU TOTAL 156 237 DIRE 24 954 688 20,3 ARHAM 3 459 277 5,54 BINGA 6 276 450 9 BOUREM SIDI AMAR 10 497 DANGHA 15 835 437 13 GARBAKOIRA 6 934 HAIBONGO 17 494 482 3,1 DIRE KIRCHAMBA 5 055 KONDI 3 744 SAREYAMOU 20 794 1 510 30,2 574 3,3 TIENKOUR 8 009 TINDIRMA 7 948 397 7,94 TINGUEREGUIF 3 560 DIRE TOTAL 134 559 GOUNDAM 15 444 ALZOUNOUB 5 493 BINTAGOUNGOU 10 200 680 6,8 ADARMALANE 1 172 78 0,78 DOUEKIRE 22 203 DOUKOURIA 3 393 ESSAKANE 13 937 929 9,29 GARGANDO 10 457 ISSA BERY 5 063 338 3,38 TOMBOUCTOU KANEYE 2 861 GOUNDAM M'BOUNA 4 701 313 3,13 RAZ-EL-MA 5 397 TELE 7 271 TILEMSI 9 070 TIN AICHA 3 653 244 2,44 TONKA 65 372 190 4,2 GOUNDAM TOTAL 185 687 RHAROUS 32 255 1496 18,7 GOURMA-RHAROUS TOMBOUCTOU BAMBARA MAOUDE 20 228 1 011 10,11 933 4,6 BANIKANE 11 594 GOSSI 29 529 1 476 14,76 HANZAKOMA 11 146 517 6,5 HARIBOMO 9 045 603 7,84 419 12,2 INADIATAFANE 4 365 OUINERDEN 7 486 GOURMA-RHAROUS SERERE 10 594 491 9,6 TOTAL G. -

MID-TERM EVALUATION of MALI A.I. PROJECT 625-0937 Oc\ VILLAGE
-m MID-TERM EVALUATION OF MALI A.I. PROJECT 625-0937 Oc\ VILLAGE REFORESTATION Prepared for: USAID/BAMAKO AND THE GOVERNMENT ooc,| 5 OF THE REPUBLIC OF MALI By: George C. Taylor, Jr., Institutional Specialist Stanislaw Wellisz, Economist George Edward Karch, Forester International Science and Technology Institute, Inc. 2033 M Street, N.W. Suite 300 Washington, D.C. 20036 and Mohamed Ag Hamaty, Forester Direction Nationale des Eaux Forets DJeldi Sylla, Sociologist Bureau d'Etudes de Conseils et Interventions dans le Sahel July 1983 TABLE OF CONTENTS Page SUMMARY ... • • • • • • • • • • • • • .... • ........ ... • • • .... 1. INTRODUCTION ..... •.... ...... ....... ..... ...... .......... """ 1 2. ADMINISTRATIVE AND INSTITUTIONAL EVALUATION ........ ..... ...... • 7 3. FINANCIAL AND ECONOMIC EVALUATION .......... .o...,..... .......... 12 4. SOCIOLOGICAL EVALUATION ....................... • ........ .... .... 32 5. TECHNICAL EVALUATION ................ o.........o.......... .. 57 6. GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS ............. .........-... 94 ANNEX: ITINERARY OF THE EVALUATION TEAM -I- SUMMARY The Village Reforestation Project (A.I.P. 625-0937) is centered in Mopti and Bandiagara cercles of the 5th (Mopti) Region of Mali. The project is Innova tive in that it is the first attempt in the Sahelian zone (rainfall 400-600 mm annually) of Mali to carry out a projett in village sylviculture. Initiated in June 1981 with a proposed duration of 5 years, the project's goal is to contri bute to the rehabilitation of Mall's renewable resource base and thereby improve and protect the well-being of the rural population. Village level reforestation interventions provided for under the project will also contribute to the GRM's efforts to check the current trend toward environmental degradation marked by loss of natural vegetative cover and its wildlife habitat together with accelerated soil erosion.