10. Théories Et Doctrines De La Sécurité
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nuclear Weapon Producers
Chapter 2 Nuclear Weapon Producers Nuclear weapon producers in this report Aecom (United States) Alliant Techsystems (United States) Babcock & Wilcox (United States) Babcock International (United Kingdom) BAE Systems (United Kingdom) Bechtel (United States) Bharat Electronics (India) Boeing (United States) CH2M Hill (United States) EADS (Netherlands) Fluor (United States) Gencorp (United States) General Dynamics (United States) Honeywell International (United States) Huntington Ingalls (United States) Jacobs Engineering (United States) Larsen & Toubro (India) Lockheed Martin (United States) Northrop Grumman (United States) Rockwell Collins (United States) Rolls-Royce (United Kingdom) Safran (France) In some of the nuclear-armed states – especially the SAIC (United States) United States, the United Kingdom and France – Serco (United Kingdom) governments award contracts to private companies to Thales (France) ThyssenKrupp (Germany) carry out work on their nuclear arsenals. This report URS (United States) looks at 27 of those companies providing the necessary infrastructure to develop, test, maintain and modernise nuclear arsenals. They are involved in producing or maintaining nuclear weapons or significant, specific components thereof. The 27 companies described in this chapter are substantially involved in the nuclear weapons programmes of the United States, the United Kingdom, France, India or Israel and themselves based in the United States, the United Kingdom, France, the Netherlands, Germany and India. In other nuclear-armed countries – such as Russia, China, Pakistan and North Korea – the modernization of nuclear forces is carried out primarily or exclusively by government agencies. In those countries, the opportunities to achieve divestment through public campaigning are limited. A potentially more effective way to challenge investments in these nuclear industries would be through influencing budgetary decision-making processes in national legislatures. -
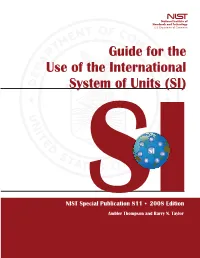
Guide for the Use of the International System of Units (SI)
Guide for the Use of the International System of Units (SI) m kg s cd SI mol K A NIST Special Publication 811 2008 Edition Ambler Thompson and Barry N. Taylor NIST Special Publication 811 2008 Edition Guide for the Use of the International System of Units (SI) Ambler Thompson Technology Services and Barry N. Taylor Physics Laboratory National Institute of Standards and Technology Gaithersburg, MD 20899 (Supersedes NIST Special Publication 811, 1995 Edition, April 1995) March 2008 U.S. Department of Commerce Carlos M. Gutierrez, Secretary National Institute of Standards and Technology James M. Turner, Acting Director National Institute of Standards and Technology Special Publication 811, 2008 Edition (Supersedes NIST Special Publication 811, April 1995 Edition) Natl. Inst. Stand. Technol. Spec. Publ. 811, 2008 Ed., 85 pages (March 2008; 2nd printing November 2008) CODEN: NSPUE3 Note on 2nd printing: This 2nd printing dated November 2008 of NIST SP811 corrects a number of minor typographical errors present in the 1st printing dated March 2008. Guide for the Use of the International System of Units (SI) Preface The International System of Units, universally abbreviated SI (from the French Le Système International d’Unités), is the modern metric system of measurement. Long the dominant measurement system used in science, the SI is becoming the dominant measurement system used in international commerce. The Omnibus Trade and Competitiveness Act of August 1988 [Public Law (PL) 100-418] changed the name of the National Bureau of Standards (NBS) to the National Institute of Standards and Technology (NIST) and gave to NIST the added task of helping U.S. -

Nuclear Warheads
OObservatoire des armes nucléaires françaises The Observatory of French Nuclear Weapons looks forward to the elimination of nuclear weapons in conformity with the aims of the Nuclear Non-Proliferation Treaty. To that end, the Observatory disseminates follow-ups of information in the forms of pamphlets and entries on the World Wide Web: • on the evolution of French nuclear forces; • on the on-going dismantling of nuclear sites, weapons, production facilities, and research; • on waste management and environmental rehabilitation of sites; • on French policy regarding non-proliferation; • on international cooperation (NGO’s, international organizations, nations), toward the elimination of nuclear weapons; • on the evolution of the other nuclear powers’ arsenals. The Observatory of French Nuclear Weapons was created at the beginning of the year 2000 within the Center for Documentation and Research on Peace and Conflicts (CDRPC). It has received support from the W. Alton Jones Foundation and the Ploughshares Fund. C/o CDRPC, 187 montée de Choulans, F-69005 Lyon Tél. 04 78 36 93 03 • Fax 04 78 36 36 83 • e-mail : [email protected] Site Internet : www.obsarm.org Dépôt légal : mai 2001 - 1ère édition • édition anglaise : novembre 2001 ISBN 2-913374-12-3 © CDRPC/Observatoire des armes nucléaires françaises 187, montée de Choulans, 69005 Lyon (France) Table of contents The break-down of nuclear disarmament ....................................................................................................................................... 5 The -

Assemblée Nationale Constitution Du 4 Octobre 1958
N° 260 —— ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2002. AVIS PRÉSENTÉ AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2003 (n° 230) TOME II DÉFENSE DISSUASION NUCLÉAIRE PAR M. ANTOINE CARRE, Député. —— Voir le numéro : 256 (annexe n° 40) Lois de finances. — 3 — S O M M A I R E _____ Pages INTRODUCTION ................................................................................................................................ 5 I. — UNE DISSUASION GARDANT UNE PLACE CENTRALE DANS LES STRATEGIES DE DEFENSE, MAIS DONT LE ROLE EVOLUE........................................................................................ 7 A. LA DISSUASION NUCLEAIRE AMERICAINE : UNE VOLONTE DE FLEXIBILITE ACCRUE .................................................................................................................................... 7 B. UNE INQUIETANTE PROLIFERATION BALISTIQUE ET NUCLEAIRE ................................... 10 C. LA DISSUASION NUCLEAIRE FRANÇAISE : UNE POSTURE ADAPTEE A L’EVOLUTION DE LA MENACE .............................................................................................. 15 1. Une dissuasion nécessaire pour faire face à l’imprévisible ........................................ 15 2. Un outil d’ores et déjà adapté ......................................................................................... 16 II. — UN BUDGET 2003 PERMETTANT LA POURSUITE DE LA MODERNISATION -

Ballistic, Cruise Missile, and Missile Defense Systems: Trade and Significant Developments, June 1994-September 1994
Missile Developments BALLISTIC, CRUISE MISSILE, AND MISSILE DEFENSE SYSTEMS: TRADE AND SIGNIFICANT DEVELOPMENTS, JUNE 1994-SEPTEMBER 1994 RUSSIA WITH AFGHANISTAN AND AFGHANISTAN TAJIKISTAN AUSTRALIA 8/10/94 According to Russian military forces in Dushanbe, the 12th post of the Moscow INTERNAL DEVELOPMENTS border troops headquarters in Tajikistan is INTERNAL DEVELOPMENTS attacked by missiles fired from Afghan ter- 9/27/94 ritory. The Russians respond with suppres- 7/94 Rocket and mortar attacks leave 58 people sive fire on the missile launcher emplace- It is reported that Australia’s University of dead and 224 wounded in Kabul. Kabul ment; no casualties are reported. Queensland can produce a scramjet air- radio attributes this attack to factions op- Itar-Tass (Moscow), 8/11/94; in FBIS-SOV-94-155, breathing engine, which may offer payload posing President Burhanuddin Rabbani. 8/11/94, p. 36 (4564). and cost advantages over conventional SLVs. More than 100 rockets and mortar shells Chris Schacht, Australian (Sydney), 7/20/94, p. 6; are fired on residential areas of Kabul by 8/27/94 in FBIS-EAS-94-152, 8/8/94, pp. 89-90 (4405). anti-Rabbani militia under the control of During the early morning hours, Tajik Prime Minister Gulbuddin Hekmatyar and Mujaheedin launch several missiles at the 7/94 northern warlord General Abdul Rashid Russian Frontier Guard observation posi- It is reported that the Australian government Dostam. tion and post on the Turk Heights in awarded Australia’s AWA Defence Industries Wall Street Journal, 9/28/94, p. 1 (4333). Tajikistan. The missiles are launched from (AWADI) a $17 million contract to produce the area of the Afghan-Tajik border and from the Active Missile Decoy (AMD) system, a Afghan territory, according to the second “hovering rocket-propelled anti-ship missile commander of Russian border guards in decoy system” providing for ship defense against sea-skimming missiles. -

Nuclear Futures: Western European Options for Nuclear Risk Reduction
Nuclear futures: Western European options for nuclear risk reduction Martin Butcher, Otfried Nassauer & Stephen Young British American Security Information Council and the Berlin Information-center for Transatlantic Security (BITS), December 1998 Contents Acronyms and Abbreviations Executive Summary Chapter One: Nuclear Weapons and Nuclear Policy in Western Europe Chapter Two: The United Kingdom Chapter Three: France Chapter Four: Nuclear Co-operation Chapter Five: NATO Europe Chapter Six: Nuclear Risk Reduction in Western Europe Endnotes About the authors Martin Butcher is the Director of the Centre for European Security and Disarmament (CESD), a Brussels-based non-governmental organization. Currently, he is a Visiting Fellow at BASIC’s Washington office. Otfried Nassauer is the Director of the Berlin Information-center for Transatlantic Security (BITS). Stephen Young is a Senior Analyst as BASIC. Previously, he worked for 20/20 Vision and for ACCESS: A Security Information Service. He has a Masters in International Affairs from Columbia University, and a BA from Carleton College. Acknowledgements The authors would like to thank the many people who pro-vided help of various kinds during the writing of this report. They include: Nicola Butler, for her inestimable assistance; Ambassador James Leonard, for his helpful comments on the report’s recommendations; Professors Paul Rogers and Patricia Chilton, for their comments on early drafts; Daniel Plesch, for his comments on the entire report; and Camille Grand, for his guidance and support in compiling the section on France. Special thanks to Lucy Amis and Tanya Padberg for excellent proofing and copy-editing work, and to Christine Kucia and Kate Joseph for advice and assistance on the layout and design of the report. -

Télécharger Au Format
N° 02/2017 recherches & documents janvier 2017 Impact économique de la filière industrielle « Composante océanique de la Dissuasion » Volet 2 HÉLÈNE MASSON, STÉPHANE DELORY WWW . FRSTRATEGIE . ORG Édité et diffusé par la Fondation pour la Recherche Stratégique 4 bis rue des Pâtures – 75016 PARIS ISSN : 1966-5156 ISBN : 978-2-911101-95-3 EAN : 9782911101953 WWW.FRSTRATEGIE.ORG 4 B I S , RUE DES P ATURES 7 50 16 P ARIS TÉL.01 43 13 77 77 FAX 01 43 1 3 77 78 SIRET 394 095 533 00045 TVA FR74 394 095 533 CODE APE 7220Z FONDATION RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE – DÉCRET DU 26 FÉVRIER 1993 Impact économique de la filière industrielle « Composante océanique de la Dissuasion ». Volet 2. Plan 1. Fondamentaux politiques, budgétaires et industriels 5 1.1. Politique de dissuasion 6 1.2. Cinq décennies d’effort de la Nation 10 1.3. Conception, production, mise en œuvre, et entretien de l’outil de dissuasion : le choix de 12 l’indépendance et de l’autonomie 1.4. La France dans le cercle restreint des États producteurs et opérateurs de SNLE et de MSBS 12 2. Des filières industrielles atypiques 14 2.1. Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre : une gouvernance originale 14 2.1.1. L’organisation Cœlacanthe 14 2.1.2. Maîtrise d’œuvre industrielle : quatre chefs de file 15 2.2. Entre exigences de performances et contraintes liées au domaine Dissuasion 18 2.3. Spécificité et criticité des compétences 18 2.3.1. Principaux domaines techniques 18 2.3.2. Savoir-faire en matière de conception et de développement 22 2.3.3. -

Maize Treatments Production Value, Income M1 M2 M3 M4 $/Ha
Table S1. Costs of variable inputs, including seed, hopper seed treatments, (inoculant for conventional soybean and SaBrex for organic crops), starter fertilizer, N fertilizer, herbicide, and fungicide in conventional and/or organic soybean in 2017 and 2018, maize in 2017, and wheat in 2018. Input Conventional Organic $ Soybean Seed/140,000 84.50 (including seed treatment) 52.50 Seed Treatment 52.25/g (Cell-Tech inoculant) 200/g (SaBrex) Herbicide 295/L (Glyphosate) - Fungicide 2170/L (Fluxapyroxad + Pyraclostrobin) - Maize Seed/80,000 335 (including seed treatment) 245 Seed Treatment 200/g (SaBrex) Starter Fertilizer 460/tonne (Mg) 325/tonne (Mg) Side-dress N 1.10/kg N 12.76/kg N Herbicide 288/L (Glyphosate) Wheat Seed/bag 31 (including seed treatment) 24 Seed Treatment 200/g (Sabrex) Starter Fertilizer 480/tonne (Mg) 330/tonne (Mg) Herbicide 276/mL (thifensulfuron + tribenuron) Top-dress N 1.09/kg N 13.05/kg N Fungicide 1325/L (Prothioconazole + Tebuconazole) Table S2. Income, selected production costs, and returns above selected production costs for conventional maize with recommended management (M1) and high input management (M2) and organic maize with recommended management (M3) and high input management (M4) in a soybean-wheat/red clover-maize- soybean rotation, and conventional maize with recommended management (M5) and high input management (M6) and organic maize with recommended management (M7) and high input management (M8) in a maize-soybean-maize-soybean rotation at a Cornell University Research Farm in central New York, USA -

US FOLICY Ron EBPLOYHENT of NUCLEJ..R 1-:EAFONS
July 7, \ US FOLICY ron EBPLOYHENT OF NUCLEJ..R 1-:EAFONS In January, 1972, a DoD panel, chaired by Dr. Foster, was established t.::> rcvie\"' US nuclear weapon employme!lt policy. In Nay, 1972, this panel forwarded to the Secretary of Defense the initial results of this review, including a drat.'t of "Tentative Policy Guidance for the Employment of Nuclear Weapons". The major features of this Tentative Policy Guidance are mur.marized belovT and compared with the current policyi - issues- arid ··· -··-·-· ·· actions for consideration by t he Secretary of Defense are thr:in-hi"gnligtii:.ea: A more detailed discussion is contained in the panel's report, "Review o.f U:.:i PoLley for the ·Employment of Nuclear Weapons." It ( should be noted that the panel addressed the employment of current and near-term US nuclear forces, not t.be design and posture of these forces. Current Employment Policy ~- -·- -· - . - ~---- - - - · - - · -·--------· The Panel reviewed US and NATO docume:1ts and t·ound -r.nat the L________l National Strategic 'l'argeting and Attack Poiicy ·(NSTAP)","prepared.". bythe___ JCS, is the only source of definitive policy for the employment of US nuclear ~eapons. The currently effective NSTAP and a revision prepared by the JCS for consideratj_on by tbe Foster Panel are summarized in this section. A. Current NSTAP The fundamental concept of the current .NST:\P is to maxuuze U.S. power so as to attain and maintain a strategic superiority which will lead to an early termination of a nuclear war on terms favorable to the United States and its allies. To implement this concept, the NSTAP calls for e~ployment of forces in the Single Integrated Operational Plan (SIOP) to meet the following objectives: 1. -

Appendix 12A. World Nuclear Forces, 2005
Appendix 12A. World nuclear forces, 2005 SHANNON N. KILE and HANS M. KRISTENSEN* I. Introduction A decade and a half after the end of the cold war, eight states deploy more than 13 000 operational nuclear weapons (see table 12A.1). If all warheads are counted— operational warheads, spares, and those in both active and inactive storage—the eight states possess a total of roughly 27 600 warheads. In addition to these intact weapons, thousands more plutonium cores (pits) are stored as a strategic reserve. The nuclear arsenals vary in both size and capability, ranging from Russia’s 7360 operational weapons to those of India and Pakistan, whose combined arsenal still contains fewer than 100 warheads. Despite their different circumstances, however, all the eight states continue to maintain and modernize their arsenals and insist, publicly or covertly, that nuclear weapons play a crucial and enduring role for their national security. Both Russia and the United States are in the process of reducing their operational nuclear forces under the terms of the 1991 START I Treaty and the 2002 Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT).1 China, India and Pakistan, on the other hand, may increase their arsenals somewhat over the next decade. France appears to have reached an equilibrium of some sort in the size of its arsenal, while the United King- dom will soon face a decision about the future of its nuclear arsenal. When the current Russian and US reductions have been completed, in 2012, these eight states (assuming no others have joined the ‘nuclear club’) will still possess a total of about 14 000 intact nuclear warheads. -
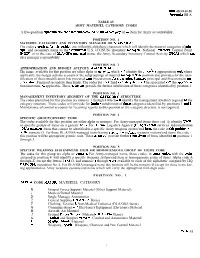
Item for Army Accountability, the Codes Presc@B@For @ P
DoD 41OO.38-M Appendix HI A TABLE 65 ARMY MATERIEL CATEGORY CODES A five-position alph~umeric code that indi~tes the finmci~ wtegory of ~ item for Army accountability, POSITION NO. 1 MATERIEL CATEGORY AND INVENTORY MANAGER OR NICP/SICA: The codes presc@b@for @ p.wition are, inflexible alphabetic characters which will identify the materiel categories of prin- cipal and secondary items to the Continen@ U.S. (CONUS) inventory mm~ers, National Invenbry Control Point (NICP), or in the case of DLA/GSA-managed items, the Army Secondary Inventory Control Activity (SICA) which exer- ekes manager responsibility. POSITION NO. 2 APPROPRIATION AND BUDGET ACTIVITY ACCOUNT& *. The codes available for this position are either alpha or numeric, which will identify the procu& appropriation ~d, where applicable, the budget activity account or the subgroupings of materiel m~ed. fiis position also providea for the iden- tification of those modification kits procured with Procurement Appropriation Financed principal and Procurement @- propriation Financed secondary item funds. The codes for stock fund second~y items wiU be associated with the aPpropna- 4 tion limitation, as applicable. These codes will provide for further subdivision of those categories identified by position 1. POSITION NO. 3 MANAGEMENT INVENTORY SEGMENT OF THE CATEGORY STRUCTURE The codes prescribed for this position are numeric 1 through 4 which will identif y the management inventory segment of the category structure. These codes will provide for further subdivision of those categories identified by positions 1 ~d 2. Maintenance of control accounts for recurring reports to this position of the category structure is not required. -

Getting Mad: Nuclear Mutual Assured Destruction, Its Origins and Practice
GETTING MAD: NUCLEAR MUTUAL ASSURED DESTRUCTION, ITS ORIGINS AND PRACTICE Edited by Henry D. Sokolski November 2004 Visit our website for other free publication downloads Strategic Studies Institute Home To rate this publication click here. ***** The views expressed in this report are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of the Department of the Army, the Department of Defense, or the U.S. Government. This report is cleared for public release; distribution is unlimited. ***** This the fifth in a series of books the Nonproliferation Policy Education Center (NPEC) has published in cooperation with the Army War College’s Strategic Studies Institute (SSI). As with the previous NPEC-SSI volumes, this received the backing of the U.S. Air Force’s Institute for National Security Studies. Besides the contributions of the chapters’ authors, Getting MAD would not have been possible without the editorial and administrative support of Carly Kinsella and Anne Hainsworth of NPEC. In addition, the assistance of Vance Serchuk of the American Enterprise Institute, Ed Petersen of NPEC, and Marianne Cowling of SSI were critical to the volume’s completion. To all who helped make this book possible, NPEC and SSI are indebted. ***** Comments pertaining to this report are invited and should be forwarded to: Director, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 122 Forbes Ave, Carlisle, PA 17013-5244. Copies of this report may be obtained from the Publications Office by calling (717) 245-4133, FAX (717) 245-3820, or by e-mail at [email protected] ***** All Strategic Studies Institute (SSI) monographs are available on the SSI homepage for electronic dissemination.