L'appropriation Du Langage Du Colonisateur, Une Lecture Du
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Références De Livres, Films, Thèses, Périodiques & Articles Ou Textes Courts
Interrogation de la banque de données Limag le mercredi 11 janvier 2006 Références de livres, films, thèses, périodiques & articles ou textes courts N.B.: Sur écran, déplacez-vous d'une page à l'autre du résultat avec les boutons fléchés en haut d'écran, et dans la page avec l'"ascenseur" sur la droite. Les liens indiqués en brun permettent d'ouvrir directement la référence sur Internet quand on est sur son ordinateur. Pour signaler d'autres références ou des erreurs, envoyer un e-mail au responsable du site Limag en cliquant sur: http://www.limag.com/Versmail.htm Pour aller à la page d'accueil du site Limag (Littératures du Maghreb), cliquez sur www.limag.com Copyright Charles Bonn & CICLIM 12 X 2. Poésie contemporaine de deux Pays: Algérie/Belgiqu rives. Revue annuelle de la Fondation Mahmoud Boucebci. Alger/Namur, Fondation Mahmoud Boucebci, 2003 ISSN 1112-5802 Revue annuelle. A Review of theory and literary criticism. Pays: U.S.A. Madison, The University of Wisconsin Press, n.d. Périodique. Numéro: 69 1992 BENSMAIA, R. p. 103-114. Writing Metafiction: Khatibi's "Le Livre du sang". Anglais Numéro: 73 1994 BEEBEE, Thomas-O. p. 63-78. The Fiction of translation: Abdelkébir Khatibi's "Love in two languages". (Le roman de la traduction: "Amour bilingue" d'A. Khatibi. Anglais A.L.A. Bulletin. Pays: U.S.A. A Publication of the African Literature Association. African Literature Association. n.c. Périodique. Numéro: 24: 4, Automne 1998 BEN JELLOUN, Tahar. GRAY, Stephen. (interv.). p. 16-17. Tahar Ben Jelloun, interview. Interview Anglais Numéro: 25: 3, Eté 1999 LAABI, Abdellatif. -
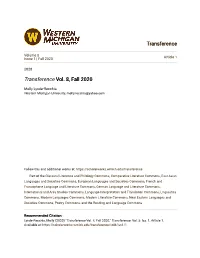
Transference</Em> Vol. 8, Fall 2020
Transference Volume 8 Issue 1 | Fall 2020 Article 1 2020 Transference Vol. 8, Fall 2020 Molly Lynde-Recchia Western Michigan University, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.wmich.edu/transference Part of the Classical Literature and Philology Commons, Comparative Literature Commons, East Asian Languages and Societies Commons, European Languages and Societies Commons, French and Francophone Language and Literature Commons, German Language and Literature Commons, International and Area Studies Commons, Language Interpretation and Translation Commons, Linguistics Commons, Modern Languages Commons, Modern Literature Commons, Near Eastern Languages and Societies Commons, Poetry Commons, and the Reading and Language Commons Recommended Citation Lynde-Recchia, Molly (2020) "Transference Vol. 8, Fall 2020," Transference: Vol. 8: Iss. 1, Article 1. Available at: https://scholarworks.wmich.edu/transference/vol8/iss1/1 Vol. 8 Fall 2020 Transference Fall 2020 We gratefully acknowledge support from Emily Transference features poetry translated from Arabic, Brooks Rowe and from the College of Arts and Chinese, French, Old French, German, Classical Greek, Latin, Sciences at Western Michigan University. and Japanese into English as well as short commentaries on the We would also like to express our appreciation to process and art of translation. Selection is made by double-blind Rosamond Robbert and to Thomas Krol. review. For submission guidelines, visit us online at: scholarworks.wmich.edu/transference ISSN (print): 973-2325-5072 ISSN (online): 2325-5099 © Transference 2020 Cover: “Reflections” by Paul Robbert Globe image © Don Hammond/Design Pics/Corbis Department of World Languages and Literatures College of Arts and Sciences Western Michigan University This issue was printed by McNaughton and Gunn using Georgia, Segoe Script, MS Mincho, SimSun, and Gabriola fonts. -

July, 7–14 2012 an École De Littérature Program Maison Du Banquet & Des
July, 7–14 2012 an école de littérature program Maison du Banquet & des générations Abbaye de Lagrasse – France Call for applications C M J N Call for applications The école de littérature invites young authors, translators, students, literary agents, and all those excited about contemporary literary creation, to apply to participate in a translation residency that will take place in Lagrasse (France), July 7-14, 2012. The residency will bring together writers, translators and scholars from the United States, Morocco and France. Applications should consist of a cover letter, CV and potentially, samples of translations and writing, to be emailed to [email protected] Approximately 20 spaces are available for the 2012 session. Resident writers and workshop leaders: Sinan Antoon, Latifa Baqa, Omar Berrada, Jocelyn Bonnerave, Siham Bouhlal, Abdelmounem Chentouf, Robyn Creswell, Anissa Derrazi, Mohamed Elkhadiri, Mohamed Hmoudane, Bernard Hoepffner, Hugues Jallon , Laird Hunt, Sarah Riggs, Lily Robert-Foley, David Ruffel, Lionel Ruffel, Tiphaine Samoyault, Kenza Sefrioui, Eleni Sikelianos, Camille de Toledo, Hamid Zaid, Abdallah Zrika, etc. TRANSLATIONS July 7-14 2012 L’ÉCOLE DE LITTÉRATURE Abbaye de Lagrasse 25 rue des Bruyères, 93260 Les Lilas http://ecoledelitterature.blogspot.com/ Translations is the first installment in a series of exchanges [email protected] proposed by the école de littérture, between authors, scholars, translators and students from the U.S., Morocco and France. It will take place in Lagrasse, Casablanca and then New York in 2012-2013. It begins with a translation residency in Lagrasse, France, from July 7-14, 2012. Applicants selected to participate in this residency will work with experienced translators and writers on untranslated texts and authors, as well as on a variety of experimental projects. -

<Em>Drops from Black Candles</Em> by Abdallah Zrika
Transference Volume 8 Issue 1 | Fall 2020 Article 16 2020 Drops from black candles by Abdallah Zrika Mike Baynham [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.wmich.edu/transference Part of the Classical Literature and Philology Commons, Comparative Literature Commons, East Asian Languages and Societies Commons, European Languages and Societies Commons, French and Francophone Language and Literature Commons, German Language and Literature Commons, International and Area Studies Commons, Language Interpretation and Translation Commons, Linguistics Commons, Modern Languages Commons, Modern Literature Commons, Near Eastern Languages and Societies Commons, Poetry Commons, and the Reading and Language Commons Recommended Citation Baynham, Mike (2020) "Drops from black candles by Abdallah Zrika," Transference: Vol. 8: Iss. 1, Article 16. Available at: https://scholarworks.wmich.edu/transference/vol8/iss1/16 Mike Baynham Abdallah Zrika Drops from black candles Qaṭarātu šumūʿin sawdāʾi I So I blew out the candle to light the darkness And I saw the sun cut off from the light And I saw doors and I didn’t see the houses And butterflies emerging from maggots that writhed in corpses And I was afraid my face might be another’s face stuck onto mine Struck with fear when I saw my leg resting on scorpions And when I got to water I searched for a mouth in the earth And all I found was an earth looking like a tortoise shell FALL 2020 83 And I cried out: Hell is all that is left of Heaven Heaven annihilated only -

Dossier Littérature Marocaine : Des Littératures D'affirmation Par Kenza Sefrioui, Amélie Boutet, Le
Dossier Littérature marocaine : des littératures d’affirmation par Kenza Sefrioui, Amélie Boutet, le 24.02.2017 dans LIVRESHEBDO La Bibliothèque nationale du royaume du Maroc (BNRM), à Rabat. - NAWAL BENNANI/CC Jeune et riche de ses nombreuses langues, la littérature marocaine brille mais peine à rayonner depuis le Maroc. Tour d’horizon de la première littérature arabe et africaine à l’honneur lors de Livre Paris, du 24 au 27 mars prochain. Qu’est-ce que la littérature marocaine ? La question se pose depuis à peine une cinquantaine d’années. Durant les années 1960, une première génération d’écrivains a regardé le travail des pionniers des années 1940, mais c’était alors plus largement l’appartenance maghrébine qui était mise en avant. Il a fallu attendre les années 1980 pour qu’on pense la littérature marocaine dans un cadre national. Deuil du rêve d’un Maghreb uni ? Apparition de structures éditoriales qui ont permis au Maroc de se doter des prémices d’une industrie du livre ? L’émergence de voix littéraires se définissant comme marocaines est indissociable de l’affirmation du Maroc comme pays indépendant - affirmation d’abord politique, avec la sortie de l’empire colonial français après quarante-quatre ans de protectorat (1912-1956), affirmation culturelle également par rapport aux grands pôles historiques de production du livre, le Moyen-Orient et la France. Et c’est cette dynamique qui marque cette production jeune et déjà jalonnée de grands noms et de grands textes. Littérature plurielle "Sans doute faudrait-il parler des littératures marocaines plutôt que de la littérature marocaine", remarque l’écrivain et critique littéraire Salim Jay (né en 1951) dans l’introduction à son Dictionnaire des écrivains marocains (Eddif/Paris Méditerranée, 2005), indispensable viatique pour qui veut se plonger dans cet univers.