Les Étoiles Variables
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Naming the Extrasolar Planets
Naming the extrasolar planets W. Lyra Max Planck Institute for Astronomy, K¨onigstuhl 17, 69177, Heidelberg, Germany [email protected] Abstract and OGLE-TR-182 b, which does not help educators convey the message that these planets are quite similar to Jupiter. Extrasolar planets are not named and are referred to only In stark contrast, the sentence“planet Apollo is a gas giant by their assigned scientific designation. The reason given like Jupiter” is heavily - yet invisibly - coated with Coper- by the IAU to not name the planets is that it is consid- nicanism. ered impractical as planets are expected to be common. I One reason given by the IAU for not considering naming advance some reasons as to why this logic is flawed, and sug- the extrasolar planets is that it is a task deemed impractical. gest names for the 403 extrasolar planet candidates known One source is quoted as having said “if planets are found to as of Oct 2009. The names follow a scheme of association occur very frequently in the Universe, a system of individual with the constellation that the host star pertains to, and names for planets might well rapidly be found equally im- therefore are mostly drawn from Roman-Greek mythology. practicable as it is for stars, as planet discoveries progress.” Other mythologies may also be used given that a suitable 1. This leads to a second argument. It is indeed impractical association is established. to name all stars. But some stars are named nonetheless. In fact, all other classes of astronomical bodies are named. -
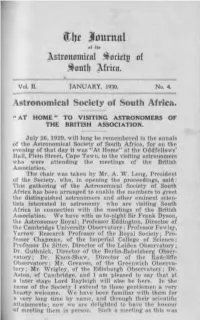
Assaj V2 N4 1930-Jan
ijtlJt Journal {If tl]t J\.strauamital ~ add!,! af ~ autb J\.frita. Vol. II. JANUARY, 1930. No.4. Astronomical Society of South Africa~ "' AT HOME" TO VISITING ASTRONOMERS OF THE BRITISH ASSOCIATION. July 26, 1929, will long be remembered in the annals of the Astronomical Society of South Africa, for on the evening of that day it was "At Home" at the Oddfellows' Hall, Plein Street, Cape Town, to the visiting astronomers who were attending the meetings of the British Association. The chair was taken by Mr. A. W. Long, President of the Society, who, in opening the proceedings, said: This gathering of the Astronomical Society of South Africa has been arranged to enable the members to greet the distinguished astronomers and other eminent scien tists interested in astronomy who are visiting South Africa in connection with the meetings of the British Association. We have with us to-night Sir Frank Dyson, the Astronomer Royal; Professor Eddington, Director of the Cambridge University Observatory; Professor Fowl~r, Yarrow Research Professor of the Royal Society; Pro fessor Chapman, of the Imperial College of Science; Professor De Sitter, Director of the Leiden Observatory; Dr. Guthnick, Director of the Berlin-Babelsberg Obser vatory; Dr. K110x-Shaw, Director of the Radcliffe Observatory; Mr. Greaves, of the Greenwich Observa tory; Mr. Wrigley, of the Edinburgh Observatory; Dr. Aston, of Cambridge, and I am pleased to say that at a later stage Lord Rayleigh will also be here. In the name of the Society I extend to these gentlemen a very hearty welcome. We have been familiar with them for a very long time by name, and through their scientific attainments; now we are delighted to have the honour of meeting them in person. -

Disertaciones Astronómicas Boletín Número 55 De Efemérides Astronómicas 28 De Octubre De 2020
Disertaciones astronómicas Boletín Número 55 de efemérides astronómicas 28 de octubre de 2020 Realiza Luis Fernando Ocampo O. ([email protected]). Noticias de la semana. Osiris–Rex y el astroide Bennu. Imagen 1: Estas imágenes muestran los cuatro sitios de recolección de muestras candidatos en el asteroide Bennu: Nightingale, Kingfisher, Osprey y Sandpiper. Imagen: NASA / / Goddard / Universidad de Arizona. La misión OSIRIS-REx de la NASA está realizó un almacenamiento temprano el martes 27 de octubre de la gran muestra que recolectó la semana pasada de la superficie del asteroide Bennu para proteger y devolver la mayor cantidad posible de muestra. Su capacidad es hasta 2 kg. El 22 de octubre, el equipo de la misión OSIRIS-REx recibió imágenes que mostraban que la cabeza recolectora de la nave espacial rebosaba de material recolectado de la superficie de Bennu, muy por encima del requisito de la misión de dos onzas (60 gramos), y que algunas de estas partículas parecían estar escapar lentamente del cabezal de recolección, llamado Mecanismo de adquisición de muestras Touch-And-Go (TAGSAM). Una solapa de mylar en el TAGSAM permite que el material entre fácilmente en el cabezal del colector y debe sellar para cerrar una vez que las partículas pasan. Sin embargo, las rocas más grandes que no pasaron completamente a través de la solapa hacia el TAGSAM parecen haber abierto esta solapa, lo que permitió que se filtraran fragmentos de la muestra. Debido a que el primer evento de recolección de muestras fue tan exitoso, la Dirección de Misiones Científicas de la NASA le ha dado al equipo de la misión el visto bueno para acelerar el almacenamiento de muestras, originalmente programado para el 2 de noviembre, en la Cápsula de Retorno de Muestras (SRC) de la nave espacial para minimizar una mayor pérdida de muestras. -

Executive Summary
The Boston University Astronomy Department Annual Report 2010 Chair: James Jackson Administrator: Laura Wipf 1 2 TABLE OF CONTENTS Executive Summary 5 Faculty and Staff 5 Teaching 6 Undergraduate Programs 6 Observatory and Facilities 8 Graduate Program 9 Colloquium Series 10 Alumni Affairs/Public Outreach 10 Research 11 Funding 12 Future Plans/Departmental Needs 13 APPENDIX A: Faculty, Staff, and Graduate Students 16 APPENDIX B: 2009/2010 Astronomy Graduates 18 APPENDIX C: Seminar Series 19 APPENDIX D: Sponsored Project Funding 21 APPENDIX E: Accounts Income Expenditures 25 APPENDIX F: Publications 27 Cover photo: An ultraviolet image of Saturn taken by Prof. John Clarke and his group using the Hubble Space Telescope. The oval ribbons toward the top and bottom of the image shows the location of auroral activity near Saturn’s poles. This activity is analogous to Earth’s aurora borealis and aurora australis, the so-called “northern” and “southern lights,” and is caused by energetic particles from the sun trapped in Saturn’s magnetic field. 3 4 EXECUTIVE SUMMARY associates authored or co-authored a total of 204 refereed, scholarly papers in the disciplines’ most The Department of Astronomy teaches science to prestigious journals. hundreds of non-science majors from throughout the university, and runs one of the largest astronomy degree The funding of the Astronomy Department, the Center programs in the country. Research within the for Space Physics, and the Institute for Astrophysical Astronomy Department is thriving, and we retain our Research was changed this past year. In previous years, strong commitment to teaching and service. only the research centers received research funding, but last year the Department received a portion of this The Department graduated a class of twelve research funding based on grant activity by its faculty. -

Information Bulletin on Variable Stars
COMMISSIONS AND OF THE I A U INFORMATION BULLETIN ON VARIABLE STARS Nos November July EDITORS L SZABADOS K OLAH TECHNICAL EDITOR A HOLL TYPESETTING K ORI ADMINISTRATION Zs KOVARI EDITORIAL BOARD L A BALONA M BREGER E BUDDING M deGROOT E GUINAN D S HALL P HARMANEC M JERZYKIEWICZ K C LEUNG M RODONO N N SAMUS J SMAK C STERKEN Chair H BUDAPEST XI I Box HUNGARY URL httpwwwkonkolyhuIBVSIBVShtml HU ISSN COPYRIGHT NOTICE IBVS is published on b ehalf of the th and nd Commissions of the IAU by the Konkoly Observatory Budap est Hungary Individual issues could b e downloaded for scientic and educational purp oses free of charge Bibliographic information of the recent issues could b e entered to indexing sys tems No IBVS issues may b e stored in a public retrieval system in any form or by any means electronic or otherwise without the prior written p ermission of the publishers Prior written p ermission of the publishers is required for entering IBVS issues to an electronic indexing or bibliographic system to o CONTENTS C STERKEN A JONES B VOS I ZEGELAAR AM van GENDEREN M de GROOT On the Cyclicity of the S Dor Phases in AG Carinae ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : J BOROVICKA L SAROUNOVA The Period and Lightcurve of NSV ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: W LILLER AF JONES A New Very Long Period Variable Star in Norma ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: EA KARITSKAYA VP GORANSKIJ Unusual Fading of V Cygni Cyg X in Early November ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -

Morphology and Kinematics of the Gas Envelope of the Mira Binary W Aquilae 3
Research in Astron. Astrophys. Vol.0 (200x) No.0, 000–000 Research in http://www.raa-journal.org http://www.iop.org/journals/raa Astronomy and Astrophysics Morphology and kinematics of the gas envelope of the Mira binary W Aquilae ⋆ D. T. Hoai, P. T. Nhung, P. N. Diep, N. T. Phuong, P. Tuan-Anh, N. T. Thao and P. Darriulat Department of Astrophysics, Vietnam National Satellite Center, VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam; [email protected] Abstract We analyse ALMA observations of the 12CO(3-2) emission of the circumstellar envelope (CSE) of the Mira variable binary star W Aql. These provide, for the first time, spatially resolved Doppler velocity spectra of the CSE up to angular distances to the central star of ∼ 5′′ (meaning some 2000 AU). The exploratory nature of the observations (only five minutes in each of two different configurations) does not allow for a detailed modelling of the properties of the CSE but provides important qualitative information on its morphology and kinematics. Emission is found to be enhanced along an axis moving from east/west to north-east/south-west when the angular distance from the central star projected on the plane of the sky increases from zero to four arcseconds. In parallel, the Doppler velocity distribution displays asymmetry along an axis moving from east/west to north-west/south-east. The results are discussed in the context of earlier observations, in particular of the dust morphology. Key words: stars: AGB and post-AGB − (Star:) circumstellar matter − Star: individual (W Aql) − Stars: mass-loss − radio lines: stars. -

Agrarian Metaphors 397
396 Agrarian Metaphors 397 The Bible provided homilists with a rich store of "agricultural" metaphors and symbols) The loci classici are passages like Isaiah's "Song of the Vineyard" (Is. 5:1-7), Ezekiel's allegories of the Tree (Ez. 15,17,19:10-14,31) and christ's parables of the Sower (Matt. 13: 3-23, Mark 4:3-20, Luke 8:5-15) ,2 the Good Seed (Matt. 13:24-30, Mark 4:26-29) , the Barren Fig-tree (Luke 13:6-9) , the Labourers in the Vineyard (Matt. 21:33-44, Mark 12:1-11, Luke 20:9-18), and the Mustard Seed (Matt. 13:31-32, Mark 4:30-32, Luke 13:18-19). Commonplace in Scripture, however, are comparisons of God to a gardener or farmer,5 6 of man to a plant or tree, of his soul to a garden, 7and of his works to "fruits of the spirit". 8 Man is called the "husbandry" of God (1 Cor. 3:6-9), and the final doom which awaits him is depicted as a harvest in which the wheat of the blessed will be gathered into God's storehouse and the chaff of the damned cast into eternal fire. Medieval scriptural commentaries and spiritual handbooks helped to standardize the interpretation of such figures and to impress them on the memories of preachers (and their congregations). The allegorical exposition of the res rustica presented in Rabanus Maurus' De Universo (XIX, cap.l, "De cultura agrorum") is a distillation of typical readings: Spiritaliter ... in Scripturis sacris agricultura corda credentium intelliguntur, in quibus fructus virtutuxn germinant: unde Apostolus ad credentes ait [1 Cor. -

Dr. Sara Seager Exoplanets and the Search for Habitable Worlds June
: Fort Worth Astronomical Society (Est. 1949) May - June 2011 Astronomical League Member May Meeting: Dr. Sara Seager Exoplanets and the Search for Habitable Worlds June Meeting: Harry Bearman Optics In the normal location Club Calendars – 2 Skyportunities – 4 Black Holes – 5 Mercury: The Elusive Planet – 6 Club Reports – 7 Hercules – 8 What’s Up with the Moon? – 9 (Back to top) PhotoBlogs – 11 1 Stargazers’ Diary – 15 May 2011 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 New Moon Museum 1:51 am Star Party Lunation 1093 3 R F Star Party Fort Worth: New Moon Moonrise 9:58 am Weekend Illuminated: 20.4% 8 9 10 11 12 13 14 First Qtr Moon 3 R F 3:33 pm Lunar Party Werner X Low in West & barely visible to us this month. (Peaks Challenge binary star for May: 48 Virginis @ 11:24 pm – shortly Notable variable star for May: R Hydrae (Hydra) before Moonset) Notable carbon star for May: SS Virginis Fort Worth: Moonset:12:25 am 15 16 17 Full Moon 18 19 20 21 Moon at Perigee 6:09 am 6 am (225,021 miles) FWAS Meeting Exoplanets & the Search for Habitable Worlds Dr. Sara Seager Normal Room 22 23 24 25 26 27 28 Moon at Apogee Last Qtr Moon Algol @ Minima 7:07 am 5 am 9:40 pm NW (251,036 miles) 29 30 31 Top ten deep-sky objects for May: M3, M51, M63, M64, M83, M87, M104, M106, NGC 4449, NGC 4565 Top ten binocular deep-sky objects for May: M3, M51, M63, M64, M84, M86, M87, M104, M106, Mel 111 Challenge deep-sky object for May: 3C 273 (Virgo) (Some objects require dark skies to be seen.) Memorial Day June 2011 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 New Moon Museum 4:03 pm Star Party Lunation 1094 3 R F Challenge: Star Party Sunset 8:32 pm Moonset 8:40 pm Can you see the Fort Worth: super-thin crescent Moonrise 8:52 am Moon? New Moon Moonset:11:07 pm You’d better have a high vantage point. -

Gaia Data Release 2 Special Issue
A&A 623, A110 (2019) Astronomy https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833304 & © ESO 2019 Astrophysics Gaia Data Release 2 Special issue Gaia Data Release 2 Variable stars in the colour-absolute magnitude diagram?,?? Gaia Collaboration, L. Eyer1, L. Rimoldini2, M. Audard1, R. I. Anderson3,1, K. Nienartowicz2, F. Glass1, O. Marchal4, M. Grenon1, N. Mowlavi1, B. Holl1, G. Clementini5, C. Aerts6,7, T. Mazeh8, D. W. Evans9, L. Szabados10, A. G. A. Brown11, A. Vallenari12, T. Prusti13, J. H. J. de Bruijne13, C. Babusiaux4,14, C. A. L. Bailer-Jones15, M. Biermann16, F. Jansen17, C. Jordi18, S. A. Klioner19, U. Lammers20, L. Lindegren21, X. Luri18, F. Mignard22, C. Panem23, D. Pourbaix24,25, S. Randich26, P. Sartoretti4, H. I. Siddiqui27, C. Soubiran28, F. van Leeuwen9, N. A. Walton9, F. Arenou4, U. Bastian16, M. Cropper29, R. Drimmel30, D. Katz4, M. G. Lattanzi30, J. Bakker20, C. Cacciari5, J. Castañeda18, L. Chaoul23, N. Cheek31, F. De Angeli9, C. Fabricius18, R. Guerra20, E. Masana18, R. Messineo32, P. Panuzzo4, J. Portell18, M. Riello9, G. M. Seabroke29, P. Tanga22, F. Thévenin22, G. Gracia-Abril33,16, G. Comoretto27, M. Garcia-Reinaldos20, D. Teyssier27, M. Altmann16,34, R. Andrae15, I. Bellas-Velidis35, K. Benson29, J. Berthier36, R. Blomme37, P. Burgess9, G. Busso9, B. Carry22,36, A. Cellino30, M. Clotet18, O. Creevey22, M. Davidson38, J. De Ridder6, L. Delchambre39, A. Dell’Oro26, C. Ducourant28, J. Fernández-Hernández40, M. Fouesneau15, Y. Frémat37, L. Galluccio22, M. García-Torres41, J. González-Núñez31,42, J. J. González-Vidal18, E. Gosset39,25, L. P. Guy2,43, J.-L. Halbwachs44, N. C. Hambly38, D. -

Molecular Line Study of the S-Type AGB Star W Aquilae ALMA Observations of CS, Sis, Sio and HCN
Astronomy & Astrophysics manuscript no. WAql-v6-revision_02_final c ESO 2018 October 5, 2018 Molecular line study of the S-type AGB star W Aquilae ALMA observations of CS, SiS, SiO and HCN M. Brunner1, T. Danilovich2; 3, S. Ramstedt4, I. Marti-Vidal2, E. De Beck2, W.H.T. Vlemmings2, M. Lindqvist2, and F. Kerschbaum1 1 Department for Astrophysics, University of Vienna, Türkenschanzstrasse 17, A-1180 Vienna e-mail: [email protected] 2 Department of Space, Earth and Environment, Chalmers University of Technology, Onsala Space Observatory, 439 92 Onsala, Sweden 3 Department of Physics and Astronomy, Institute of Astronomy, KU Leuven, Celestijnenlaan 200D, 3001 Leuven, Belgium 4 Department of Physics and Astronomy, Uppsala University, 75120 Uppsala, Sweden Received Month nr, YYYY; accepted Month nr, YYYY ABSTRACT Context. With the outstanding spatial resolution and sensitivity of the Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array (ALMA), molecular gas other than the abundant CO can be observed and resolved in circumstellar envelopes (CSEs) around evolved stars, such as the binary S-type Asymptotic Giant Branch (AGB) star W Aquilae. Aims. We aim to constrain the chemical composition of the CSE and determine the radial abundance distribution, the photospheric peak abundance, and isotopic ratios of a selection of chemically important molecular species in the innermost CSE of W Aql. The derived parameters are put into the context of the chemical evolution of AGB stars and are compared with theoretical models. Methods. We employ one-dimensional radiative transfer modeling – with the accelerated lambda iteration (ALI) radiative transfer code – of the radial abundance distribution of a total of five molecular species (CS, SiS, 30SiS, 29SiO and H13CN) and determine the best fitting model parameters based on high-resolution ALMA observations as well as archival single-dish observations. -
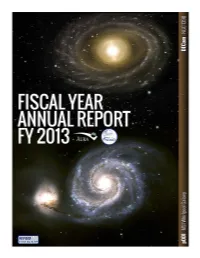
FY13 High-Level Deliverables
National Optical Astronomy Observatory Fiscal Year Annual Report for FY 2013 (1 October 2012 – 30 September 2013) Submitted to the National Science Foundation Pursuant to Cooperative Support Agreement No. AST-0950945 13 December 2013 Revised 18 September 2014 Contents NOAO MISSION PROFILE .................................................................................................... 1 1 EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................ 2 2 NOAO ACCOMPLISHMENTS ....................................................................................... 4 2.1 Achievements ..................................................................................................... 4 2.2 Status of Vision and Goals ................................................................................. 5 2.2.1 Status of FY13 High-Level Deliverables ............................................ 5 2.2.2 FY13 Planned vs. Actual Spending and Revenues .............................. 8 2.3 Challenges and Their Impacts ............................................................................ 9 3 SCIENTIFIC ACTIVITIES AND FINDINGS .............................................................. 11 3.1 Cerro Tololo Inter-American Observatory ....................................................... 11 3.2 Kitt Peak National Observatory ....................................................................... 14 3.3 Gemini Observatory ........................................................................................ -

Snake River Skies the Newsletter of the Magic Valley Astronomical Society
Snake River Skies The Newsletter of the Magic Valley Astronomical Society www.mvastro.org Membership Meeting MVAS President’s Message June 2018 Saturday, June 9th 2018 7:00pm at the Toward the end of last month I gave two presentations to two very different groups. Herrett Center for Arts & Science College of Southern Idaho. One was at the Sawtooth Botanical Gardens in their central meeting room and covered the spring constellations plus some simple setups for astrophotography. Public Star Party Follows at the The other was for the Sun Valley Company and was a telescope viewing session Centennial Observatory given on the lawn near the outdoor pavilion. The composition of the two groups couldn’t be more different and yet their queries and interests were almost identical. Club Officers Both audiences were genuinely curious about the universe and their questions covered a wide range of topics. How old is the moon? What is a star made of? Tim Frazier, President How many exoplanets are there? And, of course, the big one: Is there life out [email protected] there? Robert Mayer, Vice President The SBG’s observing session was rained out but the skies did clear for the Sun [email protected] Valley presentation. As the SV guests viewed the moon and Jupiter, I answered their questions and pointed out how one of Jupiter’s moons was disappearing Gary Leavitt, Secretary behind the planet and how the mountains on our moon were casting shadows into [email protected] the craters. Regardless of their age, everyone was surprised at the details they 208-731-7476 could see and many expressed their amazement at what was “out there”.