Les-Secrets-De-La-Reserve-Federale.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annual Report
COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS ANNUAL REPORT July 1,1996-June 30,1997 Main Office Washington Office The Harold Pratt House 1779 Massachusetts Avenue, N.W. 58 East 68th Street, New York, NY 10021 Washington, DC 20036 Tel. (212) 434-9400; Fax (212) 861-1789 Tel. (202) 518-3400; Fax (202) 986-2984 Website www. foreignrela tions. org e-mail publicaffairs@email. cfr. org OFFICERS AND DIRECTORS, 1997-98 Officers Directors Charlayne Hunter-Gault Peter G. Peterson Term Expiring 1998 Frank Savage* Chairman of the Board Peggy Dulany Laura D'Andrea Tyson Maurice R. Greenberg Robert F Erburu Leslie H. Gelb Vice Chairman Karen Elliott House ex officio Leslie H. Gelb Joshua Lederberg President Vincent A. Mai Honorary Officers Michael P Peters Garrick Utley and Directors Emeriti Senior Vice President Term Expiring 1999 Douglas Dillon and Chief Operating Officer Carla A. Hills Caryl R Haskins Alton Frye Robert D. Hormats Grayson Kirk Senior Vice President William J. McDonough Charles McC. Mathias, Jr. Paula J. Dobriansky Theodore C. Sorensen James A. Perkins Vice President, Washington Program George Soros David Rockefeller Gary C. Hufbauer Paul A. Volcker Honorary Chairman Vice President, Director of Studies Robert A. Scalapino Term Expiring 2000 David Kellogg Cyrus R. Vance Jessica R Einhorn Vice President, Communications Glenn E. Watts and Corporate Affairs Louis V Gerstner, Jr. Abraham F. Lowenthal Hanna Holborn Gray Vice President and Maurice R. Greenberg Deputy National Director George J. Mitchell Janice L. Murray Warren B. Rudman Vice President and Treasurer Term Expiring 2001 Karen M. Sughrue Lee Cullum Vice President, Programs Mario L. Baeza and Media Projects Thomas R. -

The Rockefeller Morgans
Rockefeller 11.09 10/20/09 2:27 PM Page 2 n occasion, visitors to Acadia National Park or The most notable feature of the Rockefeller State Park the Rockefeller State Park Preserve might see a Preserve, located in Pocantico Hills in Westchester County, pair or four-in-hand of lovely bay Morgans out New York, is the system of carriage roads built by John D. on the carriage roads. The turn-out will be Rockefeller, Sr. and John D. Rockefeller, Jr. The venue’s web- Oimpeccable and the horses well mannered and eye-catching, site describes the trails’ sensitivity to their setting: “designed making on-lookers wonder just who they are? to complement the landscape, the carriage roads wind They are the Rockefeller Morgans. through wetlands, woodlands, meadows, and fields and past John D. Rockefeller, Jr. was considered an expert horse- streams, rivers, and lakes. They traverse wood and stone man and preferred driving horses to automobiles. His love bridges, including the first triple arch bridge in America, of horses spurred the carriage road project on Mount and are open to the public for hiking and horse activity.” Desert Island, Maine (Acadia National Park) which resulted “We have always had Morgans to drive,” recalls David in over 50 miles of road specifically designed for carriage Rockefeller, the youngest of John D. Rockefeller, Jr.’s chil- travel graded to allow for easy pulling by horses, almost all dren and at 94, still driving his Morgans. “I believe my of which is still maintained and used today. The carriage father became interested in the breed as driving horses and roads are part of the National Park and open to the public since they are such wonderful horses, we kept that tradi- for hiking, biking and horse activity, with additional car- tion.” That tradition has been embraced by others through riage roads, open to horses only, recently opened on the generations: David Rockefeller’s late wife, Peggy, was an Rockefeller family land. -

FY19 Annual Report View Report
Annual Report 2018–19 3 Introduction 5 Metropolitan Opera Board of Directors 6 Season Repertory and Events 14 Artist Roster 16 The Financial Results 20 Our Patrons On the cover: Yannick Nézet-Séguin takes a bow after his first official performance as Jeanette Lerman-Neubauer Music Director PHOTO: JONATHAN TICHLER / MET OPERA 2 Introduction The 2018–19 season was a historic one for the Metropolitan Opera. Not only did the company present more than 200 exiting performances, but we also welcomed Yannick Nézet-Séguin as the Met’s new Jeanette Lerman- Neubauer Music Director. Maestro Nézet-Séguin is only the third conductor to hold the title of Music Director since the company’s founding in 1883. I am also happy to report that the 2018–19 season marked the fifth year running in which the company’s finances were balanced or very nearly so, as we recorded a very small deficit of less than 1% of expenses. The season opened with the premiere of a new staging of Saint-Saëns’s epic Samson et Dalila and also included three other new productions, as well as three exhilarating full cycles of Wagner’s Ring and a full slate of 18 revivals. The Live in HD series of cinema transmissions brought opera to audiences around the world for the 13th season, with ten broadcasts reaching more than two million people. Combined earned revenue for the Met (box office, media, and presentations) totaled $121 million. As in past seasons, total paid attendance for the season in the opera house was 75%. The new productions in the 2018–19 season were the work of three distinguished directors, two having had previous successes at the Met and one making his company debut. -

Historic Properties Identification Report
Section 106 Historic Properties Identification Report North Lake Shore Drive Phase I Study E. Grand Avenue to W. Hollywood Avenue Job No. P-88-004-07 MFT Section No. 07-B6151-00-PV Cook County, Illinois Prepared For: Illinois Department of Transportation Chicago Department of Transportation Prepared By: Quigg Engineering, Inc. Julia S. Bachrach Jean A. Follett Lisa Napoles Elizabeth A. Patterson Adam G. Rubin Christine Whims Matthew M. Wicklund Civiltech Engineering, Inc. Jennifer Hyman March 2021 North Lake Shore Drive Phase I Study Table of Contents Executive Summary ....................................................................................................................................... v 1.0 Introduction and Description of Undertaking .............................................................................. 1 1.1 Project Overview ........................................................................................................................... 1 1.2 NLSD Area of Potential Effects (NLSD APE) ................................................................................... 1 2.0 Historic Resource Survey Methodologies ..................................................................................... 3 2.1 Lincoln Park and the National Register of Historic Places ............................................................ 3 2.2 Historic Properties in APE Contiguous to Lincoln Park/NLSD ....................................................... 4 3.0 Historic Context Statements ........................................................................................................ -

Education Directory: Education Associations 1971-1972. INSTITUTION Office of Education (DHEW), Washington, D.C
DOCUMENT RESUME ED 066 835 EA 004 580 AUTHOR Lonergan, Bobbie D. TITLE Education Directory: Education Associations 1971-1972. INSTITUTION Office of Education (DHEW), Washington, D.C. REPORT NO DHEW-Pub-No-(0E)-72-71 PUB DATE 72 NOTE 1 17p. AVAILABLE FROMSuperintendent of Documents, U. S. Government Printing Office, Washington, D. C. 20402 (Catalog No. HE 5.210:10001-72, $1.00) EDRS PRICE MF-$0.65 HC-$6.58 DESCRIPTORS *Colleges; *Directories; *Education; *Honor Societies; Institutions; International Organizations; *Organizations (Groups); Professional Associations; Religious Education ABSTRACT Based on replies to a questionnaire sent by the Office of Education to education associations and organizations, this directory is organized by (1)national and regional education associations; (2) college professional fraternities, honor societies, and recognition societies (national);(3) State education associations; (4)foundations;(5) religious education associations; and (6) international education associations. A subject heading index is also provided.(A related document is ED 054 535.)(Author/MLF) FILMED FROM BEST AVAILABLE COPY U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION & WELFARE OFFICE OF EOUCATION THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRO. OUCEO EXACTLY AS RECEIVED FROM THE PERSON OR ORGANIZATION ORIG INATING IT POINTS OF VIEW OR OPIN IONS STATEO 00 NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL OFFICE OF EDU CATION POSITION OR POLICY DREW Publication No. (OE) 72-71 U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION, AND WELFARE / OFFICE OF EDUCATION EDUCATION ASSOCIATIONS CONTENTS -

Copyright by CLP Research 1600 1700 1750 1800 1850 1950 1650
1600 Copyright by CLP Research Partial Genealogy of the McCormicks Main Political Affiliation: (of Illinois) 1763-83 Whig/Republican Cpt. James McCormick 1789-1823 Republican (1645-at least 1701) 1824-33 National Republican 1650 (defended Londonderry for King William against King James II, 1689) 1834-53 Whig/Free Soil = Sarah McTaree Welsh 1854- Republican (1669?-1705) Hugh McCormick I 5 Others Thomas McCormick John McCormick (1695-at least 1724) (1702-62) (1703-68) 1700 (Emigrated from Ballymorton, (Emigrated from Ballymorton, Antrim, Ireland to Pennsylvania) Antrim, Ireland to Pennsylvania) SEE MCCORMICK OF OH GENEALOGY SEE MCCORMICK OF AZ = Elizabeth Carruth GENEALOGY (1705-66) 5 Others Robert McCormick I (1738-1818) (moved to Virginia) = Martha Sanderson 1750 (1747-1803) James McCormick 4 Others Robert McCormick II (1778-1839) (1780-1846); (farmer) (moved to Ohio) = Mary Ann Hall (1789-1853) SEE MCCORMICK OF OH GENEALOGY 1800 Cyrus Hall McCormick I 5 Others William Sanderson McCormick (1809-84); ($3 million estate) (1815-65) (born Virginia); (invented the mechanical reaper, 1834) (moved to Illinois) (moved to Chicago, Illinois, 1847) = Mary Ann Grigsby (founded McCormick Harvester Co., 1848-1902, (1828-78) which became the International Harvester Co.) = Annette Nettie Fowler of NY 4 Others Robert Sanderson McCormick (1835-1923) (1849-1919) (US Minister to Austria-Hungary, 1901-02) 18504 Others Cyrus Hall McCormick II Harold Fowler McCormick (US Ambassador to Austria-Hungary, 1902; (1859-1936) (1872-1941) to Russia, 1902-05; to France, 1905-07) (president, McCormick Harvester, (president, International Harvester, See Medill of IL = Catherine Van Etta Medill and then International Harvester, 1884-1936) 1936-41)) Genealogy (1853-1932) = Henrietta Bradley See Rockefeller of NY = Edith Rockefeller Harmon Genealogy (1872-1932) Joseph Medill McCormick 1 Daughter Col. -
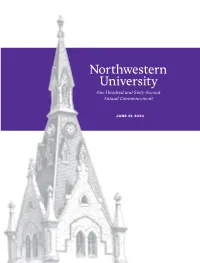
One Hundred and Sixty-Second Annual Commencement
One Hundred and Sixty-Second Annual Commencement JUNE 19, 2020 One Hundred and Sixty-Second Annual Commencement 11 A.M. CDT, FRIDAY, JUNE 19, 2020 2982_STUDAFF_CommencementProgram_2020_FRONT.indd 1 6/12/20 12:14 PM UNIVERSITY SEAL AND MOTTO Soon after Northwestern University was founded, its Board of Trustees adopted an official corporate seal. This seal, approved on June 26, 1856, consisted of an open book surrounded by rays of light and circled by the words North western University, Evanston, Illinois. Thirty years later Daniel Bonbright, professor of Latin and a member of Northwestern’s original faculty, redesigned the seal, Whatsoever things are true, retaining the book and light rays and adding two quotations. whatsoever things are honest, On the pages of the open book he placed a Greek quotation from the Gospel of John, chapter 1, verse 14, translating to The Word . whatsoever things are just, full of grace and truth. Circling the book are the first three whatsoever things are pure, words, in Latin, of the University motto: Quaecumque sunt vera whatsoever things are lovely, (What soever things are true). The outer border of the seal carries the name of the University and the date of its founding. This seal, whatsoever things are of good report; which remains Northwestern’s official signature, was approved by if there be any virtue, the Board of Trustees on December 5, 1890. and if there be any praise, The full text of the University motto, adopted on June 17, 1890, is think on these things. from the Epistle of Paul the Apostle to the Philippians, chapter 4, verse 8 (King James Version). -

Rockefeller Family from Wikipedia, the Free Encyclopedia
Rockefeller family From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search See also: Rockefeller Rockefeller Ethnicity German, English, Scotch-Irish Current New York City, New York; Charleston, West Virginia; Cincinnati, Ohio; Houston, Texas; U.S. region Place of United States origin Notable John Davison Rockefeller, Sr. member William Avery Rockefeller, Jr. s John Davison Rockefeller, Jr. John Davison Rockefeller III Nelson Aldrich Rockefeller David Rockefeller John Davison Rockefeller IV Winthrop Rockefeller Winthrop Paul Rockefeller Connect McCormick family ed Dudley–Winthrop family families The neutrality of this article is disputed. Relevant discussion may be found on the talk page. Please do not remove this message until the dispute is resolved. (June 2014) The Rockefeller family /ˈrɒkɨfɛlər/ is an American industrial, political, and banking family of German descent that made one of the world's largest fortunes in the oil business during the late 19th and early 20th centuries, with John D. Rockefeller and his brother William Rockefeller primarily through Standard Oil.[1] The family is also known for its long association with and control of Chase Manhattan Bank.[2] They are considered to be one of the most powerful families, if not the most powerful family,[3] in the history of the United States. Contents [hide] 1 Real estate and institutions 2 Conservation 3 International politics/finance/economics 4 The family archives 5 Family wealth 6 Family residences 7 Legacy 8 Generational philanthropy 9 Members 9.1 Ancestors 9.2 Descendants of John Davison Rockefeller, Sr. 9.3 Descendants of William Avery Rockefeller, Jr. 9.4 Spouses 10 Select bibliography 11 See also 12 Notes 12.1 References 13 External links Real estate and institutions[edit] 30 Rockefeller Center, New York City, NY, U.S. -

Nostalgia: Collage, Collecting and the Paste
NOSTALGIA: COLLAGE, COLLECTING AND THE PASTE Avantgarde traditions emphasize the critical moment of collage: cutting. As we have seen, artists–from dada to the situationists and punk subcultures–cut up the objects of consumer capitalism, shattering established orders and ideas, producing a critique of ideology and desire in radical and disturbing collages and assemblages. Their works emphasize the seams of collage and celebrate the fragments. But collage still has two moments: cutting and pasting, and the desire to gather together, to paste, to make a new whole is sometimes a utopian gesture, but one that is almost always profoundly nostalgic. Like the kabbalah myth of the breaking of the vessels, it is the hope that those fragments could be redeemed, the flood of words, images, and objects that make up our chaotic modern lives could be put together and made whole–that our fragmented selves might also be made whole. Artists Joseph Cornell and Andy Warhol, filmmaker Craig Baldwin, performers the Tap eBeatles, collector William Davies King, and writers like Walter Benjamin and Don DeLillo emphasize these moments of gathering. This desire to order and conserve objects, maintains Jean Baudrillard, “is the discourse of subjectivity itself, and objects are a privileged register of that discourse.”1 If we should doubt Baudrillard’s point, we need only open a magazine or walk into a mall, where every object cries out to us that it might bring happiness and wholeness. Whi le few would consciously admit to believing such slick and impossible come ons, this is one of the most powerful forces animating everyday life in 174 Banash consumer culture. -

Franklin Smallwood '51 Nelson A. Rockefeller
Franklin Smallwood '51 Nelson A. Rockefeller Professor of Government, Emeritus Vice President and Dean for Student Affairs, Emeritus An Interview Conducted by Mary S. Donin Shelburne, Vermont Hanover, NH March 11, 2003 April 22, 2003 DOH-50 Special Collections Library Dartmouth College Hanover, New Hampshire Frank Smallwood Interview INTERVIEW: Frank Smallwood INTERVIEW BY: Mary Donin PLACE: Home of Frank Smallwood, Shelburne, Vermont DATES: March 11, 2003 MARY DONIN: Today is Tuesday, March 11, 2003. I am here with Frank Smallwood at his home in Shelburne, Vermont. Professor Smallwood, I would like to start out today finding out what made you go to Dartmouth as an undergraduate. FRANK SMALLWOOD: Okay. That's a good place to start. Actually, it was a combination of things. I was born in New Jersey, northern New Jersey, and I grew up in New Jersey. I then went to Lawrenceville School for three years, which is in New Jersey down by Princeton. Then I was drafted. This is now 1945 as the war was coming to an end and I was assigned to Fort Dix, New Jersey. So I spent my entire life in New Jersey and I decided (this is a horrible thing to say) [Laughter] but I decided that I wanted to get out of New Jersey and I didn't have strong preferences. Most of my classmates from Lawrenceville went to Princeton. I just didn't think that made any sense, so my sister's husband, my older sister's husband had gone to Dartmouth and he was talking up Dartmouth. He had just gotten out of the service and he said, "You ought to go to Dartmouth. -

Download the PDF File
na Walska. To recapture his youthful vigor, Harold Fowler had Walter Newberry 1804-68 a secret operation at Wesley Memorial Hospital, rumored to Walter Newberry was a Swedish-American originally named New- have involved the transplant of organs from a blacksmith. Chi- berg. He was a prominent lumber dealer and real estate magnate who cago Society figures went about chanting: endowed the world famous Newberry Library founded in 1887, for Under the spreading chestnut tree, $2.2 million as a “free” public library. He was twice a president of The village smith stands; the Chicago School Board and founder and twice president of the The smith a gloomy man is he; Chicago Historical Society. Newberry died at sea and is buried in the McCormick has his glands. cask of brandy used to preserve his remains. He gave the name Lake He became chairman of International Harvester after his View to the township and neighborhood. brother, Cyrus Jr. Lorenz Brentano 1813-91 Joseph Medill 1823-1899 Lorenz Brentano is the only foreign head of state to serve in the “VAlley Medill was a Canadian born, American editor and publisher, United States Congress. He was born in Mannheim in the Duchy who in1855 built the Chicago Tribune (founded in 1847) and of Baden, Germany and president of the provisional government fol- of the determined the paper’s editorial policy. He wrote anti-slavery lowing the failed 1848 revolution. He fled to the United States af- editorials and worked for Abraham Lincoln’s nomination by ter being sentenced to life imprisonment. In Pottsville, Pennsylvania the Republican Party (which Medill had helped to found in he established Der Leuchtturm, a German anti-slavery journal. -

Annual Report 2011–12 3 Introduction
ANNUAL REPORT 2011–12 3 Introduction 5 Metropolitan Opera Board of Directors 7 2011–12 Season Repertory & Events 14 2011–12 Artist Roster 15 The Financial Results 38 Patrons Introduction The Metropolitan Opera’s 2011–12 season was marked by an impressive string of artistic successes, while the company continued to address a challenging financial situation in ways that wouldn’t affect the high quality of productions. The company presented seven new stagings during the 2011–12 season, including the final two installments of a new Ring cycle, the Metropolitan Opera premiere of Donizetti’s Anna Bolena, and the world premiere of a new Baroque pastiche, The Enchanted Island, conceived by the Met. All seven new produc- tions, along with four revivals, were presented in movie theaters around the world as part of the Met’s Live in HD series, which has enabled the Met to assume a global leadership position as a provider of special cinema content. The Live in HD series continued to be a money-maker for the Met, earning $27.1 million. Combined earned revenue for the Met (Live in HD and box office) totaled $121.5 million. The 2011–12 season once again brought together the finest singers, conductors, directors, designers, choreog- raphers, and video artists in the world. Such extraordinary directors as Robert Lepage, Phelim McDermott, David McVicar, and Laurent Pelly returned to create new productions, with Michael Grandage and Des McAnuff making directorial debuts with the company. The culmination of Lepage’s new Met Ring cycle was the talk of the opera world, and the new Baroque pastiche The Enchanted Island, devised and written by Jeremy Sams, represented a remarkable new creative endeavor.