© 2009 Ingrid L. Ilinca
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
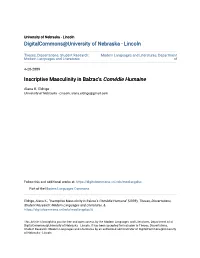
Inscriptive Masculinity in Balzac's Comédie Humaine
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Theses, Dissertations, Student Research: Modern Languages and Literatures, Department Modern Languages and Literatures of 4-20-2009 Inscriptive Masculinity in Balzac’s Comédie Humaine Alana K. Eldrige University of Nebraska - Lincoln, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss Part of the Modern Languages Commons Eldrige, Alana K., "Inscriptive Masculinity in Balzac’s Comédie Humaine" (2009). Theses, Dissertations, Student Research: Modern Languages and Literatures. 6. https://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/6 This Article is brought to you for free and open access by the Modern Languages and Literatures, Department of at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Theses, Dissertations, Student Research: Modern Languages and Literatures by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. INSCRIPTIVE MASCULINITY IN BALZAC’S COMÉDIE HUMAINE by Alana K. Eldrige A DISSERTATION Presented to the Faculty of The Graduate College at the University of Nebraska In Partial Fulfillment of Requirements For the Degree of Doctor in Philosophy Major: Modern Languages and Literature (French) Under the Supervision of Professor Marshall C. Olds Lincoln, Nebraska May, 2009 INSCRIPTIVE MASCULINITY IN BALZAC’S COMÉDIE HUMAINE Alana K. Eldrige, Ph.D. University of Nebraska, 2009. Adviser: Marshall C. Olds This reading of La Comédie humaine traces the narrative paradigm of the young hero within Balzac’s literary universe. A dynamic literary signifier in nineteenth-century literature, the young hero epitomizes the problematic existence encountered by the individual in post-revolutionary France. At the same time, he serves as a mouth-piece for an entire youthful generation burdened by historical memory. -

Balzac Et La Comédie Humaine 4 : « Un But, L’Histoire ; Un Moyen, Le Roman » : Organisation Et Composition De La Comédie Humaine I
Balzac et La Comédie humaine 4 : « Un but, l’histoire ; un moyen, le roman » : organisation et composition de la Comédie humaine I. Architecture d’un édifice littéraire Le plan de la Comédie humaine dont Balzac parle pour la première fois en 1834 se concrétise après 1840 pour trouver sa forme finale dans l’Avant-propos de 1842 et dans le catalogue pour l’édition Furne de 1845. Il s’agit d’un ensemble structuré et méthodique qui témoigne des ambitions de l’auteur. I.1 Catalogue de 1845 (disponible sur http://www.v1.paris.fr/commun/v2asp/musees/balzac/furne/protocole.htm) Observez d’abord le catalogue : comment se compose le plan de La Comédie humaine ? Quelles parties de La Comédie sont, au moment de la publication de ce catalogue, les plus complètes et quelles parties en revanche les plus lacunaires ? CATALOGUE DES OUVRAGES QUE CONTIENDRA LA COMEDIE HUMAINE. (ORDRE ADOPTE EN 1845 POUR UNE EDITION COMPLETE EN 26 TOMES) —— Les ouvrages en italiques sont ceux qui restent à faire. —— PREMIERE PARTIE : ETUDES DE MŒURS. DEUXIEME PARTIE : ETUDES PHILOSOPHIQUES. TROISIEME PARTIE : ETUDES ANALYTIQUES. —— Première partie : ETUDES DE MŒURS Six livres : 1. Scènes de la Vie Privée ; 2. de Province ; 3. Parisienne ; 4. Politique ; 5. de la Vie Militaire ; 6. de la Vie de Campagne. SCENES DE LA VIE PRIVEE. (Quatre volumes, tomes 1 à 4.) – 1. Les Enfants. – 2. Un Pensionnat de demoiselles. – 3. Intérieur de Collège. – 4. La Maison-du-Chat-qui-Pelote. – 5. Le Bal de Sceaux. – 6. Mémoires de Deux Jeunes Mariées. – 7. La Bourse. – 8. Modeste Mignon. -

Éditions Et Représentations De La Comédie Humaine
Genesis Manuscrits – Recherche – Invention 44 | 2017 Après le texte Éditions et représentations de La Comédie humaine Andrea Del Lungo Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/genesis/1747 DOI : 10.4000/genesis.1747 ISSN : 2268-1590 Éditeur : Presses universitaires de Paris Sorbonne (PUPS), Société internationale de génétique artistique littéraire et scientifique (SIGALES) Édition imprimée Date de publication : 9 mai 2017 Pagination : 81-96 ISBN : 979-1023-105636 ISSN : 1167-5101 Référence électronique Andrea Del Lungo, « Éditions et représentations de La Comédie humaine », Genesis [En ligne], 44 | 2017, mis en ligne le 16 mai 2018, consulté le 11 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/ genesis/1747 ; DOI : https://doi.org/10.4000/genesis.1747 Tous droits réservés ÉTUDES Éditions et représentations de La Comédie humaine Andrea Del Lungo « ’ai corrigé l’édition qui sert de manuscrit », écrit Balzac originale date des années 1830-1832 (notamment les Scènes à Madame Hanska en décembre 1842 1, alors qu’il entre- de la vie privée de 1830 et de 1832, et les Romans et contes Jprend la correction de la monumentale édition Furne philosophiques de 1831) ; je proposerai enfin une brève de La Comédie humaine. Cette citation célèbre témoigne réflexion sur les représentations de l’œuvre induites par les d’une incessante pratique de réécriture, au fil des éditions éditions posthumes, pour souligner précisément la nécessité successives, qui complique l’établissement d’un état définitif d’une édition génétique. de l’œuvre de Balzac. Mais elle montre aussi un cas de per- méabilité qui brouille les frontières entre avant-texte et texte, voire entre genèse du manuscrit et genèse de l’imprimé : Pratiques de la réécriture chez Balzac chaque édition publiée, loin de figer le texte, constitue le lieu fantasmatique d’une réversibilité temporelle, susceptible de L’œuvre de Balzac fournit un cas exemplaire pour l’ana- ramener l’auteur à la phase prééditoriale (celle du manus- lyse de la genèse post-éditoriale. -

II Cette Bibliographie Générale Ne Comprend Pas Les Éditions
II ÉTUDES PHILOSOPHIQUES [Titre apparaissant en 1835]. 1831. La Peau de chagrin, roman philosophique. 2 volumes. ÉDITIONS 1831. Romans et contes philosophiques, 2e édition. 3 volumes. Cette Bibliographie générale ne comprend pas les éditions 1831. Romans et contes philosophiques, 3e édition. 3 volumes. séparées des romans publiés du vivant de Balzac (voir, sur ce 1832. Nouveaux contes philosophiques. 1 volume. point, l’ouvrage cité de Stéphane Vachon, Les Travaux et les jours e d’Honoré de Balzac, CNRS, 1992). Nous nous sommes efforcé de 1833. Romans et contes philosophiques, 4 édition. 4 volumes. classer les éditions collectives de façon à montrer comment a été 1835. Le Livre mystique. 2 volumes. constituée La Comédie humaine. 1835-40.Études philosophiques. 20 volumes. A. Avant l’edition furne Détail des éditions Tableau général Nous indiquons, précédées du sigle B.F., les dates d’enregistrement à la Bibliographie de la France, qui, sans donner les Etudes de Mœurs [ Titre apparaissant en 1834]. dates certaines de mise en vente, sont plus précises que de simples millésimes. 1830. Scènes de la vie privée. 1re édition. 2 volumes ScÈnes de la vie privEe, publiée par M. Balzac [sic], auteur du e 1832. - - 2 - 4 - Dernier Chouan ou la Bretagne en 1800. - Paris, Mame et Delaunay- 1834-35. - 3e - 4 - Vallée, Levavasseur, 1830. 2 vol. in-8°. 1839. - [4e ] - 2 - I. Préface. La Vendetta. Les Dangers de l’inconduite [Gobseck]. 1834-37. Scènes de la vie de province. 1re édition. 4 volumes Le Bal de Sceaux. e 1839. - - [2 ] - 2 - II. Gloire et malheur [La Maison du chat-qui-pelote]. -
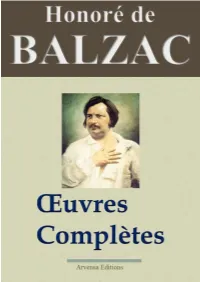
Extrait Honore De Balzac.Pdf
Extrait Honoré de Balzac : Oeuvres complètes Honoré de Balzac ARVENSA ÉDITIONS Plate-forme de référence des éditions numériques des oeuvres classiques en langue française Retrouvez toutes nos publications, actualités et offres privilégiées sur notre site Internet www. arvensa. com ©Tous droits réservés Arvensa® Éditions ISBN Epub : 9782368410004 ISBN Pdf : 9782368410257 Page 2 Copyright Arvensa Editions Extrait Honoré de Balzac : Oeuvres complètes Honoré de Balzac NOTE DE L'ÉDITEUR L’objecf des Édions Arvensa est de vous faire connaître les œuvres des plus grands auteurs de la liérature classique en langue française à un prix abordable, tout en vous fournissant la meilleure expérience de lecture sur votre liseuse. Nos titres sont ainsi relus, corrigés et mis en forme spécifiquement. Cependant, si malgré tout le soin que nous avons apporté à cee édion, vous noez quelques erreurs, nous vous serions très reconnaissants de nous les signaler en écrivant à notre Service Qualité : servicequalite@arvensa. com Pour toutes autres demandes, contactez : editions@arvensa. com Nos publicaons sont régulièrement enrichies et mises à jour. Si vous souhaitez être informé de nos actualités et des mises à jour de cee édition, nous vous invitons à vous inscrire sur le site : www. arvensa. com Nous remercions aussi tous nos lecteurs qui manifestent leur enthousiasme en l'exprimant à travers leurs commentaires. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Arvensa Editions Page 3 Copyright Arvensa Editions Extrait Honoré de Balzac : Oeuvres complètes Honoré de Balzac LISTE DES TITRES Page 4 Copyright Arvensa Editions Extrait Honoré de Balzac : Oeuvres complètes Honoré de Balzac AVERTISSEMENT : Vous êtes en train de parcourir un extrait de cette édition. -

LA JEUNB FILLE DANS LA COMEDIE HUMAINE D'honore DE BALZAC by DAWNA LOUISE MITCHELL B.A., University of British Columbia, 1963 A
LA JEUNB FILLE DANS LA COMEDIE HUMAINE D'HONORE DE BALZAC by DAWNA LOUISE MITCHELL B.A., University of British Columbia, 1963 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in the Department of French We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA April, 1972 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the Head of my Department or by his representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department of o ^ ^ The University of British Columbia Vancouver 8, Canada Date a^'A 2,fy 7 3, ABSTRACT Honore' de Balzac filled the imaginary world of his Come"die humaine with a vast array of characters of all ages, types and social classes. Although, in general, the girls among them play a secondary role, they nevertheless form a group which is not only interesting, but which receives a special form of attention from its creator. In Balzac's view, the typical girl (who is also his ideal) is sweet, pure and docile, and most of the girls he depicts fall into this category, although they often combine with these passive traits a surprising degree of will-power. -

Biblio Balzac CD Éditions
Bibliographie Cédérom Balzac-Explorer La Comédie humaine ACAMEDIA par Isabelle Tournier et Robert Tranchida Éditions des œuvres de Balzac Éditions originales Nous indiquons, dans l’ordre chronologique de leur parution, les éditions collectives qui permettent de suivre le processus d’édification de La Comédie humaine. Les éditions séparées des romans et nouvelles publiés du vivant de Balzac sont signalées dans les Notices concernant chaque œuvre dans la rubrique Histoire du texte. Entre crochets, est donné le titre actuel. Pour plus de précisions, voir l’ouvrage de Stéphane Vachon, Les Travaux et les jours d’Honoré de Balzac. Chronologie de la création balzacienne. a) Éditions collectives avant La Comédie humaine SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE, publiée par M. Balzac, auteur du Dernier Chouan ou la Bretagne en 1800. - Paris, Mame et Delaunay-Vallée, Levavasseur, 1830. 2 vol. in-8°. [S 10 I. Préface. La Vendetta. Les Dangers de l'inconduite [Gobseck]. Le Bal de Sceaux. II. Gloire et malheur [La Maison du chat-qui-pelote]. La Femme vertueuse [Une double famille]. La Paix du ménage. Note. ROMANS ET CONTES PHILOSOPHIQUES, par M. de Balzac. Seconde édition. - Paris, Charles Gosselin, 1831. 3 vol. in-8°. [S 13 Introduction [par Philarète Chasles]. La Peau de chagrin. II. La Peau de chagrin [suite et fin]. Sarrasine. La Comédie du diable. El Verdugo. III. L'Enfant maudit [1ère partie]. L'Élixir de longue vie. Les Proscrits. Le Chef-d'œuvre inconnu. Le Réquisitionnaire. Étude de femme. Les Deux Rêves [Sur Catherine de Médicis, 3e partie]. Jésus-Christ en Flandre. L'Église [suite du précédent]. ROMANS ET CONTES PHILOSOPHIQUES, par M. -

URSULE MIROUËT Du Même Auteur Dans La Même Collection
URSULE MIROUËT Du même auteur dans la même collection ANNETTE ET LE CRIMINEL. BÉATRIX. CÉSARBIROTTEAU. LECHEF-D’ŒUVRE INCONNU.–GAMBARA.–MASSIMILLADONI. LESCHOUANS. LECOLONELCHABERT (édition avec dossier). LECOLONELCHABERT suivi de L’INTERDICTION. LECONTRAT DE MARIAGE. LECOUSINPONS. LACOUSINEBETTE. LECURÉ DETOURS.–LAGRENADIÈRE. – L’ILLUSTREGAUDISSART. LECURÉ DE VILLAGE. LADUCHESSE DELANGEAIS. EUGÉNIEGRANDET (édition avec dossier). LEFAISEUR. LAFEMME DE TRENTE ANS. FERRAGUS.LAFILLE AUX YEUX D’OR. GOBSECK.UNE DOUBLE FAMILLE. ILLUSIONS PERDUES. LELYS DANS LA VALLÉE. LAMAISON DU CHAT-QUI-PELOTE.–LEBAL DESCEAUX.–LAVEN- DETTA.–LABOURSE. LEMÉDECIN DE CAMPAGNE. MÉMOIRES DE DEUX JEUNES MARIÉES. NOUVELLES(ELVERDUGO.–UN ÉPISODE SOUS LA TERREUR. –ADIEU.–UNE PASSION DANS LE DÉSERT.–LERÉQUISITION- NAIRE. – L’AUBERGE ROUGE.–MADAMEFIRMIANI.–LEMES- SAGE.–LABOURSE.–LAFEMME ABANDONNÉE.–LA GRENADIÈRE.–UN DRAME AU BORD DE LA MER.–LAMESSE DE L’ATHÉE.–FACINOCANE.–PIERREGRASSOU. – Z. MARCAS). LESPAYSANS. LAPEAU DE CHAGRIN. PEINES DE CŒUR D’UNE CHATTE ANGLAISE. LEPÈREGORIOT. PHYSIOLOGIE DU MARIAGE. PIERRETTE. LARABOUILLEUSE. LARECHERCHE DE L’ABSOLU. SARRASINE suivi de L’HERMAPHRODITE. SPLENDEURS ET MISÈRES DES COURTISANES. UN DÉBUT DANS LA VIE. UNE FILLE D’ÈVE. LAVIEILLEFILLE.–LECABINET DES ANTIQUES. BALZAC URSULE MIROUËT Présentation, notes, bibliographie et annexes par Philippe BERTHIER Chronologie par André LORANT GF Flammarion © Flammarion, Paris, 2013. ISBN : 978-2-0812-5026-0 PRÉSENTATION Être, avoir … le monde surnaturel, ce monde qui pèse tant sur l’autre, que nous étouffons sous son poids ! Barbey d’Aurevilly, Un prêtre marié. Ursule Mirouët est victime de son titre, plus encore qu’Eugénie Grandet avec qui, forcément, elle forme dip- tyque dans l’esprit du lecteur, comme d’ailleurs dans celui de Balzac lui-même, qui voyait en Ursule la « sœur heureuse » d’Eugénie 1. -

Title La Posture Herméneutique, Support D'une Violence De L'écriture
La posture herméneutique, support d'une violence de l'écriture Title dans Une double famille et Honorine de Balzac Author(s) NAKAYAMA, Kazuko Citation 仏文研究 (2006), 37: 37-56 Issue Date 2006-10-10 URL https://doi.org/10.14989/137975 Right Type Departmental Bulletin Paper Textversion publisher Kyoto University La posture herméneutique, support d'une violence de l'écriture dans Une double famille et Honorine de Balzac Kazuko NAKAYAMA Introduction Dans l'univers de La Comédie humaine, comme le remarque Paule Petitier, certains personnages attachés aux professions du droit, de la cure et de la médecine s'imposent comme étant capables de distinguer dans les mœurs de leurs contemporains les détails les plus ténus, les différences les plus infimes qui révèlent les traces cachées ou effacées du passé 1) • L'homme de loi est l'un de ces types d'observateurs sociaux, ce qui lui vaut d'assumer souvent à la fois le rôle du lecteur modèle et celui du porte-parole de l'auteur. Ce faisant, l'homme de loi, interprète du monde qui l'entoure, est le support d'un mode de communication entre l'auteur et le lecteur qu'il va s'agir d'éclairer, à la lumière des fonctions que Balzac prête à l'écrivain dans son œuvre. Nous nous intéresserons ici aux figures des hauts magistrats, Granville, Bauvan ( le « comte Octave» dans Honorine) et Sérizy, dont la réussite professionnelle, due à leur grande compétence sous-tendue par une perspicacité peu commune, s'oppose à l'échec patent de leur vie privée. Tous trois en effet souffrent de ce malheur conjugal maintes fois décliné dans les Scènes de la vie privée. -
The Cambridge Companion to Balzac Edited by Owen Heathcote , Andrew Watts Frontmatter More Information
Cambridge University Press 978-1-107-06647-2 — The Cambridge Companion to Balzac Edited by Owen Heathcote , Andrew Watts Frontmatter More Information the cambridge companion to balzac One of the founders of literary realism and the serial novel, Honoré de Balzac (1799–1850) was a prolific writer who produced more than a hundred novels, plays and short stories during his career. With its dramatic plots and memorable characters, Balzac’s fiction has enthralled generations of readers. La Comédie humaine, the vast collection of works in which he strove to document every aspect of nineteenth-century French society, has influenced writers from Flaubert, Zola and Proust to Dostoevsky and Oscar Wilde. This Companion provides a critical reappraisal of Balzac, combining studies of his major novels with guidance on the key narrative and thematic features of his writing. Twelve chapters by world-leading specialists encompass a wide spectrum of topics such as the representation of history, philosophy and religion, the plight of the struggling artist, gender and sexuality, and Balzac’s depiction of the creative process itself. owen heathcote is Honorary Senior Research Fellow in Modern French Studies at the University of Bradford. He researches on the relation between violence, gender, sexuality and representation in French literature from the nineteenth century to the present. His many publications include Balzac and Violence. Representing History, Space, Sexuality and Death in ‘La Comédie humaine’ (2009) and From Bad Boys to New Men? Masculinity, Sexuality and Violence in the Work of Éric Jourdan (2014). andrew watts is Senior Lecturer in French Studies at the University of Birmingham. -
Eugénie Grandet Du Même Auteur Dans La Même Collection
Eugénie Grandet Du même auteur dans la même collection ANNETTE ET LE CRIMINEL. BÉATRIX. Préface de Julien Gracq. CÉSAR BIROTTEAU. LE CHEF-D'ŒUVRE INCONNU – GAMBARA – MASSIMILLA DONI. LES CHOUANS. LE COLONEL CHABERT. LE COLONEL CHABERT suivi de L'INTERDICTION. LE CONTRAT DE MARIAGE. LA COUSINE BETTE. LE COUSIN PONS. LE CURÉ DE TOURS – LA GRENADIÈRE – L'ILLUSTRE GAUDISSART. LA DUCHESSE DE LANGEAIS. EUGÉNIE GRANDET (édition avec dossier). LA FEMME DE TRENTE ANS. FERRAGUS – LA FILLE AUX YEUX D'OR. GOBSECK – UNE DOUBLE FAMILLE. ILLUSIONS PERDUES. LE LYS DANS LA VALLÉE. LA MAISON DU CHAT-QUI-PELOTE – LE BAL DE SCEAUX – LA VENDETTA – LA BOURSE, MÉMOIRES DE DEUX JEUNES MARIÉES. NOUVELLES (El Verdugo. Un épisode sous la Terreur. Adieu. Une passion dans le désert. Le Réquisitionnaire. L'Auberge rouge. Madame Firmiani. Le Message. La Bourse. La Femme abandonnée. La Grenadière. Un drame au bord de la mer. La Messe de l'athée. Facino Cane. Pierre Grassou. Z. Marcas). LES PAYSANS. LA PEAU DE CHAGRIN. PEINES DE CŒUR D'UNE CHATTE ANGLAISE. LE PÈRE GORIOT. PHYSIOLOGIE DU MARIAGE. PIERRETTE. LA RABOUILLEUSE. LA RECHERCHE DE L'ABSOLU. SARRASINE, suivi de Michel Serres, L'HERMAPHRODITE. SPLENDEURS ET MISÈRES DES COURTISANES. UN DÉBUT DANS LA VIE. UNE FILLE D'ÈVE. LA VIEILLE FILLE – LE CABINET DES ANTIQUES. BALZAC Eugénie Grandet CHRONOLOGIE PRÉSENTATION NOTES DOSSIER BIBLIOGRAPHIE MISE À JOUR (2008) par Éléonore Reverzy GF Flammarion © Flammarion, Paris, 2000. Édition mise à jour en 2008. ISBN : 978-2-0812-6000-9978-2-0812-1317-3 SOMMAIRE CHRONOLOGIE 6 PRÉSENTATION 15 Eugénie Grandet DOSSIER 1. Documents • Préambules et épilogues supprimés 253 • Extraits de la correspondance 256 • Introduction aux Études de mœurs e du XIX siècle par Félix Davin 258 • Les jugements de Sainte-Beuve 261 2. -
Õ Ät Yt†ÉÇ Wx Utäétv
Décorez votre intérieur õ Ät yt†ÉÇ wx UtÄétv Une série littéraire en 6 épisodes Episode 2 LA CHAMBRE A COUCHER Conception Sébastien Cotte Angélique Ivanov véronique Prest / Dessins Angélique Ivanov Ivanov / Dessins Angélique Prest véronique Ivanov Angélique Cotte Sébastien Conception ⁄ W|á@ÅÉ| É∞ àâ ä|á? }x àx w|Üt| Öâ| àâ xá Ó? ÑÉâÜÜt|à@£àÜx Ät wxä|áx wx UtÄétvA Le musée vous propose deux activités pour découvrir la façon dont les personnages de La Comédie humaine s’insèrent dans leur décor : Jeu littéraire Glissez-vous dans la peau d’un personnage en savourant l’humour de Balzac et en vous adonnant au jeu de la fiction. Atelier du décorateur Faites tourner les meubles et créez ainsi votre chez vous. JEU LITTERAIRE Episode 2 / LA CHAMBRE A COUCHER Au XIXème siècle, dans les appartements bourgeois, la chambre devient définitivement un lieu d’intimité. Pour y pénétrer, il faut y être invité, alors que dans les demeures aristocratiques, elle garde sa dimension sociale de pièce de réception, comme la chambre de la comtesse Fœdora dans La Peau de chagrin. Pièce centrale dans la maison, on y nait, on y rêve, on s’y adonne à toutes les voluptés, on y pleure, on y écrit, on y meurt… La chambre reflète la personnalité de son propriétaire, en même temps que ses états d’âme. Dans La Comédie humaine, les lits posent souvent le décor, du modeste lit de sangle au lit richement paré. Il est un dénominateur commun, c’est le désordre qui peut régner aussi bien dans la chambre de la concierge, de l’aristocrate ou du bourgeois enrichi, mais un désordre arrangé.