Diplomová Práce
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Collection and Analysis of a Longitudinal Twitter Sentiment Dataset
The emojification of sentiment on social media: Collection and analysis of a longitudinal Twitter sentiment dataset Wenjie Yin, Rabab Alkhalifa, Arkaitz Zubiaga Queen Mary University of London, UK {w.yin,r.a.a.alkhalifa,a.zubiaga}@qmul.ac.uk Abstract Social media, as a means for computer-mediated communication, has been extensively used to study the sentiment expressed by users around events or topics. There is however a gap in the longitudinal study of how sentiment evolved in social media over the years. To fill this gap, we develop TM-Senti, a new large-scale, distantly su- pervised Twitter sentiment dataset with over 184 million tweets and covering a time period of over seven years. We describe and assess our methodology to put together a large-scale, emoticon- and emoji-based labelled sentiment analysis dataset, along with an analysis of the re- sulting dataset. Our analysis highlights interesting temporal changes, among others in the increasing use of emojis over emoticons. We pub- licly release the dataset for further research in tasks including sentiment analysis and text classification of tweets. The dataset can be fully rehy- drated including tweet metadata and without missing tweets thanks to the archive of tweets publicly available on the Internet Archive, which the dataset is based on. 1 Introduction Social media research (Ngai, Tao, & Moon, 2015) and sentiment analysis (Poria, Hazarika, Majumder, & Mihalcea, 2020) have gained popularity in the last decade, both separately and jointly. Sentiment analysis of social media content is a fertile research area in a wide variety of fields including natural language processing (Wilson, Wiebe, & Hoffmann, 2005), computa- tional social science (Vydiswaran et al., 2018), information science (Zimbra, Ghiassi, & Lee, 2016) and beyond. -

Administering Avaya Social Media Manager
Administering Avaya Social Media Manager Release 6.2.x July 2016 © 2012-2016, Avaya, Inc. IF YOU DO NOT WISH TO ACCEPT THESE TERMS OF USE, YOU All Rights Reserved. MUST NOT ACCESS OR USE THE HOSTED SERVICE OR AUTHORIZE ANYONE TO ACCESS OR USE THE HOSTED Notice SERVICE. While reasonable efforts have been made to ensure that the Licenses information in this document is complete and accurate at the time of printing, Avaya assumes no liability for any errors. Avaya reserves THE SOFTWARE LICENSE TERMS AVAILABLE ON THE AVAYA the right to make changes and corrections to the information in this WEBSITE, HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO, document without the obligation to notify any person or organization UNDER THE LINK “AVAYA SOFTWARE LICENSE TERMS (Avaya of such changes. Products)” OR SUCH SUCCESSOR SITE AS DESIGNATED BY AVAYA, ARE APPLICABLE TO ANYONE WHO DOWNLOADS, Documentation disclaimer USES AND/OR INSTALLS AVAYA SOFTWARE, PURCHASED “Documentation” means information published in varying mediums FROM AVAYA INC., ANY AVAYA AFFILIATE, OR AN AVAYA which may include product information, operating instructions and CHANNEL PARTNER (AS APPLICABLE) UNDER A COMMERCIAL performance specifications that are generally made available to users AGREEMENT WITH AVAYA OR AN AVAYA CHANNEL PARTNER. of products. Documentation does not include marketing materials. UNLESS OTHERWISE AGREED TO BY AVAYA IN WRITING, Avaya shall not be responsible for any modifications, additions, or AVAYA DOES NOT EXTEND THIS LICENSE IF THE SOFTWARE deletions to the original published version of Documentation unless WAS OBTAINED FROM ANYONE OTHER THAN AVAYA, AN such modifications, additions, or deletions were performed by or on AVAYA AFFILIATE OR AN AVAYA CHANNEL PARTNER; AVAYA the express behalf of Avaya. -
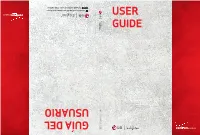
Guحadel Usuario User Guide
E R D I E S U U G MFL67235901(1.0) MW U G This booklet is made from 60% post-consumer paper. recycled booklet ismade from This U S This booklet is printed with soy ink. with soy booklet isprinted This U Í A A D R Printed inMexico Printed E I O L Copyright©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. TM Enlighten is registered trademark of Verizon Wireless and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners. Important Customer Information 1 When using this product, the safety precautions below must be taken to avoid possible legal liabilities and damages. Retain and follow all product safety and operating instructions. Observe all warnings in the product operating instructions. To reduce the risk of bodily injury, electric shock, fire, and damage to the equipment, observe the following precautions. ELECTRICAL SAFETY This product is intended for use when supplied with power from the designated battery or power supply unit. Other usage may be dangerous and will invalidate any approval given to this product. SAFETY PRECAUTIONS FOR PROPER GROUNDING INSTALLATION CAUTION: Connecting to improperly grounded equipment can result in an electric shock to your device. This product is equipped with a USB Cable for connecting to a desktop or notebook computer. Be sure your computer is properly grounded (earthed) before connecting this product to the computer. The power supply cord of a desktop or notebook computer has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet which is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. -

Acronyms and Emoticons on a Popular Web Forum: Does Gender Makes a Difference? a Corpus-Based Study of Reddit Marie Flesch
Acronyms and Emoticons on a Popular Web Forum: Does Gender Makes a Difference? A Corpus-Based Study of Reddit Marie Flesch To cite this version: Marie Flesch. Acronyms and Emoticons on a Popular Web Forum: Does Gender Makes a Difference? A Corpus-Based Study of Reddit. Humanities and Social Sciences. 2016. hal-02317528 HAL Id: hal-02317528 https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02317528 Submitted on 16 Oct 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. AVERTISSEMENT Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l’utilisation de ce document. D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale. Contact : [email protected] LIENS Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm Université de Lorraine – ERUDI Master Mention Langues et Cultures Etrangères Spécialité Mondes anglophones, Parcours Tourisme culturel 2ème session 2016 Acronyms and Emoticons on a Popular Web Forum: Does Gender Makes a Difference? A Corpus-Based Study of Reddit Par Marie Flesch Sous la direction de Alex Boulton Table of contents Abstract Introduction……………………………………………………..………………......1 I. -

An Empirical Study of Verbal Irony; Identification, Interpretation, and Its Role in Turn-Taking Discourse
AN EMPIRICAL STUDY OF VERBAL IRONY; IDENTIFICATION, INTERPRETATION, AND ITS ROLE IN TURN-TAKING DISCOURSE By DEBANJAN GHOSH A dissertation submitted to the School of Graduate Studies Rutgers, The State University of New Jersey in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in Communication, Information and Library Studies written under the direction of Smaranda Muresan, Ph.D. and approved by New Brunswick, New Jersey May, 2018 ABSTRACT OF THE DISSERTATION An Empirical Study of Verbal Irony; Identification, Interpretation, and its Role in Turn-taking Discourse By DEBANJAN GHOSH Dissertation Director: Smaranda Muresan, Ph.D. Human communication often involves the use of figurative language, such as verbal irony or sarcasm, where the speakers usually mean the opposite of what they say. In this dissertation, I address three problems regarding verbal irony: automatic identifica- tion of verbal irony and its characteristics from social media platforms, interpretation of verbal irony, and examining the role of verbal irony in identifying dis(agreement) relations in discussion forums. To automatically detect verbal irony I propose compu- tational models that are based on theoretical underpinnings of irony. I first reframe the question of irony identification as a word-sense disambiguation problem to understand how particular target words are used in the literal or figurative sense. Next, I thoroughly analyze two characteristics of irony; irony markers, and irony factors. I propose em- pirical models to identify irony, irrespective of contextual knowledge as well as with conversation context. I also analyze the context to understand what triggers an ironic reply and perform user studies to explain the machine learning model predictions. -

Face with One Eyebrow Raised
Proposal to Add Emoji: Face With One Eyebrow Raised Maximilian Merz, [email protected] November 5, 2015 Abstract Currently, there is no emoji encoded in Unicode that shows a face with one raised eyebrow. A raised eyebrow is a widely used facial expression and equally widely recognized as conveying a variety of meanings, centered around scepticism, surprise, disagreement, and being impressed. This proposal presents evidence of high usage of emoticons expressing similar mimics, suggesting a high expected usage level for the suggested emoji. An emoji with the name FACE WITH ONE EYEBROW RAISED is proposed to be included in the Unicode standard. 1 Introduction The author proposes the encoding of a new emoji, depicting a face with one eyebrow raised. A single raised eyebrow is a common form of facial expression. If accompanied by an \neutral mouth" (neither smiling nor frowning), it can be interpreted as a sign of scepticism, disbelief, or disapproval, as a sign of surprise or wonder, or as a silent greeting. Currently, there is no emoji to express these feelings, centering around \mild surprise" and no way to convey this particular facial expression. The proposed emoji would close this \gap of expression". The author expects high usage if this emoji should be encoded. (a) Black and White (b) Colored Figure 1: Image of the Proposed Emoji. Designed by Maximilian Merz and placed into the Public Domain. 1 Proposal to Add Emoji: Face With One Eyebrow Raised Maximilian Merz 2 Discussion of Emoji Selection Factors 2.1 Factors for Inclusion 2.1.1 Compatibility In Table 2, two existing emojis that match the proposed one are presented. -

From Emojis to Sentiment Analysis Gaël Guibon, Magalie Ochs, Patrice Bellot
From Emojis to Sentiment Analysis Gaël Guibon, Magalie Ochs, Patrice Bellot To cite this version: Gaël Guibon, Magalie Ochs, Patrice Bellot. From Emojis to Sentiment Analysis. WACAI 2016, Lab-STICC; ENIB; LITIS, Jun 2016, Brest, France. hal-01529708 HAL Id: hal-01529708 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01529708 Submitted on 31 May 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. From Emojis to Sentiment Analysis Gaël Guibon Magalie Ochs Patrice Bellot Aix Marseille Université, Aix Marseille Université, Aix Marseille Université, CNRS, ENSAM, Université de CNRS, ENSAM, Université de CNRS, ENSAM, Université de Toulon, LSIS UMR7296,13397 Toulon, LSIS UMR7296,13397 Toulon, LSIS UMR7296,13397 Caléa Solutions Marseille Marseille Marseille France France France [email protected] [email protected] [email protected] ABSTRACT for sentiment analysis, to highlight the different possibilities Studies on Twitter are becoming quite common these years. they offer. [12] Even so, the majority of them did not focused on emoticons, The paper is organised as follow: At first, after defining even less on emojis. An overview of emoticons related work emoticons and emojis (Section 2), we present a categoriza- has been made recently [11]. -

Text Mining and Visualization
Computer Science & Engineering Chapman & Hall/CRC Chapman & Hall/CRC Data Mining and Knowledge Discovery Series T Data Mining and Knowledge Discovery Series EX T “The timing of this book could not be better. It focuses on text mining, text be- M ing one of the data sources still to be truly harvested, and on open-source tools TEXT MINING AND for the analysis and visualization of textual data. … Markus and Andrew have INING done an outstanding job bringing together this volume of both introductory and VISUALIZATION advanced material about text mining using modern open-source technology in a highly accessible way.” —From the Foreword by Professor Dr. Michael Berthold, University of Konstanz, Case Studies Using Germany AND Text Mining and Visualization: Case Studies Using Open-Source Tools pro- Open-Source Tools vides an introduction to text mining using some of the most popular and powerful open-source tools: KNIME, RapidMiner, Weka, R, and Python. V The contributors—all highly experienced with text mining and open-source soft- ware—explain how text data are gathered and processed from a wide variety of ISUALIZA sources, including books, server access logs, websites, social media sites, and message boards. Each chapter presents a case study that you can follow as part of a step-by-step, reproducible example. You can also easily apply and extend the techniques to other problems. All the examples are available on a supplemen- tary website. The book shows you how to exploit your text data, offering successful applica- T tion examples and blueprints for you to tackle your text mining tasks and benefit ION from open and freely available tools. -

Samsung Galaxy J7 J700P User Manual
User Guide [UG template version 16a] [Boost-Samsung-J7-ug-en-042516-FINAL] Table of Contents Getting Started .............................................................................................................................................. 1 Introduction ........................................................................................................................................... 2 About the User Guide ................................................................................................................... 2 Get Support from Boost Zone ....................................................................................................... 2 Set Up Your Phone ............................................................................................................................... 4 Parts and Functions ...................................................................................................................... 4 Battery Use ................................................................................................................................... 6 Install the Battery .................................................................................................................. 7 Charge the Battery ................................................................................................................ 8 SD Card ........................................................................................................................................ 9 Insert an SD Card .............................................................................................................. -

Sentiment Analysis of Social Sensors for Local Services Improvement
International Journal of Computing and Digital Systems ISSN (2210-142X) Int. J. Com. Dig. Sys. 6, No.4 (July-2017) http://dx.doi.org/10.12785/ijcds/0600402 Sentiment Analysis of Social Sensors for Local Services Improvement Olivera Kotevska1 and Ahmed Lbath2 1,2 University of Grenoble Alpes, CNRS, LIG, F-38000, Grenoble, France Received 2 Dec. 2016, Revised 3 Jun. 2017, Accepted 15 Jun. 2017, Published 1 July 2017 Abstract: Today, there is an enormous impact on a generation of data in everyday life due to microblogging sites like Twitter, Facebook, and other social networking websites. The valuable data that is broadcast through microblogging can provide useful information to different situations if captured and analyzed properly promptly. In the case of Smart City, automatically identifying event types using Twitter messages as a data source can contribute to situation awareness about the city, and it also brings out much useful information related to it for people who are interested. The focus of this work is an automatic categorization of microblogging data from the certain location, as well as identify the sentiment level at each of the categories to provide a better understanding of public needs and concerns. As the processing of Twitter messages is a challenging task, we propose an algorithm to preprocess the Twitter messages automatically. For the experiment, we used Twitter messages for sixteen different event types from one geo- location. We proposed an algorithm to preprocess the Twitter messages, and Random Forest classifier automatically categorize these tweets into predefined event types. Therefore, applying sentiment analysis to tweets related to these categories allows if people are talking in negative or positive context about it, thus providing valuable information for timely decision making for recommending local service. -

APA Newsletters NEWSLETTER on TEACHING PHILOSOPHY
APA Newsletters NEWSLETTER ON TEACHING PHILOSOPHY Volume 09, Number 1 Fall 2009 FROM THE EDITORS, TZIPORAH KASACHKOFF & EUGENE KELLY ARTICLES RALPH H. JOHNSON AND J. ANTHONY BLAIR “Teaching the Dog’s Breakfast: Some Dangers and How to Deal with Them” J. AARON SIMMONS AND SCOTT F. AIKIN “Teaching Plato with Emoticons” RUSSELL W. DUMKE “Using Euthyphro 9e-11b to Teach Some Basic Logic and to Teach How to Read a Platonic Dialog” BOOK REVIEW Stephen Mulhall: Philosophical Myths of the Fall REVIEWED BY DANIEL GALLAGHER BOOKS RECEIVED ADDRESSES OF CONTRIBUTORS © 2009 by The American Philosophical Association APA NEWSLETTER ON Teaching Philosophy Tziporah Kasachkoff and Eugene Kelly, Co-Editors Fall 2009 Volume 09, Number 1 from the layout of a textbook he was assigned for a course in ROM THE DITORS philosophy. The text contains a chapter on logic that is followed F E by a chapter that discusses Plato’s and Aristotle’s notions of form, and includes, as a reading selection, Plato’s Euthyphro 9d-11b. Here Socrates and Euthyphro discuss the latter’s Tziporah Kasachkoff, The Graduate Center, CUNY definition of piety as what the gods all love. The passage may ([email protected]) be seen as an illustration of basic concepts in logic. Dumke’s paper offers an excellent analysis of this passage, using truth- Eugene Kelly, New York Institute of Technology functional operators to show the structure of Socrates’ analysis, ([email protected]) and a diamond-shaped diagram for exhibiting plastically the two men’s dispute about the definition. The author brings out Welcome to the fall 2009 edition of the APA Newsletter on via his analysis examples of possible circular reasoning and an Teaching Philosophy. -

Christmas Crackers
Christmas Crackers 1990 - 1997 Gavin Holman 1990 1990 Computerwocky 'Twas binary, and the wysiwyg Did gulp and gigo in the mips: All bubble were the memories, And bipolar were the chips. "Beware the Jargontalk, my son! Like 'gigabytes' and 'Riscs' and 'rings'! Beware all technospeak, and shun Those dubious buzz-word things." Base two! Base two! and through and through The packet-switch went buffer-stack! With multithread and thin-film head It went on looping back. "And hast thou sussed the Jargontalk In interactive user code? O frabjous day! Callooh! Callay!" (in Lewis Carroll mode). Pregenesis In the beginning there was maximum entropy. And then it came to pass that it decreased. Out of the chaos and darkness came order. On the first day, matter was formed. It separated from the primordial energy and created space. On the second day, baryons and leptons were formed. They took unto themselves positive and negative charges. On the third day, atoms were formed. Great and small forces made baryons and leptons cling to each other. On the fourth day, molecules were formed. They were of all types: small, large, polar and nonpolar, stable and unstable. On the fifth day, molecular aggregates were formed. Water molecule cleaved unto water molecule, magnesium unto chlorophyll, globin unto heme. 1990 On the sixth day, the molecules reproduced themselves. DNA separated and rejoined, RNS clung unto amino acids, amino acids clung onto proteins. And on the seventh day, the entropy started to increase again.... Variations on "As good as gold" etc.. As gold as green As eery as complaint As prime as stove As right as cramp As saucy as apprentice As lank as sheer As full as earth As wily as telegrapy As finned as fish fingers As fast as sleep As mad as on Avenue As matty as Rosie As squat as rights As benign as split As jewelly as Caesar As vain as blood As off as dyke As old as Huxley As foul as Modern English As tight as oats As taut as shell As wicked as Almanac As find as keepers As cheep as creepers Grammar Rules? Don't use no double negatives.