Syria , Recensions 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

LEARNING in the 21ST CENTURY Author Photograph : © Monsitj/Istockphoto
FRANÇOIS TADDEI LEARNING IN THE 21ST CENTURY Author photograph : © Monsitj/iStockphoto © Version française, Calmann-Lévy, 2018 SUMMARY FRANÇOIS TADDEI with Emmanuel Davidenkoff LEARNING IN THE 21ST CENTURY Translated from French by Timothy Stone SUMMARY SUMMARY To all those who have taught me so much. SUMMARY SUMMARY If you want to build a ship, don’t drum up people to collect wood and don’t assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea...” Antoine de SAINT-EXUPÉRY, Citadelle SUMMARY Summary Prologue ......................................................................................................................................................... 11 Introduction .................................................................................................................................................13 1. Why will we learn differently st in the 21 century? ................................................................................................21 2. What i’ve learned ...........................................................................................55 3. New ways of teaching .........................................................................79 4. Before you can learn, you have to unlearn ...................................................................................113 5. Learn to ask (yourself) good questions ........................................................................................................201 6. A how-to guide for a learning planet -

Iran Animation Takes Part in Chinese Festival
Art & Culture January 4, 2020 3 This Day in History (January 4) Iran Animation Takes Part Today is Saturday; 14th of the Iranian month of Dey 1398 solar hijri; corresponding to 8th of the Islamic month of Jamadi al-Awwal 1441 lunar hijri; and January 4, 2020, of the Christian Gregorian Calendar. 503 solar years ago, on this day in 1517 AD, the Battle of Ridhaniya near Cairo, led to the total victory of the Ottoman Turks of Sultan Salim I over the in Chinese Festival Turkic Mamluk dynasty of Egypt and the killing of Sultan Bay. In this battle, Kong Arts Centre will be receiving regardless of the fact that, their the Ottoman commander, Grand Vizier Sinan Pasha, who had engineered a resounding victory over the Mamluks in the decisive Battle of Khan Yunus in Iranian animation on the aftermath countries are burning in the fire of Gaza on October 28, lost his life. This last phase of the Ottoman-Mamluk wars of war directed by Lida Fazli. a war that the adults have brought started in August 1516, when Sultan Salim, two years after his narrow victory In an earlier exclusive talk with upon it. at Chaldiran in Azarbaijan over the Shah of Persia, Ismail I, suddenly invaded ifilm, Fazli had said that she has According to the official website Syria, since he greatly feared the Iranians might reorganize and counterattack in made the short to convey the of the event, this year edition of the view of the widespread influence of the Safavids in Syria and Anatolia (modern day Turkey). -

History of the Education of the Blind
HISTORY OF THE EDUCATION OF THE BLIND HISTORY OF THE EDUCATION OF THE BLIND BY W. H. ILLINGWORTH, F.G.T.B. SUPERINTENDENT OP HENSHAW's BLIND ASYLUM, OLD TRAFFORD, MANCHESTER HONORARY SECRETARY TO THE BOARD OF EXAMINERS OF THE COLLEGE OF TEACHERS OF THE BLIND LONDON SAMPSON LOW, MARSTON & COMPANY, LTD. 1910 PRISTKD BY HAZELL, WATSON AND VINEY, LI)., LONDON AND AYLKSBURY. MY BELOVED FRIEND AND COUNSELLOR HENRY J. WILSON (SECRETARY OP THE GARDNER'S TRUST FOR THE BLIND) THIS LITTLE BOOK IS RESPECTFULLY DEDICATED IN THE EARNEST HOPE THAT IT MAY BE THE HUMBLE INSTRUMENT IN GOD'S HANDS OF ACCOMPLISHING SOME LITTLE ADVANCEMENT IN THE GREAT WORK OF THE EDUCATION OF THE BLIND W. II. ILLINGWORTH AUTHOR 214648 PREFACE No up-to-date treatise on the important and interesting " " subject of The History of the Education of the Blind being in existence in this country, and the lack of such a text-book specially designed for the teachers in our blind schools being grievously felt, I have, in response to repeated requests, taken in hand the compilation of such a book from all sources at my command, adding at the same time sundry notes and comments of my own, which the experience of a quarter of a century in blind work has led me to think may be of service to those who desire to approach and carry on their work as teachers of the blind as well equipped with information specially suited to their requirements as circumstances will permit. It is but due to the juvenile blind in our schools that the men and women to whom their education is entrusted should not only be acquainted with the mechanical means of teaching through the tactile sense, but that they should also be so steeped in blind lore that it becomes second nature to them to think of and see things from the blind person's point of view. -

Here, I Will Argue That the of Neo-Assyrian Success Reach Back
7 ûsslriolagiqueinternationøle,Miünchen,zg.Juni bisj.J:ulirgTo,ed.DierzO.Edzard, zo9-t6. Munich: Verlag der Bayerischen Akadamie der \ffissenschaft. Zaccagnini, Carlo. 1989. "Asiatic Mode of Production and Ancient Near East: Notes towards a Discussion."In Production and Consumption in the AncientNear Eøst,ed. Carlo Zaccagnini, r-126. Budapest: University of Budapest. Zadok Ran. 1995. "The Ethno-Linguistic Character of the Jezireh and Adjacent Regions in the 9th7th Centuries (Assyria Proper vs. Periphery)." In Me o-,l.ssyrian Geography, ed. Mario Liverani, zt7-8z.Rome: IJniversità di Roma "LaSapienza.,' 2 Zeh.nder, Markus. zoo5. Umgang mit Fremden in Israel und Assyrien: Ein Beitrag zur Anthropologie des "F¡emden" im Licht antiker Q¡ellen. Stuttgart: arglrably the first world- Åt the Root of the Møtter Kohlhammer. The Neo-Assyrian Empire, often presented by scholars as a fundamen- Zehnder,Markus. zoo7."Die Aramaisierung'Assyriens als Folge der Expansion des empire, is phenornenon. Here, I will argue that the The Middle Assyrian assyrischen Reiches." In In . der seine Lust hat øm Wort des flerrn! FætscÌrift tally new of Neo-Assyrian success reach back in Prelude ta Ernpire fiir ErnstJenni zum 8o: Geùartstag, ed.Jürg Luchsinger, F{ans-Peter Mathys, and foundations preceding Middle Assyrian Markus Saur,417-39. Münster, Germany: Ugarit Vedag. D^rt iîto the short-lived state. This continuity can be seen in a range Zimansl<y, Paul E. 1995. "fhe Kingdom of Urartu in Ðastern Anatolia."In CANE, imperi^l and in a Brpoa S. DünrNc n35-46. of imperial practices in conquered territories the Late Btonze (Lnroar Uurvnnsrrv) "ôulture of empire" that has its roots in Age. -

New Perspectives on Aramic Epigraphy in Mesopotamia
Orientalische Religionen in der Antike Ägypten, Israel, Alter Orient Oriental Religions in Antiquity Egypt, Israel, Ancient Near East (ORA) Herausgegeben von / Edited by Angelika Berlejung (Leipzig) Nils P. Heeßel (Marburg) Joachim Friedrich Quack (Heidelberg) Beirat / Advisory Board Uri Gabbay (Jerusalem) Michael Blömer (Aarhus) Christopher Rollston (Washington, D.C.) Rita Lucarelli (Berkeley) 40 New Perspectives on Aramaic Epigraphy in Mesopotamia, Qumran, Egypt, and Idumea Proceedings of the Joint RIAB Minerva Center and the Jeselsohn Epigraphic Center of Jewish History Conference Research on Israel and Aram in Biblical Times II Edited by Aren M. Maeir, Angelika Berlejung, Esther Eshel, and Takayoshi M. Oshima Mohr Siebeck AREN M. MAEIR is a full professor of archaeology at the Department of Land of Israel Studies and Archaeology, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel. ANGELIKA BERLEJUNG is a professor for Old Testament Studies at the University of Leipzig, Germany, and professor extraordinaire for Ancient Near Eastern Studies at the University of Stellenbosch, South Africa. ESTHER ESHEL is an associate professor of Bible and Epigraphy at the Department of Land of Israel Studies and Archaeology and the Department of Bible, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel. TAKAYOSHI M. OSHIMA is a privatdozent at the Altorientalisches Institut, the Faculty of History, Art, and Area Stuides, of the University of Leipzig, Germany. ISBN 978-3-16-159894-4 / eISBN 978-3-16-159895-1 DOI 10.1628/978-3-16-159895-1 ISSN 1869-0513 / eISSN 2568-7492 (Orientalische Religionen in der Antike) The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographic data are available at http://dnb.dnb.de. -

Archaeological Explorations in Syria 2000-2011 Proceedings of ISCACH-Beirut 2015
Archaeological Explorations in Syria 2000-2011 Proceedings of ISCACH-Beirut 2015 edited by Jeanine Abdul Massih Shinichi Nishiyama in collaboration with Hanan Charaf and Ahmad Deb Archaeopress Archaeology Archaeopress Publishing Ltd Summertown Pavilion 18-24 Middle Way Summertown Oxford OX2 7LG www.archaeopress.com ISBN 978 1 78491 947 4 ISBN 978 1 78491 948 1 (e-Pdf) © Archaeopress and the authors 2018 All rights reserved. No part of this book may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the copyright owners. Printed in England by Oxuniprint, Oxford This book is available direct from Archaeopress or from our website www.archaeopress.com Tribute to Khaled Al-Assaad, Giro Orita, and Antoine Suleiman The Japanese Society for West Asian Archaeology and the Lebanese University Archaeological Mission of Cyrrhus-Syria International Syrian Congress on Archaeology and Cultural Heritage (ISCACH): Results of 2000-2011 December 3-6, 2015 Beirut, Lebanon Organizing Committee Prof. Dr Jeanine Abdul Massih (Director of the Archaeological Mission to Cyrrhus), Lebanese University, Lebanon Prof. Kiyohide Saito (Director of the Archaeological Mission to Palmyra), President, the Japanese Society for West Asian Archaeology, Japan Prof. Dr Akira Tsuneki (Director of the Archaeological Mission to Tell El-Kerkh), University of Tsukuba, Japan Dr Shinichi Nishiyama, Chubu University, Japan Dr Ahmad Deb (Director of Ain Al-Arab Mission), DGAM, Syria All -

11 Dja'de El-Mughara (Aleppo)
A History of Syria in One Hundred Sites edited by Access Youssef Kanjou and Akira Tsuneki Open Archaeopress Archaeopress Archaeology Copyright Archaeopress and the authors 2016 Archaeopress Publishing Ltd Gordon House 276 Banbury Road Oxford OX2 7ED www.archaeopress.com ISBN 978 1 78491 381 6 ISBN 978 1 78491 382 3 (e-Pdf) © Archaeopress and the authors 2016 Access Cover Illustration: View of the excavation at Hummal site © The Syro-Swiss mission on the Palaeolithic of the El Kowm Area Open All rights reserved. No part of this book may be reproduced, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, Archaeopresswithout the prior written permission of the copyright owners. Printed in England by Oxuniprint, Oxford This book is available direct from Archaeopress or from our website www.archaeopress.com Copyright Archaeopress and the authors 2016 Contents Preface ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� vii Introduction: The Significance of Syria in Human History ��������������������������������������������������������������������������������������1 Youssef Kanjou and Akira Tsuneki Chapter 1: Prehistory 1� El Kowm Oasis (Homs) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 Reto Jagher, Dorota Wojtczak and Jean-Marie Le Tensorer 2� Dederiyeh Cave (Aleppo) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 -

PLAIN of ANTIOCH III Oi.Uchicago.Edu
oi.uchicago.edu EXCAVATIONS IN THE PLAIN OF ANTIOCH III oi.uchicago.edu Back cover: View of Chatal Höyük from the northeast. Photo taken by Claude Prost, probably in the summer of 1932 oi.uchicago.edu iii EXCAVATIONS IN THE PLAIN OF ANTIOCH III STRATIGRAPHY, POTTERY, AND SMALL FINDS FROM CHATAL HÖYÜK IN THE AMUQ PLAIN MARINA PUCCI with appendices from J. A. BRINKMAN, E. GÖTTING, and G. HÖLBL THIS RESEARCH WAS CARRIED OUT THANKS TO THE FINANCIAL SUPPORT OF THE SHELBY WHITE-LEON LEVY FOUNDATION PART 1 | TEXT O R I E N TA L INSTITUTE PUBLICATIONS • VOLUME 143 THE O R I E N TA L INSTITUTE OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO oi.uchicago.edu iv LCCN: 2019930795 ISBN-13: 978-1-61491-046-6 ISSN: 0069-3367 The Oriental Institute, Chicago ©2019 by The University of Chicago. All rights reserved. Published 2019. Printed in the United States of America. Oriental Institute Publications 143 Series Editors Charissa Johnson and Thomas G. Urban with the assistance of Rebecca Cain, Alexandra Cornacchia, Jaslyn Ramos, Emily Smith, and Steven Townshend Cover Illustration Painted potstand, Iron Age I (A26946, cat. no. 134). Illustration by Angela Altenhofen, coloring by Tiziana d’Este. Spine Illustration Scene incised on ostracon (A17370, cat. no. 1110). Illustration by Angela Altenhofen. Printed by Marquis Book Printing in Montmagny, Québec Canada through Four Colour Print Group. This paper meets the requirements of ansi/niso Z39.48-1992 (Permanence of Paper) oi.uchicago.edu v Table of Contents List of Tables .............................................................................. xiii List of Figures ..............................................................................xv Preface (James F. Osborne) ................................................................... -
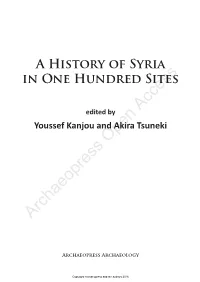
Archaeopress Open Access
A History of Syria in One Hundred Sites edited by Access Youssef Kanjou and Akira Tsuneki Open Archaeopress Archaeopress Archaeology Copyright Archaeopress and the authors 2016 Archaeopress Publishing Ltd Gordon House 276 Banbury Road Oxford OX2 7ED www.archaeopress.com ISBN 978 1 78491 381 6 ISBN 978 1 78491 382 3 (e-Pdf) © Archaeopress and the authors 2016 Access Cover Illustration: View of the excavation at Hummal site © The Syro-Swiss mission on the Palaeolithic of the El Kowm Area Open All rights reserved. No part of this book may be reproduced, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, Archaeopresswithout the prior written permission of the copyright owners. Printed in England by Oxuniprint, Oxford This book is available direct from Archaeopress or from our website www.archaeopress.com Copyright Archaeopress and the authors 2016 Contents Preface ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� vii Introduction: The Significance of Syria in Human History ��������������������������������������������������������������������������������������1 Youssef Kanjou and Akira Tsuneki Chapter 1: Prehistory 1� El Kowm Oasis (Homs) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 Reto Jagher, Dorota Wojtczak and Jean-Marie Le Tensorer 2� Dederiyeh Cave (Aleppo) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 -

Touch Exhibition 21St, 22Nd, and 23Rd, August, 2008
Louis Braille Touch Exhibition 21st, 22nd, and 23rd, August, 2008 International Conference Centre 17 rue de Varembé CH – 1211 Geneva 20 Noëlle ROY Curator of the Valentin Haüy Museum Exhibition Organiser © ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 5 rue Duroc Fr-75007 PARIS T. 33 (0)1 44 49 27 27 www.avh.asso.fr Louis Braille Touch Exhibition Genève, 21st, 22nd, and 23rd, August, 2008 2 Louis Braille 1809 - 1852 Touch Exhibition Presented by the Valentin Haüy Association 7th General Meeting of the Word Blind Union International Conference Centre 17 rue de Varembé CH – 1211 Geneva 20 21st, 22nd, and 23rd, August, 2008 3 Louis Braille Touch Exhibition Genève, 21st, 22nd, and 23rd, August, 2008 Louis Braille Touch Exhibition Genève, 21st, 22nd, and 23rd, August, 2008 4 Louis Braille’s life Louis Braille was born on 4th January 1809 in Coupvray, a small village in Seine-et- Marne about 30 kilometres from Paris. His family had been saddlemakers for generations. At the age of three, he wounded an eye while playing with some tools in his father’s workshop. He turned out to be a lively, inquisitive child, characteristics which his family nurtured even after his blindness became permanent and total. After attending his village school, he entered the ROYAL INSTITUTION FOR THE YOUNG BLIND in Paris at the age of ten. This was housed in the former St. Firmin seminary at N° 68 rue St. Victor. These buildings, no longer standing, were located where N°° 2, 4 & 4 b rue des Écoles are now to be found. It was a cold, damp, uncomfortable, unhealthy place, ridden with tuberculosis, which Louis Braille was to die of. -

Guzana/Tell Halaf
Originalveröffentlichung in: Kutlu Aslihan Yener (Hrsg.), Across the border: Late Bronze–Iron Age relations between Syria and Anatolia (Ancient Near Eastern Studies : Supplement 42), Leuven 2013, S. 293-309 CHAPTER 12 BETWEEN THE MUSKU AND THE ARAMAEANS THE EARLY HISTORY OF GUZANA/TELL HALAF Mirko NOVAK Universitat Bern Institut fur Archaologische Wissenschaften Abteilung fur Vorderasiatische Archaologie Langgassstrasse 10 CH-3012 Bern Switzerland E-mail: [email protected] Abstract One of the main goals of the renewed Syro-German excavations in Tell Halaf is the reconstruction of its history during the Iron Age. According to the ceramics discovered in the earliest Iron Age levels, the predecessor settlement of the Aramaean town of Gozan/ Guzana was founded by immigrants from Eastern Anatolia. Probably they were settled outside the gates of the Middle Assyrian provincial town of Assukanni, modern Tell Fekheriye, by the Assyrian government in the early 11th century. After the occupation by Aramaean tribes and its reconquering by the Assyrians the town underwent major recon structions and changes in its layout) Thus, several breaks can be traced in the material culture of the site, each time followed by distinguished acculturations. Introduction In 2006 a Syro-German mission started new excavations at Tell Halaf in northeast ern Syria, precisely 77 years after the end of the large-sized explorations of Max von Oppenheim at this site. It revealed both a prehistoric settlement with a characteristic type of painted pottery and the capital of an Aramaean principality with a previously unknown monumental art dating to the early Iron Age. The new project is conducted by the General Directorate of Antiquities and Museums in Damascus and the Museum 1 The project is co-directed by Abdel Mesih Baghdo (Damascus/Hassake), Lutz Martin (Berlin) and the present author. -

Changing Perspectives on the Value of Literacy to Blind Persons Reflected
Changing perspectives on the value of literacy to blind persons reflected in the production, dissemination and reception of publications in raised type in Britain c.1820-1905 John Philip Oliphant of Rossie Institute of Education Doctor of Philosophy 2011 ProQuest Number: 10629685 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a com plete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest ProQuest 10629685 Published by ProQuest LLC(2017). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States C ode Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106- 1346 I hereby declare that, except where explicit attribution is made, the work presented in this thesis is entirely my own. Word count (exclusive of appendix and bibliography): 83,423 words Abstract This study examines historically the provision of literature to Britain’s blind community. It addresses issues relevant to present debates on the blind person’s right to equality of access to information, and the state’s responsibility to ensure this. Changing perceptions of blindness and blind people’s needs are traced through hitherto neglected primary sources, including institutional records, government reports, conference proceedings and journals. The legacies of individuals who invented reading systems and of institutions and associations that shaped attitudes and practice are evaluated.