Voyage Dans Les Villes Intelligentes : Entre Datapolis Et Participolis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Speaker Talk Titles & Topics
DAY 1: POPULATION SCALE AI Monday, October 12th, 2pm - 6pm IST SESSION DETAILS TITLE SPEAKER SESSION 1 (2pm - 3pm IST) Nivruti Rai, Country Head, Intel India and Welcome Address Vice President, Data Platforms Group Dr. Biswajit Saha, Director (Trainings & Skill Welcome Note Education), Central Board of Secondary Education (CBSE) Jeffrey J. Rittener, Chief Government Affairs Officer & General Manager, Intel Congratulatory Remarks Governments, Markets and Trade (GMT) AI for Future Workforce group Shri Manoj Ahuja, IAS, Chairperson CBSE, Special Remarks Ministry of Education, Government of India Smt. Anita Karwal, IAS, Secretary, Special Remarks Department of School Education & Literacy, Ministry of Education, Government of India Hon'ble Shri Ramesh Pokhriyal, Minister of Launch of AI For Youth Symposium Education, Government of India SESSION 2 (3pm - 4:15pm IST) Nivruti Rai, Country Head, Intel India and Intel's AI Vision for India & Population Scale AI Vice President, Data Platforms Group Prof. P. J. Narayanan, Director, International Introducing Applied AI Research Center Institute of Information Technology (IIIT), Hyderabad Hon'ble Shri K T Rama Rao Cabinet Minister for IT E&C, MA & UD and Inauguration of Applied AI Research Center Industries & Commerce Departments, Applied AI - The India Plan Government of Telangana Hon'ble Shri K T Rama Rao, Cabinet Minister for IT E&C, MA & UD and Industries & Telangana's Year of AI Highlights & Vision Commerce Departments, Government of Telangana Hon'ble Shri Ravi Shankar Prasad Cabinet Minister for Law & Justice, Communications Address by Hon'ble Minister and Electronics & Information Technology, Government of India SESSION 4 (4:15pm - 6pm IST) Prof. K. VijayRaghavan, Principal Scientific Applied AI, Outcome-based Research in AI, a reality Advisor, Government of India Building & leveraging Indian genomic databases to create future Kiran Mazumdar-Shaw, Executive products & solutions Chairperson, Biocon Limited Srini Raju, Founder & Chairman, iLabs Leapfrogging public healthcare using AI Capital The Way Ahead Prof. -

Press Release Sai Wardha Power Generation Limited
Press Release Sai Wardha Power Generation Limited February 11, 2021 Rating Facilities/Instruments Amount (Rs. crore) Ratings Rating Action CARE BBB-; Stable Long Term Bank Facilities 755.93 (Triple B Minus; Assigned Outlook: Stable) CARE BBB-; Stable / CARE A3 Long Term / Short Term 100.00 (Triple B Minus; Assigned Bank Facilities Outlook: Stable/ A Three) 855.93 Total Bank Facilities (Rs. Eight Hundred Fifty-Five Crore and Ninety-Three Lakhs Only) Details of instruments/facilities in Annexure-1 Detailed Rationale & Key Rating Drivers The ratings assigned to the bank facilities of Sai Wardha Power Generation Limited (SWPGL) derive strength from the benefits derived out of the resolution plan implemented for the company with change in management and investment by the iLabs Group, significant debt reduction and fund infusion by the new management, long term off-take agreement entered with Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd. (MSEDCL) for 45% of total gross capacity and back-to-back with Brihanmumbai Electricity Supply and Transport (BEST) through Manikaran Power Limited (MPL) for 19% of total gross capacity and gradual improvement in the operational & financial performance of the company in the current fiscal. The rating strengths are however, tempered by the demand risk and price risk with respect to untied capacity, relatively low PLF level during 9MFY21 (refers to period April 01 to December 31) dependence upon auction coal for partial capacity thereby, resulting in susceptibility to raw material price volatility, exposure to counterparty credit risk arising from existing domestic off-takers having moderate financial risk profile and pending finalization of capex for flue gas desulphurization (FGD). -

A Magazine for Alumni and Friends of Emory University's
A MAGAZINE FOR ALUMNI AND FRIENDS OF EMORY University’s GOIZUETA BUSINESS SCHOOL business FALL 2012 HOW POWERFUL IS YOUR NETWORK? ALUMS CHART PATH BBA TREK TO SUPPORT DURING + FROM GOIZUETA TO HOLLYWOOD TOUGH TIMES WALL STREET EMORY PROFESSOR NAMED US POET LAUREATE UNVEILING: Roberto C. Goizueta legacy | Natasha Trethewey, Mural celebrates the nation’s official poet, life, achievements 47 wows audiences at Emory 10 FEATURES Goizueta Network: 16 BEYOND GRADUATION contents sets the Jason E. Wynn Relationships among classmates stay strong stage for 15 04JD/MBA TV sitcom and Kimberly 28 CRISIS MANAGEMENT (Schuster) Alums recall Goizueta community’s generosity Wynn 01BBA in time of need Coffee with . 6 Ramnath Chellappa 34 42 business goizuetabuzz yournetwork + plus FALL 2012 POWERHOUSE 04 SOCIAL ENTERPRISE 40 FOOD FOR THOUGHT 34 SUPPORT FOR CAMPAIGN NETWORK Students, alums, assist Atlanta Lettuce Works Ralph Bower 10EMBA on moving up corporate ladder AS DEADLINE NEARS On cover: 05 ALUMNA HONORED 41 NIELSON RATINGS 46 ADVICE ON Connectivity in action: Meredith R. Farahmand 14BBA, center, The Goizueta network, like a powerhouse Jackie Breiter 01EMBA Liz Yurkevicz 08BBA on creating value through analytics STAYING CONNECTED with Jackie Breiter 01EMBA and Professor Benn Konsynski in server, delivers value to its members Georgia WIT Woman of the Year 44 RISK-TAKING AND SUCCESS 47 What’S new: the Emory Data Center. while creating a competitive advantage for our community 40 07 NEW FACULTY Roger Ares 01EMBA on self-motivation COMMENCEMENT HIGHLIGHTS -

Leading Business Digital Transformations and Innovation
Leading Business Digital Transformations and Innovation 01 AUG 2018 – 31 JAN 2019, HYDERABAD Leading Business Digital Transformations and Innovation Emerging technologies and digital business models are fundamentally transforming how firms compete with one another. Traditional boundaries and value networks of firms are getting disrupted at a rapid pace, forcing organisations to rethink strategies not just for business growth and competitive advantage, but also for survival. Technology giants such as Amazon, Google, Apple, and Facebook, as well as digital native entrepreneurs, are increasingly challenging the dominance of large established industry incumbents across diverse sectors. Digital technologies are also opening up a host of unprecedented opportunities for executives and leaders across all business functions to redefine value, innovate, shape culture, collaborate, and grow. To realise these opportunities, organisations require a new breed of digitally-savvy leaders, who are ready for uncertain, open and dynamic competitive contexts. It is imperative for these leaders to understand and effectively leverage appropriate digital technologies to transform their business strategies and models, lead their organisations to new paradigms of data-driven analytical insights and customer-focused innovation, and acquire the ability to continually learn, armed with lessons and innovative trends from around the world. To help meet these different and dynamic leadership requirements of growing competition in the digital age, ISB has launched a -

Annual Report
ANNUAL REPORT 2020-21 About the Benefactor About SRITNE The Srini Raju Centre for Information Technology and the Networked Economy (SRITNE) is Srini Raju Centre for IT and the Networked Economy (SRITNE) is a multi-disciplinary research centre aimed at fostering rigorous and relevant research, education and supported by a generous endowment set up by Srini Raju, who is the Managing Director and outreach that advances our understanding of how Information and Communication Co-Founder of Peepul Capital (formerly, iLabs Capital). He is also the founding member of Technologies (ICT) create value for business and society. the International Institute of Information Technology (IIIT), Hyderabad and a member of the governing board of Indian School of Business (ISB). Vision To provide an interdisciplinary lens for understanding the nature of technology-led transformations and their impacts on business and society Srini Raju Benefactor / Supporter The core activities of SRITNE are as follows: Ÿ Research that addresses practical and policy questions related to the effective ICT selection, adoption, & exploitation Message from Dean Ÿ Education that trains future leaders to leverage ICT for competitive success Ÿ Dialogue with academics, industry, government and students though speaker During the difficult year that went by, we faced considerable COVID-instigated challenges series, conferences and symposia across research centres and departments. But despite that, I am very happy to note that Thematic Areas of Focus SRITNE has had an eventful and an impactful year across a range of initiatives. Ÿ Digital Economy and Future of Work Ÿ Digital Transformations for Business and Society SRITNE has been an active research centre in evaluating the impact of the COVID crisis Ÿ Technology Innovation and Entrepreneurship through interactions with academicians and industry veterans and also through surveys, Ÿ Digital Experiments, Big Data and Computational Policy Ÿ Bridging the Digital Divide research findings and publications. -

Giving Report
GIVING REPORT Annual Giving Report | 1 CHAIRMAN’S MESSAGE It is with great pleasure that I present the We have much more to achieve, and a many more peaks to conquer. Giving Report of the Indian School of Business As we celebrate our remarkable success and push forward towards (ISB). For any institution to be successful, achieving our vision to be among the top 10 global business schools support from a wide array of constituents is in the near future, I look forward to your unflagging support critical, and so is the case with ISB. On behalf of the entire Governing Board of the School, I thank you The School has received unstinted support profusely for your contributions. from individuals, institutions, business houses and the government. Liberal monetary contributions from a multitude of donors, chiefly the alumni, have p opelled the School to the glorious heights it is at, today. Their magnanimity has helped the School add Harish Manwani, newer facilities, provide a great experience to its students and drive Chairman of the Board, Indian School of Business research excellence Celebrating ISB’s Impactful Journey. DEAN’S MESSAGE Thank you for your continued support and belief. My heartfelt thanks to all our donors. You have the School. I look forward to your continuing support and greater played a key role in our remarkable success. involvement in our quest to conquer greater heights in the The School has strengthened its reputation as coming years. a global b-school with world-class academic programs, research centres and institutes and our strong alumni community has reached the 10,000 mark. -

Great Lakes Celebrates a Decade of Excellence at Mumbai the Institute Had Earlier Celebrated Its 10 Years Anniversary at Bangalore, Delhi, Hyderabad and Mumbai
Great Lakes celebrates a decade of excellence at Mumbai The Institute had earlier celebrated its 10 years anniversary at Bangalore, Delhi, Hyderabad and Mumbai Mumbai, January 12, 2015: Great Lakes Institute of Management celebrated a decade of excellence at Mumbai. To mark this special occasion an eventful evening was organized at Taj Mahal Hotel, Mumbai. The chief guest of the event Sh. Adi Godrej, Chairman, Godrej Group and the guests of honour Sh. Keki Dadiseth, Former Chairman, Hindustan Unilever Limited and Sh. Jerry Rao, Founder and former CEO of MphasiS were present along with Prof. Bala V Balachandran, Founder, Dean and Chairman, Great Lakes Institute of Management and other dignitaries. Speaking on the occasion, Prof Bala V Balachandran said, “I am proud to be part of such a young and enterprising Institute. Our innovative and world class management offerings have put Great Lakes Institute of Management on the global B School map. It is without a doubt that a high quality of education offered is of paramount importance to the institute and we assure that for the next decade and many more decades to come we will continue to perform at a global standard. Our one and only objective is to educate extraordinary leaders who can positively reshape business and society while constantly revolutionizing.” Shri. Adi B Godrej - Chairman, Godrej Group congratulated Dr. Bala on successfully completing 10 years and spoke how the association between Great Lakes and the Godrej group goes a long way back. The event also saw the release of the book “Dare to Dream - Biography of Prof. -
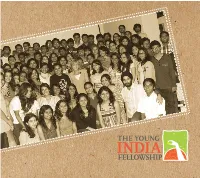
The YIF Vision... About the YIF
an idea whose time has come. an idea whose time has come. The YIF vision... About the YIF The Young India Fellowship is a one-year, funded, To develop committed change agents for multi-disciplinary course for exceptionally gifted young men India through a multi‐disciplinary and women. They represent India’s diversity – geographically and across academic disciplines. The YIF grooms young people to become change agents for programme guided by eminent leaders tomorrow by instilling in them the requisite skills, knowledge and experience. It exposes them to a rich set of subjects and perspectives, delivered by some of the and scholars of our time highest-calibre teachers from around the world. Fellows are mentored by pre-eminent individuals, respected captains of industry, academics, policy makers and proven change agents within India and globally. To complement the role modelling, they undertake a unique “learning-by-doing” programme, the Experiential Learning Module (ELM), which creates an opportunity to gain real experience in their area of interest. Whether students graduated in the arts, science, engineering or commerce, the Fellowship's commitment is to provide momentum to their leadership journey. The YIF vision... About the YIF The Young India Fellowship is a one-year, funded, To develop committed change agents for multi-disciplinary course for exceptionally gifted young men India through a multi‐disciplinary and women. They represent India’s diversity – geographically and across academic disciplines. The YIF grooms young people to become change agents for programme guided by eminent leaders tomorrow by instilling in them the requisite skills, knowledge and experience. It exposes them to a rich set of subjects and perspectives, delivered by some of the and scholars of our time highest-calibre teachers from around the world. -

Srinivasa Raju Chintalapati (Srini Raju)
Srinivasa Raju Chintalapati (Srini Raju) Chairman – iLabs Group Mr. Srini Raju founded iLabs Group in 2000. iLabs Group is one of the pioneers of the Investment Ecosystem in India. Over the years, it has grown its scope in terms of both Investment and Industry. Originally started as an Angel Investor, iLabs Capital has expanded into, Seed-Stage, Early-Stage and Growth-Stage Investments, as well as Re-Structures and Buy- Outs. Initially focused on Technology & Technology enabled Ventures, iLabs Capital has extended into Consumer Products & Services; Health Care; Skills-Development; Media and Entertainment; Corporate and Industrial Parks. Today, iLabs Group is one of the front-runners of the investment landscape in India. Srini has an MS in Civil & Environmental Engineering from Utah State University, USA and a BS in Civil Engineering with Honors from REC (NIT), Kurukshetra. Srini has over 35 years of experience in Information Technology, Venture Capital and Private Equity. Prior to iLabs Group, Srini was Founding CEO & MD of Dun & Bradstreet Satyam Software (later became Cognizant Technology Solutions) and Satyam Enterprise Solutions. Number of iLabs Investee Companies have become Leading Companies in their respective areas. Sri City, a leading Industrial City started by iLabs Group is home to over 150 companies from 25 Countries and two of India's leading Universities. Srini is passionate about Educations and Skills Development. He is a Founding-Member & Member of Governing Council of International Institute of Information Technology (IIIT), Hyderabad; Industry Partner (Donor) & Member of Board of Governors of Indian Institute of Information Technology, Sri City; Executive Board Member of Indian School of Business (ISB) and Benefactor of Srini Raju Center for Networked Economy (SRITNE); Co-Sponsor (Donor) and Board Member of KREA University; and Founding-Member & Board Member of T-Hub, Hyderabad. -

ISB-SRITNE ANNUAL REPORT 2017-18 the Srini Raju Centre for Information Technology and the Networked Economy (SRITNE) Is Supported by a Generous Endowment Set up by Mr
ISB-SRITNE ANNUAL REPORT 2017-18 The Srini Raju Centre for Information Technology and the Networked Economy (SRITNE) is supported by a generous endowment set up by Mr. Srini Raju, who is the Chairman of iLabs Group. He is also the founding member of the International Institute of Information Technology (IIIT), Hyderabad and Indian Institute of Information Technology, Sri City. He is also a member of the Governing Board of Indian School of Business. Srini Raju Benefactor/Supporter Message from Dean I am very happy to note that SRITNE has had an extremely active and an impactful year across a range of initiatives. Besides sponsoring interdisciplinary and rigorous research ideas of our ISB faculty members, SRITNE has also been an active research partner for national, state governments and corporates. I am particularly pleased to say that SRITNE has also created innovative executive education offerings around digital transformation for government bureaucrats, corporate leaders and small and medium businesses. I wish the entire SRITNE team continued success for the upcoming years. Rajendra Srivastava Dean, Indian School of Business Message from Executive Director It’s an exciting time for technology. Big data, artificial intelligence, on-demand computing and an increasingly networked economy are catalysing change in diverse industries and changing how we live and work. Grounded in the ISB tradition of rigorous and relevant research, SRITNE advances the understanding of industry leaders and policymakers of the impacts of technology on business and society and the drivers of such impact. Through research, education and outreach activities, the centre stimulates interaction between business leaders, students, ISB faculty, and the academic community at large, and provides an important opportunity for these stakeholders to co-create value in a rapidly changing business context. -

Curriculum Vitae
February 11, 2021 CURRICULUM VITAE RAVI BAPNA IDENTIFYING INFORMATION Academic Rank: Curtis L. Carlson Chair Professor in Business Analytics and Information Systems Professor, Department of Information and Decision Sciences Associate Dean, Executive Education Academic Director, Carlson Analytics Lab Academic Director, Analytics for Good Institute Carlson School of Management University of Minnesota Degrees Awarded Degree Institution Date Degree Granted B. Comm. University of Calcutta 1989 Area - Commerce B. Tech. University of Mangalore 1993 Area – Computer Engineering Ph.D. University of Connecticut 1999 Area – Information Systems Employment University of Minnesota, Twin Cities Associate Dean, Executive Education 5/2017 – to date Curtis L. Carlson Chair in Business Analytics and Information Systems 5/2015 – to date Academic Director, Analytics for Good Institute 1/2020 – to date Academic Director, Carlson Analytics Lab 8/2015 – to date Program Director, MS-Business Analytics Program 8/2015 – 7/2017 Department Chair, Information and Decision Science 9/2014 – 8/2015 Board of Overseers (Full) Professor 7/2010 – 4/2015 Tenured Associate Professor 6/2008 – 6/2010 Co-director, SOBACO 7/2012 – 6/2016 Chief Data Scientist, Mississippi River Capital 4/2017 – 3/2018 Indian School of Business, Hyderabad, India 9/2006 – 5/2008 Tenured Associate Professor of Information Systems 1 February 11, 2021 University of Connecticut Tenured Associate Professor and Ackerman Scholar 8/2004 – 8/2006 Tenure-track Assistant Professor 8/2001 – 7/2004 Northeastern -

IITH-AFI-April-2-Event-Brochure.Pdf
MESSAGE FROM THE ORGANIZING TEAM Dear Friends, It is our pleasure to invite you to 'Innovation, Startups and Social Impact: Strengthening the Ecosystem', a joint initiative by i-TIC Foundation of IIT Hyderabad and Action For India (AFI). This is an engaging dialogue among distinguished private, public, and social sector leaders to identify opportunities and address the challenges often faced by innovators seeking to scale up their social enterprises. This initiative focuses on bringing together inputs for designing a leading social entrepreneurship accelerator at IIT Hyderabad. We, at IIT Hyderabad and AFI, collectively believe that it is an exciting time for the social entrepreneurship ecosystem with so many innovators setting the stage for a growing worldwide movement. The social entrepreneurs are the game changers who are setting the rules of today’s world riddled with its complexity and nuances. These bold efforts warrant the creation of an enabling environment for the social entrepreneurs to thrive and reach new heights. It is a privilege to note that India is increasingly becoming a fertile ground for this new stage of the intermingling of technology and social causes. The available resources and success of social enterprises have attracted attention from across the world. However, there are certain challenges faced by social enterprises on their way to success which must be addressed at an early stage to allow functional growth and development. With this proposed accelerator, we will collectively try to support social enterprises on their technology based innovations in the healthcare, agriculture, and education sectors. Through this initiative, IIT Hyderabad and AFI, intend to identify high-potential social enterprises and provide a supportive system to help them in their scaling journeys.