Réseau Natura 2000 Document D'objectifs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annie Hardy Calais
Florent and Agnes Angelle Hardy Family Memorial Honoring Annie Hardy Calais Established by Dr. Florent “Pon” Hardy, Jr. “Pon” and Aunt Annie Annie Hardy Calais Memorial Donors Dr. Florent “Pon” Hardy, Jr. Mary Hardy dela Houssaye Belleau Henry Charles Taylor Rod and Betty Roy A Selection of Annie Hardy Calais’ Personal Family Memoires Compiled by Nephew Florent “Pon” Hardy, Jr., Ph.D. September 2016 July 26, 1927 – April 2, 2020 ~~~Contents~~~ Mama’s Family in France Genealogy Summary Written by Annie My mother Adelaide Blasia Pelafigue Hardy, beloved doesn't begin to say it! As Daughter Earliest Remembrances of Child Experiences Growing Up Mai Babelles World’s Fair (1924) Tante La Gross Guerre Social of Sorts Extras Memories of All Saints Day in the 1930s A Selection of Annie Calais’ Personal Family Memoires Compiled by Florent “Pon” Hardy, Jr., Ph.D. September 2016 Mama’s Family in France Notes from Mr. J. P. Nogaret from research conducted by Mr. Guy Cassagnet 65490-Oursbelille, France. Telephone (62) 35-31-23. No date. The origin of your family stems from Beaucens, a village at the foot of the Pyrenees. Your grandmother, Adelaide, was born there on November 22, 1881. Her father, Jean- Marie Pelafigue, was born at St. Pastous; a charming village of the pastoral zone, near Argelez-Gazhoste and Beaucens. He came to Beaucens to marry Melanie Pere, and lived there with his wife in a beautiful home in this beautiful country called Lavedan. This house is still standing. The couple had five children, of which your grandmother, Adelaide, was one. -

100 Dpi) L ^ ^ Eb Igon a Dé 0 1 2 4 R 4 O Km U T E
720000 725000 730000 735000 740000 745000 750000 0°14'30"W 0°9'0"W 0°3'30"W 0°2'0"E 0 0 GLIDE number: N/A Activation ID: EMSR-048 0 0 0 0 0 0 Product N.: 03Lourdes, v1 9 9 7 7 4 4 Lourdes - FRANCE Flood - 18/06/2013 Reference Map - Overview Landes Production date: 19/06/2013 United GeKrinsgdom Belgium Germany English Paris Channel ^ France France Midi-Pyrenees Switzerland Bay of Leg Aquitaine Italy N a Biscay " ve 0 d 3 e ' 1 P 1 au ° , 3 4 L es G av Mediterranean e s Spain Sea R e u n i s Pontacq Hautes-Pyrenees N .! " 0 3 ' n 1 .! ro ne 1 a ° ^ 4 G 3 4 Asson .! 0 Pontacq 0 0 0 Lourdes 0 0 A 5 Labatmale 5 d 8 ^ 8 o 7 7 ur 4 ^ 4 Lamarque-Pontacq Pyrenees-Atlantiques Coarraze Cartographic Information K 1:50000 Full color ISO A1, low resolution (100 dpi) L ^ ^ eB Igon a dé 0 1 2 4 R 4 o km u t e d e ^ Map Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 30N L o Graticule: WGS 84 geographical coordinates u Barlest r ± d e s Legend General Information Hydrology Transportation 0 0 0 0 £ 0 0 0 0 Area of Interest River " Bridge 8 ^ 8 7 7 4 ^ 4 Administrative boundaries Stream (!u Helipad Region Canal X Station Montaut Municipality Lestelle-Bétharram ^ Lake Railway Montaut-Betharram ^ Bartrès Settlements Railway Station Julos River Primary Road ^ R om ^ ! Populated Place z Poueyferré o u u ^ Point of Interest Secondary Road t O e ' Built-Up Area 4 Educational L d e Industry / Utilities P au K Medical Extraction Mine Lab le de atma Lac de au Lac de la ^ Religious Ruisse ^ Quarry Lourdes ^ N " ferme Larrouy Bourréac 0 ^ ' 6 e ° d 3 R e 4 ou ^ u te ^ Saint-Pé-de-Bigorre -

Comite Tech 07/01/2016
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves COMITE TECHNIQUE PAPI 07/01/2016 – Salle du conseil de la CCPL - Lourdes Objet : - Suivi administratif du PAPI - Proposition de tableaux de suivi de l’avancement du PAPI - Point sur les actions en cours - Ordre du jour du prochain comité de pilotage Etaient présents : Mme CHATAGNER Sylvie : SRNOH, DREAL Midi -Pyrénées Mme MASSON Angélique : Chargée d’interventions spécialisée, Agence de l’Eau Adour -Garonne M MARTINET Régis : Mission post -crue, DDT65 M MASY Alain : SIVOM du Pays Toy M BRECHES Olivier : CACG – Conduite d’opération AMOA SIVOM du PAYS Toy M HAMON Frédéric : Directeur du SYMIHL Mme NOEL-HETIER Clotilde : DDT65 \SEREF M SCHANG Christophe : DDT65 \SEREF M SANSAS Michaël : Technicien Rivière, SIRPAL Mme ARTIGUES Delphine : Chargée de mission, Ville de Lourdes M LASPLACES Jean-Yves : Chef du service RTM 64 -65 M ABAD Noël : Fédération de pêche des Hautes -Pyrénées Mme SAZATORNIL Hélène : Contrat de Rivière, P ays de Lourdes et des Vallées des Gaves M FRYSOU Olivier : PAPI, Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves Le Conseil Régional était excusé. Propos : Les 4 exemplaires originaux de la convention cadre du PAPI ont été signés par l’ensemble des partenaires du PAPI et remis au PLVG par la DDT65 en début de réunion. Le PLVG a ensuite remis un exemplaire original signé à la DDT65 et un exemplaire original signé à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Un exemplaire original signé sera adressé par courrier au CR COTEC 07-01-2016 1 Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves Conseil Régional et le dernier exemplaire sera conservé au PLVG et sera scanné et mis à disposition des partenaires sur le site internet du PLVG. -

LIGNE 965 TARBES - LOURDES - CAUTERETS / BAREGES / GAVARNIE 06.07.2020 Au 30.08.2020
LIGNE 965 TARBES - LOURDES - CAUTERETS / BAREGES / GAVARNIE 06.07.2020 au 30.08.2020 JOURS LMMeJVS Vendredi DIMANCHE & FETES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gare SNCF 06:55 08:00 08:10 09:55 11:30 12:15 13:15 14:30 16:25 17:25 18:15 08:10 Victor Hugo 06:57 08:02 08:12 09:57 11:32 12:17 13:17 14:32 16:27 17:27 18:17 08:12 Tarbes Allée Leclerc 07:00 08:05 08:15 10:00 11:35 12:20 13:20 14:35 16:30 17:30 18:20 08:15 Assedic 07:02 08:07 08:17 10:02 11:37 12:22 13:22 14:37 16:32 17:32 18:22 08:17 Hôpital 07:04 08:09 08:19 10:04 11:39 12:24 13:24 14:39 16:34 17:34 18:24 08:19 Odos La Pene 07:09 08:14 08:24 10:09 11:44 12:29 13:29 14:44 16:39 17:39 18:29 08:24 Route de Lourdes Nord 07:10 08:15 08:25 10:10 11:45 12:30 13:30 14:45 16:40 17:40 18:30 08:25 Route de Lourdes Centre 07:12 08:17 08:27 10:12 11:47 12:32 13:32 14:47 16:42 17:42 18:32 08:27 Stade Banive - - - - - 12:34 - - - - 18:34 - Juillan Mairie - - - - - 12:36 - - - - 18:36 - Rue Victor Hugo - - - - - 12:39 - - - - 18:39 - Juillan/Louey - - - - - 12:41 - - - - 18:41 - Louey Route de Tarbes 07:16 08:21 08:31 10:16 11:51 - 13:36 14:51 16:46 17:46 - 08:31 Aéroport 07:20 08:25 08:35 10:20 11:55 12:45 13:40 14:55 16:50 17:50 18:45 08:35 Juillan Pyrène pôle tertiaire 07:23 08:28 08:38 10:23 11:58 12:48 13:43 14:58 16:53 17:53 18:48 08:38 Louey Pyrène pôle industrie 07:24 08:29 08:39 10:24 11:59 12:49 13:44 14:59 16:54 17:54 18:49 08:39 La chapelle 07:27 08:32 08:42 10:27 12:02 12:52 13:47 15:02 16:57 17:57 18:52 08:42 Adé Place -
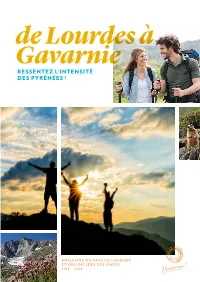
Argelès-Gazost
de Lourdes à Gavarnie RESSENTEZ L'INTENSITÉ DES PYRÉNÉES ! MAGAZINE DU PAYS DE LOURDES ET DES VALLÉES DES GAVES 2015 – 2016 Gavarnie — Mont Perdu, patrimoine mondial de l’Unesco Ce paysage de montagne exceptionnel, qui Ce site est également un paysage pastoral qui La zone Gavarnie - Mont Perdu vous offre un rayonne des deux côtés des frontières de France reflète un mode de vie agricole autrefois répandu paysage culturel exceptionnel qui allie la beauté et d’Espagne, est centré sur le pic du Mont-Perdu, dans les régions montagneuses d’Europe. Il panoramique à une structure socio-économique massif calcaire qui culmine à 3 352 m. Le site présente des témoignages inestimables sur la qui a ses racines dans le passé et illustre un mode comprend deux des canyons les plus grands et société européenne d’autrefois à travers son de vie montagnard devenu rare en Europe. profonds d’Europe, du côté espagnol, et trois paysage de villages, de fermes, de champs, de cirques spectaculaires sur le versant français. hauts pâturages et de routes de montagne. Entrées du Parc national des Pyrénées Grands sites Midi-Pyrénées Tarbes Pau Barlest Toulouse Bordeaux Stations de ski alpin Loubajac Adé Stations de ski nordique Pau Bordeaux Bartrès Julos Thermes et centres thermoludiques Poueyferré Bagnères-de-Bigorre Paréac Lac de St-Pé-de-Bigorre Lourdes Bourréac Points info Peyrouse Escoubès-Pouts Grottes Lourdes Gav Lourdes de Bétharram e de Pau Arcizac- Lézignan ez-Angles Arrayou-Lahitte Gez-ez-Angles Sites touristiques Artigues Jarret RÉSERVE NATURELLE Aspin-en- -

This Winter… It’S Never Been Easier to Get to the Pyrenean Ski Slopes - Just €15 Per Transfer
This winter… It’s never been easier to get to the Pyrenean ski slopes - just €15 per transfer With flights on Ryanair from as little as £40 return, ski holidays Rates: to the Hautes-Pyrenees are better value than ever! €15 one way • €30 return Free for children under 4 years old. All people travelling this winter, from London Stansted to Tarbes Lourdes airport, on Ryanair can transfer to their chosen ski resort for just e15 one way (e30 with return). If you are travelling from London Stansted to Tarbes WHICH FLIGHTS Lourdes airport, Ryanair, DOES IT SERVE? on on Saturday and Tuesday. 1 From 3 December 2015 to 25 April 2016. TO WHICH SKI RESORTS? HOW TO BOOK? • Cauterets, Book online on www.tlp.aeroport.fr 2 • Luz-Saint-Sauveur 3 By email or by phone: • Grand Tourmalet (Bareges) Reservations required before midday, • Grand Tourmalet (La Mongie) the day before your arrival. • Saint-Lary [email protected] • Piau-Engaly 00 335 62 32 77 00 • Peyragudes HOW DO AT THE AIRPORT: tickets are available from the IN THE SKI RESORT: tickets are available information desk, at the airport, on arrivals from the shuttle driver (payment by cash I COLLECT level. If you do not buy your ticket on-line, or credit card). 4 MY TICKET? payment by cash or credit card. The shuttle service is organised according to the SHUTTLE STOP IN THE SKI RESORTS number of bookings. Ski resort Arrival / Departure Reservations should be made in advance as if there are none the service will not run. -

Aménagement Foncier, Agricole Et Forestier D'adé Et De
Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur l’aménagement foncier, agricole et forestier d’Adé et de Lourdes avec extension sur la commune de Julos (65) n°Ae : 2016- 113 Avis délibéré n°2016-113 adopté lors de la séance du 25 janvier 2017 Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable Avis délibéré du 25 janvier 2017 - Aménagement foncier, agricole et forestier d’Adé-Lourdes avec extension sur la CGEDD commune de Julos (65). Page 1 sur 15 Préambule relatif à l’élaboration de l’avis L’Autorité environnementale1 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), s’est réunie le 2 5 janvier 2017, à La Défense. L’ordre du jour comportait notamment l’avis sur l’aménagement foncier, agricole et forestier d’Adé et de Lourdes avec extension sur la commune de Julos (65). Étaient présents et ont délibéré : Fabienne Allag-Dhuisme, Christian Barthod, Barbara Bour-Desprez, Marc Clément, François Duval, Sophie Fonquernie, Thierry Galibert, Philippe Ledenvic, Serge Muller, François-Régis Orizet, Thérèse Perrin, Mauricette Steinfelder, Gabriel Ullmann, Eric Vindimian. En application de l'article 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci- dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis. Étaient absents ou excusés : François Letourneux * * L’Ae a été saisie pour avis par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, le dossier ayant été reçu complet le 27 octobre 2016. -

Projet D’Agglomération Edité En Novembre 2017 Crédits Photos : Communauté D’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées / Mairie De Lourdes / Mairie De Tarbes / O
Propositions pour unprojet d’agglomération Edité en novembre 2017 Crédits photos : Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées / Mairie de Lourdes / Mairie de Tarbes / O. Micouleau / P. Vincent - Offi ce de Toursime de Lourdes Propositions pour un projet d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées Sommaire I- L’esprit ..............................................................................................................4 II- Les objectifs ....................................................................................................6 III- Les projets ......................................................................................................9 1- Les projets irrigants ...................................................................................10 a- Une identité affi rmée..........................................................................11 b- Des déplacements connectés .............................................................13 c- La route numérique ...........................................................................14 2- Les projets rayonnants ...............................................................................16 a- Au cœur de l’agglomération ..............................................................17 b- Vers l’extérieur ..................................................................................17 3- Les projets structurants ..............................................................................18 a- Le Sud ..............................................................................................20 -

Great Tourist Sites
Great Tourist Sites in Midi-Pyrenees Your Holiday Destination Midi-Pyrénées, it rhymes with hurray! Great Tourist Sites in Midi-Pyrenees Holidays don’t just happen; they’re planned with the heart! Midi-Pyrénées has a simple goal: making you happy! Some places are so exceptional that people talk about them on the other side of the world. Their names evoke images that stir travellers’ emotions: Conques, Rocamadour, From Toulouse ‘the pink city’ to the banks of the Canal du Midi; from the amazing sight of the Cirque de Gavarnie to the Lourdes, Marciac, the Millau Viaduct, the Cirque de Gavarnie, the Canal du Midi…. Millau Viaduct; from authentic villages of character like Saint-Cirq-Lapopie to exuberant festivals like Jazz in Marciac; you These great sites create our region’s identity and are part of its infl uence, which extends can explore the many facets of a region whose joie de vivre is contagious! well beyond its borders. Step into the culture of Midi-Pyrénées and discover its accent, fl avours, laughter and generosity! Half-measures, regrets and To discover them, you need to expand your outlook and let yourself be guided by your restraint are not allowed. Enjoy your stay to the full, with a real passion. You’ll go home a different person! tastes and desires. Follow the Route des Bastides through fortifi ed towns or the Way of St James, criss-crossing through towns of art and history. Or revel in the freedom and Long live freedom, long live passion, long live Midi-Pyrénées! fresh air of the Pyrenean peaks. -

LOURDES - SNCF 941 CAUTERETS Horaires Valables À Compter Du 10 Décembre 2017
LIGNE LOURDES - SNCF 941 CAUTERETS Horaires valables à compter du 10 décembre 2017 Tous Tous Tous Tous Tous Tous les les les les les les Vendredi jours jours jours jours jours jours Lourdes-SNCF 8:45 10:45 12:40 15:05 16:50 19:00 20:50 Lugagnan - 8:53 10:53 12:48 15:13 16:58 19:08 20:58 Pont Neuf Argelès-Gazost - 9:04 11:04 12:59 15:24 17:09 19:19 21:09 Gare Argelès-Gazost - 9:06 11:06 13:01 15:26 17:11 19:21 21:11 Le Parc Lau-Balagnas - 9:08 11:08 13:03 15:28 17:13 19:23 21:13 Eglise Saint-Savin - 9:11 11:11 13:06 15:31 17:16 19:26 21:16 La Plaine Pierrefitte- Nestalas - 9:14 11:14 13:09 15:34 17:19 19:29 21:19 Gare Cauterets 9:39 11:39 13:34 15:59 17:44 19:54 21:44 La mention " Tous les jours " fonctionne également les jours fériés La circulation du vendredi (20:50), fonctionne hors jours fériés. LIGNE LOURDES - SNCF 941 BAREGES Horaires valables à compter du 10 décembre 2017 Tous Tous Tous Tous Tous Tous les les les les les les Vendredi jours jours jours jours jours jours Lourdes-SNCF 8:45 10:45 12:40 15:05 16:50 19:00 20:50 Lugagnan - 8:53 10:53 12:48 15:13 16:58 19:08 20:58 Pont Neuf Argelès-Gazost - 9:04 11:04 12:59 15:24 17:09 19:19 21:09 Gare Argelès-Gazost - 9:06 11:06 13:01 15:26 17:11 19:21 21:11 Le Parc Lau-Balagnas - 9:08 11:08 13:03 15:28 17:13 19:23 21:13 Eglise Saint-Savin - 9:11 11:11 13:06 15:31 17:16 19:26 21:16 La Plaine Pierrefitte-Nestalas - 9:14 11:14 13:09 15:34 17:19 19:29 21:19 Gare Luz-Saint-Sauveur 9:34 11:34 13:29 15:54 17:39 - - Betpouey 9:39 11:39 13:34 15:59 17:44 - - Barèges 9:49 11:49 13:44 16:09 17:54 - - La mention " Tous les jours " fonctionne également les jours fériés La circulation du vendredi (20:50), fonctionne hors jours fériés. -

Porter À Connaissance Et Enjeux De L'état
Direction départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées Service Urbanisme Foncier Logement Bureau Aménagement Planification Territoriale Juin 2017 Porter à Connaissance et enjeux de l’État Ex- communauté de communes du Pays de Lourdes Élaboration d'un Plan Local d’Urbanisme intercommunal Extrait Atlas des paysages des Hautes Pyrénées 1 Sommaire Le porter à connaissance....................................................................................5 1.Le contenu et la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal..................5 2.Les grands principes du code de l’urbanisme applicables au PLUi.............................................17 3.Le rapport du PLUi avec les autres documents applicables........................................................21 4.L'évaluation environnementale...................................................................................................29 5.L’évaluation des incidences Natura 2000....................................................................................31 6.Les risques connus.....................................................................................................................31 7.Les servitudes d'utilité publique (SUP)........................................................................................32 8.Les prescriptions en matière d'archéologie.................................................................................32 9.La sécurité routière et les déplacements....................................................................................33 -

Lourdes - Sncf 941 ‰ Cauterets
LIGNE LOURDES - SNCF 941 CAUTERETS Tous Tous Tous Tous Tous Tous les les les les les les Vendredi jours jours jours jours jours jours Lourdes-SNCF 8:10 10:45 12:55 14:50 16:50 18:20 20:50 Lugagnan - 8:20 10:55 13:05 15:00 17:00 18:30 21:00 Pont Neuf Argelès-Gazost - 8:24 10:59 13:09 15:04 17:04 18:34 21:04 Gare Argelès-Gazost - 8:26 11:01 13:11 15:06 17:06 18:36 21:06 Le Parc Lau-Balagnas - 8:28 11:03 13:13 15:08 17:08 18:38 21:08 Eglise Saint-Savin - 8:32 11:07 13:17 15:12 17:12 18:42 21:12 La Plaine Pierrefitte- Nestalas - 8:35 11:10 13:20 15:15 17:15 18:45 21:15 Gare Cauterets 9:00 11:35 13:45 15:40 17:40 19:10 21:40 La mention " Tous les jours " fonctionne également les jours fériés La circulation du vendredi (20:50), fonctionne hors jours fériés. LIGNE LOURDES - SNCF 941 BAREGES Tous Tous Tous Tous Tous Tous les les les les les les Vendredi jours jours jours jours jours jours Lourdes-SNCF 8:10 10:45 12:55 14:50 16:50 18:20 20:50 Lugagnan - 8:20 10:55 13:05 15:00 17:00 18:30 21:00 Pont Neuf Argelès-Gazost - 8:24 10:59 13:09 15:04 17:04 18:34 21:04 Gare Argelès-Gazost - 8:26 11:01 13:11 15:06 17:06 18:36 21:06 Le Parc Lau-Balagnas - 8:28 11:03 13:13 15:08 17:08 18:38 21:08 Eglise Saint-Savin - 8:32 11:07 13:17 15:12 17:12 18:42 21:12 La Plaine Pierrefitte-Nestalas - 8:35 11:10 13:20 15:15 17:15 18:45 21:15 Gare Luz-Saint-Sauveur 9:00 11:35 - 15:40 17:40 - 21:40 Barèges 9:10 11:45 - 15:50 17:50 - 21:50 La mention " Tous les jours " fonctionne également les jours fériés La circulation du vendredi (20:50), fonctionne hors jours fériés.