SAGE De La RISLE Etat Des Lieux III "Les Usages De L'eau" � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Camembert De Normandie »
CAHIER DES CHARGES de L’APPELLATION D’ORIGINE « Camembert de Normandie » Version du 19/07/2012 1/17 SOMMAIRE 1. NOM DU PRODUIT :................................................................................................3 2. DESCRIPTION DU PRODUIT: ................................................................................3 3. DELIMITATION DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE :.....................................................3 4. ELEMENTS PROUVANT QUE LE PRODUIT EST ORIGINAIRE DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE :.........................................................................................................8 4.1. Déclaration d’identification :....................................................................................................................... 8 4.2. Déclaration des installations de sanitation.................................................................................................. 9 4.3. Déclarations nécessaires à la connaissance et au suivi des volumes ......................................................... 9 4.4. Tenue de registres......................................................................................................................................... 9 4.5. Contrôles sur le produit ............................................................................................................................. 10 5. DESCRIPTION DE LA METHODE D'OBTENTION DU PRODUIT : .....................10 5.1. Race............................................................................................................................................................. -

Risle, Guiel, Charentonne
Date d'édition : 24/09/2021 Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne. http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300150 NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC) FR2300150 - Risle, Guiel, Charentonne 1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1 2. LOCALISATION DU SITE .............................................................................................................. 2 3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 5 4. DESCRIPTION DU SITE ............................................................................................................... 9 5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ......................................................................................... 10 6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 11 1. IDENTIFICATION DU SITE 1.1 Type 1.2 Code du site 1.3 Appellation du site B (pSIC/SIC/ZSC) FR2300150 Risle, Guiel, Charentonne 1.4 Date de compilation 1.5 Date d’actualisation 31/12/1995 09/04/2020 1.6 Responsables Responsable technique Responsable national et européen Responsable du site et scientifique national Ministère en charge -
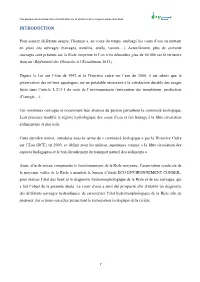
Introduction
Plan pluriannuel de restauration et d’entretien sur le territoire de la moyenne vallée de la Risle INTRODUCTION Pour assurer différents usages, l’homme a, au cours du temps, aménagé les cours d’eau en mettant en place des ouvrages (barrages, moulins, seuils, vannes…). Actuellement, plus de soixante ouvrages sont présents sur la Risle moyenne et l’on n’en dénombre plus de 60 000 sur le territoire français (Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement 2011). Depuis la Loi sur l’Eau de 1992 et la Directive cadre sur l’eau de 2000, il est admis que la préservation des milieux aquatiques, est un préalable nécessaire à la satisfaction durable des usages listés dans l’article L.211-1 du code de l’environnement (prévention des inondations, production d’énergie…). Ces nombreux ouvrages et notamment leur absence de gestion perturbent la continuité écologique. Leur présence modifie le régime hydrologique des cours d’eau et fait barrage à la libre circulation sédimentaire et piscicole. Cette dernière notion, introduite sous le terme de « continuité écologique » par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en 2000, se définit pour les milieux aquatiques comme « la libre circulation des espèces biologiques et le bon déroulement du transport naturel des sédiments » Ainsi, afin de mieux comprendre le fonctionnement de la Risle moyenne, l’association syndicale de la moyenne vallée de la Risle a mandaté le bureau d’étude ECO ENVIRONNEMENT CONSEIL, pour réaliser l’état des lieux et le diagnostic hydromorphologique de la Risle et de ses ouvrages, qui a fait l’objet de la présente étude. -

Rěgion Risloise Et Rugloise
CHE CAPELLE R1 O c 125 PEHD G RTE DE RATIER RTE DU COQ N la pacoterie O E R DE LE FROMAGERIE ratier 80 AC R1 c R DU BROUILLARD c I R SAINT NICOLAS R1 63 PVC 63 PVC S cH RTE DE RATIER RTE DU COQ le brouillard le bois de picasse le val de sommaire 150 2GS 63 PVC G 50 R1c R DU BROUILLARDcI 63 PVC c transières 63 PVC 75 PVC le mesnil des frétils I c RTE DE TRANSIERE R1cR1 c 80 AC Ic 90 PVC R1 Ic cR1 R1 63 PVC R1c 63 PVC R1 Z la roche c cc le cornet R1R1 R1 c 26 PVC P c R1 O R DU BOUT DU BOIS 50 I c RTE DE TRANSIERE le long l'eau RTE DU COURANT cI RTE DE CHENNECOURT R DU BOUT DU BOIS c R DE CHENNECOURT I c I chteau de l’hermite le courant RTE DE CHENNECOURT 63 PVC R1 63 PVC 50 PVC chennecourt 63 PVC R DE CHENNECOURT R1 c R1 cR1 Ic cI 63 PVC RTE DE TRANSIERE 63 PVC cR1R1 63 PVC R DE CHENNECOURT le moulin de l'hermiteI c 150 2GS R DU BOUT DU BOIS la métairie RTE DE CHENNECOURT la vallée héron RTE DU COURANT H 80 AC O R1c R1 Zcc BR1 G Equipements de Mesure Etage pression (9) G campagne de chennecourt RTE DE TRANSIERE 63 PVC RES Ambenay R DU BOUT DU BOIS R DES RENARDIERES Analyse chlore v RES Bois Normand 110 PVC Compteur Eau (Couleur du réseau) B RES Chéronvillier c B RES Neaufles Compteur Eau (sectorisation) RES Rugles Débitmètre (Couleur du réseau) V 63 PVC RES Rugles le Saptel Débitmètre (sectorisation) V RES ST Antonin Mesure niveau t RES Vieille Lyre c Rugles centre RTE DES POTERIES Mesure pression u 90 PVC les poteries H Equipements de Régulation de RTE DE MAUREPAS Equipements R1 c c R1 Réducteur Pression E launel c I 30 PVC Stabilisateur -

Communauté De Communes Du Canton De Rugles, on Trouve : - Une Installation De Reprise À Bois Branger - Un Réservoir À La Haye Saint Sylvestre
Département de l’Eure Communauté de Communes du Canton de Rugles ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 4B1 ANNEXES SANITAIRES NOTICE SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE, DES EAUX USEES ET DES DECHETS DOSSIER D’ARRET Vu pour être annexé à la Délibération du Conseil Communautaire en date du 1er JUIN 2016 P.L.U. Prescrit le Arrêté le Approuvé le ELABORATION 13 JANVIER 2012 1ER JUIN 2016 Xavier DEWAILLY - Urbaniste QUALIFIE 3 allée Jean Jaurès 72100 LE MANS TEL : 02 43 72 79 13 E-MAIL : [email protected] SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE I-LE SYNDICAT D’ADDUCTION EN EAU POTABLE DE LA REGION RISLOISE ET RUGLOISE Sur une grande partie du canton de Rugles, le service de l'eau est géré par Le Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la Région Risloise et Rugloise (SAEP3R) : sont concernées les 13 communes de Rugles, Chéronvilliers, Bois- Arnault, Ambenay, Neaufles Auvergny, La Vieille Lyre, La Neuve Lyre, Champignolles (en partie), Bois Normand près Lyre, Chambord (en partie), Juignettes, Les Bottereaux et Saint Antonin de Sommaire. Il regroupe également Glos la Ferrière et Saint Martin d’Ecublei qui ne font pas partie du canton de Rugles. Le nombre d’abonnés est de 4314 en 2014, dont 4 abonnés non domestiques. Le service géré par LE SAEP3R comprend la production, le transfert et la distribution d’eau potable. Le service est exploité en délégation de service public (affermage). Le fermier est Véolia Eau (Rouen). Le contrat a pris effet le 1er janvier 2011 pour 12 ans. Le syndicat garde à sa charge le renouvellement des canalisations sur plus de 12 m, les grosses réparations et les ouvrages de génie civil, les captages et les ouvrages de traitement. -

Référents BEF Bernay – Pont-Audemer
Référents BEF Bernay – Pont-Audemer. Implantation Référent Circonscription(s) Secteur Bernay Mme Catherine SIMON Bernay Ville de Bernay, Serquigny, Cahorches, St Nicolas, Courbépine, Fontaine l’Abbé, Collège Marie Curie Menneval, Plasnes, St Aubin le Vertueux, St Route des granges Assistante de Gestion MDPH : Valérie Victor de Chrétienville, Landepeureuse, 27300 Bernay Le Monnier Broglie, Capelle les Grands, Grand Camp, St 06.43.18.85.21 Aubin du Thenney, St jean du Thenney, La [email protected] Chapelle Gauthier, Montreuil l’Argilé, Thiberville, Boissy-Lamberville, Giverville, Le Theil Nolent, Bazoques, Drucourt, St Aubin s/ Scellon, Folleville St Germain la Campagne ITEP de Serquigny Pont-Audemer Mme Ghislaine VANDERERVEN Pont-Audemer Pont-Audemer Beuzeville Inspection de l’Education Nationale Cormeille 5 rue Stanislas Delaquaize Assistante de Gestion MDPH : Valérie Manneville s/R. 27500 PONT AUDEMER Le Monnier 07.86.66.52.32 [email protected] Le Neubourg M. Reynald LEROUX Le Neubourg Secteur Le Neubourg : Le Neubourg, Cesseville, Criquebeuf la Cgne, Hectomare, Inspection de l’Education Nationale Iville, Crosville la Vieille, Epégard, Vitot, 73 rue Octave Bonnel Assistante de Gestion MDPH : Valérie Graveron Semerville, Tilleul Lambert, 27110 LE NEUBOURG CEDEX Le Monnier Tournedos Bois Hubert, Le Bosc duTheil, 06.43.17.03.21 Villez s/ Le Neubourg, St Aubin d’Ecrosville, [email protected] Ste Collombe de la Commanderie. Bernay Secteur de Brionne : Brionne, Boisney/Carsix/Fontaine la Sorel/St Léger de Rôtes, Goupillère, Thibouville, Nassandres, Perrier la Cgne, Harcour, Calleville, La Haye de Calleville, Franqueville, Berthouville, Neuville s/Authou, St Pierre de Salerne, Brétigny, Authou Bosrobert, St éloi de Fourques. -

DRAC Haute-Normandie
DRAC Haute-Normandie Liste sommaire des monuments historiques Département de l'Eure ACLOU - Route départementale - Grange dîmière (rue), 8 Pont des Planches Manoir de la haule inscription le 31/10/2007 inscription partielle Pont des Planches (cad. ZE 168 et 174) inscription conservatoire le 13/12/2011 Logis et grange du manoir de la Haule, chacune en totalité AILLY (cad. A 232, 458) Eglise inscription partielle ACON inscription le 17/04/1926 - 27002 Acon ; 27503 Sacq sans objet Clocher Nécropole dolménique des "Prés d'Acon" inscription le 24/02/1998 - Eglise (rue de l') 2 ; Eglise (rue del') 2 Nécropole dolménique des "Prés d'Acon" (cad. 1997 C 85, Manoir du Chapître 94) inscription le 10/11/1998 Logis, assise foncière en totalité (cad. 1998 G 74) - Prés d'Acon (Les) ; lieu-dit "Les Prés d'Acon" Eglise paroissiale Saint Denis AIZIER inscription le 08/01/1998 Croix de cimetière En totalité (cad. 1997 C 57) inscription le 28/04/1965 Croix de cimetière (cad. AC 14) ACQUIGNY Chapelle du cimetière Eglise inscription le 08/12/1954 protection mixte Chapelle du cimetière classement le 15/11/1913 Clocher et abside Domaine d'Acquigny inscription le 21/10/1961 protection mixte Nef (cad. AC 13) classement le 17/09/1946 Façades et toitures du château Maladrerie Saint-Thomas-Becket classement le 29/05/2001 inscription le 20/09/1993 Petit château en totalité (Cad AC 199 et 201) Vestiges visibles ou enfouis de la chapelle et de la inscription le 06/08/1951 maladrerie Saint Thomas Becket, y compris la mare et Façades et toitures des communs l'enclos (cad. -

Liste Des Communes Dans Les Bassins Versants
NOM DES COMMUNES N° INSEE Bassins-Zones d'alerte ACLOU 27001 Risle aval ACON 27002 Avre moyen ACQUIGNY 27003 Iton aval AIGLEVILLE 27004 Eure moyenne AILLY 27005 Eure moyenne AIZIER 27006 Risle aval AJOU 27007 Risle amont ALIZAY 27008 Andelle AMBENAY 27009 Risle amont AMECOURT 27010 Epte AMFREVILLE-LA-CAMPAGNE 27011 Risle aval AMFREVILLE-LES-CHAMPS 27012 Andelle AMFREVILLE-SOUS-LES-MONTS 27013 Epte AMFREVILLE-SUR-ITON 27014 Iton aval ANDE 27015 Epte ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE 27017 Eure moyenne APPEVILLE-ANNEBAULT 27018 Risle aval ARMENTIERES-SUR-AVRE 27019 Avre amont ARNIERES-SUR-ITON 27020 Iton aval ASNIERES 27021 Calonne AUBEVOYE 27022 Eure moyenne AULNAY-SUR-ITON 27023 Iton aval AUTHEUIL-AUTHOUILLET 27025 Eure moyenne AUTHEVERNES 27026 Epte AUTHOU 27028 Risle aval AVIRON 27031 Iton aval AVRILLY 27032 Iton aval BACQUEPUIS 27033 Iton aval BACQUEVILLE 27034 Andelle BAILLEUL-LA-VALLEE 27035 Calonne BALINES 27036 Avre amont BARC 27037 Risle amont BARNEVILLE-SUR-SEINE 27039 Risle aval BARQUET 27040 Risle amont BARVILLE 27042 Calonne BAZINCOURT-SUR-EPTE 27045 Epte BAZOQUES 27046 Risle aval BEAUBRAY 27047 Iton amont BEAUFICEL-EN-LYONS 27048 Andelle BEAUMESNIL 27049 Risle amont BEAUMONTEL 27050 Risle amont BEAUMONT-LE-ROGER 27051 Risle amont BEMECOURT 27054 Iton amont BERENGEVILLE-LA-CAMPAGNE 27055 Iton aval BERNAY 27056 Charentonne NOM DES COMMUNES N° INSEE Bassins-Zones d'alerte BERNIENVILLE 27057 Risle aval BERNIERES-SUR-SEINE 27058 Eure moyenne BERNOUVILLE 27059 Epte BERTHENONVILLE 27060 Epte BERTHOUVILLE 27061 Risle aval BERVILLE-EN-ROUMOIS -

Cie Pont-Audemer Cie Louviers Cie Bernay Cie Evreux Cie
BP QUILLEBEUF-Quillebeuf- SUR-SEINEsur-Seine Saint-Aubin- sur-Quillebeuf Saint-Samson- Marais- Berville- Vernier de-la-Roque Aizier Vascœuil sur-Mer Sainte-Opportune- Vieux- la-Mare Port Le Tronquay Fatouville- Conteville Perruel Trouville- Sainte-Croix- Fleury- Grestain la-Haule sur-Aizier Letteguives Les Hogues la-Forêt Lorleau Fiquefleur- Saint- Tocqueville Le Landin Équainville Thurien La Haye- Perriers- Saint-Ouen- de-Routot sur-Andelle Bosquentin Saint-Pierre- Foulbec Bouquelon Beauficel- des-Champs La Haye- du-Val Bourneville Hauville BPLyons- LYONS-LA- en-Lyons Lilly Aubrée Bézu- Bouchevilliers Barneville- Renneville la-Forêt FORET la-Forêt Martagny Charleval Saint-Sulpice- Saint-Mards- Fourmetot COBRoutot ROUTOT sur-Seine Mesnil- Bourg- Manneville- Boulleville de-Grimbouville de-Blacarville Étréville Honguemare- sous- Guenouville Beaudouin Vandrimare la-Raoult Éturqueraye Rosay- Vienne Manneville- Amécourt Saint- Valletot Caumont sur-Lieure Morgny Mainneville Toutainville sur-Risle Rougemontiers La Trinité- Maclou Cauverville- de-Thouberville COB FLEURY-SURFleury- Saint-Germain- Pont- en-Roumois Bouquetot sur-Andelle La Neuve- COB PONT-AUDEMER Bosgouet Ménesqueville Grange Village Saint-Ouen- Radepont Lisors Puchay Audemer Corneville- Colletot ANDELLE Hébécourt de-Thouberville Longchamps Sancourt sur-Risle Le Torpt Brestot Bourg- Pont- Touffreville Triqueville Flancourt- Saint-Pierre Grainville Fort- Achard BP BEUZEVILLEBeuzeville Catelon Nojeon- Moville Les Préaux Romilly- Gaillardbois- Coudray Tourville-sur- Appeville- Pîtres -

Bilan De La Concertation Préalable
Bilan de concertation préalable Projet éolien « Transition Euroise Mesnil-Hamel » Janvier 2021 Page 1 sur 72 Bilan de concertation préalable Projet éolien « Transition Euroise Mesnil-Hamel » TABLE DES MATIERES Introduction .............................................................................................................................................. 4 Le processus de concertation amont ...................................................................................................... 6 Les comités de suivi ............................................................................................................................ 6 L’information des élus du territoire dès la genèse du projet ................................................................ 7 Le SIEGE 27 .................................................................................................................................... 7 L’Intercommunalité Bernay Terres de Normandie ........................................................................... 7 Les Conseils municipaux des communes d’implantation ................................................................ 7 Les maires des communes limitrophes ........................................................................................... 7 L’information des habitants et des riverains ........................................................................................ 8 La presse en parle .............................................................................................................................. -

Normandie – Les Cartes Par Bassin D'emploi
Normandie – Les cartes par bassin d’emploi Bassin d’emploi d’Évreux Pôle emploi Normandie – Service Statistiques, Études et Évaluation Bassin d’emploi d’Évreux : les communes (Population) 4 000 habitants ou plus Entre 3 000 et 3 999 hab. Entre 2 000 et 2 999 hab. Entre 1 000 et 1 999 hab. Moins de 1 000 hab. Insee – RP 2015 Périmètre des agences Pôle emploi Normandie – Service Statistiques, Études et Évaluation Bassin d’emploi d’Évreux : les communes (Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois) 1 000 DEFM ou plus Entre 500 et 999 DEFM Entre 250 et 499 DEFM Entre 100 et 249 DEFM Moins de 100 DEFM Pôle emploi STMT – DEFM ABC moyenne 2017 Pôle emploi Normandie – Service Statistiques, Études et Évaluation Agence d’Évreux Brossolette : les communes - 1 Population (Insee- Population (Insee- Nom de la commune Nom de la commune RP 2015) RP 2015) Arnières-sur-Iton 1 601 Émalleville 538 Aulnay-sur-Iton 718 Émanville 595 Avi ron 1 116 Épégard 569 Bacquepuis 321 Épreville-près-le-Neubourg 483 Beaubray 322 Fauville 359 Bérengeville-la-Campagne 309 Faverolles-la-Campagne 148 Bernienville 280 Ferrières-Haut-Clocher 1 211 Boncourt 191 La Ferrière-sur-Risle 227 La Bonneville-sur-Iton 2 234 Feuguerolles 180 Le Boulay-Morin 767 Le Fidelaire 1 025 Brosville 629 Fontaine-sous-Jouy 877 Burey 388 Gauciel 921 Canappeville 666 Gaudreville-la-Rivière 223 Ca ugé 841 Gauville-la-Campagne 546 Cesseville 481 Glisolles 818 Champ-Dolent 71 Graveron-Sémerville 294 La Chapelle-du-Bois-des-Faulx 591 Gravigny 3 924 Cierrey 727 Hardencourt-Cocherel 250 Claville 1 077 Hectomare 225 -

COMPTE RENDU Conseil Communautaire Du 21 OCTOBRE 2020
COMPTE RENDU Conseil Communautaire du 21 OCTOBRE 2020 L’an deux mil vingt, le 21 octobre à 18h30, le Conseil de Communauté, légalement convoqué le 15 octobre 2020, s’est réuni en séance publique dans la salle des fêtes de Breteuil, sous la présidence de M. Jean-Luc BOULOGNE Etaient présents : MM. AMIGON, , BACCARO, BAÏSSAS, Mme BAUDOUIN, M. BENSALAH, M. BODEY, Mme BONNARD, M. BONTE, Mme BOUCHER, MM BOUCHERIE, BOULOGNE, BOURLON DE ROUVRE, BRAULT, BRISSET, BRUNET, Mme BULARD, M. CHATEAUGIRON, Mme CHAUVIERE, M. CHERON, Mme CORMIER, MM. CORNET, DE SELLE DE BEAUCHAMP, Mmes DELHOME, DEPRESLE, DESNOS, DHAESES, DHEYGERS, M. DOUBLET, Mmes DUMONTIER, Mme GICQUIAUD, M. GOSSET, Mme GOUGIS, MM. GOUTTEFARDE, GRUDE, GUITTON, Mme JOBART, MM. JOUSSET, LAINE, LANOS, LEBON, Mmes LEPELTIER, MARTIN, M. MIGUET, M. MORIERE, M. NOEL, Mme. NOEL, M. OBADIA, M. OSMOND, PETITBON, POURVU, PRIVE, PROVOST, Mme REBER, MM. REY, RIVEMALE, ROMERO, SAMON, Mme SAS, SURMULET, MM. VANDEWALLE, WOHLSCHLEGEL. Excusés : MM. AUFFRET, Mme BIQUET, M. BOUDEYRON, Mme COMPAGNON (pouvoir à M. VANDEWALLE), DE TOMASI (pouvoir à M. GUITTON), M. DERYCKE (pouvoir à Mme BONNARD), Mme FRANCHET, Mme LEFORT, M. LOUVARD, Mme MOUTONNET (pouvoir M. PRIVE), Mme TOPART (remplacée par M.DHAESE). Secrétaire de séance : Mme Sophie DELHOME En exercice : 71 Présents : 61 Votants : 65 Le quorum est atteint, le conseil peut délibérer. La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BOULOGNE, Président. Après l'appel nominal des conseillers communautaires de chaque commune adhérente, Monsieur le Président demande s’il y a des remarques ou des objections sur le projet de procès-verbal du dernier conseil communautaire qui a été transmis avec la convocation à chaque conseiller communautaire.