Pietro Bembo, De L'etna
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Islamic World and the Latin East: William of Tripoli and His Syrian Context
University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Doctoral Dissertations Graduate School 8-2018 THE ISLAMIC WORLD AND THE LATIN EAST: WILLIAM OF TRIPOLI AND HIS SYRIAN CONTEXT Jeremy Daniel Pearson University of Tennessee Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss Recommended Citation Pearson, Jeremy Daniel, "THE ISLAMIC WORLD AND THE LATIN EAST: WILLIAM OF TRIPOLI AND HIS SYRIAN CONTEXT. " PhD diss., University of Tennessee, 2018. https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/5076 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a dissertation written by Jeremy Daniel Pearson entitled "THE ISLAMIC WORLD AND THE LATIN EAST: WILLIAM OF TRIPOLI AND HIS SYRIAN CONTEXT." I have examined the final electronic copy of this dissertation for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree of Doctor of Philosophy, with a major in History. Thomas E. Burman, Major Professor We have read this dissertation and recommend its acceptance: Maura K. Lafferty, Jay C. Rubenstein, Alison M. Vacca Accepted for the Council: Dixie L. Thompson Vice Provost and Dean of the Graduate School (Original signatures are on file with official studentecor r ds.) THE ISLAMIC WORLD AND THE LATIN EAST: WILLIAM OF TRIPOLI AND HIS SYRIAN CONTEXT A Dissertation Presented for the Doctor of Philosophy Degree The University of Tennessee, Knoxville Jeremy Daniel Pearson August 2018 Copyright © 2018 by Jeremy Daniel Pearson. -

Varia Bibliographica GILBERTUS JACCHAEUS, PRIMAE
Varia bibliographica GILBERTUSJACCHAEUS, PRIMAE PHILOSOPHL4E, SIVEINSTITUTTOJYUM METAPHYSICARUM IJBRISEX. ED. POSTREMAPRIORE CORRECTIOR. LUGDUNI BATAVORUM, PROSTANT APUD ELSEVIRIOS, I640. At first sight this new acquisition of Leiden University Library can hardly be said to appear spectacular, but when opened it soon transpires that the little book occupies its own if modest place in a great tradition, that of the collection and description of Elze- vier editions. The text of Jacchaeus's manual is no longer as useful nowadays as it was at the time of its publication. Instead, what lends the copy special interest is its provenance. It can be reconstructed from about 1830. To judge from the style, the book must then have been rebound, whereby both upper and lower cover received the arms of B. Comte de Nedonchel de Tournay as supralibros. It next came into the possession of Charles Pieters of Ghent (1782-1863), an avid Elzevier collector and - rather uncritical - bibliographer. He proudly pasted his exlibris into it and described it in his Annales de l'imprimerieelse- virienne ...,' adding a footnote leaning heavily on Brunet,2 containing the observation that it could not have been printed by the Elzeviers and that 'le titre porte une mar- que etrangere.' He stated besides that there is an edition of 1621. At the end of 1864 Pieters's collection was sold at auction in Ghent and the book, number 138 in the cat- alogue, was bought by the Lille firm of Leleu for one and a half francs. It was no doubt they who sold the book on to Lucien Jannin of Dunkirk who also stuck in his exlibris and moreover put his name stamp into it. -

THE LAST FONT – the Rhetorics of Egyptian Typefaces
THE LAST FONT – the Rhetorics of Egyptian Typefaces abstract: The Last Font explores the development of the theories of Richard A. Lanham (The Economics of Attention) Egyptian (also known as Slab-serif) typefaces in the context of and visual information analysis by Charles Kostelnick and cultural, economic and technical changes through the 19th and Michael Hassett (Shaping Information–the Rhetoric of Visual 20th centuries. Conventions), in order to open up the discourse and unveil a Before photography, complex layouts and more subtle range of new questions related to visual communication. advertising techniques, these letterforms were developed, The work does offer not rules for the use of Egyptian decorated and ornamented to the extreme in order to give typefaces, but through a broad range of theoretical reference commercial messages greater impact following the rapid wishes to provide new approaches to the design discourse, for growth of advertising that came with the industrialisation. practitioners from the typographic field as well as from related Soon overtaken by a range of new communication tools, design and communication fields. these were the last fonts where the shapes of the letters were Closely linked to my writing is the development of Mido, allowed such a great part in the process of communication. my own Egyptian typeface. My discoveries while developing This paper examines the development of Egyptians through the typeface will contextualise the arguments, while the the media theories of Walter Ong (Orality and Literacy) and theoretical explorations give new insight to the construction Friedrich Kittler (Gramophone, Film, Typewriter), rhetoric of these letterforms. eva grinder konstfack 2007 introduction Before photography, complex layouts and various advertising Brumberger has identified another sort of rhetoric, and her 3› Brumberger, The Rhetoric of techniques, typographic forms were developed, expanded and Ph.D. -

CORPORATE IDENTITY GUIDELINES Rev
CORPORATE IDENTITY GUIDELINES Rev. October 2016 CONTENTS Table of Contents ABOUT THESE GUIDELINES These guidelines include information for your development of branded materials . Contained within this document are brand strategy, brand design, co-branding, promotional/technical material, special applications and packaging information . For trade shows consult the Tradeshow Guidelines document . For instruments consult the Instrument Identity Guidelines document . Welcome . iv Headline Box and Introduction Headlines . 2-42 Sign-off . 2-44 BRAND STRATEGY Using Trademarks and Service Marks . 2-45 Brand Positioning . 1-2 Paper Stock . 2-47 Tag Line . 1-3 Corporate Stationery . 2-48 Brand Model . 1-4 Brand Architecture . 1-5 CO-BRANDING Communications Strategy . 1-6 Co-branding . 3-2 Building a Value Proposition . 1-7 Internal Co-branding . 3-3 Brand Voice . 1-9 PerkinElmer Acquisitions . 3-4 Brand Voice Evaluation Tree . 1-13 External Distributors/Dealers and Collaborators . 3-5 BRAND DESIGN PROMOTIONAL MATERIALS SPECIFICATIONS Introduction . 2-2 Introduction . 4-2 Use of PerkinElmer Name . 2-3 Brochures . 4-5 Logo . 2-4 Application Guides . 4-17 Color . 2-12 Sell Sheets . 4-24 Typography . 2-20 Flyers . 4-31 Photography . 2-24 Direct Mail . 4-35 Video . 2-27 Print Advertising . 4-39 Illustration . 2-33 E-Marketing . 4-45 Product Visual Treatments . 2-34 Software Visual Treatments . 2-38 Technology Indicators . 2-40 Grid and White Space . 2-41 Corporate Identity Guidelines | PerkinElmer | ii CONTENTS Table of Contents, continued TECHNICAL MATERIALS SPECIFICATIONS PACKAGING Introduction . 5-2 Introduction . 7-2 Grids . 5-4 Packaging Types . 7-3 Layout Specifications–Set A . 5-7 Small Products . -

Type Designers Who Had Based Their Designs on What Had Come Before, Baskerville Wanted to Design As It Was Written with a Pen Held at Right-Angle to the Baseline
Johannes Gutenberg Gutenberg’s knowledge of metallurgy enabled him to produce durable alloy letter punches using moulds. These could be replicated over and over giving the printer a usable number of letters to form his text and that then could be reused in infinite combinations unlike the fixed plates, used previously, which could only be used once. Following his invention of moveable type, in 1455 it was used to produce his 42-line Bible, thought to be the first printed in using this method. Gutenberg had made printing a lot more accessible and a lot cheaper to the public than the hand- scribed documents that had preceded them. Before print, the ability to read was useful mainly to the elite and the trained scribes who handled their affairs. Affordable books made literacy a crucial skill and an unprecedented means of social advancement to those who acquired it. Gutenberg’s Bible is printed using a font called Textura. It is a Blackletter font with heavy upright letters with emphasised verticals and angled junctions and contains over 300 glyphs in order to replicate the handwritten documents it was trying to emulate. Although it is pretty illegible by today’s typographical standards, it remains a work of art comparable to the manuscripts it imitated. Johannes Gutenberg has been voted one of the top 100 most influential people of the millennium for his contribution to printing and giving ordinary people the opportunity to read and reflect on their own terms. William Caxton William Caxton introduced the art of printing to England. He was a businessman who could foresee and understand the value of printing, publishing and selling books. -
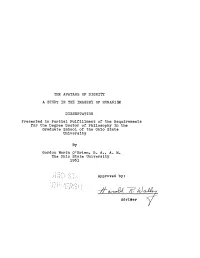
View of the Most Articulate Critics, Had a Common Goal, and the Poet Had the Advantage Over the Philosopher
THE AVATARS OP DIGNITY A STUDY IN THE IMAGERY OP HUMANISM DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University By Gordon Worth O'Brien, B. A., A. M. The Ohio State University 1951 Approved by: ~7r?6JcJ&X Adviser ACKNOWLEDGMENT « I wish here to express my thanks to Professor Harold R. Walley of the Ohio State University for his long patience with and his invaluable guidance in this project, and for his encouragement; to Messrs. Ivan Schreiber and N G Davis for their unsparing assistance with the parturition of many ideas over many cups of coffee; to my father and mother, who never lost hope; and to my wife and children, who suffered me— and with me— in this adventure. Gordon W. O'Brien December 6, 1951 888551 TABLE OF CONTENTS page number Chapter I: Introduction..................I Chapter II: The Clear Spirit: The. .23 Avatar of Knowledge Chapter III: Microcosmos: The.......... 92 Avatar of Power Chapter IV: Conclusion.................. 187 Bibliography: ............................ 198 Autobiography! ........................... 203 1 THE AVATARS OF DIGNITY: A STUDY IN THE IMAGERY OF HUMANISM CHAPTER ONE INTRODUCTION Vi/hat surmounts the reach Of human sense, I shall delineate so, By lik’ning spiritual to corporal forms, As may express them best... ((Yet)) who, though with the tongue Of Angels, can relate, or to what things Liken on Earth conspicuous, that may lift Human imagination to such highth Of Godlike Power? Paradise Lost Creating avatars for good and evil and sensualizing— that is, materializing for the imagination— the conse quences of beatitude or malediction are not properly the office of the theologian or the philosopher. -

Download Portfolio
SARA CORRAVO 517.937.9793 [email protected] scorravodesigns.com POOR FOR NUTRITION Detroit, Michigan, located in Wayne County has a population of 673,104 people. They are suffering from a poverty rate of 22.7%. A household in Detroit is considered to be at poverty level when the annual income is at or below $24,250. Neighborhoods have anywhere from 0 - 100% of their community at the income level for poverty. Detroit also endures an obesity rate of 12.9%. Obesity is when your weight is above what is considered healthy for your age and height. This can stem from healthy/non-healthy choices available in your area, along with the household type you live within. PERCENT OF RESIDENTS AT OR BELOW POVERTY LEVEL: $24,250 HEALTHY VS. NON-HEALTHY OPTIONS 81 – 100% Farmers Markets Top 5 Fast Food Restaurants 61 – 80% McDonald’s, KFC, Burger King, Taco Bell, Wendy’s Top 5 Natural Grocery Stores 41 – 60% Whole Foods, Westborn Market, Honey Bee La Colmena, Trader Joe’s, Plum Market 21 – 40% 0 5 miles 0 – 20% Poor for Nutrition Information Graphic Design, Fall 2019 This information graphic, is comparing the levels between the poverty and food availability in Detroit, Michigan. These levels are in relation to neighborhood/sub-division, as well as the access to healthy/unhealthy options (i.e. farmers markets, fast food restaurants and natural grocery stores). 18 82 – 1940 Eric Gill, an English typographer was an 1925 Perpetua asset to the type and design industry while 1927 – 30 Gill Sans he was alive. Along with being a big factor 1929 Perpetua Greek to the arts and crafts movement. -

Database of Italian Humanists and Jews.Pdf (766.0Kb)
A Database of Italian Humanists and Jews This list, arranged in chronological order by author’s date of birth, where known, is a preliminary guide to Italian humanists’ Latin and vernacular prose and poetic accounts of Jews and Judaic culture and history from about 1440 to 1540. In each case, I have sought to provide the author’s name and birth and death dates, a brief biography highlighting details which especially pertain to his interest in Jews, a summary of discussions about Jews, a list of relevant works and dates of composition, locations of manuscripts, and a list of secondary sources or studies of the author and his context arranged alphabetically by author’s name. Manuscripts are listed in alphabetical order by city of current location; imprints, as far as possible, by ascending date. Abbreviations: DBI Dizionario biografico degli Italiani (Rome: Istituto della enciclopedia italiana, 1960-present) Kristeller, Iter Paul Oskar Kristeller, Iter Italicum: A Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and Other Libraries; Accedunt alia itinera, 6 vols (London: Warburg Institute; Leiden: E. J. Brill, 1963-1991) Simon Atumano (d. c. 1380) Born in Constantinople and became a Basilian monk in St John of Studion there. Bishop of Gerace in Calabria from 1348 until 1366, and Latin archbishop of Thebes until 1380. During his time in Thebes, which was the capital of the Catalan duchy of Athens, he studied Hebrew and in the mid- to late-1370s he began work on a polyglot Latin-Greek-Hebrew Bible dedicated to Pope Urban VI. -

Eric Gill Press Type Solus Joanna Aries Floriated Capitals Bu- Nyan Jubilee Gill Sans Perpetua Pilgrim Perpetua
Gill Sans Perpetua Pilgrim Perpetua Greek Golden Cockeral Press Type Solus Joanna Aries Floriated Bunyan Jubilee Gill Sans Perpetua Pilgrim Perpetua Eric Greek Golden Cockeral Press Type Solus Joanna Aries Floriated Capitals Bunyan Jubilee Gill Sans Perpetua Pilgrim Perpetua Greek Golden Cockeral Press Type Solus Joanna Aries Floriated Capitals Bu- nyan Jubilee Gill Sans Perpetua Pilgrim Perpetua Greek Golden Cockeral Press Type Solus Joanna Ar- ies Floriated Capitals Bunyan Jubilee Gill Sans Per Pilgrim Perpetua Greek Golden Cockeral Press Gill Type Solus Joanna Aries Floriated Capitals Bunyan Ju 1882 - born in Brighton, Sussex 1887 - began his studies at Chichester Technical and Art School. Gill Sans Perpetua Pilgrim Perpetua Greek Golden 1900 - he moved to London for training to become an architect began evening Cockeral Press Type Solus Joanna Aries Floriated classes in stonemasonry at Westminster Technical Institute and calligraphy at the Central School of Arts and Crafts. Bunyan Jubilee Gill Sans Perpetua Pilgrim Perpetua 1903 - stopped his architectural training to become a calligrapher, letter-cutter and monumental mason Greek Golden Cockeral Press Type Solus Joanna 1914 - created sculptures for stations of the cross in Westminster Cathedral 1925 - designed the Perpetua typeface for Morison Aries Floriated Capitals Bunyan Jubilee Gill Sans 1927 - designed another typeface which is based on the serif lettering origi- nally designed for the London Underground. Perpetua Pilgrim Perpetua Greek Golden Cockeral 1928 - settled in Pigotts where he set up workshop for printing and lettering. 1932 - created Aries and Floriated Capitals Press Type Solus Joanna Aries Floriated Capitals Bu- 1932 - produced a group of sculptures, Prospero and Ariel, for the BBC's Broadcasting House in London nyan Jubilee Gill Sans Perpetua Pilgrim Perpetua 1934 - Bunyan and Jubilee 1937 - created the background for the first George VI definitive stamp for the Greek Golden Cockeral Press Type Solus Joanna Ar- Post Office. -

GILL SANS BENJAMIN FALL G 2 Fall
Fall MONOTYPE 1 GILL SANS BENJAMIN FALL g 2 Fall Gill Sans Edited and Designed by Benjamin Fall 2013 Fall Eric Gill, designer of the font Gill Sans, was not completely satisfied with Johnston Sans, the font of his mentor, Edward Johnston: “The first notable attempt to work out the norm for plain letters was made by Mr Edward Johnston when he designed the sans-serif letter for the London Underground Railways. Some of these letters are not 3 entirely satisfactory, especially when it is remembered that, for such a purpose, an alpha- bet should be as near as possible ‘fool-proof’… as the philosophers would say—nothing should be left to the imagination of the sign-writer or enamel-plate maker.” Eric Gill’s creativity allowed him to create Gill Sans, often hailed as the “Helvetica of England.” Just as the name implies, Gill Sans is a Humanist sans-serif font. The Gill Sans family includes light, regular, bold, extra bold, ultra bold, italic, condensed, and bold extra con- densed. It is more classical in proportion and has a more geometric feel than a mechani- cal one. Eric Gill intended for his font to function both in text and on display. Released in 1928, Gill Sans rose in popularity in 1929 when the London and North Eastern Railway adopted it as their standard typeface. The prominence of this use helped Gill Sans to become the preferred font of many British institutions, being widely used by the Church of England, the BBC, and Penguin Books, among others. Since 2006, Gill Sans has been freely distributed through Apple’s Operating System, as well as through Adobe’s Creative Suite. -

Ideas, Attitudes and Beliefs About Language in Italy from The
Ideas, Attitudes and Beliefs about Language in Italy from the Thirteenth to the Fifteenth Century Marco Spreafico A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Combined Historical Studies The Warburg Institute University of London 2018 1 I declare that the work presented in this thesis is my own. …………………………………… Marco Spreafico 2 Abstract Peter Burke has described the early modern period in Europe as the age of the ‘discovery of language’. The aim of my dissertation is to trace the linguistic and cultural phenomena which prepared the way for this discovery by studying how ideas, attitudes and beliefs about language were formed and developed in Italy from the thirteenth to the fifteenth century. In particular, I analyse the contemporary perception of the shifting relationship between Latin and the vernaculars in light of two highly significant events in the social history of language: on the one hand, the collapse of the medieval language system of functional compartmentalization of Latin and vernaculars, which is usually referred to as diglossia; on the other hand, the process of the formation of national languages known as standardization. I examine the concept of ‘historical language’ and construct a theoretical framework to analyse how it was formed and developed within communities of speakers. From this perspective, I discuss how specific varieties of the vernacular came to acquire recognition; and I interpret in sociological and historical terms the progressive emancipation of the vernaculars from Latin and their acquisition of autonomous existence in the minds of speakers. Finally, I advance an interpretation of the language ideas and choices of Italian humanists and the role they played in changing the image of Latin in early modern Italy and making it a prototype of European standardized national languages. -

Maestros Tipógrafos Y Desde Estas Obser- Vaciones Habían Llegado a Conclusiones Similares
HISTORIA DE LA TIPOGRAFÍA III Grandes tipógrafos Recopilación de José Ramón Penela editada por Angel E. Iglesias Delgado Detalle de una página del «Hypnerotomachia Poliphili» uno de los más bellos libros impresos por el impresor veneciano Aldus Manutius en el año 1499 HISTORIA DE LA TIPOGRAFÍA III Grandes tipógrafos Recopilación de José Ramón Penela editada por Angel E. Iglesias Delgado NEW MONESUCH PRESS MADRID-SORIA Este libro ha sido compuesto con: URW Garamond, normal, de 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos ; negrita, de 10 puntos y cursiva de 8 y 10 puntos. Helvética, normal, de 10, 14, 18 y 25 puntos. Prefacio Como todo arte, la tipografia también tiene sus maestros. Tipografos que durante su carrera sir- vieron como guia y ejemplo para muchos otros y que dejaron para la posteridad creaciones que aun hoy gozan de una reputa- da solidez y fiabilidad y que en todo caso conforman unos hitos que los interesados en la tipografía debemos conocer. Indudablemente, nunca mejor dicha la frase hecha «no están todos los que son, ni son todos los que están» porque, afortunadamente, jla nó- mina de creadores de tipos es extensa y variada, pero como punto de partida y para darnos una visión global de la historia de la tipografía a través de sus protagonistas, los que aparecen en esta sección de Unos tipos duros son en verdad una apuesta segura. Índice Prefacio ........................................................................................... 5 Nicholaus Jenson ......................................................................... 9 Erhard