Promotion De L'elevage Caprin Dans Le Cadre De La
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Panoramique Et Gros-Plan Sur L'operation Coup D'arret
midi-madagasikara.mg http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2014/11/14/panoramique-gros-plan-loperation-coup-darret-grand-reportage-latimer- rangers/ Panoramique et gros-plan sur l’operation coup d’arret Un grand Reportage de Latimer Rangers Le Premier ministre Kolo Roger a regagné récemment à Amboasary-Sud afin d’assister à la cérémonie de ce que l’on a qualifié de « reddition des dahalo contre nourriture ! ». De nombreux observateurs avisés ne croient pas à cette farce qui relève plutôt de la mise en scène, sinon de la bouffonnerie. Certes, tout le monde est plus ou moins d’accord pour admettre que la persistance de l’insécurité dans le Sud, est une épine dans le pied du gouvernement, qu’il convient d’arracher au plus vite, autant que faire se peut. Car il y va de son aura et de sa crédibilité vis-à-vis des bailleurs de fonds qui ne sont pas légion à se bousculer au portillon. Les finances de l’Etat étant à sec, tous les ingrédients ont été mis en branle, explorés les voies et moyens pour éteindre ce récurrent et lointain incendie. Les séminaires, les colloques, et les ateliers n’ont pas été d’un quelconque secours pour éteindre le brasier. Bien avant son accession à la primature, j’ai eu d’excellentes relations de franche camaraderie avec M. Kolo Roger et avec son grand-frère Kolo Roland, le sénateur. Et c’est justement à sa demande à titre officieux, et aussi pour mon propre compte, que les mois d’août, septembre et toute la première quinzaine d’octobre 2014, que je me trouvais dans le Sud, pour enquêter sur le déroulement de l’Opération « coup d’arrêt ». -

Series of Revisions of Apocynaceae XLIV
WAGENINGEN AGRICULTURAL UNIVERSITY PAPERS 97-2 (1997) Series of Revisions of Apocynaceae XLIV Craspidospermum Boj. ex A. DC, Gonioma E. Mey., Mascarenhasia A. DC, Petchia Livera, Plectaneia Thou., and Stephanostegia Baill. by A.J.M. Leeuwenberg Date of publication: 12Augus t 1997 Wageningen MM Agricultural University rn,,\;!(Ni;-. L.NV 1 iHiisaaAT N Series of Revisions of Apocynaceae XLIV / Craspidospermum Boj. ex A. DC, Gonioma E. Mey., Mascarenhasia A. DC, Petchia Livera, Plectaneia Thou., and Stephanostegia Baill. / A.J.M. Leeuwenberg ISBN 90-73348-76-5 NUGI 823 ISSN 0169-345X Distribution: Backhuys Publishers, P.O.Box 321,230 0 AH Leiden, The Netherlands. Telephone: +31-71-5170208 Fax: +31-71-5171856 E-mail: [email protected] All rights reserved Printed in The Netherlands Series of Revisions of Apocynaceae XLIV Craspidospermum Boj. ex A. DC, Gonioma E. Mey., Mascarenhasia A. DC, Petchia Livera, Plectaneia Thou., and Stephanostegia Baill. byA.J.M . Leeuwenberg Department of PlantTaxonomy, Wageningen Agricultural University, P.O.Box 8010, 6700Wageningen, the Netherlands Abstract Six genera of Apocynaceae have been monographed. These six are restricted to Africa, except for Petchia, which also occurs in Sri Lanka with one endemic species. The study is based on herbarium material and living plants, mostly observed and collected by the author in Madagascar. Petchia replaces the well-known genus name of Cabucala as it has priority, so six new combinations have been made here. Petchia africana from Cameroun has been described as new to science. For Carissa verticillata a new name has been proposed to replace Pichon's homonym, C.pichoniana. In all, 23 names have been reduced to synonymy, 14 of which are even synonymso fPlectaneia thouarsii. -

Marches De Travaux Saisis Sur Sigmp Durant L'annee 2017
MARCHES DE TRAVAUX SAISIS SUR SIGMP DURANT L'ANNEE 2017 Appel à Manifestation Marché sur Appel d'offres Légende : AMI AOOI AOO Marché sur Appel d'Offres National d'Intêret International Marché sur Appel Marché sur Appel d'Offres AOR AORI AV Avenant d'Offres Restreints Restreints International BC Bon de Commande CNV Convention sous forme de Marché GG Marché de Gré à Gré Financ Région Contrat Montant TTC Unité Autorité Contractante Objet Titulaire ement MINISTERE AUPRES DE LA Travaux de construction de la route PRESIDENCE CHARGE DES CHINA ROAD AND BRIDGE reliant Ivato-Village Artisanal et la route Centrale AOO 576 659 142 913,27 MGA PROJETS PRESIDENTIELS, FC CORPORATION MADAGASCAR reliant Boulevard de l`Eurpoe-Village de DE L'AMENAGEMENT DU OFFICE CRBC SA la Francophonie TERRITOIRE ET DE Travaux de construction d'urgence de deux cent quarante et un bâtiments MINISTERE DE L'EDUCATION Centrale GG 42 998 930 400,00 MGA PIP scolaires préfabriqués meubles à la OPHIRS RESOURCES CO SARL NATIONALE suite de dégats cyclonique Enawo dans tout Madagascar. MINISTERE AUPRES DE LA Travaux de construction du camp PRESIDENCE CHARGE DES premier Régiment des forces CHINA HARBOUR ENGINEERING Centrale AOO 42 938 730 400,28 MGA PROJETS PRESIDENTIELS, FC d`Intervention et une partie du camp de COMPANY LTD DE L'AMENAGEMENT DU la Base Aéronavale d`Ivato (BANI) TERRITOIRE ET DE Travaux d`aménagement des SOCIETE NATIONALE CHINOISE DES AUTORITE ROUTIERE DE infrastructures routières et portuaires de Centrale AOOI 17 731 365 954,00 MGA BADEA TRAVAUX DE PONTS ET CHAUSSES -
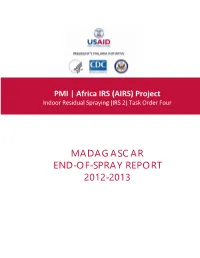
IRS Technical Report Template
PMI | Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four MADAGASCAR END-OF-SPRAY REPORT 2012-2013 Recommended Citation: PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four. June 2013. Madagascar End-of-Spray Report2012-2013. Bethesda, MD. PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four, Abt Associates Inc. Contract No.: GHN-I-00-09-00013-00 Task Order: AID-OAA-TO-11-00039 Submitted to: United States Agency for International Development/PMI Abt Associates Inc. 1 4550 Montgomery Avenue 1 Suite 800 North 1 Bethesda, Maryland 20814 1 T. 301.347.5000 1 F. 301.913.9061 1 www.abtassociates.com 2012-2013 MADAGASCAR END-OF-SPRAY REPORT CONTENTS Contents …. .................................................................................................................................. iii Acronyms … .................................................................................................................................vii Executive Summary ..................................................................................................................... ix 1. Introduction ............................................................................................................................ 1 1.1 Background of IRS in Madagascar ................................................................................ 1 1.2 Objectives for AIRS Madagascar during the 2012-2013 IRS Campaigns .................. 2 2. Pre-IRS Campaign Activities ............................................................................................... -
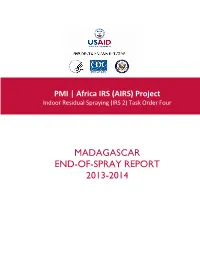
IRS Technical Report Template
PMI | Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four MADAGASCAR END-OF-SPRAY REPORT 2013-2014 Recommended Citation: PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four. May 2014. Madagascar End-of-Spray Report 2013-2014. Bethesda, MD. PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four, Abt Associates Inc. Contract No.: GHN-I-00-09-00013-00 Task Order: AID-OAA-TO-11-00039 Submitted to: United States Agency for International Development/PMI Abt Associates Inc. 1 4550 Montgomery Avenue 1 Suite 800 North 1 Bethesda, Maryland 20814 1 T. 301.347.5000 1 F. 301.913.9061 1 www.abtassociates.com 2013-2014 MADAGASCAR END-OF-SPRAY REPORT CONTENTS Contents….. .................................................................................................................................. iii Acronyms… ..................................................................................................................................vii Executive Summary ..................................................................................................................... ix 1. Introduction ............................................................................................................................ 1 1.1 Background of IRS in Madagascar ................................................................................................................... 1 1.2 Objectives for AIRS Madagascar During the 2013-2014 IRS Campaigns ............................................. -

Les Marchés De Travaux
MARCHES DE TRAVAUX SAISIS SUR SIGMP DURANT L'ANNEE 2011 Appel à Manifestation Légende : AMI AOOI Marché sur Appel d'offres International AOO Marché sur Appel d'Offres National d'Intêret Marché sur Appel Marché sur Appel d'Offres Restreints AOR AORI AV Avenant d'Offres Restreints International BC Bon de Commande CNV Convention sous forme de Marché GG Marché de Gré à Gré Région ou Financ Contrat Montant TTC Unité Autorité Contractante Objet Titulaire Direction ement Travaux de réhabilitation dela Route AUTORITE ROUTIERE DE KOEXI Centrale AORI 46 953 287 863,20 MGA Nationale RN 35 entre Mahabo (Pont SOGEA SATOM - SA MADAGASCAR M sur le canal de Dabara) et Morondava Travaux de construction des logements Ministère de l'Aménagement du RATOVOARISOA RENE (ENTREPRISE Centrale AOO 2 636 878 560,00 MGA RPI sociaux 1ere vague,réparties en sept Territoire et de la Décentralisation ENGEMAFI) Lots Travaux de construction des logements Ministère de l'Aménagement du Centrale AOO 2 384 210 760,00 MGA RPI sociaux (1ere vague) à Tsarakofafa ENTREPRISE ETRO Territoire et de la Décentralisation Toamasina Travaux de construction des logements RASEHENOARISOA MARIE CLAIRE Ministère de l'Aménagement du Centrale AOO 2 270 590 440,00 MGA RPI sociaux 1ere vague,réparties en sept RASOANANAHARY ENTREPRISE Territoire et de la Décentralisation Lots ORIENTALE Travaux de construction des logements Ministère de l'Aménagement du ANDRIAMAMPIANINA LOVASOA Centrale AOO 2 204 749 200,00 MGA RPI sociaux 1ere vague,réparties en sept Territoire et de la Décentralisation HERIZO -
UN Mcar Joint Project. Final Narrative Report 2018 Draft
1 2018 final report to the Government of Japan for Assistance through Supplementary Budget Madagascar Report Cleared by: Marie Dimond, UNDP Deputy Representative (Programme) PROJECT SUMMARY Country Madagascar Project Title Support to humanitarian response and early recovery activities for the most vulnerable people in a situation of severe food insecurity affected by the drought in the Androy region (“Grand Sud” of Madagascar) Duration March 22, 2017 – September 30, 2018 Total Contribution US$ 2,095,000 Mapping of the Municipalities covered by the joint project in the Androy region 1 2 TABLE OF CONTENTS 1) Background/Issues 2) Results a. Objectives b. Achieved results 3) Partnership and Coordination 4) Challenges and lessons learned 5) Monitoring 6) Visibility of the funding from the Government of Japan 7) Financial implementation (in line with budget table in the proposal) 8) Contacts 9) Annexes Executive Summary The joint project is part of the emergency response plan and the early recovery/resilience plan in response to the drought situation in the South (Grand Sud) of Madagascar where over 1.61 million people live. These plans cover the period from February 2016 to June 2019. Priority was given to the Androy region which has been the most affected by the humanitarian crisis. The joint project effectively started in September 2017 although some Agencies starting pre-financing the implementation of activities from May 2017. Implementation was somewhat delayed in part by the outbreak of a pulmonary plague epidemic from September to November 2017 which affected a large part of the country in an unprecedented manner, including major urban areas, and led to restrictions in movement and activities. -
Chapter 5 Existing Institution and Organization for Water Supply
The Study on the Sustainable, Autonomic Drinking Water Supply Program in the South Region of Madagascar Final Report Summary Report Chapter5 Existing Institutions and Organizations for Water Supply CHAPTER 5 EXISTING INSTITUTION AND ORGANIZATION FOR WATER SUPPLY 5.1 Organization of AES and JIRAMA in the South Region 5.1.1 Organization of AES The headquarters of AES is in the capital city of Antananarivo with a General Director and eighteen (18) staff in the office. AES also has a regional office in Ambovombe city serving the South Region with water supply as a center of the service area. To the regional office, a Technical Director and 114 staff in 2006, decreased from 120 in 2005, are assigned for operation and maintenance of the water services. In the area of Beloha-Tsihombe pipeline water supply system, which was constructed under the water supply project with the official assistance of Japan in 1995 to 1997, there is an area office in Beloha city, and a liaison office in Tsihombe city. In the system, service staffs are arranged at each water supply station to sell the water from the reservoir along the pipeline. Additionally, the water is provided to the remote villages using water tank trucks operated by Beloha office and Tsihombe office. However, the drinking water is not sufficiently provided to the villages due to the shortage of water tank trucks and expensive water charge of AES. One bucket with 13liters of water costs 100Ar(5.6Yen), which is equivalent to 6,600Ar/m3 (370Yen/m3) and 16.5 times of JIRAMA’s rate of 400Ar/m3 (22Yen/m3) in 2005. -

Santénet2 REVISED ANNUAL REPORT No
Santénet2 REVISED ANNUAL REPORT No. 4 October 2011–September 2012 ©Santénet2/ASOS Central: Community members in village taking patient to CSB of Marofotra commune, Manakara DECEMBER 2012 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by RTI International. REVISED ANNUAL REPORT No. 4 October 2011–September 2012 Contract GHS-1-01-07-00005–00 Prepared for Robert Kolesar, COR USAID/Madagascar Prepared by RTI International 3040 Cornwallis Road Post Office Box 12194 Research Triangle Park, NC 27709-2194 RTI International is one of the leading research institutes in the world and is dedicated to improving human condition by turning knowledge into practice. Its staff of more than 2,800 people provides research and technical services to governments and businesses in over forty countries in the areas of health, pharmaceuticals, education & training, surveys & statistics, advanced technology, democratic governance, economic and social development, energy, and environment. For more information, please visit www.rti.org Table of Contents ACRONYMS ................................................................................................................................................ V INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 7 TECHNICAL COMPONENTS ............................................................................................................................ -

RAKOTONDRAZANANY Mamizara Masiharison ASPECTS
RAKOTONDRAZANANY Mamizara Masiharison ASPECTS NUTRITIONNELS ET TYPOLOGIQUES DES PRINCIPALES RESSOURCES FOURRAGERES NATURELLES DANS LE DISTRICT D’AMBOVOMBE Thèse pour l’obtention du Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine Vétérinaire UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DE MEDECINE DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ET DE MEDECINE VETERINAIRE ANNEE : 2018 N° : 0259 VET ASPECTS NUTRITIONNELS ET TYPOLOGIQUES DES PRINCIPALES RESSOURCES FOURRAGERES NATURELLES DANS LE DISTRICT D’AMBOVOMBE THESE Présentée et soutenue publiquement le 25 Juin 2018 à Antananarivo Par Monsieur RAKOTONDRAZANANY Mamizara Masiharison Né le 13 Novembre 1987 à ANKADIFOTSY Pour obtenir le grade de DOCTEUR EN MÉDECINE VETERINAIRE (Diplôme d'État) Directeur de Thèse : Professeur RANDRIANARIVELOSEHENO Arsène MEMBRES DU JURY Président : Professeur RASAMINDRAKOTROKA Andriamiliharison Jean Juges : Professeur RAKOTO ALSON Aimée Olivat Professeur RAHARIVELO Adeline Rapporteur : Professeur RANDRIANARIVELOSEHENO Arsène DEDICACES ET REMERCIEMENTS Je dédie ce travail à tout ceux qui me sont chers et pour tout l’amour et l’aide qu’ils m’ont porté : Dieu tout puissant Recommande à l’Eternel tes œuvres, et tes projets réussiront (Proverbes 16 : 3). Ma mère RAZAOHARISOA Marie Claudine et ma tante RAZOELINORO Marie Françoise Pour leur tendresse et leur patience, sans elles je ne serai pas là aujourd’hui. Ma bien aimée Qui m’a toujours encouragée, écoutée et priée pour moi. A ma grande famille RAKOTONDRAZANANY et RANDRIANATOANDRO Qu’ils trouvent ici toute ma gratitude pour leur soutien tout au long de mes études. Je souhaite que Dieu leur octroie une longue vie et qu’ils trouvent dans ce modeste travail le témoignage de ma reconnaissance et toutes mes affections A la promotion SIFAKA, Pour les bons moments que nous avons passés ensemble pendant nos années d’études. -

Madagascar PRRO 200735 BR 03
BUDGET INCREASE TO PROTRACTED RELIEF AND RECOVERY OPERATION Protracted Relief and Recovery Operation - Madagascar 200735 Start date: 1 January 2015 End date: 30 June 2017 Extension period: 1 July - 31 December 2017 Total revised number of beneficiaries 2 069 140 Duration of entire project 36 Months Extension period 6 months Gender marker code 2A WFP food tonnage 92 616 Cost (United States dollars) Current Budget Increase Revised Budget 54 428 605 7 296 132 Food and Related Costs 61 724 737 Cash and Vouchers and Related Costs 36 437 330 7 063 247 43 500 576 Capacity Development & Augmentation 2 710 020 0 2 710 020 DSC 11 282 863 2 041 978 13 324 841 ISC 7 340 117 1 148 095 8 488 212 Total cost to WFP 112 198 935 17 549 452 129 748 387 NATURE OF THE INCREASE 1. This third budget revision to Madagascar Protracted Relief and Recovery Operation (PRRO) 200735 seeks to extend the period of the operation by six months until the start of the country Transitional Interim Country Strategic Plan (T-ICSP) in January 2018, and to include WFP’s relief and early recovery response to the cyclone ENAWO which struck the country in March 2017. Specifically, this budget revision will: • Increase food requirements by 8,725 mt to a total of 92,616 mt; • Increase food and related costs by USD 7,296,132 to USD 61,724,737; • Increase Direct Support Costs (DSC) by USD 2,041,978 to USD 13,324,841; • Increase Indirect Support Costs (ISC) by USD 1,148,095 to USD 8,488,212; and • Increase the total project budget by USD 17,549,452 to USD 129,748,387. -

MADAGASCAR Grand South Livelihood Zones Revision November 2017
MADAGASCAR Grand South livelihood zones revision November 2017 FEWS NET is a USAID-funded activity. The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the view of the United States Agency for International Development or the United States Government. FEWS NET Washington [email protected] www.fews.net TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS ................................................................................................................................................................ 1 ACRONYMS AND ABBREVIATIONS ........................................................................................................................................... 3 ACKNOWLEDGEMENTS ............................................................................................................................................................ 4 INTRODUCTION ....................................................................................................................................................................... 5 The Household Economy Analysis ............................................................................................................................................ 6 Data collection and field methods ........................................................................................................................................... 9 SUMMARY DESCRIPTIONS OF THE GRAND SOUTH LIVELIHOOD ZONES ................................................................................. 10 ZONE MG22 –