Bandjoun, Analyse D'une Accumulation Symbolique (Cameroun)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Masks on the Move Defying Genres, Styles, and Traditions in the Cameroonian Grassfields
Masks on the Move Defying Genres, Styles, and Traditions in the Cameroonian Grassfields Silvia Forni n the realm of African art, masks are some of the most This article investigates the longstanding history of commer- exemplary and iconic artworks. Whether displayed cial practices and stylistic experimentation that characterize to be admired for their shape, form, and volumes, or the production of masks and other artworks in the Grassfields presented in dialogue with ethnographic information of Western Cameroon. While I acknowledge the importance of and contextual images, masks are omnipresent in col- long-distance and international trade as an important stimulus lections and displays of African art. As aesthetic and for creativity and artistic production, my intention is to high- ethnographic objects, masks are used as gateways to the under- light the significance of contemporary artistic inventions in Istanding and appreciation of “cultural styles” as well as the for- shaping local understanding of aesthetics and material displays. mal and creative solutions adopted by artists and workshops. Yet Collections, museums, eco-museological itineraries and, more the appeal of masks also relies on their perceived irreducible dif- recently, experimentations and artistic interventions by contem- ference and mysterious spiritual aura. Even when isolated and porary artists Hervé Youmbi and Hervé Yamguen (Fig. 1) have stripped of their fiber costumes and attachments, there is always produced a complex and intriguing regional and national artistic a reference to the body of an absent wearer, thus evoking a sit- scene. Here the taxonomies distinguishing commercial produc- uated and embodied history of production, performance, and tions from “authentic artworks” have been blurred and subverted social meaning that often does not accompany the mask into the in local practices, where masks are now moving between spheres museum. -
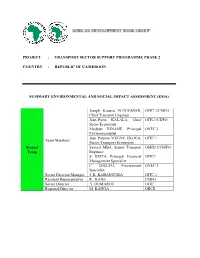
Project : Transport Sector Support Programme Phase 2
PROJECT : TRANSPORT SECTOR SUPPORT PROGRAMME PHASE 2 COUNTRY : REPUBLIC OF CAMEROON SUMMARY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) Joseph Kouassi N’GUESSAN, OITC.1/CMFO Chief Transport Engineer Jean-Pierre KALALA, Chief OITC1/CDFO Socio-Economist Modeste KINANE, Principal ONEC.3 Environmentalist Jean Paterne MEGNE EKOGA, OITC.1 Team Members Senior Transport Economist Project Samuel MBA, Senior Transport OSHD.2/CMFO Team Engineer S. KEITA, Principal Financial OITC1 Management Specialist C. DJEUFO, Procurement ONEC.3 Specialist Sector Division Manager J. K. KABANGUKA OITC.1 Resident Representative R. KANE CMFO Sector Director A. OUMAROU OITC Regional Director M. KANGA ORCE SUMMARY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) Programme Name : Transport Sector Support Programme Phase 2 SAP Code: P-CM-DB0-015 Country : Cameroon Department : OITC Division : OITC-1 1. INTRODUCTION This document is a summary of the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) of the Transport Sector Support Programme Phase 2 which involves the execution of works on the Yaounde-Bafoussam-Bamenda road. The impact assessment of the project was conducted in 2012. This assessment seeks to harmonize and update the previous one conducted in 2012. According to national regulations, the Yaounde-Bafoussam-Babadjou road section rehabilitation project is one of the activities that require the conduct of a full environmental and social impact assessment. This project has been classified under Environmental Category 1 in accordance with the African Development Bank’s Integrated Safeguards System (ISS) of July 2014. This summary has been prepared in accordance with AfDB’s environmental and social impact assessment guidelines and procedures for Category 1 projects. -
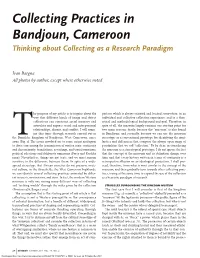
Collecting Practices in Bandjoun, Cameroon Thinking About Collecting As a Research Paradigm
Collecting Practices in Bandjoun, Cameroon Thinking about Collecting as a Research Paradigm Ivan Bargna All photos by author, except where otherwise noted he purpose of my article is to inquire about the parison which is always oriented and located somewhere, in an way that different kinds of image and object individual and collective collection experience, and in a theo- collections can construct social memory and retical and methodological background and goal. Therefore, in articulate and express social and interpersonal spite of all, the museum largely remains our starting point for relationships, dissent, and conflict. I will exam- two main reasons: firstly, because the “museum” is also found ine this topic through research carried out in in Bandjoun; and secondly, because we can use the museum the Bamileke kingdom of Bandjoun, West Cameroon, since stereotype as a conventional prototype for identifying the simi- T2002 (Fig. 1). The issues involved are to some extent analogous larities and differences that compose the always open range of to those concerning the transmission of written texts: continuity possibilities that we call “collection.” To be clear, in considering and discontinuity; translations, rewritings, and transformations; the museum as a stereotypical prototype, I do not ignore the fact political selections and deliberate omissions (Forty and Kuchler that the concept of the museum and its definition change over 1999). Nevertheless, things are not texts, and we must remain time and that every history written in terms of -

Chapter 6 Third Person Pronouns in Grassfields Bantu Larry M
Chapter 6 Third person pronouns in Grassfields Bantu Larry M. Hyman University of California, Berkeley “In linguistic theory, the 3rd person has had bad luck.” (Pozdniakov n.d.: 5) In this paper I have two goals. First, I propose a reconstruction of the pronoun system of Grassfields Bantu, direct reflexes of which are found in Eastern Grass- fields, with a close look at the pronoun systems, as reflected across thisvaried group. Second, I document and seek the origin of innovative third person pro- nouns in Western Grassfields. While EGB languages have basic pronouns inall persons, both the Momo and Ring subgroups of WGB have innovated new third person (non-subject) pronouns from demonstratives or perhaps the noun ‘body’. However, these languages show evidence of the original third person pronouns which have been restricted to a logophoric function. I end with a comparison of the Grassfields pronouns with nearby Bantoid and Northwest Bantu languages as well as Proto-Bantu. 1 The problem While Eastern Grassfields Bantu, like Narrow Bantu, has an old and consistent paradigm of pronouns, Western Grassfields Bantu has innovated new third per- son forms, often keeping the original forms as logophoric pronouns. The major questions I address in this chapter are: (i) Where do these new third person pro- nouns come from? (ii) Why were they innovated? (iii) What is the relation, if any, Larry M. Hyman. Third person pronouns in Grassfields Bantu. In JohnR. Watters (ed.), East Benue-Congo: Nouns, pronouns, and verbs, 199–221. Berlin: Language Science Press. DOI:10.5281/zenodo.1314329 Larry M. Hyman to logophoricity? In the following sections I first briefly introduce the subgroup- ing of Grassfields Bantu that I will be assuming, then successively treat thirdper- son pronouns in the different subgroups: Eastern Grassfields, Ring Grassfields, and Momo Grassfields. -

Traditions and Bamiléké Cultural Rites: Tourist Stakes and Sustainability
PRESENT ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, VOL. 7, no. 1, 2013 TRADITIONS AND BAMILÉKÉ CULTURAL RITES: TOURIST STAKES AND SUSTAINABILITY Njombissie Petcheu Igor Casimir1 , Groza Octavian2 Tchindjang Mesmin 3, Bongadzem Carine Sushuu4 Keywords: Bamiléké region, tourist resources, ecotourism, coordinated development Abstract. According to the World Travel Tourism Council, tourism is the first income-generating activity in the world. This activity provides opportunities for export and development in many emerging countries, thus contributing to 5.751 trillion dollars into the global economy. In 2010, tourism contributed up to 9.45% of the world GDP. This trend will continue for the next 10 years and tourism will be the leading source of employment in the world. While many African countries (Morocco, Gabon etc.) are parties to benefit from this growth, Cameroon, despite its huge touristic potential, seems ill-equipped to take advantage of this alternative activity. In Cameroon, tourism is growing slowly and is little known by the local communities which depend on agro-pastoral resources. The Bamiléké of Cameroon is an example faced with this situation. Nowadays in this region located in the western highlands of Cameroon, villages rich in natural, traditional or socio-cultural resources, are less affected by tourist traffic. This is probably due to the fact that tourism in Cameroon is sinking deeper and deeper into a slump, with the degradation of heritages, reception facilities and the lack of planning. In this country known as "Africa in miniature", tourism has remained locked in certain areas (northern part), although the tourist sites of Cameroon are not as limited as one may imagine. -

Plants Used in Bandjoun Village (La
The Journal of Phytopharmacology 2016; 5(2): 56-70 Online at: www.phytopharmajournal.com Research Article Plants used in Bandjoun village (La'Djo) to cure infectious ISSN 2230-480X diseases: An ethnopharmacology survey and in-vitro Time- JPHYTO 2016; 5(2): 56-70 March- April Kill Assessment of some of them against Escherichia coli © 2016, All rights reserved S.P. Bouopda Tamo*, S.H. Riwom Essama, F.X. Etoa S.P. Bouopda Tamo ABSTRACT Department of Biochemistry, Laboratory of Microbiology, An ethnopharmacology survey concerning the medicinal plants used in Bandjoun village (La'Djo) to cure University of Yaoundé I, PO Box infectious diseases was carried out in three districts of this village. The survey led to the identification of 79 812 Yaoundé, Cameroon medicinal plants species listed in 41 families. These plants were cited to be use to treat about 25 infectious diseases among which malaria, diarrhea and intestinal-worms were the most cited. Chromolaena odorata, S.H. Riwom Essama Voacanga africana, Moringa oleifera, Mammea africana, Euphorbia hirta, Psidium guajava, Allium cepa, Department of Microbiology, Enantia chlorantha, Alstonia boonei and Picralima nitida, were the ten most cited plants. Extractions of parts Laboratory of Microbiology, of these last plants were performed in hydro-ethanol (3:7) solvent and then tested in-vitro against an University of Yaoundé I, PO Box Escherichia coli isolate. The minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration 812 Yaoundé, Cameroon (MBC) were assessed by microdilution assay and the time-kill assessment was carried out by measure of log reduction in viable cell count, on a period of 48 hours. -

Prevalence of Geo-Helminths And
ISSN: 2643-461X Cedric et al. Int J Trop Dis 2020, 3:036 DOI: 10.23937/2643-461X/1710036 Volume 3 | Issue 2 International Journal of Open Access Tropical Diseases RESEARCH ARTICLE Prevalence of Geo-Helminths and Evaluation of Single Dose of Albendazole (400 mg) among School Children in Poumougne, Western Region, Cameroon Yamssi Cedric1*, Kamga Simo Sabrina Lynda2, Noumedem Anangmo Christelle Nadia3 and Check for Vincent Khan Payne2 updates 1Department of Biomedical Sciences, Faculty of Health Sciences, University of Bamenda, P.O. Box 39 Bambili, Cameroon. 2Department of Animal Biology, Faculty of Science, University of Dschang, P.O. Box 067, Dschang, Cameroon 3Department of Microbiology, Hematology and Immunology Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Dschang, P.O. Box 96, Dschang, Cameroon *Corresponding author: Yamssi Cedric, Department of Biomedical Sciences, Faculty of Health Sciences, University of Bamenda, PO Box 39 Bambili, Cameroon, Tel: (237)-677413547 Abstract and trichuriasis. This study may contribute to the fight against intestinal helminthiasis among school age children Background: Soil Transmitted Helminths (STHs) also in Bandjoun. called Geo-helminths are endemic in rural areas of devel- oping countries. This study was conducted to determine Keywords the prevalence of Geo helminths, their risk factors and an evaluation of a single dose of Albendazole 400 mg among STH, Prevalence, Infection, Intensity, Poumougne, Alben- infected School Children. dazole, School age children Methodology: Three High schools and Colleges, three Pri- Abbreviations mary schools and a Nursery School were selected at ran- ALB: Albendazole; CR: Cure Rate, EPG: Egg per gram of dom for sample collection. Stool was collected from each faeces; ERR: Egg Reduction Rate; NTDs: Neglected Tropi- subject and analyzed using floatation technique and Mc- cal Disease; SPSS: Statistical Package for Social Science; Master method respectively. -

Bamileke Bamileke Language & Culture in the Unitedstates
STUDYING BAMILEKE BAMILEKE LANGUAGE & CULTURE IN THE UNITEDSTATES Bamileke belongs to the Mbam-Nkam group of Graffi Please contact the National African Language languages, whose attachment to the Bantu division is still Resource Center, or check the NALRC disputed. While some consider it as a Bantu or a semi-Bantu website at http://www.nalrc.indiana.edu/ language, others prefer to in-clude Bamileke in the Niger-Congo group. Bamileke is not an unique language. It seems that Bamileke Medumba stems from ancient Egyptian and is a root language for many other Bamileke variants. The Bamiléké languages, which are tonal, belong to the Grasslands Bantu Group of the Broad Bantu languages. Nearly every Bamileke kindom names its own dialect as a separate language. Bamiléké languages are not al-ways mutually intelligible between bordering kingdoms. The Bamileke are renowned for their skilled craftsmenship. Bamileke are particularly celebrated carvers in wood, ivory, and horn. Chief’s compounds are notable for their intricately carved door frames and columns. Much of the art produced by the Bamileke tribes are associated with NATIONAL AFRICAN royal ceremonies. Beadwork and masks are common in this LANGUAGE RESOURCE tribe. Even the king may put on a mask for an appearance at a CENTER (NALRC) Kuosi celebration which is a public dance held every other year as a display of the kingdom’s wealth. Bamileke of 701 Eigenmann Hall, 1900 E. 10th St. Bloomington, IN 47406 USA Cameroon raise their dead to the rank of ancestors, worthy BAMILEKE TRADITIONAL ATTIRE T: (812) 856 4199 | F: (812) 856 4189 of worship and sacrifice. -

Water Supply Bafoussam
Cameroon: Water Supply Bafoussam Ex-post evaluation OECD sector 14030 / Water supply and sewage disposal BMZ project ID 1991 65 028 1991 70 408 Project-executing agency Ministère des Mines, de l’Eau et de l’Energie (MINMEE) Consultant IGIP Year of ex-post evaluation 2004 Project appraisal Ex-post evaluation (planned) (actual) Start of implementation Q 3 1991 Q 3 1993 Period of implementation 48 months 69 months Investment costs EUR 14.7 million EUR 15.1 million Counterpart contribution EUR 1.4 million EUR 0.0 million1 Financing, of which Financial EUR 13.3 million EUR 15.1 million Cooperation (FC) funds Other institutions/donors involved None None Performance rating Overall slightly insufficient degree of developmental effectiveness (rating 4) • Significance / relevance Rating 4 • Effectiveness Rating 4 • Efficiency Rating 3 Brief Description, Overall Objective and Project Objectives with Indicators The project comprised the rehabilitation and expansion of the existing water supply system in Bafoussam and Bandjoun as well as the connection of the towns of Baham, Bamendjou and Baméka to the system. Under a complementary measure, the city administration of Bafoussam was advised on how to operate the sewage disposal system more efficiently. In addition, the Direction Régionale de l’Ouest (DRO) of the national water utility Société Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC) was offered advice on how to increase water sales. Sensitization activities were also carried out in connection with the measure. The overall objective of the project was to contribute to reducing the health risks resulting from water-borne and water-related diseases. At the time of the project appraisal in the year 1991 the 1 Cameroon’s counterpart contribution as stated in the project appraisal report of 10% of the investment costs was made by privately financed, additional measures amounting to approx. -

Prevalence of Soil Transmitted Helminths and Associated Risk Factors Among Children Residents in Bandjoun, West Region of Cameroon
ACTA SCIENTIFIC MICROBIOLOGY (ISSN: 2581-3226) Volume 3 Issue 10 October 2020 Research Article Prevalence of Soil Transmitted Helminths and Associated Risk Factors among Children Residents in Bandjoun, West Region of Cameroon Dzune Fossouo Dirane Cleopas1,2* and Yondo Jeannette3,4 Received: August 19, 2020 1Center for Research on Filariasis and others Tropical Diseases, Cameroon Published: October 07, 2020 2Department of Biochemistry, Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, University of Yaounde 1, Cameroon © All rights are reserved by Dzune Fossouo 3Department of Biology Sciences, Faculty of Medicine and Pharmaceutic Sciences, Dirane Cleopas and Yondo Jeannette. University of Dschang, Cameroon 4Department of Animal Biology, University of Dschang, Cameroon *Corresponding Author: Dzune Fossouo Dirane Cleopas, Center for Research on Filariasis and others Tropical Diseases, Cameroon. Abstract Geohelminth infections, such as Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura and Hookworms are major public health concerns. These helminths distributed throughout the world with high prevalence in poor and socio-economically deprived communities in the tropics and subtropics cause morbidity and sometimes death. Our study aimed at evaluating the prevalence and intensity of infection of geohelminths and the risk factor in Bandjoun, West Region of Cameroon. Qualitative and quantitative analyses were carried out on three hundred and fifteen (315) stool samples collected from residents using the simple centrifugal flotation and McMaster count Ascaris lumbricoides technique respectively. Out of the 315 samples examined, twenty-one (6.7%) were infected with the eggs of at least one helminth Trichuris trichiura A. lumbricoides and parasite with prevalence and intensities of infection of 6.7% and 6971.4286 ±14662.4228 for and 0.3% and 50 T. -

Himalayan Journal of Humanities and Cultural Studies the Survival of Community Museums in Cameroon
Himalayan Journal of Humanities and Cultural Studies Open Access Research Article The Survival of Community Museums in Cameroon Dr. Ngitir Victor Bayena1 & Dr. Rene Ngek Monteh 2 1University of Douala, Cameroon 2HTTC/University of Yaounde 1, Cameroon Abstract: The dilemma of what museums are and what they ought to be in African settings, *Corresponding Author has continued to sustain scholarly debate for over two decades. Animated by African and Dr. Ngitir Victor Bayena western schools of thought, this debate centers on three main questions: do African collections actually qualify as museums? Are western-style museums suitable for Africa? Article History Can Africans actually sustain museums on the western model? It is on the sidelines of this Received: 30.03.2021 debate and attempts to provide responses that hinge concerns of survival for these museums. Accepted: 10.04.2021 In Cameroon where the museum institution is fairly young, questions continue to linger as Published: 20.04.2021 to whether her over thirty collections actually qualify as museums. Ever since the establishment of the nation‟s earliest museums in the 1920s, these instit utions have indeed Citations: survived in precarity owing to a litany of obstacles. In these circumstances, public access Ngitir Victor Bayena & Rene Ngek has thinned rapidly, outreach and clientele satisfaction have remained elusive and the Monteh (2021); The Survival of primary missions of preservation and conservation are shadows of their mission statements. Community Museums in Cameroon; Hmlyn J Human Cul Stud, 2(2) 31-40 Created after the year 2000, the community museums of Babungo, Oku, Bafut, Mankon, Bandjoun, Batoufam and Baham bear testimony to this. -

Programmation De La Passation Et De L'exécution Des Marchés Publics
PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS EXERCICE 2021 JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES RÉGION DE L’OUEST EXERCICE 2021 SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES Nbre de Montant des N° Désignation des MO/MOD N° Page Marchés Marchés 1 Services déconcentrés régionaux 14 526 746 000 3 2 Communauté Urbaine de Bafoussam 18 9 930 282 169 5 Département des Bamboutos 3 Services déconcentrés 6 177 000 000 7 4 Commune de Babadjou 12 350 710 000 7 5 Commune de Batcham 8 250 050 004 9 6 Commune de Galim 6 240 050 000 10 7 Commune de Mbouda 25 919 600 000 10 TOTAL 57 1 937 410 004 Département du Haut Nkam 8 Services Déconcentrés 4 81 000 000 13 9 Commune de Bafang 7 236 000 000 13 10 Commune de Bakou 11 146 250 000 14 11 Commune de Bana 6 172 592 696 15 12 Commune de Bandja 14 294 370 000 16 13 Commune de Banka 14 409 710 012 17 14 Commune de Banwa 10 155 249 999 19 15 Commune de Kékem 5 152 069 520 20 TOTAL 71 1 647 242 227 Département des Hauts Plateaux 16 Services déconcentrés départementaux 1 10 000 000 21 17 Commune de Baham 11 195 550 000 21 18 Commune de Bamendjou 12 367 102 880 22 19 Commune de Bangou 20 371 710 000 24 20 Commune de Batié 6 146 050 002 26 TOTAL 50 1 090 412 882 Département du Koung Khi 21 Services Déconcentrés 2 122 000 000 27 22 Commune de Bayangam 6 257 710 000 27 23 Commune de Dembeng 5 180 157 780 28 24 Commune de Pete Bandjoun 12 287 365 000 28 TOTAL 25 847 232 780 Département de la Menoua 25