ANNEXE a Anciennes Exploitations De Bauxite De Rougiers, Tourves
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapport Enquête Publique L'eygoutier
Déclaration d’intérêt général du plan d’entretien de 15 cours d’eau et leurs affluents du bassin versant de l’Eygoutier sur le territoire des communes de Carqueiranne, La Crau, La Farlède, La Garde, Le Pradet, Solliès-Ville, Toulon et La Valette-du-Var. Rapport d'enquête RAPPORT D'ENQUETE PUBLIQUE Enquête publique portant sur la déclaration d’intérêt général du plan d’entretien de 15 cours d’eau et leurs affluents du bassin versant de l’Eygoutier sur le territoire des communes de Carqueiranne, La Crau, La Farlède, La Garde, Le Pradet, Solliès-Ville, Toulon et La Valette- du-Var. Déroulement de l'enquête publique : du 3 janvier 2020 au 4 février 2020 inclus Destinataire : DDTM du Var Copie : Tribunal Administratif de Toulon Olivier LUC - Commissaire Enquêteur Page 1 sur 23 Enquête n° : E19000074/83 Déclaration d’intérêt général du plan d’entretien de 15 cours d’eau et leurs affluents du bassin versant de l’Eygoutier sur le territoire des communes de Carqueiranne, La Crau, La Farlède, La Garde, Le Pradet, Solliès-Ville, Toulon et La Valette-du-Var. Rapport d'enquête Je soussigné Olivier LUC, chef d’entreprise, ai été désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulon par décision n° E19000074/83 en date du 9 septembre 2019. Monsieur le Préfet du Var a pris, en date du 5 décembre 2019, l'arrêté n° DDTM/SAGJ/2019/37 prescrivant l’enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la déclaration d’intérêt général du plan d’entretien de 15 cours d’eau et leurs affluents du bassin versant de l’Eygoutier sur le territoire des communes de Carqueiranne, La Crau, La Farlède, La Garde, Le Pradet, Solliès-Ville, Toulon et La Valette-du-Var. -

Redevance Incitative Mes Déchets, Ma Facture Toutes Les Infos En Pages 8 Et 9
FlashLe journal d’informations du SIVED Nouvelle GénérationTri - Printemps 2017 € € € € € € € € Redevance incitative Mes déchets, ma facture Toutes les infos en pages 8 et 9 SIVED NG Poule Position Foyers Z’Héros Déchet Le territoire Recevez un poulailler Le zéro déchet, et si vous s’élargie et adoptez deux poules vous y mettiez ? pages 6 et 7 page 12 page 13 Le SIVED NG vous parle Editorial « Le SIVED NG en ordre de marche » Le 2 mars 2017, après que la Communauté C’est dire l’importance des choix que nous d’Agglomération Provence Verte ait confirmé serons amenés à faire prochainement, ses délégués SIVED Nouvelle Génération, le sachant que ne rien décider aujourd’hui serait Conseil Syndical réuni à Néoules, a procédé à dommageable pour l’avenir. l’élection du Président et des six Vice-Présidents, constituant ainsi son bureau. Imaginez une situation, sans installation de valorisation proche de notre territoire, qui Il aura fallu trois ans, au groupe de travail et nous conduirait à supporter le coût prohibitif à son comité de pilotage, pour constituer appliqué au transport de nos ordures cette structure porteuse, préciser ses objectifs ménagères hors de notre région ... et s’inscrire dans la démarche du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Mais le traitement des déchets n’est qu’une Non Dangereux (P.P.G.D.N.D). Un plan facette de cette compétence, et le SIVED NG Départemental devenu Régional depuis la Loi entend bien poursuivre ses efforts de prévention, Notre. afin de réduire la quantité de déchets à la source. L’éventail des actions est rappelé dans Le SIVED NG est maintenant en ordre de marche ce numéro du Flash-Tri, mais pour réussir et pour mettre en place dans notre secteur poursuivre le développement de la culture du une installation moderne de valorisation tri, là nous avons besoin de vous tous… des ordures ménagères qui réponde aux exigences environnementales d’aujourd’hui C’est probablement pour toutes ces raisons et de demain : c’est le projet TECHNOVAR. -

Lettre N°15 Informations Covid-19 Du 20 Novembre 2020
Lettre info COVID-19 - n°15 - 20 novembre 2020 - Semaine 47 Le mot du Préfet À l’image de la tendance nationale, les indicateurs de suivi épidémiologique observés dans le Var affichent une tendance à la baisse depuis 2 semaines. Pour autant, il convient de rester circonspect pour plusieurs raisons : baisse du dépistage notamment avec un our férié la semaine dernière qui vient s’a outer au "eek$end, déploiement progressif des tests antigéniques qui ne sont pas encore comptabilisés au niveau de leurs résultats... %e plus, la pression hospitalière reste marquée et le nombre de décès très important à l’h&pital, en '(P)% et sans doute en ville. *l convient donc de se montrer très prudent quant au+ perspectives de ces prochains ours et de ces prochaines semaines. ,e s-st!me hospitalier est tou ours e+trêmement sollicité. )u+ patients atteints du coronavirus s’a outent les accidents de la vie et les pathologies qu’il faut continuer à traiter. ,es efforts que chacun fournit dans cette période difficile doivent se poursuivre. /e baissons pas la garde 0 Evence Richard, préfet du Var P"INT PIDÉ!I"L"#I$UE INDICATEURS DE SUIVI PID !I"L"#I$UE P"UR LE VAR AU %5 N"VE!'RE 2020 S39 S40 S/% S4( S43 S45 S41 S44 (%,)+- (0,)+- )&,%0 - %(,%0 - %+,%)- )(,%%- )+,%% - (1,%)-)%,%% (.,)+ )/,%0 %%,%) %0,%) (&,%) )0,%% %&,%% Nom2re de te3t3 12 345 12 246 15 744 13 819 25 946 27 677 (0 %*1 %+ 1./ réali3é3 Nom2re de te3t3 925 926 1126 2246 5132 6612 /+&/ (.&0 po3itif3 Taux de po3itivité 5,90 % 5,30 : 3,70 : 12,00 % 14,70 : 13,20 % %.,60 % %/,)) 6 Taux d7incidence 68 68 176 212 287 614 /1% (&. -

SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE ET DE L' ENREGISTREMENT DE DRAGUIGNAN 2 Ses Coordonnées 43 CHEMIN DE SAINTE BARBE CS 30407 83008 DRAGUIGNAN CEDEX
SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE ET DE L' ENREGISTREMENT DE DRAGUIGNAN 2 Ses coordonnées 43 CHEMIN DE SAINTE BARBE CS 30407 83008 DRAGUIGNAN CEDEX 04 83 08 70 99 [email protected] Ses horaires d'accueil Le ressort territorial de sa compétence LES ADRETS DE L ESTEREL COTIGNAC LE THORONET SAINT ANTONIN DU VAR AIGUINES DRAGUIGNAN LE VAL SAINT JULIEN AMPUS ENTRECASTEAUX LES ARCS SUR ARGENS SAINT MARTIN DE PALLIERES ARTIGNOSC SUR VERDON ESPARRON LES MAYONS SAINT PAUL EN FORET ARTIGUES FAYENCE LES SALLES SUR VERDON SAINT RAPHAEL AUPS FIGANIERES LORGUES SAINT TROPEZ BAGNOLS EN FORET FLASSANS SUR ISSOLE MAZAUGUES SAINT ZACHARIE BARGEME FLAYOSC MEOUNES LES MONTRIEUX SAINTE MAXIME BARGEMON FORCALQUEIRET MOISSAC BELLEVUE SALERNES BARJOLS FOX AMPHOUX MONS SEILLANS BAUDINARD SUR VERDON FREJUS MONTAUROUX SEILLONS SOURCE D ARGENS BAUDUEN GAREOULT MONTFERRAT SILLANS LA CASCADE BESSE SUR ISSOLE GASSIN MONTFORT SUR ARGENS ST MAXIMIN STE BAUME BRAS GINASSERVIS MONTMEYAN STE ANASTASIE SUR ISSOLE BRENON GONFARON NANS LES PINS TANNERON BRIGNOLES GRIMAUD NEOULES TARADEAU BRUE AURIAC LA BASTIDE OLLIERES TAVERNES CABASSE LA CELLE PIGNANS TOURRETTES CALLAS LA CROIX VALMER PLAN D AUPS TOURTOUR CALLIAN LA GARDE FREINET PONTEVES TOURVES CAMPS LA SOURCE LA MARTRE POURCIEUX TRANS EN PROVENCE CARCES LA MOLE POURRIERES TRIGANCE CAVALAIRE SUR MER LA MOTTE PUGET SUR ARGENS VARAGES CHATEAUDOUBLE LA ROQUE ESCLAPON RAMATUELLE VERIGNON CHATEAUVERT LA ROQUEBRUSSANNE RAYOL CANADEL VIDAUBAN CHATEAUVIEUX LA VERDIERE REGUSSE VILLECROZE CLAVIERS LE BOURGUET RIANS -

Mise En Page 1
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE o Adobre Stock - VOUS ATTENDEZ UN ENFANT Préparons ensemble sa venue La Protection Maternelle et Infantile est un service du Conseil départemental du Var Direction de la Communication du Conseil départemental Var : pôle création graphique IC ; imprimerie - 11-2019 Phot PARTOUT, POUR TOUS, LE VAR ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN PARTOUT, POUR TOUS, LE VAR ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN Vous attendez un enfant Pour bénéficier de la présence d’une sage-femme, prenez directement contact avec Nous avons eu connaissance de votre déclaration de grossesse par la Caisse le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) de votre commune de résidence. d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole. Les sages-femmes de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil départemental se tiennent à s LA SEYNE-SUR-MER - SAINT-MANDRIER LA SEYNE-SUR-MER : 04 83 95 49 00 la disposition des futurs parents pour des informations, une écoute, un soutien, un conseil, une consultation… s TOULON TOULON : 04 83 95 23 53 C’est avant la naissance qu’il est important de poser vos questions. s BANDOL - ÉVENOS - LA CADIÈRE - LE BEAUSSET - LE CASTELLET LITTORAL SUD SAINTE-BAUME : Vous pouvez faire appel à elles. OLLIOULES - RIBOUX - SAINT-CYR - SANARY - SIGNES - SIX-FOURS 04 83 95 27 60 s BELGENTIER - BORMES - CARQUEIRANNE - COLLOBRIÈRES - CUERS VAL GAPEAU ILES D’OR : HYÈRES - LA CRAU - LA FARLÈDE - LA GARDE - LA VALETTE - LA LONDE 04 83 95 39 50 LE LAVANDOU - LE PRADET - LE REVEST - PIERREFEU - SOLLIÈS-PONT Où rencontrer une sage-femme ? SOLLIÈS-TOUCAS - SOLLIÈS-VILLE La sage-femme peut vous recevoir lors d’une consultation au service de PMI de votre s BESSE - CABASSE - CARNOULES - FLASSANS - GONFARON - LE CANNET CŒUR DU VAR : 04 83 95 19 35 territoire ou se rendre à votre domicile pour répondre à toutes vos questions. -

PAPI Complet De L'argens Et Des Côtiers De L'estérel
PAPI Complet de l'Argens et des côtiers de l'Estérel Cartographie Syndicat mixte de l'argens| [email protected]| www.syndicatargens.fr| 09.72.45.24.91 PAPI de l'Argens et des côtiers de l'Esterel Programme d'Actions de Prévention des Inondations Carte 2 2016 - 2022 Relief et principaux sous-bassins versants de l'Argens µ Régusse Moissac- Bellevue Montferrat Bargemon La Verdière Ampus Châteaudouble Aups La B La Nartuby r Claviers L es 'E qu a e Varages u Tavernes Tourtour S a Fox-Amphoux La Bresque lé L'Endre e L'Endre Saint-Paul- L'Eau Salée Figanières Callas en-Forêt Villecroze LeR Saint-Martin Sillans-la-Cascade ey Salernes ran et Barjols av Bl Bagnols-en Pontevès Flayosc e La Cassole Draguignan L -Forêt La Florieye Le Reyran L'Argens Source L L Saint-Antonin e a Cotignac La Le Le Blavet C F N La Motte Brue-Auriac -du-Var lo R a a ri é r Entrecasteaux è t G s y a u Seillons-Source e l Trans-en b s y r a -d'Argens o -Provence n Ollières l e Châteauvert Puget-sur d Le Real e La L'Argens Amont Lorgues -Argens La Meyronne GGrande Montfort- Le Muy a Correns Garoronne sur-Argens L'Argens Moyenne n Carcès n Côtiers Taradeau L'Argens Aval e Bras L'A Le Thoronet rg Les Arcs Saint- en s Raphaël Saint-Maximin Roquebrune- -la-Sainte-Baume La Ribeirotte sur-Argens Fréjus Le Val Vins-sur-Caramy Cabasse Le C o u n l l o Le o e r u n Le Cauron u r a Tourves Vidauban Couloubrier b u C r Le Fournel Brignoles i o e e F r Le L Le Caramy Le Cannet- lle Le Luc des-Maures Ai La Celle Le Caramy Flassans L' Nans- Camps- Rougiers -sur-Issole les-Pins -

Secteurs Des Assistantes Sociales Site Du Var
Secteurs des Assistantes sociales Site du Var Les Le Bourguet Chateauvieux Salles Brenon La Martre Trigance Vinon Aiguines La Bastide Baudinard Bargème Bauduen La Roque St Julien Artignosc Comps Esclapon Mons Ginasservis Régusse Vérignon La Verdière Seillans Montmeyan Moissac Rians Aups Montferrat Bargemon Callian Esparron Varages Tavernes Ampus Fayence Fox Amphoux Artigues Tourtour Chateaudouble Claviers Tourettes Montauroux St Sillans Tanneron Martin Barjols SalernesVillecroze Ponteves Figanières Callas St Paul Brue Pourrières Flayosc Auriac Entrecasteaux DRAGUIGNAN Bagnols Les Adrets Seillons Chateauvert Cotignac Ollières St Antonin La Motte Trans Bras Correns Monfort Lorgues Pourcieux St Maximin Carcès Taradeau Le Muy Puget sur Argens St Raphaël Le Val Les Arcs Vins Cabasse Le Thoronet Fréjus Tourves Roquebrune Mme Mylène GEOFFROY Brignoles St Zacharie Vidauban La Celle Agence de Brignoles Nans les Rougiers Le Luc Le Cannet Pins Camps Flassans Ste Maxime Accueil sur Rendez-Vous Mazaugues Tél : 04 94 69 68 84 Plan d’Aups La Roquebrussanne Forcalqueiret Besse Plan de Ste Gonfaron La Garde Mail : [email protected] Garéoult Anastasie la Tour Riboux Carnoules Freinet Signes Rocbaron Les Mayons Néoules Pignans Puget-Ville Grimaud Méounes Cuers St Tropez Mme Marie TIREAU Le Castellet Belgentier Pierrefeu Collobrières Cogolin Gassin La Cadière Le Ramatuelle Agence de Brignoles Beausset Solliès-Toucas La Môle La Croix Accueil sur Rendez-Vous Solliès Solliès Le Revest Pont Valmer Evenos Ville Cavalaire Tél : 04 94 69 68 88 -

D'emploi Offres
OFFRES D’EMPLOI BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS • MANOEUVRE RESEAUX TELECOM, BARJOLS, CDD • PLOMBIER, CARCES, CDD OU CONTRAT D’APPRENTISSAGE • AIDE CARRELEUR, VAR, CDD • SOUDEUR·EUSE, BRIGNOLES, CONTRAT D’APPRENTISSAGE • MAÇON DU BATI ANCIEN, VARAGES, ST MARTIN DE PALIERES, CDD INSERTION • AGENT D'ENTRETIEN DU BATIMENT, BRIGNOLES, CDD INSERTION COMMERCE, VENTE, GRANDE DISTRIBUTION • TELECONSEIL ET TELEVENTE, ROCBARON, CDD • VENDEUR·EUSE EN VINS ET SPIRITUEUX, SAINT MAXIMIN, CDI • EMPLOYÉ·E DE VENTE EN SUPERMARCHÉ, GINASSERVIS, CDD • EMPLOYÉ· E LIBRE SERVICE, VINON, CDD SUPPORT À L’ENTREPRISE • AGENT D’ACCUEIL, BRIGNOLES, CDD • ASSISTANT CLIENTELE, BRIGNOLES, CDD • ASSISTANT·E TECHNIQUE ADMINISTRATIF, BRIGNOLES, CONTRAT D’APPRENTISSAGE • CONSEILLER·E TECHNIQUE TELEPHONIQUE, ROUSSET, CDI Mise à jour 25/02/2021 Pour plus d'informations, adressez-vous à votre conseiller·e 1 OFFRES D’EMPLOI INSTALLATION ET MAINTENANCE • ELECTROTECHNICIEN·NE, TAVERNES, CONTRAT D’APPRENTISSAGE • ELECTROTECHNICIEN·NE OU ELECTROMECANICIEN· NE, BRIGNOLES, CDD SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITÉ • ASSISTANT DE CRECHE, REGUSSE, CDD • ASSISTANT D’EDUCATION EN COLLEGE, SAINT MAXIMIN, CDD • RIPEUR, DEPART DE SILLANS LA CASCADE, CDD • GARDE D’ENFANTS, LE VAL, CDD • AGENT D’ENTRETIEN EN CAMPING, NANS LES PINS, CDD • OPERATEUR·TRICE DE BLANCHISSERIE, ROUSSET, CDD • AGENT D’ENTRETIEN DE LOCAUX, VINON, CDD • AIDE À DOMICILE AIDE MENAGER·E, SAINT MAXIMIN, BRIGNOLES, BARJOLS, CDD • AIDE À DOMICILE, NANS LES PINS, ST ZACHARIE, ROUGIERS, ST MAXIMIN, CDD • AGENT DE VALORISATION -

Palmares Concours Des Soleils 2018
PALMARES CONCOURS DES SOLEILS 2018 MILLESIM RAISON SOCIALE COMMUNE DENOMINATION MENTION GEO COMPL COULEUR CEPAGE CUVE/LOT MARQUE COMMERCIALE E CHÂTEAU CLARETTES ARCS SUR ARGENS (LES) IGP VAR BLANC 2017 CHARDONNAY I12/LOTBQ BLANC DE CHARDONNAY CHÂTEAU CLARETTES ARCS SUR ARGENS (LES) IGP VAR ROUGE 2016 MERLOT I2 MISTRAL NOIR DOMAINE DE CABAUDRAN BEAUSSET (LE) IGP VAR ROUGE 2017 LOT BQ CAVEAU DEI BORMANI BORMES LES MIMOSAS IGP MAURES ROUGE 2017 MERLOT C31 CAVEAU DEI BORMANI BORMES LES MIMOSAS IGP MAURES ROSE 2017 C10 LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE BRIGNOLES IGP VAR BLANC 2017 GV1200 LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE BRIGNOLES IGP MEDITERRANEE BLANC 2017 L18046/1 LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE BRIGNOLES IGP VAR ROSE 2017 L18046/2 DOMAINE DES TROIS FILLES - EARL ARLON CADIERE D'AZUR (LA) IGP MONT-CAUME BLANC 2017 MACABEU LI334817 SCV LA CADIERENNE CADIERE D'AZUR (LA) IGP MONT-CAUME BLANC 2017 C091 SCV LA CADIERENNE CADIERE D'AZUR (LA) IGP MONT-CAUME ROSE 2017 C040 SCV LA CADIERENNE CADIERE D'AZUR (LA) IGP MONT-CAUME ROSE 2017 C152 CHÂTEAU SAINTE-CROIX CARCES IGP VAR BLANC 2017 MUSCAT P-G L01M HAMEAU DES VIGNERONS DE CARCES CARCES IGP VAR BLANC 2017 ROLLE C323 BASTIDE DE LA CISELETTE CASTELLET (LE) IGP VAR ROUGE 2017 L3382217 LES VIGNERONS DE CORRENS CORRENS IGP VAR ARGENS BLANC 2017 31 PESQUE LUNE LES VIGNERONS DE CORRENS CORRENS IGP MEDITERRANEE ROSE 2017 L01189/L0218 CELLIER DE LA CRAU CRAU (LA) IGP VAR BLANC 2017 110/102 DOMAINE DU DRAGON DRAGUIGNAN IGP VAR ARGENS ROUGE 2016 MERLOT C24 DOMAINE DU DRAGON DRAGUIGNAN IGP VAR ARGENS -

TOURVES – CHEMIN DE FER MINIER DE MAZAUGUES IRSP N°83140.1 Inventaire Des Réseaux Spéciaux Et Particuliers
TOURVES – CHEMIN DE FER MINIER DE MAZAUGUES IRSP n°83140.1 Inventaire des Réseaux Spéciaux et Particuliers Chemin de fer des mines de bauxite de Tourves et de Mazaugues Réseaux des mines de bauxite des concessions de Tourves et de Mazaugues MC Code INSEE – Commune(s) 83076 – Mazaugues 83140 – Tourves Fiche IRSP de présentation générale Var du bassin de Brignoles : 83000.0 N°RSU N° officiel Intitulé Ouverture Fermeture 13040.01N 947 000 FUVEAU > TOURVES 1880 1939(V) 83140.01N 947 000 TOURVES > CARNOULES 1880 1939(V) 83140.02M / Tourves-gare > PN 26 RD 1 1909 1925 83140.03M PN 26 RD 1 > Dépôt Piéredon 1909 1925 83140.04M PN 26 RD 1 > MAZAUGUES - Baume St-Michel Mine 1909 1925 MAZAUGUES - Caire de Pourian Puits 2 > MAZAUGUES - 83076.01M / Pourian Stockage Transbordeur 1930 ≤ 1950 MAZAUGUES - Caire de Pourian Puits 1 > MAZAUGUES - 83076.02M Pourian Stockage Transbordeur 1930 ≤ 1950 MAZAUGUES - Les Fouilles Mine > MAZAUGUES - La Caire de 83076.03M / Sarrazin Transbordeur 1904 Vers 1950 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025 La Revue de Paris – Tome II -1918 – pages 845 à 859 Gallica Annales de la Société d’histoire naturelle de Toulon – 1910-1945 Gallica Le Ciment – Mars 1930 Gallica Annales des sciences géologiques Gallica Musée des Gueules Rouges Les mines de bauxite de France Les mines de Bauxite La gare de Tourves Le génie Civil n°2575 du 19/12/1931 Gallica La bauxite à Tourves [email protected] ATTENTION : le fonctionnement des liens vers les sites mentionnés ne sont pas garantis. Symbole « » : Crtl+clic pour accéder au site. -
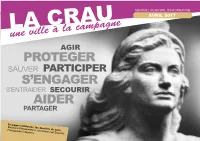
Proteger S'engager Aider
MENSUEL MUNICIPAL D’INFORMATION AVRIL 2017 LAune ville CRAU à la campagne AGIR PROTEGER SAUVER PARTICIPER S’ENGAGER S’ENTRAIDER SECOURIR AIDER PARTAGER En pages intérieures, les dossiers du mois : Elections Présidentielles, les Gestes qui Sauvent, Participation Citoyenne. SOMMAIRE INFOS LOCALES TRAVAUX Page 4 Page 14 DEVELOPPEMENT SÉCURITÉ ECONOMIQUE Page 15 Pages 5-7 ELECTIONS INFOS DU JIS Pages 8-9 Page 16 VIE ASSOCIATIVE RETOUR EN IMAGES Page 10 Page 17 EDUCATION AGENDA DU MOIS Page 11 Pages 20-21 DOSSIER LA CRAU AUTREFOIS Les Gestes qui sauvent Page 23 Pages 12-13 2 EDITO J’ai souhaité que la com- tion de 286 logements sociaux. L’argent des contribuables ne peut mune dénonce, devant le pas être destiné à ce seul axe politique. Il doit aussi permettre de tribunal, l’instruction dite continuer à financer nos stades, nos écoles, nos centres de loisirs, notre sécurité ou nos voiries dans les quartiers. « Valls », qui renforce les obligations faites aux Les différentes lois en vigueur en matière d’habitat social, votées communes en matière sous les gouvernements Jospin et Valls, fixent par ailleurs le nombre de construction de lo- hallucinant de mille cinq cents logements sociaux sur La Crau à l’hori- gements sociaux. Le zon 2025. Sans compter les nombreuses procédures juridiques dont Conseil d’Etat nous a don- font l’objet les projets, quand bien même la commune déciderait de réaliser 100% de logements sociaux, compte tenu d’une moyenne né raison ! de cent permis de construire délivrés par an, ce chiffre serait de toute Pour imposer en force aux communes façon intenable. -

C. Feminine & Feminisation
COMMISSION FEMININE & FEMINISATION La Commission se réunit tous les Jeudis De 14h30 à 16 heures 30 N° direct : 04.94.08.97.72 Réunion du Jeudi 04 Mai 2017 P.V. n° 33343444 Présidente : Mme Cathy DARDON Secrétaire : Mme Vanessa STEHLY-VURTH Présent : Mme Aline VERLAQUE – MM Frédéric BAUMANN - Raymond CAZEAUX INFORMATION En application des articles 188 des R.G. et 80 des R.S. du District du Var, les décisions de la C. Féminine peuvent être frappées d’appel en 2 ème instance auprès de la C. d’Appel Règlementaire du District du Var, dans le délai de DIX jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée (par exemple, une décision notifiée le 15 du mois ne peut être contestée que par l’envoi d’un appel, au plus tard le 25 du mois). Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant le jour de la notification est, selon la méthode utilisée : - soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée, - soit le jour de la transmission de la décision par fax ou par courrier électronique (avec accusé de réception), - soit le jour de la publication de la décision sur internet, Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte. L’appel est adressé à la Commission d’Appel par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique obligatoirement avec en-tête du club, ou par email émanant de l’adresse officielle délivrée par la Ligue de la Méditerranée.