Volume ! La Revue Des Musiques Populaires
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

(Pdf) Download
Artist Song 2 Unlimited Maximum Overdrive 2 Unlimited Twilight Zone 2Pac All Eyez On Me 3 Doors Down When I'm Gone 3 Doors Down Away From The Sun 3 Doors Down Let Me Go 3 Doors Down Behind Those Eyes 3 Doors Down Here By Me 3 Doors Down Live For Today 3 Doors Down Citizen Soldier 3 Doors Down Train 3 Doors Down Let Me Be Myself 3 Doors Down Here Without You 3 Doors Down Be Like That 3 Doors Down The Road I'm On 3 Doors Down It's Not My Time (I Won't Go) 3 Doors Down Featuring Bob Seger Landing In London 38 Special If I'd Been The One 4him The Basics Of Life 98 Degrees Because Of You 98 Degrees This Gift 98 Degrees I Do (Cherish You) 98 Degrees Feat. Stevie Wonder True To Your Heart A Flock Of Seagulls The More You Live The More You Love A Flock Of Seagulls Wishing (If I Had A Photograph Of You) A Flock Of Seagulls I Ran (So Far Away) A Great Big World Say Something A Great Big World ft Chritina Aguilara Say Something A Great Big World ftg. Christina Aguilera Say Something A Taste Of Honey Boogie Oogie Oogie A.R. Rahman And The Pussycat Dolls Jai Ho Aaliyah Age Ain't Nothing But A Number Aaliyah I Can Be Aaliyah I Refuse Aaliyah Never No More Aaliyah Read Between The Lines Aaliyah What If Aaron Carter Oh Aaron Aaron Carter Aaron's Party (Come And Get It) Aaron Carter How I Beat Shaq Aaron Lines Love Changes Everything Aaron Neville Don't Take Away My Heaven Aaron Neville Everybody Plays The Fool Aaron Tippin Her Aaron Watson Outta Style ABC All Of My Heart ABC Poison Arrow Ad Libs The Boy From New York City Afroman Because I Got High Air -

Popular Music Studies in Italian Universities —A Petition—
Popular Music Studies in Italian Universities: a petition — signatories 1 Popular Music Studies in Italian Universities —a Petition— Final list: 573 signatories from 47 nations (2015‐06‐14, 15:37 hrs BST) Signatory numbers by nation state Argentina 12 Australia 23 Austria 5Belgium 2Brazil 56 Bulgaria 2 Canada 34 Chile 8 China 1 Colombia 7Croatia 1Cuba 2 Cyprus 1Denmark 6Estonia 5Finland 21 France 16 Germany 18 Greece 3Iceland 1Ireland 10 Israel 4Italy 77 Jamaica 1 Japan 1 Lithuania 1Mexico 3 Mozambique 1Netherlands 9New Zealand 4 Norway 7Peru 1 Poland 1Portugal 6Singapore 1Slovenia 2 South Africa 8South Korea 1Spain 33 Sweden 5Switzerland 2South Africa 8 Turkey 3Uganda 1UK 108 Uruguay 5USA 43 THE FOLLOWING IS A LIST OF SIGNATORIES IN ALPHABETICAL ORDER OF FAMILY NAME. •There is a basic list of signatories in alphabetical order of nation state at http://tagg.org/html/Petition1405/PetitionResidence.htm •The ACTUAL PETITION can be viewed in English, Italian or Spanish by visiting http://tagg.org/html/Petition1405.html. List of 573 signatories to the petition A 1. Silvia Irene ABALLAY — Profesor Titular, Universida Nacional de Villa María (Argentina) 2. Lauren ACTON — Course Director, Centennial College/York University, Toronto (Canada) 3. Roberto, AGOSTINI — Professore a contratto, Conservatori di Cesena e di Sassari, Bologna (Italy) 4. Coriún AHARONIÁN — Composer and former professor, Escuela Universitaria de Música, Universidad de la República; Director, Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán; Emeritus researcher, National System of Researchers (Uruguay) 5. Michael AHLERS — Professor for music education and popular music, Leuphana University of Lüneburg (Germany) 6. Kaj AHLSVED — PhD Candidate in Musicology, Åbo Akademi University, Turku (Finland) 7. -

Contents Acknowledgements
Contents Acknowledgements 1 Welcome 2 Conference Schedule 3 Abstracts 15 Posters 79 About the RMA 80 Exhibitors & Advertisers 83 Milton Court Floor Outline 87 Conference Timetable 88 Acknowledgements Guildhall School of Music and Drama Cormac Newark (Conference Director) Aoife Shanley (Conference Manager) Sophie Timms (Conference Assistant) Research & Enterprise Team Performance Venues, Audio Visual, and Facilities Teams 1 Programme committee Suzanne Aspden (University of Oxford) Warwick Edwards (RMA / University of Glasgow) Katy Hamilton (RMA) Freya Jarman (University of Liverpool), representing RMA Annual Conference 2017 Cormac Newark (Guildhall School of Music & Drama), chair Royal Musical Association Conference programme abstracts edited by Suzanne Aspden and Freya Jarman The Royal Musical Association wishes to thank all the above, along with Routledge Taylor & Francis Group and the Musica Britannica Trust for sponsorship of the conference receptions Welcome Dear Colleagues Welcome to the 52nd Annual Conference of the Royal Musical Association, meeting at the Guildhall School of Music and Drama in London. Here we have assembled a programme of around 130 speakers from across the globe. The programme includes panel discussions by internationally renowned academics, and individual papers on topics ranging from the Cantigas de Santa Maria to Boulez. The conference also includes the Edward J. Dent medal presentation and Lecture by Marina Frolova- Walker, and in a departure from tradition the Peter Le Huray Lecture takes the form of a panel involving four leading practitioners and commentators in the field of opera production and reception. In addition to the Annual General Meeting of the Association, there are receptions sponsored by Routledge and by the Musica Britannica Trust, and the usual exhibition of books and other materials. -

“A Jamaica É Aqui”: Arranjos Audiovisuais De Territórios Musicados
2 “A Jamaica é aqui”: arranjos audiovisuais de territórios musicados Aluno: Leonardo Alvares Vidigal Tese apresentada para o Programa de Pós- Graduação em Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor em Comunicação Social. Área de Concentração: Comunicação e Sociabilidade Contemporânea Linha de pesquisa: Meios e Produtos da Comunicação Orientadora: Professora Doutora Maria Regina de Paula Mota Belo Horizonte 2008 3 FICHA CATALOGRÁFICA Vidigal, Leonardo Alvares. “A Jamaica é aqui”: arranjos audiovisuais de territórios musicados. / Leonardo Alvares Vidigal. – Belo Horizonte, MG: [s.n.], 2008. Orientadora: Mota, Maria Regina de Paula . Tese (doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 1. Comunicação social. 2. Documentário. 3. Música Popular. 4. Estudos Caribenhos. 5. Reggae I. Mota, Maria Regina de Paula. II. Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. III.Título. 4 Dedicada à memória de: João Fortunato Vidigal Geraldo Carvalho Perry Henzell 5 Agradecimentos Gostaria de agradecer, principalmente: À minha orientadora, Professora Regina Mota, pela forma sempre direta e perspicaz com que fez as suas leituras do texto e apresentou diversas soluções, pela confiança em um trabalho algumas vezes tortuoso, por ter me guiado pelas dificuldades variadas que surgiram no caminho, além da elucidativa e reveladora disciplina, por ela ministrada, a respeito do cinema documental e as teorias mais representativas acerca dessa modalidade de produto audiovisual. A todos que contribuíram para a coleta dos filmes: professor Antônio Moreno (Universidade Federal Fluminense), Marcia Coeli, Éder Santos, Peter Gittins (Reggae Film Festival), David Katz e funcionários da Film-Images, pela generosidade e indicações preciosas que me levaram a exemplares importantes para a trajetória desta pesquisa. -

Download the Annual Review 2013–14
THE BIGGEST MUSEUM ALLIANCE SCIENCE IN / The Science Museum helped The universe cannot wish The National Railway fuel my fascination with for a more perceptive eye Museum’s celebration of physics. So it is wonderful to see that than the Science Museum Mallard’s world speed record was more young people than ever are ROBBERT DIJKGRAAF a triumph, attracting an astonishing DIRECTOR AND LEON LEVY PROFESSOR AT THE INSTITUTE FOR getting the opportunity to feel that ADVANCED STUDY IN PRINCETON 364,000 visits same inspiration LORD FAULKNER OF WORCESTER SMG TRUSTEE PROFESSOR STEPHEN HAWKING AT THE LAUNCH OF THE COLLIDER EXHIBITION The Museum of Science & Our Bradford collections Industry is a fantastic asset hold many treasures by and will help keep the northwest’s media pioneers from the dawn of spirit of curiosity and innovation alive photography. These collections © 2014 The Board of Trustees of the Science Museum PROFESSOR BRIAN COX will drive the radical shift in UNIVERSITY OF MANCHESTER perceptions that is required to Edited by David Johnson with generous input from staff at SMG attract more visitors into the and its many bloggers National Media Museum LORD GRADE SMG TRUSTEE AND CHAIR, NATIONAL MEDIA MUSEUM Designed by the Science Museum Design Studio ADVISORY BOARD Project manager, Sian Worsfold SNAPSHOTS OF HUMAN INGENUITY OUR FIVE WORLD-BEATING MUSEUMS Picture researchers, Nick Hedley, Richard Nicholls Copy editor, Lawrence Ahlemeyer Science Museum, London Astronauts floating weightlessly Museum of Science & Industry, Manchester in space loved spinning around National Railway Museum, York Main photography from Group resources: like tops within the tiny Apollo Museum of Science & Industry 10 command module. -

Contemporary African
Hassan Hajjaj Morocco’s “Andy Wahloo” What to collect at the fair: Our selection of 15 artists 1-54 London A Limitless Retelling of History Diptyk n°42. février-mars 2018 >> 1 SPECIAL ISSUE: 1-54 LONDON Are you looking to optimise business travel for your company and make it easy for your staff to travel in comfort and peace of mind ? Royal Air Maroc will make your business travel smooth and enjoyable. Connectivity : Modern fleet of 56 aircraft with an average age of 8 years that cover 97 destinations in 4 continents. Network from UK: - a daily direct flight from both Heathrow and Gatwick to Casablanca - 3 weekly direct flights from Manchester to Casablanca - twice weekly direct flights from Heathrow to Rabat Cost Effectiveness: Outstanding fares Bespoke service regardless of the size of the business Frequent Flyer Corporate program Renown Expertise : Awarded the 4-star rating from Skytrax Voted Best Regional Airline to Africa for 3 years running 2015, 2016, 2017. London office : +44 (0)20 7307 5820│Call center : 020 7307 5800│royalairmaroc.com diptyk Rue Mozart, Résidence Yasmine, quartier Racine, Casablanca 20000, Morocco +212 5 22 95 19 08/15 50 [email protected] www.diptykblog.com © Jean-François Robert Director and Editor-in-chief Meryem Sebti editor’s note Artistic Director and Graphic Designer Sophie Goldryng A partner of the 1-54 Contemporary African Art Fair Project Manager and Copy Editor since its first London edition in 2013, Diptyk is now proud Marie Moignard to present its very first issue in English. As an African publication alive to the present day realities of Moroccan Administrative Manager and life, our bimonthly magazine has been documenting the Commercial Back-Office contemporary art scene on the continent since 2009. -

M************************************************W*************** Reproductions Supplied by EDRS Are the Best That Can Be Made from the Original Document
DOCUMENT RESUME ED 344 578 IR 015 527 AUTHOR Prinsloo, Jeanne, Ed.; Criticos, Costes, Ed. TITLE Media Matters in South Africa. Selected Papers Presented at the Conference on Developing Media Education in the 1990s (Durban, South Africa, September 11-13, 1990). INSTITUTION Natal Univ., Durban (South Africa). Media Resource Centre. REPORT NO ISBN-0-86980-802-8 PUB DATE 91 NOTE 296p. PUB TYPE Collected Works - Conference Proceedings (021) EDRS PRICE MF01/PC12 Plus Postage. DESCRIPTORS Educational Television; Elementary Secondary Education; Film Study; Foreign Countries; Higher Education; Instructional Films; *Instructional Materials; Mass Media Role; Media Research; *Media Selection; Teacher Education; Visual Literacy IDENTIFIERS *Media Education; *South Africa ABSTRACT This report contains a selection of contributed papers and presentations from a conference attended by 270 educators and media workers committed to formulate a vision for media education in South Africa. Pointing out that media education has been variously described in South Africa as visual literacy, mass media studies, teleliteracy, and film studies, or as dealing with educational technology or educational media, the introduction cites a definition of media education as an exploration of contemporary culture alongside more traditional literary texts. It is noted that this definition raises issues for education as a whole, for traditional language study, for media, for communication, and for u0erstanding the world. The 37 selected papers in this collection are presented in seven categories: (1) Why Media Education? (keynote paper by Bob Ferguson); (2) Matters Educational (10 papers on media education and visual literacy); (3) Working Out How Media Works (4 papers on film studies, film technology, and theory); (4) Creating New Possibilities for Media Awareness (9 papers on film and television and 4 on print media);(5) Training and Empowering (2 papers focusing on teachers and 4 focusing on training producers); (6) Media Developing Media Awareness (2 papers); and (7) Afterthoughts (I paper). -

Cheltenham Symphony’
richard witts Shopping and Fricker: the origins of the Cheltenham Festival of Modern British Music and the ‘Cheltenham Symphony’ The author is grateful to t remains a remarkable fact that during World War 2 a civic the late Mrs Ann Wilkinson and the late Mrs Eleanor enter tain ments manager in the Cotswolds planned a festival of modern Budge, whose husbands Imusic. The Tory council supported his idea. He staged it merely five were involved with the weeks after the war’s end, and it continued yearly and continues still. Festival’s creation; Steven Blake, curator of the Cheltenham’s summer festival of music occasionally tweaked its name to Cheltenham Museum; Sue meet the evolving demands of marketing, as Table 1 shows, while the share Robbins, archivist of the Gloucestershire Echo; Sue of new music in it steadily dwindled. Yet it has remained a presence on the Liptrot of the Cheltenham festival calendar and in certain contemporary music circles for 70 years. Reference Library; Meurig I argue here that the festival’s precepts are tied to the political and Bowen of Cheltenham Music Festival; Lewis Foreman, economic strategies of Cheltenham town itself. Even so, the origins of the Simon Frith and, above all, festival in wartime England deserve wider examination for three reasons. Jeremy Tyndall, formerly Head of Cheltenham Firstly, Britain’s integrative national arts policy is based on a 1940s formula Festivals. in which Cheltenham became the first peacetime example of that system in action for new music. Secondly, Cheltenham initiated the postwar arts festival movement. According to the British Arts Festivals Association there are around 140 such festivals in force, and 2,000 in general across the United Kingdom. -
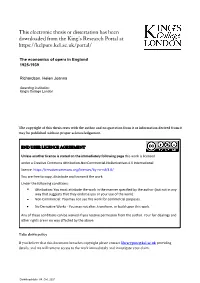
2019 Richardson Helen 09664
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ The economics of opera in England 1925-1939 Richardson, Helen Joanna Awarding institution: King's College London The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 04. Oct. 2021 The Economics of Opera in England: 1925-1939 Helen Richardson King’s College London August 2019 A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Music. -

Christidispetros2017.Pdf
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Πτυχιακή Εργασία Dub Μουσική: η ιδέα, η σημασία και η εξέλιξή της έτ ος ηστίδης ΑΜ 1074 Επιβλέποντες Καθηγητές: Κώστας Παπαρρηγόπουλος Δημήτρης Ξενικάκης Ρέθυμνο 2017 2 3 ε ιεχόμενα Περιεχόμενα ...................................................................................................................... 3 Ευχαριστίες ....................................................................................................................... 5 Περίληψη .......................................................................................................................... 7 Abstract ............................................................................................................................. 7 Κεφάλαιο 1 ....................................................................................................................... 9 1.1 Ιστορική Εισαγωγή ................................................................................................. 9 1.1.2 Rastafari ......................................................................................................... 10 1.2 Μουσική ................................................................................................................ 12 1.2.1 mento ............................................................................................................. 12 1.2.2 R'n'B .............................................................................................................. -

Musical Jamaicana Al Regne Unit
BLACK CULTURE, WHITE YOUTH: LA TRADICIÓ CULTURAL JAMAICANA AL REGNE UNIT (DES DE 1948 FINS A FINALS DELS ANYS SETANTA) TREBALL DE FINAL DE GRAU Lluís Bienes Pelaó (NIA: 101096) Tutor: Antoni Luna García Universitat Pompeu Fabra - Facultat d’Humanitats Curs 2012-2013 2 “Every time that you are being racist to someone, you put something against yourself as well, every time you do it”. Gladdy Wax Black is a colour just like white Tell me how can a colour determine whether You're wrong or right We all have our faults yes we do So look in your mirror (Look in the mirror) What do you see? (What do you see?) Two eyes, a nose and a mouth just like me. The Heptones - Message From A Black Man 3 ÍNDEX AGRAÏMENTS .............................................................................................................. 6 INTRODUCCIÓ ............................................................................................................ 7 Proposta de recerca .............................................................................................. 7 Metodologia ......................................................................................................... 8 Esquema ............................................................................................................... 9 1. ANTECEDENTS HISTÒRICS DE JAMAICA .................................................... 10 2. BRIXTON FIGHT: Relacions ètniques al Regne Unit en el sí de la comunitat jamaicana .................................................................................................................... -

Black Voices, German Rebels: Acts of Masculinity in Postwar Popular Culture
Black Voices, German Rebels: Acts of Masculinity in Postwar Popular Culture By Priscilla Dionne Layne A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in German and the Designated Emphasis in Film Studies in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Deniz Göktürk, Chair Professor Anton Kaes Professor Jocelyne Guilbault Spring 2011 Abstract Black Voices, German Rebels: Acts of Masculinity in Postwar Popular Culture by Priscilla Dionne Layne Doctor of Philosophy in German and the Designated Emphasis in Film Studies University of California, Berkeley Professor Deniz Göktürk, Chair This dissertation examines practices of embodying Black popular culture in Germany. My analysis is based on close readings of texts from a variety of media including novels, films and musical theater from West and East Germany of the 1950s to the reunified Germany of the 1990s. Black popular culture, particularly popular music, has appealed to Germans since the 19th century, when the Fisk Jubilee singers toured Europe. In most of my analyses, music plays a prominent role as a gateway to Black popular culture. Stuart Hall defines Black popular culture as a product of the African Diaspora, therefore it is produced in a space populated by people who are linked to many different geographic locales. Nevertheless, in the texts I examine, the African American contribution to this culture is given precedent. This preference for African American culture is based on an articulation of factors, including the large presence of African American GIs in occupied postwar Germany and German stereotypes that designate African Americans as both primitive and modern, oppressed victims yet also producers of incredibly different, liberating styles.