Projet Educatif Territorial
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

VU Le Code Général Des Collectivités Territoriales Et Notamment Les Articles L5211-1 Et Suivants Et L5214-1 Et Suivants;
Liberté • Égalité • Ft•attrnité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE Préfecture Direction de l'action focale Bureau du contrôle de légalité, de l'intercommunalité et du conseil aux collectivités LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE LE PRÉFET DE LA MOSELLE Officier de la légion d'honneur Officier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur Officier dans l'Ordre National du Mérite VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-1 et suivants et L5214-1 et suivants; VU la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, notamment son article 35 Ill ; VU le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2003 autorisant la création de la communauté de communes du Val de Moselle ; VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2010 autorisant la création de la communauté de communes du Chardon Lorrain ; VU l'arrêté préfectoral du 22 avril 2013 complété par l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2013 autorisant, à compter du 1er janvier 2014, la création d'une communauté de communes issue de la fusion de la communauté de communes du Toulois et de la communauté de communes des côtes en Haye sans la commune de Martincourt qui porte le nom de« Communauté de communes du Toulois » ; VU l'arrêté préfectoral du 14 juin 2016 fixant le projet de périmètre de la communauté de communes issue de la fusion de la communauté de communes du Chardon lorrain et de la communauté de communes du Val de Moselle (57) intégrant la commune d'Hamonville issue de la communauté de communes du Toulois. -

Pelouses Et Vallons Forestiers De La Vallee Du Rupt De Mad Fr4100161
PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE PELOUSES ET VALLONS FORESTIERS DE LA VALLEE DU RUPT DE MAD FR4100161 Document d’objectifs 1. SYNTHESE Juin 2001 PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE Site Natura 2000 « Pelouses et vallons forestiers de la vallée du Rupt de Mad » Documents d’objectifs 1. SYNTHESE Synthèse et rédaction Stéphanie HARRAULT Jérôme DAO Juin 2001 SOMMAIRE INTRODUCTION 3 A CARACTERISTIQUES DU SITE 4 A.1 Le périmètre « Pelouses et Vallons Forestiers de la vallée du Rupt de Mad » en quelques mots 4 A.2 Caractéristiques physiques 6 A.2.1 Topographie et hydrographie 6 A.2.2 Géologie et pédologie 6 A.2.3 Climat 7 A.3 Contexte socio-économique 7 A.3.1 Population 8 A.3.2 Utilisation du sol 8 A.3.3 Principales activités humaines 9 A.3.4 Cadre de vie 14 A.4 Considérations relatives à la biodiversité sur le site 16 A.4.1 Quelques constats d’évolution et leurs facteurs explicatifs 16 A.4.2 Actions de conservation déjà engagées sur le site 17 A.4.3 La vallée du Rupt de Mad, un corridor pour la faune et la flore 18 B HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 20 B.1 Inventaires et cartographie 20 B.1.1 Méthodologie suivie 20 B.1.2 Habitats naturels inscrits à l’annexe I de la Directive recensés sur le site 21 B.1.3 Espèces inscrites aux annexes II et IV de la Directive recensées sur le site 25 B.1.4 Inventaires complémentaires nécessaires 27 B.2 Analyse écologique 28 B.2.1 Exigences écologiques 28 B.2.2 Facteurs naturels ou humains qui modifient ou maintiennent leur état de conservation 28 B.2.3 Etat de conservation initial des habitats -

Routes Départementales De Meurthe-Et-Moselle : 110 Kilomètres Rénovés Entre Le 29 Avril Et 15 Juillet
INVITATION PRESSE Nancy, le mardi 16 avril 2019 Routes départementales de Meurthe-et-Moselle : 110 kilomètres rénovés entre le 29 avril et 15 juillet Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle informe qu’à partir du 29 avril 2019, il lance une vaste campagne de réfection des routes départementales. Au total, 110 kilomètres de routes seront concernés sur le territoire de 45 communes. La technique dite de mise en œuvre d’enduits superficiels d’usure, permet de réduire les coûts, d’améliorer la sécurité des usagers et de participer de la transition écologique. 2,76 M€ sont consacrés à ce programme. La mise en œuvre d’enduits superficiels d’usure est une technique d’entretien préventif qui permet d’assurer une bonne étanchéité de la chaussée et une fermeture des premières fissures constatées, la protégeant ainsi de l’eau, son ennemi n°1. L’enduit permet également de redonner une bonne adhérence à la chaussée, tout en pérennisant son état structurel, par protection de la couche de surface. Le Département informe les usagers que cette technique présente de légers inconvénients en début de réalisation (nuisances sonores, rejets de gravillons, etc.). Ils sont bien sûr amenés à disparaître rapidement après ouverture à la circulation reprise du trafic routier. Il est rappelé l’importance de respecter les consignes de sécurité et de prudence (limitation de vitesse notamment) mises en place durant les chantiers. À noter que certaines routes du réseau local seront donc interdites le temps de la réalisation sur un délai très court. Les usagers sont invités à prendre leur disposition le cas échéant. -

Famille De Produits Exploitation NOM MILLARD Rucher Des Six Reines
Famille de produits Exploitation NOM MILLARD Rucher des Six Reines Luc et Françoise BARTHELEMY Miel Professionnels Michel PERRIN Robert GENEVAUX Le rucher de Gorze DEGLI ESPOSI Le moulin à miel LEMAIRE Etablissement LAMBINET LAMBINET La Ferme des Crêtes BERCHE Volailles BELLO et Oeufs Ferme de Belleville La Ferme du Grand Pré TRIVEILLOT PIERON Chèvrerie Les Tournesols Produits laitiers et fromage GIROUX La chèvrerie de Lorry EARL du Vieux Poirier WAHU Les pains vagabonds MOREAU Farines et Huiles Farines Micro entreprise - Pas de nom commercialMOYEN et Huiles EARL La Gloriette NAUT EARL Jadinot HOUIN GORSKI Domaines des Coteaux de Dornot BERT La tomate rouge et noire MALMANCHE VOIR LISTING CMA 54 LANG Les Jardins d'Arnaville LEFEBVRE La cave aux pommes AUBRIOT Les Jardins Ecotones OLRY MOMBELLI Fruits SCEA de Mandrise et ou MILLARD Légumes SCEA des Mirabellières FERVILLE EARL de l'Hatto BRIER Domaine de la Grange en Haye EARL La grange aux fruits d'or Fruits et Légumes Prunelles MANSARD SCHIVRE Elevage Michel Besançon BESANCON PHILIPPE La Porcinière NICOLAS-BOSCH Viandes Ferme de la Souleuvre NOEL EARL de Tantelainville CHONE EARL du Cytise EARL de Champagne RAUX Brasserie de l'Epitaphe MARCHAL Brasserie l'Abeille Noire LORRAIN Alcools Domaine les Béliers MAURICE Domaine Buzea BUZEA Alcools Domaine des Coteaux de Dornot BERT Domaine Oury-Schreiber OURY Association « La Côte des Caures» BATTAGLIA Domaine de la Joyeuse STAPUREWICZ L'herbe folle GALANO GOETGHEBER AMAP PERRIN Le Charpagne LUDWIG Graine d'Ortie ROLIN EARL du Pré Labarre SENERS -

Meurthe Et Moselle Meuse
Genre NomPrénom Titre Maires Adresse CP Ville MEURTHE ET MOSELLE Monsieur TARDY Yvan Maire de ANDILLY Mairie-Place de l'Eglise 54200 ANDILLY Monsieur COLLET Thierry Maire de ANSAUVILLE Mairie-2 rue de l'Eglise 54470 ANSAUVILLE Monsieur CAILLOUX René Maire de ARNAVILLE Mairie-98 Grande Rue 54530 ARNAVILLE Madame ROCH Marie-Line Maire de BAYONVILLE SUR MAD Mairie-1 rue de Biard 54890 BAYONVILLE SUR MAD Monsieur CIOLLI Christophe Maire de BEAUMONT Mairie-8 Grande rue 54470 BEAUMONT Monsieur LAURENT Serge Maire de BELLEVILLE Mairie-Rue de la Mairie 54940 BELLEVILLE Monsieur BUVET Daniel Maire de BERNECOURT Mairie-12 Grande Rue 54470 BERNECOURT Monsieur LIOUVILLE Gérald Maire de BOUCQ Mairie-1 place du Souvenir 54200 BOUCQ Monsieur RENOUARD Gérard Maire de BOUILLONVILLE Mairie-9 rue Sur l'Eau 54470 BOUILLONVILLE Monsieur MANET Claude Maire de BRULEY Mairie- 36 rue Victor Hugo 54200 BRULEY Monsieur MANGIN Michel Maire de BRUVILLE Mairie-1Bis rue de l'Ecole 54800 BRUVILLE Madame ROSELEUR Lise Maire de CHAMBLEY BUSSIERES Mairie-12 rue de l'Eglise 54890 CHAMBLEY BUSSIERES Monsieur LARA Lionel Maire de CHAREY Mairie-10 rue Edmond Henry 54470 CHAREY Monsieur ARGAST Michel Maire de DAMPVITOUX 19 rue de la Mairie 54470 DAMPVITOUX Monsieur POIRSON Henri Maire de DIEULOUARD Mairie-8 rue Saint Laurent-BP 13 54380 DIEULOUARD Monsieur SEGAULT Jean-François Maire de DOMEVRE-EN-HAYE Mairie-2 place de l'Eglise 54385 DOMEVRE EN HAYE Monsieur PETIT Denis Maire de DOMMARTIN LA CHAUSSEE Mairie-3 rue de l'Eglise 54470 DOMMARTIN LA CHAUSSEE Monsieur SILLAIRE Roger -

Mise En Page 1
40 communes classées en ZRR Arnaville Bayonville/Mad Beaumont Bernécourt Bouillonville Chambley-Bussières Charey Dampvitoux Dommartin-la-Chaussée 40 communes Essey-et-Maizerais classées en ZRR Euvezin jusqu'au 30 juin 2020 Fey-en-Haye Flirey Hageville Hamonville Hannonville-Suzemont Jaulny Limey Lironville Mamey Mandres aux 4 Tours Mars la Tour Onville Pannes Preny Puxieux DES AVANTAGES FISCAUX Rembercourt/Mad Saint Baussant Saint Julien les Gorze ET SOCIAUX POUR LES ENTREPRISES Seicheprey Sponville Thiaucourt nExonération d’impôts sur les bénéfices Tronville Vaudelainville nExonération de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) Vieville-en-Haye Exonération de charges patronales Vilcey sur Trey n Villecey sur Mad Waville Xammes Xonville taller enez vous ins Profitez-en, v us ! Communauté de Communes Mad & Moselle chez no 2 bis rue Henri Poulet - 54470 THIAUCOURT - 03 83 81 91 69 [email protected] - www.cc-madetmoselle.fr L'EXONéRATION D’ImPôT SUR LES béNéFICES L'EXONéRATION DE ChARGES PATRONALES Les entreprises éligibles bénéficieront d’une exonération totale pendant 5 ans puis En cas d’embauche, les entreprises de moins de 50 salariés (tous établissements confondus), partielle pendant 3 ans. Un plafond est fixé à 200 000 € sur 3 exercices. implantées sur les communes classées en ZRR de la Communauté de Communes mad & moselle, peuvent bénéficier, pour leurs nouveaux recrutements , d’une exonération Conditions de cotisations patronales de sécurité sociale pendant 12 mois. n Le siège social et toutes les activités de l’entreprise doivent être implantés sur l’une des 40 communes meurthe-et-mosellanes du territoire classées ZRR. Eligibilités n Entreprise créée ou reprise avant le 30 juin 2020 et exerçant une activité industrielle, commerciale, Toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, tout groupement d’employeurs (chaque membre artisanale ou non commerciale soumise à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. -

Liste Des Sites Et Monuments Autour De Metz
CROIX DE LA LOUVE Site monument VANY 57070 Érigée en 1445, détruite en 1940, reconstruite en 1981. Prestataire Période(s) d'ouverture CROIX DE LA LOUVE Du 01/01/2020 au 31/12/2020 le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. en bordure du RD 3 57070 VANY MONUMENT NATIONAL DU SOUVENIR FRANCAIS Site monument NOISSEVILLE 57645 Jean Pierre Jean, typographe et futur député, a créé le premier comité du Souvenir Français en 1907 dans le petit village de Vallières, sous le nom de « comité messin du Souvenir Français ». Il est à l’origine de la souscription et de l’accord des 13 communes environnantes de la rive droite des champs de bataille de 1870 pour ériger ce monument en l’honneur de ces soldats morts pour la France. Après une négociation difficile avec les autorités prussiennes, le monument, œuvre du sculpteur Emmanuel Hannaux est inauguré le 4 octobre 1908 devant une foule de 120 000 personnes. Pour la première fois depuis le conflit de 1870, des drapeaux français flottent sur la terre de Moselle annexée. Prestataire Période(s) d'ouverture SOUVENIR FRANCAIS Du 01/01/2020 au 31/12/2020 André Masius le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Lieudit l'Amitié [email protected] Bordure de la RD 954 57645 NOISSEVILLE Tel : 06 31 02 84 03 Email : [email protected] VILLAGE REMARQUABLE DE PRENY Réf 798000157 Site monument PRENY 54530 Le village, dominé par le château, s'étale sur trois étages. -

Avis Ouverture D'une Enquête Publique
PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE AVIS OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE Communes d’Arnaville, Bayonville-sur-Mad, Onville et Vandelainville Par arrêté inter-préfectoral du 18 août et du 25 août 2017, les préfets de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle prescrivent l’ouverture d’une enquête publique, d'une durée de 22 jours, du mardi 26 septembre au mardi 17 octobre 2017 inclus, dans les communes d’Arnaville, Bayonville-sur-Mad, Onville et Vandelainville. Cette enquête porte sur la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la dérivation des eaux dans le milieu naturel de la prise d’eau au barrage d’Arnaville dans le Rupt-de-Mad et de l’instauration des périmètres de protection autour de cette ressource, au profit de la Ville de Metz. M. Jean-Marie VOIRIOT, retraité, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le tribunal administratif de Nancy. Le siège de l’enquête publique est fixé à la mairie d’Arnaville. Les communes de Villecey-sur-Mad, Waville, Essey-et-Maizerais, Pannes, Saint-Baussant (Meurthe-et-Moselle), Buxières-sous-les-côtes, Heudicourt-sous-les-côtes, Lahayville, Montsec, Nonsard-Lamarche et Richecourt, (Meuse), sont concernées uniquement par les périmètres de protection éloignée. Le dossier d'enquête peut être consulté par le public pendant toute la durée des enquêtes aux jours et heures d’ouverture habituels au public des mairies d’Arnaville, Bayonville-sur-Mad, Onville et Vandelainville, lors des permanences du commissaire enquêteur et sur les sites internet des préfectures aux adresses suivantes : - préfecture de Meurthe-et-Moselle : http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr - rubriques « politiques publiques » - « enquêtes et consultations publiques » - « enquêtes publiques » - « liste des enquêtes publiques en cours » ; - préfecture de la Meuse : http://www.meuse.gouv.fr - rubriques « environnement » - « participation du public » - « consultations en cours ou à venir ». -

DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 1Ère Circonscription
DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 1ère circonscription CUSTINES BRIN-SUR-SEILLE BOUXIERES-AUX-CHENES BRIN-SUR-SEILLE MONCEL-SUR-SEILLE BOUXIERES-AUX-CHENES MAZERULLES BOUXIERES-AUX-DAMES BOUXIERES-AUX-DAMES AMANCE AMANCE MAZERULLES LLAY--SAIINT--CHRIISTOPHE EULMONT SORNEVILLE EULMONT LAITRE-SOUS-AMANCE SORNEVILLE LAITRE-SOUS-AMANCE CHAMPENOUX DOMMARTIN- CHAMPENOUX DOMMSOAURST-IANM-SAONUCSE-AMANCE AGINCOURT LANEUVELOTTE AGINCOURT MALZEVILLE LANEUVELOTTE DOMMARTEMONT SEICHAMPS SEICHAMPS VELAINE-SOUS-AMANCE ESSEY-LES-NANCY ESSEY-LES-NANCY SAINT-MAX PULNOY NANCY-2 PULNOY SAULXURES-LES-NANCY NANCY SAULXURES-LES-NANCY NANCY-3 Légende Couleur : Canton Entre Seille et Meurthe Grand Couronné Saint-Max Nancy-3 Nancy-2 SICOM 54 06/12/2016 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 2ème circonscription NANCY-1 LAXOU JARVILLE- LA-MALGRANGE VILLERS-LES-NANCY VANDOEUVRE-LES-NANCY HEILLECOURT HOUDEMONT LUDRES Légende Couleur : Canton Laxou Vandoeuvre-lès-Nancy Jarville-la-Malgrange Nancy-1 SICOM 54 06/12/2016 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 3ème circonscription MONT-SAINT-MARTIN VILLE-HOUDLEMONT MONT-SAINT-MARTIN GORCY LONGLAVILLE SAULNES GORCY LONGLAVILLE VILLE-HOUDLEMONT SAINT-PANCRE SAULNES COSNES-ET-ROMAIN HERSERANGE COSNES-ET-ROMAIN LONGW Y LONGW Y SAINT-PANCRE HERSERANGE TELLANCOURT LEXY MEXY VILLERS-LA-CHEVRE MEXY ALLONDRELLE-LA-MALMAISON TELLANCOURT LEXY ALLONDRELLE-LA-MALMAISON VILLERS-LA-CHEVRE HAUCOURT-MOULAINE FRESNOIS-LA-MONTAGNE REHON HUSSIGNY-GODBRANGE EPIEZ-SUR-CHIERS FRESNOIS-LA-MONTAGNE HAUCOURT HUSSIGNY-GODBRANGE -MOULAINE EPIEZ-SUR-CHIERS -

Lettre Circulaire 2019-14
LETTRE CIRCULAIRE n° 2019-0000014 Montreuil, le 05/06/2019 DRCPM OBJET Sous-direction production, Instauration du versement transport (art. L. 2333-64 et s. du Code gestion des comptes, Général des Collectivités Territoriales) fiabilisation VLU-grands comptes et VT Par un arrêté du 12 décembre 2016, la Préfecture de Meurthe et Moselle a autorisé la création au 1er janvier 2017 de la Communauté de Communes Affaire suivie par : Mad et Moselle par fusion de la Communauté de Communes du Chardon ANGUELOV Nathalie, Lorrain et de la Communauté de Communes du Val de Moselle et avec BLAYE DUBOIS Nadine, intégration de la commune d’Hamonville (54248) issue de la de la WINTGENS Claire Communauté de Communes du Toulois. Par une délibération du 9 avril 2019, la Communauté de Communes Mad et Moselle a décidé de créer un taux de versement transport de 0,55 % sur le territoire de toutes les communes comprises dans son ressort territorial. La délibération prend effet au 1er juillet 2019. La délibération entraine la création de l’identifiant 9305414 au 1er juillet 2019 Par un arrêté du 12 décembre 2016, la Préfecture de Meurthe et Moselle a autorisé la création au 1er janvier 2017 de la Communauté de Communes Mad et Moselle par fusion de la Communauté de Communes du Chardon Lorrain et de la Communauté de Communes du Val de Moselle et avec intégration de la commune d’Hamonville (54248) issue de la Communauté de Communes du Toulois. Par une délibération du 9 avril 2019, la Communauté de Communes Mad et Moselle a décidé de créer un taux de versement transport de 0,55 % sur le territoire de toutes les communes comprises dans son ressort territorial. -
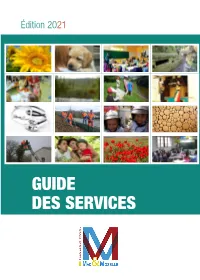
Guide Des Services
Édition 2021 GUIDE DES SERVICES ASSOCIATIONS Menuiserie - Ebénisterie - Scierie Sommaire Associations sportives Métallerie - Serrurerie - Travaux de soudure Associations caritatives Peinture - Sols - Carrelage Associations de cultes Sécurité CARTE INTERACTIVE SANTÉ Associations des écoles Terrassement - Travaux Publics LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EN BREF Organismes Traitement - Dépollution Les hôpitaux de proximité Associations des Sapeurs Pompiers LES URGENCES Les autres services de proximité Associations environnementales Associations patriotiques Café - Restaurant - Hébergement LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES Café - Bar - Club DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI Associations socio-culturelles État Associations de santé Camping Région Les organismes d’État Gîtes - Chambres d’hôtes Les chambres consulaires Département TOURISME ET PATRIMOINE Hôtels Communauté de Communes Appui et conseil de proximité Restaurants Accueil - Informations Mairies Accompagnement à la création et au dévelop- Traiteurs pement d’entreprises Patrimoine naturel VIE QUOTIDIENNE Hébergement d’entreprises ENTREPRISES Commerce de proximité Enseignement- Formation Activités spécialisées HABITAT ET LOGEMENT Agriculture Les organismes Ameublement - Equipement de la Activités de soutien Les établissements scolaires : Conseils maison Culture - Elevage } Écoles maternelles et primaires Les aides : OPAH - RR Boucherie -Charcuterie Fruits - Légumes } Collèges Boulangerie - Patisserie TRANSPORT Produits du terroir Les services postaux Commerce ambulant Viticulture Trésor public et -

Classifiche Comune Di Puxieux
23/09/2021 Mappe, analisi e statistiche sulla popolazione residente Bilancio demografico, trend della popolazione e delle famiglie, classi di età ed età media, stato civile e stranieri Skip Navigation Links FRANCIA / GRAND EST / Provincia di MEURTHE ET MOSELLE / Puxieux Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAFIA ECONOMIA CLASSIFICHE CERCA FRANCIA Comuni Powered by Page 2 Abaucourt Flirey Affianca >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin AdminstatAbbéville- logo Fontenoy- DEMOGRAFIA ECONOMIA CLASSIFICHE CERCA lès-Conflans FRANCIAla-Joûte Aboncourt Fontenoy- sur-Moselle Affléville Forcelles-Saint- Affracourt Gorgon Agincourt Forcelles- Aingeray sous-Gugney Allain Foug Allamont Fraimbois Allamps Fraisnes- Allondrelle- en-Saintois la-Malmaison Francheville Amance Franconville Amenoncourt Fréménil Ancerviller Frémonville Anderny Fresnois- Andilly la-Montagne Angomont Friauville Anoux Frolois Ansauville Frouard Anthelupt Froville Armaucourt Gélacourt Arnaville Gélaucourt Arracourt Gellenoncourt Arraye-et-Han Gémonville Art-sur-Meurthe Gerbécourt- Athienville et-Haplemont Atton Gerbéviller Auboué Germiny Audun- Germonville le-Roman Gézoncourt Autrepierre Gibeaumeix Autreville- Giraumont sur-Moselle Giriviller Autrey Glonville Avillers Gogney Avrainville Gondrecourt-Aix Avricourt Gondreville Avril Gondrexon Powered by Page 3 Azelot Gorcy L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Province Azerailles Goviller Adminstat logo DEMOGRAFIA ECONOMIA CLASSIFICHE CERCA Baccarat FRANCIAGrand-Failly